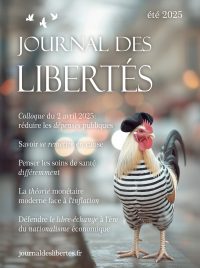Avec des prélèvements obligatoires s’élevant à 45,6 % du PIB en 2023, la France est notoirement le champion du monde de la fiscalité. L’activité économique est particulièrement ponctionnée. A 18 % du PIB, la fiscalité sur le travail est de moitié plus lourde que celle de l’UE (12 %). Les impôts sur la production s’élèvent en France à 4,5 % du PIB, presque le double de la moyenne de l’UE (2,5 %). Ce niveau d’imposition pèse sur la capacité de la France à attirer et maintenir de l’activité économique.
Confronté à l’évidente nocivité de ce fardeau fiscal, l’État a mis en place des mécanismes de compensation. Ils sont souvent qualifiés d’aides aux entreprises, une acception très discutable. Il s’agit en effet plus de compenser une fiscalité excessive que de fournir des aides à proprement parler. En outre, le bénéficiaire final n’est pas l’entreprise. Rappelons cette évidence : comme une maison, une entreprise est un objet et non un sujet.
Ce n’est pas la maison qui paie la taxe foncière, c’est son propriétaire. De même, ce n’est pas l’entreprise, objet juridique, sur laquelle pèse la fiscalité, mais les personnes physiques qui y sont parties prenantes. En premier lieu les actionnaires ; mais aussi tous ceux qui vont être touchés par les impacts d’une hausse de la fiscalité : le client qui paiera plus cher, le salarié qui bénéficiera d’une moindre hausse de salaire ou qui verra son emploi menacé, le fournisseur auquel on demandera une baisse de prix. Ces « aides aux entreprises » sont en réalité des compensations pour réduire l’effet nocif de la fiscalité sur les personnes associées à l’activité économique.
Si on exclut les mécanismes visant à éviter la double imposition, et notamment le régime mère-fille, le montant total de ces compensations s’élève à environ 160 Mds d’euros. 88 Mds sont constitués d’exemptions sociales, essentiellement des réductions de cotisations sociales sur les salaires bas (inférieurs à 1,6 SMIC) à moyens (inférieurs à 3,5 SMIC). Cette catégorie inclut également, pour 10 Mds, les exemptions de cotisations diverses : participation, chèques restaurant, indemnités de licenciement, PEE, CESU, etc.
34 Mds proviennent de réduction d’impôts, via 147 dispositifs : crédits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés (comme le crédit impôt recherche), taux de TVA réduits, exonération de fiscalité des carburants, etc.
Enfin, une quarantaine de milliards est constituée d’aides budgétaires diverses, incluant notamment les aides aux entreprises publiques (SNCF, audiovisuel public, retraités de La Poste ou France Telecom), la formation professionnelle, Action logement ou encore les chambres de commerce.
L’État redistribue donc d’une main une partie de ce qu’il a pris de l’autre. Ce mouvement de pompage shadokien entraîne des surcoûts de traitement et d’intermédiaires à la fois pour les entreprises et les services publics ; une forte complexité, particulièrement lourde pour les TPE/PME peu outillées en matière juridique et comptable ; enfin des effets d’aubaine aboutissant à une utilisation sous-optimale de l’argent du contribuable. Elle entraîne aussi des pressions particulièrement malsaines du politique sur les entreprises, prompt à leur reprocher les aides perçues dès qu’elles sont confrontées à des difficultés pouvant impacter l’emploi. En imposant puis redistribuant, l’État s’arroge ainsi une forme détestable de créance morale sur l’entreprise.
Une baisse globale de la fiscalité, assise durablement sur une baisse des dépenses publiques, reste un enjeu essentiel de la compétitivité du pays. Cette baisse ne peut s’inscrire que dans une approche globale visant à repenser le périmètre d’intervention de l’État et à le refocaliser sur ses fonctions essentielles. Cette démarche prendra du temps, pour autant qu’elle soit engagée.
A court terme et à équilibre budgétaire constant, une première étape pourrait être une réduction simultanée de la fiscalité sur les entreprises et des compensations, un « effacement parallèle » pour reprendre les termes proposés par Génération Libre en 2016. Analyser isolément chaque compensation serait toutefois voué à l’échec. Nombreuses, elles représentent souvent des montants unitaires relativement faibles et sont logiquement défendues avec acharnement par leurs bénéficiaires. Une approche plus radicale s’impose : inverser la charge de la preuve. Le principe ? Supprimer a priori toutes les compensations, à l’exception de celles qui peuvent démontrer leur efficacité économique, c’est-à-dire, une création de valeur nettement supérieure à leur coût. La plupart ne passeraient vraisemblablement pas le test.
Cette suppression serait bien sûr associée à une baisse de la fiscalité d’un montant strictement équivalent. Elle serait considérable, probablement entre 100 et 150 Mds d’euros, et pourrait inclure à la fois la suppression d’une grande partie des impôts de production, la réduction des cotisations sociales et la diminution du taux d’impôt sur les sociétés. L’allocation des baisses entre les différents impôts serait calibrée afin d’être autant que possible neutre pour les différents types d’entreprises, grand groupe investissant en R&D, ETI industrielle ou PME du bâtiment employant de la main d’œuvre peu qualifiée.
La démarche serait neutre pour les finances publiques et donc acceptable dans le contexte budgétaire actuel. Elle produirait des impacts indirects très positifs tant pour les entreprises que pour les finances publiques : baisse des coûts de gestion et d’intermédiaires, suppression des coûts de contrôle, simplification globale, amélioration de l’attractivité de la France. Elle pourrait être pilotée par les partenaires sociaux, et notamment les représentants des entreprises, afin d’aboutir à des propositions acceptables par les différents secteurs économiques.
Ambitieux ? Certes ; mais l’heure n’est plus aux ajustements cosmétiques. Seule une réforme d’ampleur, combinant simplification, baisse des prélèvements obligatoires et évaluation rigoureuse de l’efficacité des dépenses publiques, permettra de sortir de cet invraisemblable maquis administratif et de redonner du souffle à notre économie.