1. Introduction
Le titre de cet article imite ouvertement le célèbre pamphlet d’Andreï Amalrik « L’Union soviétique survivra-t-elle jusqu’en 1984 ? ». Mais outre la grande distance qui sépare les auteurs, il existe d’autres différences significatives : Amalrik était un dissident soviétique qui a purgé de longues peines de prison en Sibérie avant d’être contraint à l’exil. Non seulement il prévoyait, mais il préconisait également la chute du régime qui l’opprimait.

Cet article, au contraire, ne souhaite en aucun cas la fin de l’UE. Personne mieux qu’un Italien ayant grandi après la Seconde Guerre mondiale n’est conscient – également pour des raisons personnelles – que si son pays a connu un développement incroyablement rapide à partir des décombres matériels et politiques de la guerre, c’est grâce à la vision de ces compatriotes qui ont contribué à la naissance des communautés européennes.
En fait, c’est parce que je suis convaincu de l’importance d’une union entre les pays européens que je propose ici une vision critique de la politique et des pratiques actuelles au sein des institutions européennes et de la pente glissante sur laquelle ces dernières s’avancent et qui – c’est la crainte – amenera à leur dissolution progressive.
Je me concentrerai sur les aspects suivants qui, à mon avis, ne présagent rien de bon pour l’avenir de l’Union.
a) La concentration de facto de plus en plus de pouvoirs au sein de la Commission à travers une utilisation anormale du principe de « subsidiarité » et le fait que cette dernière se considère comme le « Gouvernement de l’Europe ».
b) L’idée selon laquelle la solution à tout problème – naturel, social, économique, politique – réside principalement dans les normes, avec une production législative continue, sans fin et massive.
c) La production calculée d’« irritants juridiques » visant à plaire aux groupes minoritaires qui suscite des doutes croissants, voire une opposition directe, chez la majorité des citoyens.
d) Une approche « taille unique » qui ne prend pas en compte de profondes différences historiques, culturelles et sociales entre les 27 États membres.
e) Un activisme judiciaire frénétique qui a transformé le principe de l’État de droit en celui de l’État des juges.
f) Une politique étrangère impérialiste en herbe, empreinte d’hypocrisie.
2. Le rôle surexposé de la Commission
L’extraordinaire succès de la CEE fut en grande partie dû à sa présentation discrète comme étant « uniquement » une organisation économique supranationale semblable à de nombreuses autres organisations, beaucoup plus visibles, qui ont proliféré dans les années d’après-guerre sous l’égide de l’ONU.
Son modèle de gouvernance, typique d’une agence internationale, était centré sur deux niveaux de décision : le niveau politique supérieur, le Conseil, et le niveau exécutif, la Commission. Lorsque, vingt ans plus tard, un Parlement européen élu a complété le cadre institutionnel, il a été à sa naissance émasculé, le privant de la prérogative de tout Parlement dans un système démocratique, c’est-à-dire, du pouvoir exclusif de légiférer. La formulation de l’article 14 du traité de Lisbonne parvient difficilement à voiler son inutilité : « Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législatives et budgétaires ».
Je n’entrerai pas ici dans le débat vieux de plusieurs décennies sur le « déficit démocratique » des institutions européennes, et je suis prêt à épouser l’idée selon laquelle un système parlementaire traditionnel est tout à fait inadapté à la gouvernance des politiques communes d’un si grand nombre d’États indépendants et souverains.
Ce que je postule, c’est qu’en présence d’un gouvernement centré sur l’exécutif, l’équilibre entre les différentes institutions est d’autant plus important et que, en l’absence d’une séparation claire des pouvoirs (d’un point de vue formel, le Conseil et la Commission se partagent le pouvoir exécutif ; le Conseil et le Parlement se partagent le législatif), les conventions constitutionnelles sont indispensables si l’on veut garantir le respect des rôles respectifs.
Au lieu de cela, ces dernières années, notamment après les élections européennes de 2019 et à la suite de deux catastrophes extraordinaires, la pandémie de Covid-19 et l’invasion russe de l’Ukraine, la Commission a surgi über alles. La variabilité structurelle du Conseil – avec une rotation régulière des chefs d’État et de gouvernement – et donc sa faiblesse a déterminé – comme dans tout contexte politique – l’élargissement des pouvoirs de la Commission – en droit, en fait et apparents – dont les relations avec le président du Conseil sont similaires à celles de nombreux pays avec un chef d’État plébiscité. La Commission est non seulement stable, mais elle dispose également de son budget et d’une organisation puissante et autonome. Ce qui peut en être perçu de l’extérieur est une attitude qui est bien résumée par le terme grec d’hubris : un mélange de fierté, d’arrogance et de dédain. Elle se sent investie de la mission de gouverner l’Europe en ces temps périlleux, « quoi qu’il en coûte ». Les États membres, à l’exception de quelques-uns, sont des écoliers indisciplinés qui doivent être maîtrisés, réveillés de leur léthargie, envoyés au coin lorsqu’ils se comportent mal. L’Europe – raccourci pour l’Union européenne –, c’est la Commission : elle loue, elle prévient, elle châtie (à travers le principe de « conditionnalité »), elle promeut. Cela est dû en partie au fait que de plus en plus de pouvoirs lui ont été confiés, mais aussi au fait que la Commission, de discrète, est devenue ostentatoire. Cela peut satisfaire son ego, mais soulève de plus en plus de questions sur sa légitimité. Les États membres, en entrant dans l’Union, lui ont transféré et lui ont conféré des compétences. Mais cela signifiait-il que leurs gouvernements légitimes devaient se montrer timides et craindre chaque mot de la Commission ? Lorsque la main invisible du faiseur de marché se transforme en l’image visible et omniprésente du président de la Commission et des commissaires individuels, le message transmis aux 450 millions de citoyens européens est que leurs gouvernements – pour lesquels ils ont peut-être voté ou auxquels ils se sont opposés, mais qui sont en tout cas une institution nationale – sont marginaux et presque sans pertinence.
Le contraste est évident entre la règle énoncée à l’article 4 du traité de Lisbonne (« les compétences non conférées à l’Union dans les traités restent du ressort des États membres ») et son exception (partielle) énoncée à l’article 5 :
« Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. (…) En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. »
Ce qui aurait dû être une exception appliquée dans des cas exceptionnels a désormais avalé la règle. Ce processus n’est pas sans fondement : dans un monde globalisé, il est peu probable que des politiques nationales isolées puissent être efficaces et durables. L’intégration des économies de l’UE favorise clairement l’uniformité de sa réglementation. Mais cela passe par un transfert subreptice et massif de compétences des États vers l’Union et en premier lieu vers la Commission. Le principe énoncé à l’article 4 est ainsi vidé.
D’un point de vue technique, cela est réalisé grâce à trois mécanismes : l’adoption de Règlements – il s’agit de dispositions auto-exécutoires par opposition aux Directives qui nécessitent une mise en œuvre nationale et autorisent des variations. En deuxième lieu, il est devenu courant que chaque texte législatif confère des pouvoirs délégués à la Commission, qui, à travers eux, dirige l’application des normes primaires et récupère ce qu’elle n’a pas pu obtenir au cours de négociations législatives complexes avec le Conseil et le Parlement. La dernière autoroute vers la centralisation est la conception très particulière que la Commission européenne se fait des autorités indépendantes. Celles-ci ont été établies sur la base de la législation sectorielle du marché afin d’encadrer des secteurs économiques spécifiques, de les ouvrir à la concurrence et d’éviter les conflits d’intérêts. Mais dans l’esprit de la Commission, ces autorités doivent être indépendantes des gouvernements ou des parlements nationaux, mais pas de la Commission elle-même. De facto, elles sont considérées comme des départements subsidiaires de la Commission et leurs activités quotidiennes sont constamment surveillées par la Commission et leurs actions coordonnées par des « groupes » de régulateurs nationaux réunis à Bruxelles et pilotés par la Commission.
Je ne possède pas suffisamment d’expertise dans le domaine de l’économie et de la finance. Je vais donc omettre une analyse des actions de la Commission dans ces domaines. Mais en tant qu’observateur extérieur, je ne peux m’empêcher de remarquer que ce qui était considéré il y a dix ans comme des dogmes incontestables (et fermement gardés) dans la politique européenne a été considérablement renversé. Je ne peux pas questionner le bien-fondé des politiques passées ou actuelles, mais je peux simplement souligner que de tels revirements soulèvent une question de cohérence et de crédibilité.
3. La « baguette magique » de la loi
Si le PIB calculait également la production normative, l’UE serait de loin la région la plus riche du monde, devant les États-Unis et la RPC.
Au-delà des paradoxes, ce qui frappe dans le modèle européen, c’est l’idée (ou l’idéologie ?) omniprésente selon laquelle tout problème posé, tout programme ou projet qui doit être mis en place a dès le départ et en permanence une solution normative. Qu’il s’agisse de l’invasion russe de l’Ukraine ou de la culture du radis ; qu’il s’agisse du développement d’une industrie informatique européenne ou de l’importation d’objets en ivoire, la réponse est dans un déluge de dispositions qui permettent, interdisent, définissent, disciplinent, sanctionnent tout et tous ceux qui sont impliqués.
Mais quel type de législation ? Ce modèle est une atteinte permanente aux principes énoncés il y a trois siècles et demi par Gottfried Wilhelm Leibniz dans sa Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae (1667) qui a ouvert la voie à la codification. Cette remarque n’est pas un souvenir nostalgique des phrases raffinées du Code Napoléon dans lesquelles Stendhal cherchait son inspiration. Lorsqu’un texte juridique contient en moyenne 100/200 « considérants » et entre 50 et 100 articles, tout lecteur – qui doit tenter de comprendre, d’interpréter, d’appliquer, de faire respecter le texte – se retrouve jeté dans un buisson normatif, une jungle équatoriale d’où il est peu probable qu’il puisse sortir indemne.
Le résultat de cette régulation omniprésente, d’une part, entrave les activités économiques et sociales – on ne peut faire que ce qui est expressément autorisé et dans les conditions où cela est discipliné – et, d’autre part, augmente le pouvoir d’intervention de la puissance publique, que ce soit au niveau national ou au niveau européen.
Il ne s’agit évidemment pas d’une caractéristique unique de la Commission européenne et cela ne peut en aucun cas être considéré comme une sorte de perversion. Les organes administratifs trouvent leur raison d’être dans la régulation d’activités qui leur sont extérieures. Et les fondements de la réglementation sont des normes qui doivent être constamment mises à jour et étendues à de nouveaux contextes et à des innovations.
Il peut paraître étrange qu’un avocat se plaigne de la surproduction de normes : il les forge, les applique, les interprète, les conteste. On pourrait s’attendre à ce que l’avocat se réjouisse de cette multiplication d’objets dont il vit plutôt bien.
Cependant, si l’on regarde plus loin que le bout de son nez, il est facile de constater qu’au-delà d’un certain point, de plus en plus de normes (mesurées en milliers par jour) n’apportent qu’un désordre, une incertitude et des conflits croissants. Les destinataires des normes ont du mal à les comprendre et sont désorientés par les nouveautés et les changements continus. Les normes consomment notre temps et notre esprit et engendrent un coût administratif et organisationnel pour s’y conformer.
Et lorsque ces normes s’accompagnent de sanctions pénales – une véritable frénésie de pancriminalisation a frappé l’UE – ce qui est complètement oublié, c’est que l’effet final est d’obstruer et de paralyser des tribunaux pénaux déjà surchargés.
L’ironie de la situation est que l’ensemble du processus législatif relève de normes procédurales estampillées « meilleure réglementation » (c’est-à-dire, des normes sur la manière de produire des normes) et que les normes sont publiées après une « évaluation d’impact ». Si l’on a la patience de parcourir les longs rapports qui précèdent chaque proposition de loi, on a l’impression de vivre dans un monde féerique, où chaque mesure est pour le mieux, les coûts sont négligeables et les prévisions pointent vers une fin heureuse. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un processus de vérification qui aboutit invariablement à un feu vert et sans réserve apparaît discutable sur sa finalité. Et il en va de même des procédures de « consultation publique » qui précèdent chaque nouvelle proposition et valident systématiquement – à l’instar des référendums dans certains pays non occidentaux – les mesures proposées.
Cependant, ce que l’on souhaite souligner, ce ne sont pas des défauts spécifiques dans l’exercice par la Commission de ses pouvoirs exécutifs, mais sa perception globale en tant que décideur ultime qui s’immisce dans la vie de chaque citoyen et entreprise d’Europe, les dirigeant, les incitant, les mettant sur certaines pistes. À cela, il faut ajouter l’imposition de sanctions administratives de plusieurs millions d’euros, immédiatement annoncées dans les médias avec l’intention de jeter l’opprobre et dont les effets seront rarement, des années plus tard, atténués lorsque le Tribunal annulera la sanction.
Ce modus operandi a ses nobles ancêtres chez les souverains éclairés de l’Autriche et de la Prusse du XVIIIème siècle, engagés avec bienveillance dans la promotion du bien-être de leurs sujets. Il est cependant douteux que cette approche soit acceptable dans nos sociétés occidentales contemporaines, plurielles, fluides et égocentriques. La Commission n’apparaît pas dans des robes de fée, mais dans les robes d’une belle-mère ou d’une belle-mère intrusive qui s’immisce constamment dans les affaires des autres ; ou celles d’un maître d’école obtus du XIXème siècle prêt à frapper de sa règle les élèves désobéissants.
4. Le déferlement des « irritants juridiques »
Il y a trente ans, Gunther Teubner, commentant l’une des premières directives sur la protection des consommateurs, qualifiait d’« irritant juridique » la tentative d’imposer au système juridique anglais le principe de « bonne foi ». Cette expression est restée non seulement en raison de son contenu saisissant, mais aussi parce que l’UE a perfectionné sa production d’« irritants juridiques » destinés à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Le problème central – qui réside fondamentalement dans la Commission et dans les messages qu’elle transmet constamment à travers tous ses canaux institutionnels et sociaux – est que l’UE doit non seulement réglementer – parce qu’elle s’est dotée de tous les pouvoirs pertinents – les activités économiques, mais qu’elle est également le guide et gardien des valeurs européennes.
Il ne fait aucun doute que l’UE repose sur trois piliers : le traité de Lisbonne, le traité sur le fonctionnement de l’UE et la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Et que ce dernier document est un texte très vaste qui inclut les droits fondamentaux de première, deuxième et troisième génération. Cependant, l’interprétation de ces droits, leur contenu précis et leur portée, leur application à des situations changeantes est une question ouverte au débat, surtout lorsqu’elle touche à des opinions extrêmement personnelles, voire éthiques.
L’approche de la Commission est en revanche péremptoire : il n’y a qu’une seule notion qui s’impose et doit s’imposer non seulement à tous les États membres mais aussi à tous les citoyens européens. Quelques exemples suffiront.
a) Choix et technologies en matière de reproduction
Le développement, au cours des cinquante dernières années, de la fécondation in vitro a débouché sur des réponses extraordinaires à l’infertilité, un dysfonctionnement aux conséquences psychologiques extrêmement graves. Alors que la science médicale progresse sans relâche et à l’échelle mondiale, les réponses juridiques ont été lentes et fragmentaires, sujettes à de nombreux débats, parfois houleux.
Établir qui sont les parents d’un enfant ; faire la distinction entre la biologie, les sentiments et la socialité nécessite un effort d’équilibre très délicat, compte tenu de l’importance des intérêts en jeu – tant individuels que publics. Mais une discipline normative requiert également une acceptation sociale de la part de tous les acteurs impliqués. Et cette acceptation nécessite des temps longs qui coïncident rarement avec ceux de la science et de la pratique médicale. Aujourd’hui, l’énigme de la maternité de substitution est sur la table. Parfois utilisé comme remède à l’impossibilité pour une femme de porter et de donner naissance à un enfant, mais de plus en plus utilisé par les couples homosexuels masculins pour mimer un partenariat hétérosexuel.
Déterminer si la maternité de substitution est autorisée, si l’enfant doit être considéré comme l’enfant du porteur, du parent d’intention (qui pourrait avoir fourni le sperme), de l’un ou des deux partenaires est une décision laborieuse qu’il est préférable de laisser aux législateurs nationaux et aux tribunaux. Pas à la Commission qui déclare sans ambages que les enfants nés de la maternité de substitution doivent être reconnus et enregistrés. Il faut se demander si ces déclarations relèvent des compétences de la Commission et, en tout cas, s’il est judicieux qu’elle s’engage dans des questions qui sont extrêmement controversées et soulèvent des préoccupations tout à fait légitimes.
b) Orientation sexuelle
L’une des principales innovations de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est d’avoir inclus dans sa disposition sur l’égalité des droits l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’extension vise clairement à remédier à une longue tradition de persécution, de bannissement et de dérision des homosexuels. Progressivement, les États membres ont introduit et reconnu le partenariat et le mariage entre personnes de même sexe.
Cependant, la disposition se transforme en une perversion juridique lorsque du principe de non-discrimination on tire un statut spécial pour les personnes qui prétendent appartenir à la communauté Lesbienne+Gay+Bisexuel+Transgenre+Quelle (l’acronyme LGBT est chaque jour plus long).
La première approche absurde de l’UE – contenue dans de nombreux actes de la Commission et du Parlement – est d’accorder une sorte de statut à l’une des expressions les plus diverses, variables et insondables de l’être humain, à savoir, son orientation sexuelle, qui peut prendre d’innombrables formes, et surtout être modifiée selon le plaisir (le terme est tout à fait approprié) de la personne elle-même.
La deuxième évolution absurde consiste à utiliser une disposition relative à l’« égalité des droits » comme base pour la création de « droits spéciaux ». C’est comme si, après avoir affirmé qu’il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la race, on construisait un statut pour les personnes caucasiennes, noires ou orientales. Ou bien, après avoir affirmé qu’il ne peut y avoir de discrimination sur la base de la religion, on construisait un statut pour les catholiques, les juifs, les bouddhistes et – pourquoi pas ? – les athées.
La perversion juridique ultime réside dans le fait que les institutions européennes, y compris la Commission, jouent de plus en plus avec le soi-disant programme de « reconnaissance légale du genre », selon lequel les individus ont le droit de modifier leur qualification sexuelle biologique publique : ils ne sont plus « masculins » ou « féminins », mais peuvent puiser dans une liste de classifications douteuses appelées avec imagination « genre ». Pour dire les choses clairement, affirmer que la personne a un droit individuel (et fondamental) de décider de son sexe équivaut à canoniser les théories de la Terre plate. Au lieu de contester le caractère infondé de ces théories anti-scientifiques (il suffit de penser à leur impact sur le diagnostic médical et la thérapie), l’UE les cajole, ouvrant la voie à un choix illimité et toujours variable de son identité et de son identification. Autrefois, ceux qui prétendaient être Napoléon étaient enfermés dans un asile d’aliénés. Aujourd’hui, grâce à l’UE, ils sont présentés comme les héros et les martyrs de la liberté sans restriction, et les États qui la refusent comme des violateurs des valeurs européennes fondamentales.
c) Immigration
Depuis des milliers d’années, le monde est façonné par des vagues migratoires massives. Ce que sont aujourd’hui les pays est le résultat de ces mouvements, et l’histoire de chaque État de l’UE, sa langue, sa culture et ses traditions remontent aux migrations survenues au cours des trente derniers siècles.
De nos jours, les migrations ont pris une structure beaucoup plus limitée, principalement sur une base individuelle ou familiale, dans certains cas pour échapper à des conflits, mais surtout pour rechercher un avenir plus acceptable pour les migrants et leurs enfants. Personne mieux qu’un Italien n’est conscient du phénomène de migration économique qui, entre le XIXème et le milieu du XXème siècle, a drainé plus de dix millions de ses compatriotes vers les Amériques, l’Europe du Nord et l’Australie.
Mais comprendre les raisons de la migration ne signifie pas qu’il existe un devoir d’accepter les migrants.
Si le principe de souveraineté populaire n’est pas une imposture, le premier droit d’une société établie et démocratique est de décider qui doit en faire partie. Et en fait, l’une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles l’UE est fondée – la libre circulation des personnes – ne signifie pas que, hypothétiquement, des millions de citoyens finlandais ont le droit d’émigrer vers l’Espagne parce qu’ils veulent échapper à des conditions météorologiques extrêmes ou que des millions de citoyens grecs ont le droit d’émigrer vers l’Allemagne pour l’efficacité de son État-providence.
Et lorsqu’au niveau de l’UE on assure que l’accès est accordé « uniquement » aux demandeurs d’asile fuyant les guerres et l’oppression politique, l’argument est absurde si l’on considère que – selon les normes de l’UE – les régimes antidémocratiques et répressifs qui bafouent les droits humains fondamentaux sont en place dans la plupart des régions du monde. Ceci, de jure sinon de facto, garantit l’accès à l’Europe à des millions d’Afghans, de Syriens, d’Iraniens, de minorités chinoises et à pratiquement l’ensemble de la population africaine.
Ceux qui contestent l’approche des portes ouvertes sont immédiatement qualifiés – et traqués – de xénophobes et de racistes odieux.
Le fait est que si seulement les citoyens européens avaient la possibilité d’exprimer leur vote sur de telles politiques, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la réaction d’une écrasante majorité soit contre ces politiques.
5. La mentalité « taille unique »
La standardisation des procédés et des produits est un facteur essentiel du développement des industries et de l’élargissement des marchés. Dans l’ensemble, cela réduit les coûts de production, apporte une certitude aux consommateurs et améliore le commerce international. Depuis un siècle et demi, les économies occidentales s’efforcent – avec la coopération active de l’industrie – de promouvoir et de créer des organismes internationaux de normalisation.
L’UE est parfaitement intégrée dans ce mouvement avec des dizaines d’organismes de normalisation générale et sectorielle. Le lecteur averti du Journal officiel de l’UE constate immédiatement que la plupart des textes publiés – les règlements, les décisions et les innombrables annexes – visent explicitement la normalisation.
Cependant, comme le dit la maxime latine, est modus in rebus. La normalisation des produits industriels répond aux objectifs énumérés ci-dessus. Mais lorsqu’il s’agit d’autres produits – généralement agricoles – ou de procédures qui impliquent un comportement social, on peut se demander si cette approche est appropriée et bénéfique.
En ce qui concerne l’agriculture, l’UE semble oublier deux faits fondamentaux : le premier est que depuis des millénaires, l’humanité vit sur la terre, exploitant ses diverses ressources. L’industrie est une évolution récente – vieille d’environ deux siècles.
L’agriculture signifie non seulement la nourriture, mais aussi la socialisation, les fêtes et les jeûnes, l’adaptation aux événements défavorables tels que la sécheresse, les inondations, les températures extrêmes, les ravageurs, la famine. Chaque partie géographique de l’Europe s’est, au fil des siècles, adaptée à de tels événements, a développé des techniques spécifiques, mais aussi façonné son rapport à la terre, à ses exploitations, à ses produits. Cette diversité est une immense richesse que la standardisation aplatit et disperse. On a souvent l’impression que pour l’UE la norme – générale et sans exceptions – se construit autour des rayons d’un supermarché bruxellois.
Les défauts de l’approche universelle – taille unique – sont encore plus évidents lorsque l’on examine les procédures de conformité et les organismes de surveillance introduits par chaque nouveau texte réglementaire. Non seulement ils ignorent la taille des États membres, qui va de 80 millions pour l’Allemagne à un million pour Malte, mais ils oublient que certains pays ont une tradition centenaire en matière de contrôle administratif – on pense immédiatement aux organisations éclairées de Prusse et d’Autriche au milieu du XVIIIème siècle – alors que d’autres manquent d’une telle expérience et d’une telle expertise humaine (appelée élégamment le « capital politique »), et que la mise en place d’organismes complexes qui doivent tous obéir au dogme bruxellois est extrêmement coûteuse et, en fin de compte, inefficace.
Ce qui semble absent de la weltanschauung de cet UE contemporaine, c’est le sens profond de l’article 4 du traité de Lisbonne :
« L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, incluant l’autonomie régionale et locale. »
Alors que les institutions constitutionnelles centrales établies par le Traité (Conseil, Parlement, Commission, Cour de justice, Cour des comptes) sont mandatées par un traité international par lequel tous les États membres sont liés, la floraison d’autres organes, au-delà de toute imagination, n’a de sens que pour certains pays et est – au mieux – inutile pour d’autres.
Une fois de plus, ce que l’on souhaite souligner, c’est l’idée selon laquelle le principe de proportionnalité n’est pas un bon-à-tout-faire, mais impose des liens stricts à l’action des institutions européennes, qui devraient avoir une vision moins égoïste d’elles-mêmes si elles ne souhaitent pas finir comme la grenouille de la fable d’Ésope qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf.
6. L’absence de retenue judiciaire
Dans les pages précédentes, on a surtout critiqué la Commission qui se comporte comme une institution qui serait son propre référentiel, avec son propre agenda qui a souvent pour elle valeur de mission.
Toutefois, cette attitude n’est pas unique parmi les institutions européennes. Bon nombre des critiques que l’on a présentées peuvent, dans une mesure encore plus large, être adressées au système judiciaire de l’UE et en particulier à sa Cour de justice. Là encore, il ne faut pas minimiser le rôle de cette institution fondamentale qui, au cours de ses premières décennies, a joué un rôle essentiel en freinant les multiples tentatives, de la part de tous les États membres, de contournement des traités. Et si l’on analyse sa jurisprudence du début à la fin du siècle dernier, on a la photographie d’une institution judiciaire typique qui devait équilibrer – la balance dans l’allégorie de la Justice – les conflits entre la Commission et les États membres.
De ce point de vue, les comparaisons avec la Cour suprême des États-Unis et sa recherche permanente sur la répartition des pouvoirs entre les institutions fédérales et les États membres sont innombrables.
Toutefois, au cours des vingt-cinq dernières années, son rôle a considérablement changé, passant d’un tribunal d’équilibre à celui du législateur le plus important et le plus élevé de l’UE.
Il ne s’agit évidemment pas d’un rôle usurpé.
Comme cela arrive souvent – et cela se produit depuis l’Antiquité –, dans le gouvernement de tout État, le rôle que joue une institution ou un individu dépend beaucoup de ce qui se passe sur scène et de la capacité des autres acteurs à interpréter avec succès leur rôle dans l’intrigue.
Le nouveau rôle législatif de la Cour de Justice a été provoqué, en premier lieu, par la production normative incessante de la Commission qui, comme la plupart des organes administratifs, s’intéresse rarement au système mais s’intéresse à ses objectifs immédiats. Pour la Commission, l’élaboration de normes est aussi vitale que la respiration pour les humains ou la natation pour un requin.
Ce que la Commission ne parvient pas à comprendre c’est qu’au plus il y a de normes mises en circulation, plus nombreux seront les conflits entre normes, qu’elles soient européennes ou nationales. Ces conflits doivent être résolus par la Cour au moyen de ses questions préjudicielles. Et comme la Commission est une déesse Kali (bienveillante), chacun de ses bras (les multiples directions générales et commissaires concernés) n’est pas réellement conscient de ce que font les autres bras. Ce qui engendre de nouveaux conflits. En fin de compte, une approche fataliste est adoptée : si des difficultés surviennent dans la promulgation de ce Babel législatif, elles seront résolues par la Cour.
Mais dans ces cas-là, la Cour n’est pas un tiers arbitre.
Elle est chargée, par les Traités faut-il le souligner, de fournir une interprétation authentique et faisant autorité de la législation qui lui est soumise. Elle donne des orientations au juge de renvoi, mais de jure et de facto, elle réécrit la norme. Par conséquent, toute décision préjudicielle n’est pas un acte visant à résoudre des conflits mais un acte législatif, avec des effets erga omnes.
De ce point de vue, la Cour de justice dispose d’un pouvoir qui va bien au-delà de celui d’une Cour constitutionnelle telle que nous l’avons connue en Europe depuis la première éphémère expérience kelsenienne jusqu’aux modèles solides des tribunaux allemands et italiens. Dans ces derniers modèles, le jugement de la Cour constitutionnelle porte généralement sur la compatibilité d’une norme avec la Constitution du pays qui est donc le paramètre à évaluer. Les cours constitutionnelles interprètent donc la constitution. La Cour de justice européenne est en revanche chargée de la mission d’interpréter l’ensemble de la législation de l’UE à la lumière non seulement du Traité et de la Charte (qui, mutatis mutandis, constituent la Constitution de l’UE), mais aussi des 358 articles du TFUE qui n’ont assurément pas un tel statut.
Des milliers de pages ont été consacrées au fil des années aux modèles concurrents que sont la retenue judiciaire – typiquement britannique – et l’activisme judiciaire – typiquement américain.
Ces modèles sont le résultat de deux visions de la Justice très liées à leurs cultures respectives et profondément enracinées, qui peuvent (et doivent) être comprises à travers le contexte historique dans lequel elles se sont développées.
On ne peut donc pas reprocher à la Cour de justice d’avoir embrassé avec autant d’ardeur le dramatis personae de l’activiste judiciaire. On peut cependant douter de la sagesse d’une telle solution collective (en se souvenant de l’ancienne maxime romaine : Senatores boni viri, senatus mala bestia [les sénateurs sont des hommes bons mais le Sénat une bête féroce]) précisément en raison du contexte.
Aux États-Unis, la Cour suprême (et les tribunaux fédéraux) marchent toujours sur une corde raide sous laquelle les États, le Congrès, l’exécutif et l’opinion publique attendent comme des lions ou des alligators affamés.
Au Royaume-Uni, la convention constitutionnelle non écrite stipule que le pouvoir judiciaire n’empiètera pas sur les pouvoirs du Parlement, dans la mesure où celui-ci respectera les prérogatives des tribunaux.
Quoi qu’il en soit, dans les deux expériences – extraordinaires et éclairantes –, la clé de voûte est le principe d’organes législatif et exécutif qui s’équilibrent et qui sont toujours sous le contrôle à court terme des électeurs.
Mais dans le système européen déséquilibré – un Conseil toujours instable et un Parlement marginal – il est pour le moins étrange que le sceptre du dernier décideur soit placé dans le sanctuaire de la Cour de Justice. Pour dire les choses franchement, le règne du droit [Rue of law] n’est pas – et ne devrait pas être – le règne des juges.
7. Une politique étrangère empreinte d’hypocrisie
L’UE souhaite se présenter comme le champion mondial des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Un modèle qui vise à s’imposer sans avoir besoin d’armes nucléaires, de missiles balistiques, de porte-avions, et sans l’arrogance de son partenaire transatlantique.
Il est certain – et heureusement – qu’il n’existe pas de forces armées européennes et que sa politique étrangère ne peut donc pas s’appuyer sur elles. Cependant, ce qui est discutable, c’est l’authenticité du récit qui embellit chaque discours public des dirigeants européens.
En premier lieu, il convient de noter que l’ensemble de la politique commerciale extérieure de l’UE (elle ne peut être que commerciale) porte sur son chapeau les lettres majuscules MEGA (« Make Europe Great Again »). La vulgarité trumpienne de MAGA est certes absente, mais sa substance est très similaire. L’UE est cent pour cent favorable au libre-échange lorsqu’il s’agit d’exportations et cent pour cent protectionniste lorsqu’il s’agit d’importations. Et ce zèle protectionniste n’est pas simplement une réponse du tac au tac à son homologue américain. Il s’adresse de manière significative aux pays en développement que l’UE prétend aider.
Si les négociations de l’OMC à Doha sont dans l’impasse ces vingt dernières années, c’est aussi parce que l’UE – et pas seulement l’UE, bien entendu – veut protéger ses diverses composantes nationales. Il suffirait d’énumérer les innombrables cas, à la limite du ridicule, de la banane, des sardines ou de l’huile de palme, dans lesquels l’UE a littéralement inventé une botanique et une zoologie de science-fiction pour empêcher l’importation de ces produits en provenance des pays en développement.
La variante de l’approche « portes fermées » est l’approche missionnaire du commerce mondial. Autrefois, les sauvages devaient se convertir au christianisme pour acquérir la capacité juridique. À l’époque contemporaine, pour exporter vers l’UE, les pays tiers doivent souscrire à des engagements sociaux, politiques et environnementaux et vénérer la sainte démocratie. Les intentions – tout comme celles des missionnaires – sont des plus nobles, et il est impossible d’ignorer la situation critique des conditions, de travail et sociales, dans la plupart des pays en développement. Mais si l’on regarde le résultat, il s’agit tout simplement de ce que l’on pourrait appeler une attitude impérialiste ou coloniale de la part de pays qui ont bâti leur fortune il y a à peine plus d’un siècle sur les souffrances de la classe ouvrière.
Imposer les clauses sociales européennes signifie, de facto, rendre non compétitifs les produits issus des pays en développement, comme l’expliquait David Ricardo au début du XIXème siècle. Avec pour résultat qu’il est plus commode de ne pas délocaliser, à la grande satisfaction des syndicats européens qui, apparemment, ne tiennent pas en grande estime la devise « Travailleurs du monde, unissez-vous ». Il faut être clair : en soi, il n’y a rien de mal à promouvoir par des moyens pacifiques la prospérité d’une nation. Ce qui est franchement ennuyeux, c’est de revêtir ces politiques d’habits altruistes.
La politique étrangère est un jeu difficile, dans lequel chaque joueur poursuit son propre intérêt. Se prévaloir d’une sorte de supériorité morale revient simplement à clamer que l’Empereur ou l’Impératrice sont nus.
Il y a un autre point à souligner. L’UE se présente comme un champion de l’ordre public international. Mais elle a déclaré à plusieurs reprises et explicitement qu’elle n’était pas liée par le droit international lorsque cela ne lui convenait pas. Ici, la Cour de justice a joué un rôle fondamental dans la formation de cette « exception européenne ». Je me limiterai à trois cas : dans l’affaire de la centrale nucléaire de Sellafield (2006), la Cour de justice a déclaré que le droit de l’UE avait préséance sur la Convention des Nations Unies de Montego Bay sur le droit de la mer. Dans l’affaire Khadi et al Barakaat (2008), la Cour de justice a soumis à revue judiciaire des sanctions prises par le Conseil de sécurité de l’ONU. Et dans l’affaire Achmea (2018), la Cour a déclaré que les États membres ne devraient pas respecter les traités bilatéraux d’investissement (qui sont à tous égards des traités internationaux) s’ils préemptent les prérogatives de l’UE.
Ce n’est pas le lieu de discuter du bien-fondé de ces trois affaires. Ce qu’ils soulignent, c’est l’idée selon laquelle l’UE est un ordre politique et économique autosuffisant qui peut mettre de côté, à sa convenance, le droit international.
* * * *
Les paragraphes précédents se sont concentrés sur la pars destruens [la partie critique], insistant sur ce qui semble être des politiques et des attitudes autodestructrices.
Si l’on devait élaborer un pars construens [la partie constructive], il pourrait contenir :
D’un point de vue institutionnel :
• Le principe de subsidiarité devrait redevenir une (rare) exception, dûment et politiquement vérifiée.
• La conditionnalité ne peut pas être un gros bâton entre les mains de la Commission, mais un outil promotionnel entre les mains du Conseil.
• Toutes les institutions européennes devraient respecter les traditions nationales sur les questions éthiquement sensibles.
• La politique étrangère de l’UE devrait être clairement dirigée par le Conseil et non par la Commission.
Du point de vue de l’équilibre des pouvoirs :
• De nouveaux pouvoirs ne devraient pas être confiés à la Commission.
• La Commission devrait faire preuve de retenue lorsqu’elle impose des amendes administratives à des parties privées.
Du point de vue de l’action législative :
• Les textes législatifs doivent être rationalisés et rendus clairs, en réduisant considérablement la taille gigantesque des considérants.
• La réglementation déléguée à la Commission devrait être une mesure exceptionnelle et strictement justifiée.
• La production normative devrait suivre l’idée selon laquelle « moins c’est mieux » et un moratoire sur les interventions législatives dans le domaine du droit pénal devrait être introduit.
D’un point de vue judiciaire :
• Dans un système très déséquilibré de répartition des pouvoirs, la retenue judiciaire sert d’équilibre et évite la création d’une nouvelle institution législative irresponsable.
Vœux pieux ? Très probablement, et l’auteur de ces pages n’ignore pas le sort qui fut réservé à Cassandre. Cependant, il ne faut pas oublier que les élections européennes n’auront lieu que dans quelques mois et qu’elles pourraient s’avérer être le temps de la reddition des comptes.



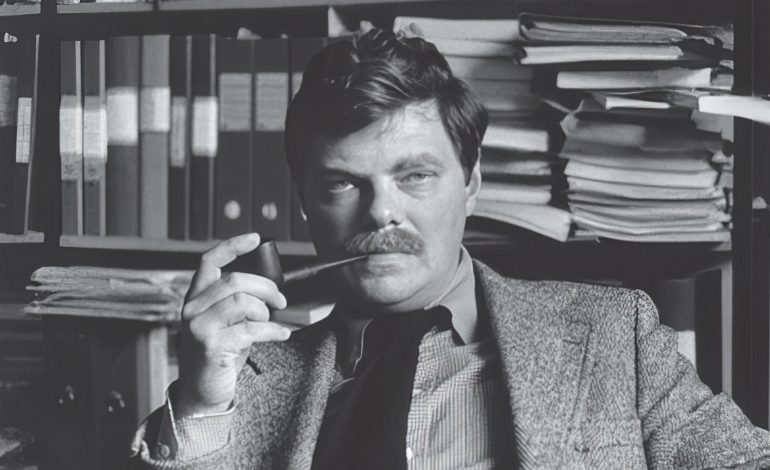


1 Commentaire
Noel