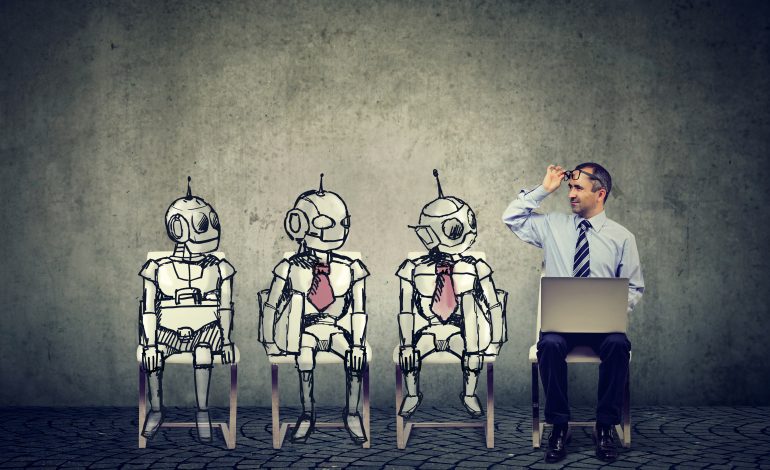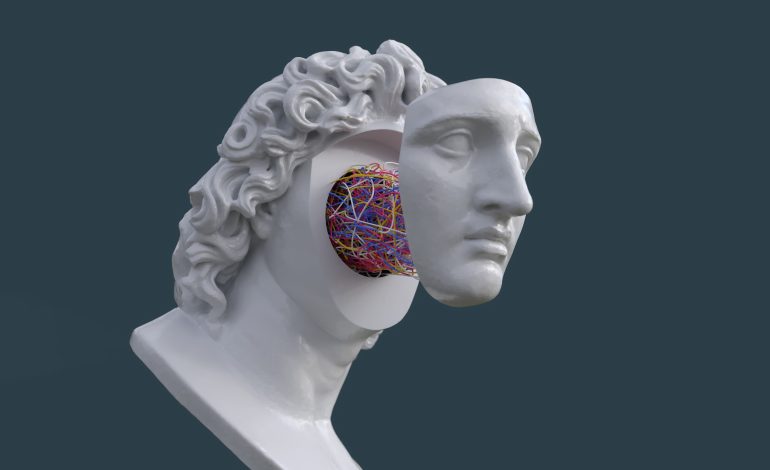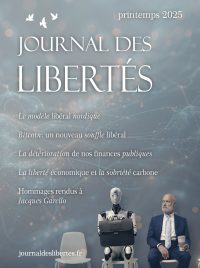L’intelligence artificielle est en prise directe avec l’actualité scientifique, industrielle et intellectuelle depuis des lustres. Replacée dans l’histoire et dans la philosophie des sciences, ces pages d’Angelo Petroni –tout comme l’article publié au n°8 de notre revue du printemps 2020 – inscrivent ce phénomène moderne dans l’histoire longue de la science et des techniques.
L’auteur que je sers et l’interprète que je suis travaillent sur ce sujet depuis des années, mais avec des perspectives différentes : si je ne me trompe pas, le regard de notre collègue romain est surtout celui d’un philosophe des sciences et d’un logicien, conformément à l’intitulé de la chaire qu’il occupe à l’université La Sapienza de Rome ; quant à moi, après avoir simulé des procédés industriels, conduit de la « recherche opérationnelle » civile et militaire, j’ai analysé (et tenté de modéliser) des comportements économiques et sociaux. Sous une forme ou sous une autre, j’ai ainsi croisé ce que l’on nomme « intelligence artificielle »à chaque étape de mon itinéraire.
Je prends la plume « avec bon sens », dans une perspective que j’aimerais libérale, c’est-à-dire : argumentée, contradictoire et constructive. Et j’essaie de « mettre les pendules à l’heure », si je puis dire, comme les chroniqueurs de la Lettre de l’IREF le font au jour, le jour.
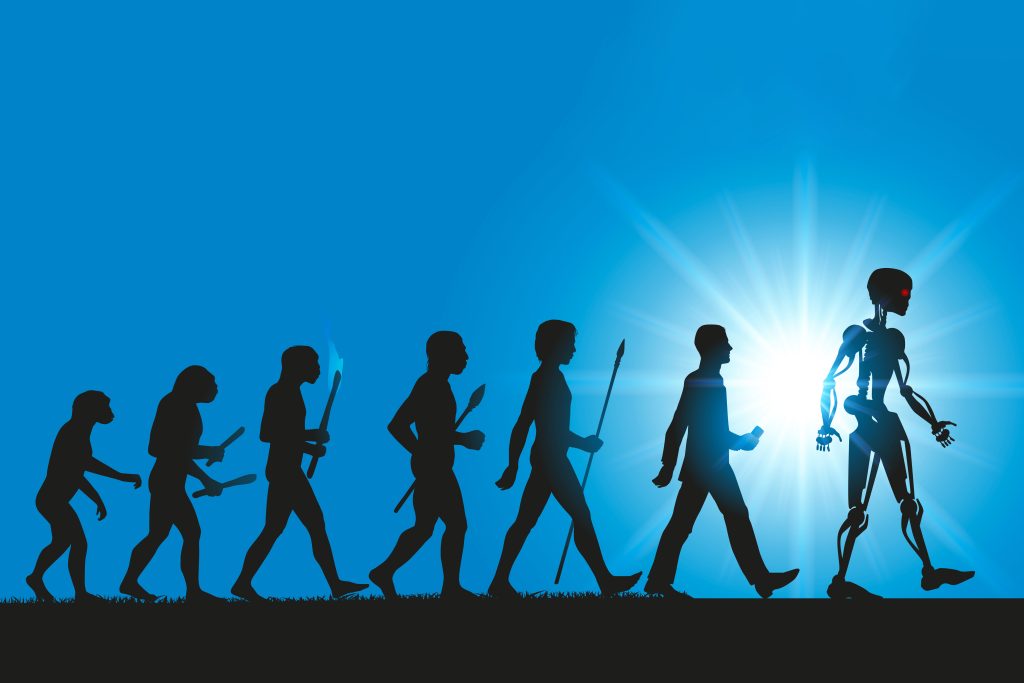
L’intelligence artificielle est-elle une duperie ?
J’emprunte mon titre à un ouvrage de 1990[1] préfacé par le grand physicien Louis Leprince-Ringuet qui présidait la Fondation Bull où se rencontraient de brillants esprits d’origine, de formations et d’histoires très diverses[2]. On y tentait des exercices de pensée qui évoquaient les cénacles du XVIII° siècle où se décanta en partie le savoir moderne.
Venue d’Amérique dans les années 1950, l’intelligence artificielle est uneexpression anglo-américaine toute faite ; nous la prononçons sans trop y penser ; mais elle sonne mal : n’est-il pas surprenant d’associer l’intelligence, faculté typique de la personne humaine, avec le qualificatif artificiel ? Au sens étymologique, l’intelligence (n.f.) est une « faculté de concevoir et de comprendre qui distingue l’homme de l’animal » dit le Petit Larousse. Et l’adjectif artificiel convient pour qualifier une machine ou un objet fabriqué ; il est donc tout-à-fait paradoxal d’associer l’intelligence, faculté typiquement humaine, à l’artificiel qui qualifie une machine.Cetteexpression est un oxymore, ; une figure de style qui n’est pas innocente.
Cas particulier des robots
Très proche de l’intelligence artificielle, la robotique est un solide objet d’étude. Le robot est un outil, indissociable de l’industrie : il démultiplie et relaie la force et l’habileté des ouvriers. Bruno Bonnel qui connaît bien ce domaine[3] considère à raison que ces « machines savantes » accélèrent, régularisent et normalisent la production (en chaîne, en rafales ou même à l’unité). Ils remplacent du travail manuel. Le robot actuel est donc un progrès moral pour l’industrie car l’automate transforme l’ancien ouvrier en un pilote intelligent. C’est lui, l’ancien ouvrier, qui surveille, qui entretient et qui dépanne les robots lorsqu’ils en ont besoin ; une tâche, réellement intelligente, qui impose de réfléchir, de comprendre et d’analyser tout événement, toute perturbation, toute cause de panne; l’opérateur guide le robot, juge des conséquences d’un incident sur la production ; qualifié et responsable c’est lui qui surveille la production, sans que sa tâche soit répétitive ; il s’adapte aux circonstances !
C’est pourquoi il a fallu très profondément revoir et élargir les métiers de l’industrie au cours du dernier demi-siècle, entraînant une nette réhabilitation des tâches de production. Dans l’industrie – je devrais dire : dans ce qui en reste à ce jour ! – les anciens ouvriers forment désormais un corps de techniciens qualifiés – moins nombreux que les OS d’autrefois, mais beaucoup mieux formés, respectés et payés en conséquence.
Les robots stimulent le progrès technique : cela devrait faire taire la voix nostalgique de ceux qui regrettent l’ancien asservissement des hommes aux machines (comme celui des ouvrières qui peuplaient encore les usines du textile et de l’électronique des années 1960). La caricature de l’industrie, par le Charlot des « Temps modernes », a disparu ; dans les usines et sur les chantiers, les robots d’aujourd’hui, qu’ils soient « intelligents » ou pas, sont un progrès à tous les niveaux. Il est bon que ce marché grandisse, que l’on sache les concevoir, les construire et les exploiter en France : ils sont une composante essentielle de l’industrie contemporaine : dans l’électronique, dans les travaux publics, pour la manutention portuaire, dans les entrepôts, les aéroports, la chirurgie etc.
Mythe, déraison ou manipulation ?
La machine qui échappe à son créateur est un mythe qui a la vie dure, même (et surtout!) lorsqu’il est fantasmé : la science-fiction l’exploite autant que le cinéma et les jeux vidéo, au point que les auteurs finissent par croire à cette baliverne qu’une machine puisse vraiment manipuler l’homme qui l’a créée. Purement imaginaire, il s’agit d’une menace dystopique et déraisonnable qui continue de s’imposer, malheureusement, comme un lieu commun du divertissement ; c’est un poncif, répété à satiété par les scénaristes de séries et de jeux vidéo, qui prend le tour d’un rêve païen. Pourquoi se poursuit-il ? Serait-ce « à dessein » ?
Établi depuis plus de deux siècles, un autre lieu commun consiste à affubler l’automate d’une forme humaine, humanoïde ou monstrueuse, sinon bestiale. Ce fut le fantasme des horlogers comme Vaucanson, inventeur du « canard digérateur » disparu dans l’incendie d’un palais russe en 1879[4] ! De nos jours, la forme des robots est dictée par la fonction qu’ils remplissent : en robotique, la fonction dicte la forme, en 3D ; et la forme humaine n’est, en règle générale, pas la plus efficace pour exécuter les tâches que l’on confie à une machine : fantasme, quand tu nous tiens…
Des machines intelligentes, peut-être ; mais pas raisonnables !
Jean Gatty, discret financier-philosophe, résuma l’intention du séminaire de Dartmouth, fondateur de l’intelligence artificielle en 1956[5]. Son article n’a pris aucune ride, trente-cinq ans après publication[6]. A l’instinct s’oppose l’intelligence humaine qui implique un exercice logique et de la raison : l’être intelligent pose un problème et s’efforce de le résoudre. Depuis Binet[7], on veut mesurer cette aptitude du sujet à résoudre des problèmes, dans un contexte professionnel ou à des fins pratiques (grâce à des tests psychotechniques, par ex.). Très vivace, cette quête implique qu’intelligence et comportement sont liés (p. 170) ; cela suggère d’imiter l’intelligence humaine pour résoudre des problèmes avec une machine, propos de l’intelligence artificielle que l’on évoque ces temps-ci : Chat GPT, pour rédiger une lettre, par exemple.
En d’autres termes: la psychologie du comportement quise limite à l’interaction de l’homme avec son milieu, exclut toute notion d’âme ; dès lors, un robot bien entraîné peut sembler aussi intelligent (je préférerais dire : aussi habile) qu’un homme placé dans les mêmes conditions, dans la mesure où l’un et l’autre se comportent « comme un pion dans un échiquier ». Une acception très étroite, voire « provocante » de l’intelligence, suggérait Gatty !
A la veille de la première guerre mondiale (1913) le behaviorisme de Watson relaya la psychologie scientifique de Binet ; le comportement (behaviour) y joue un rôle analogue à celui que l’on attribuait à la force en mécanique classique. Cette psychologie (expérimentale) poursuivant une « finalité technique », tend-elle à « manipuler les hommes » ?Gatty décèle « à l’état de germe…une maîtrise de l’intelligence de l’homme (qui) donne des moyens au behaviorisme ». Au tournant des années 1940, Orwell et Huxley sentirent que ce behaviorisme peut prendre un tour machiavélique, préparer une tyrannie ou la sélection génétique, sous prétexte de préparer un « monde meilleur »[8] !
Garder les idées claires et fixer des priorités
Jean Gatty était optimiste ; j’appréciai son diagnostic : « la machine n’a pas de volonté… l’homme a une volonté » ; il ajoutait : « plus question de dresser les hommes mais de substituer les machines à eux » (p. 173) ; la robotique lui donne en partie raison. Mais d’autres aspects de l’intelligence artificielle sont bien moins encourageants : le behaviorisme refleurit autour du « pape » trans-humaniste, Ray Kurzweil, qui plaide sans relâche pour l’homme augmenté : « nous deviendrons bientôt un hybride de la pensée biologique et non-biologique » (www.singularity.org ) !
Cette vision mécaniste et utilitariste du monde et de la société cache un désir prométhéen: perfectionner la personne humaine, allonger sa vie etc. Et suggère, sans le dire, qu’une puissance tutélaire, omniprésente et omnipotente, aiderait chacun à se perfectionner, physiquement et psychologiquement, afin de construire une « nouvelle société » potentiellement encadrée par le sympathique « Big Brother » qu’annoncent les « intelligences artificielles » de Google & C°. A cela je dis : « Attention !», en souvenir d’une sentence de Revel : « sous la marque du Bien, la tentation totalitaire est une constante de l’esprit humain. »[9]
Car, par bien des aspects, le transhumanisme n’est pas différent du « contrôle social » que la Chine communiste étend sur le gigantesque territoire dont elle maîtrise la population. Imposée dans cette société communiste, l’analyse automatique des données et la reconnaissance faciale des passants, des promeneurs, des visiteurs, des voyageurs etc. est générale. Appuyés sur leurs « intelligences artificielles », Huawei, Tencent, Baidu etc. prélèvent et exploitent (sous l’œil vigilant des autorités) une masse gigantesque de données individuelles, saisies au vol dans l’espace public et dans des lieux privés. Ces données indiscrètes peuvent nous condamner à tout moment : finance, santé, relations, rencontres etc. nous classent selon des critères behavioristes choisis par le Parti au pouvoir: Big Brother technologique et Big Brother politique convergent vers le contrôle social, une situation que, pourtant, Gatty refusait d’avance en disant : l’homme ne se réduit pas à ses comportements (p. 176). J’aurais aimé qu’il en soit ainsi ; mais, au cœur de la société numérique, les faits disent autre chose.
En définitive, s’il est vrai qu’il est intéressant d’inscrire l‘intelligence artificielle dans l’histoire et la philosophie des sciences, il importe aussi de s’interroger sur son usage et son impact sur nos libertés. Je tenais à le souligner ; et termine avec ce témoignage de son camarade Guillaumet, rapporté par Saint-Exupéry : rentré gelé mais vivant du crash hivernal de son avion dans une combe perdue des Grandes Andes, il prouve que sa force morale place l’homme au sommet de la hiérarchie du vivant : « Ce que j’ai fait, je te le jure, aucune bête ne l’aurait fait ![10] » Qu’aurait fait une intelligence « fabriquée » en de telles circonstances ? Rien, car elle ne saurait penser !
[1] Intelligence artificielle et bon sens, Masson, coll. Fredrik Bull n°10 (dir. R. Moch).
[2] Établie en mémoire de l’entrepreneur norvégien F. R. Bull (1882-1925), cette Fondation siégeait à Louveciennes. Leprince-Ringuet succéda à Raymond Aron. Différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 45 ans, l’Institut Fredrik Bull suit encore la conjoncture industrielle et commerciale du numérique et l’IA.
[3] Fondateur d’Infogramme en 1993, il a présidé l’École de management de Lyon, ville où il fut élu député.
[4] Spillemaecker, C., Vaucanson & l’homme artificiel, PUG, Grenoble, 2010, pp. 5-6.
[5] Établissement réputé, installé au nord-est des États-Unis depuis le XVIII° siècle, dans l’État du New Hampshire. Réunis dans ce campus, les participants rédigèrent une « profession de foi » quasi-positiviste sur l’intelligence artificielle ; Herbert Simon, Nobel d’économie en 1978 pour ses travaux sur la « rationalité limitée », y contribua.
[6] D’après Jean Gatty, « Le modèle psychologique » in : Intelligence & bon sens , Masson, (pp. 167-176).
[7] Fondateur de l‘Institut de psychologie de Paris, composante de l’actuelle université Paris-Cité (ex. Paris-Descartes).
[8] Je pense évidemment aux deux romans emblématiques : 1984 et Le meilleur des mondes !
[9] In : La grande parade, Plon, 2000, p. 343.
[10] Antoine de Saint-Exupéry : Terre des hommes, NRF-Gallimard, Paris (1939), p.46, livre dédié à Henri Guillaumet.