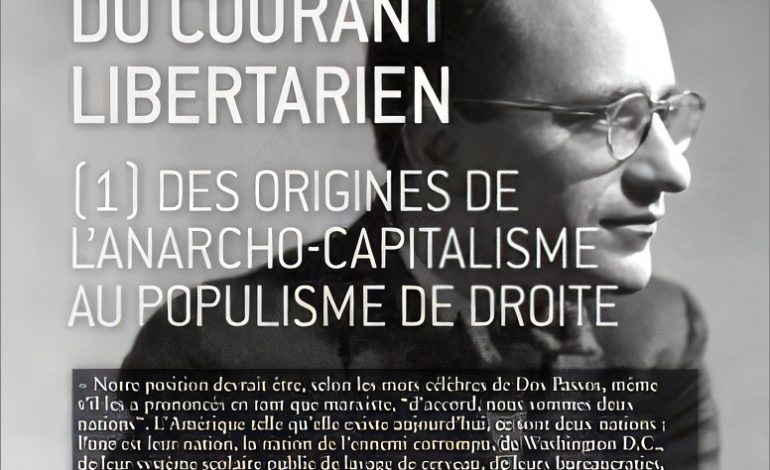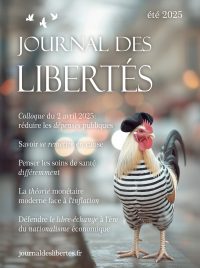Ce petit volume reprend des thèmes qui ont fait la notoriété d’Antoine Compagnon, spécialiste de la littérature française des XIX° et XX° siècles qui a travaillé sur Montaigne, sur Baudelaire et Pascal, ainsi que sur Proust qu’il a édité en Pléiade. Étonnante, sa dévotion pour Roland Barthes remonte à sa jeunesse. Il a plusieurs cordes à son arc, rarement évoquées aussi clairement que par cet essai qui contient des pages originales.
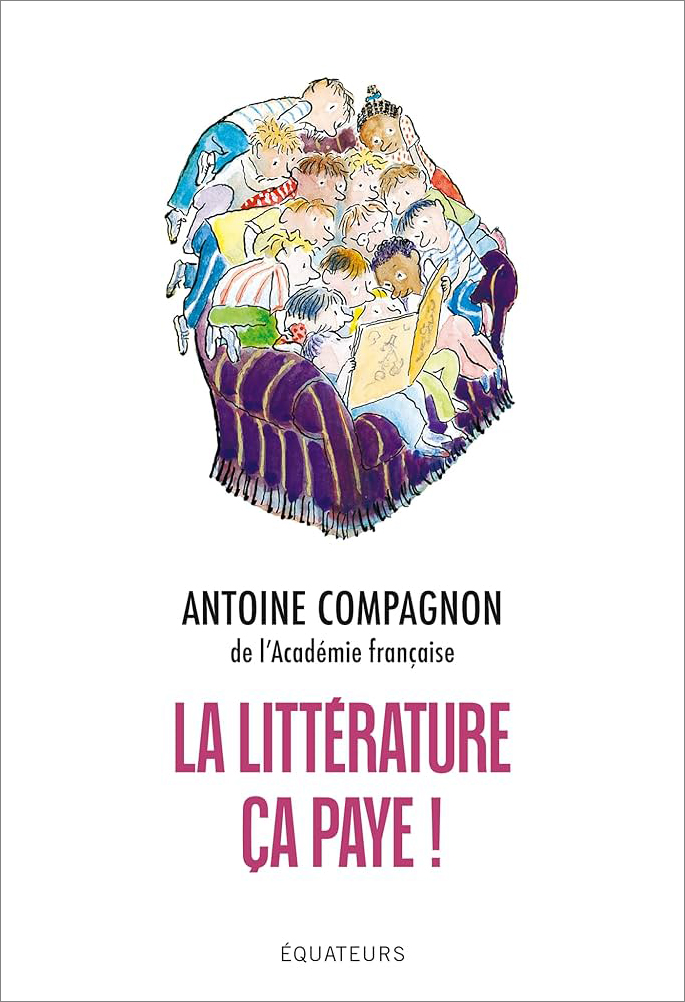
Ce livre est rarement polémique : Antoine Compagnon s’exprime avec modération et finesse, deux qualités utiles au sein des cénacles universitaires, qui ont facilité sa récente élection à la Française et le font immortel depuis quelques mois ! Il « rend hommage à la littérature et célèbre la lecture » (p. 9). Et parsème son récit de nombreuses citations – marotte de littéraire, dira-t-on – mais y ajoute des preuves, ce qui nous convient. Il conclut (p. 186) : [littérature et lecture] « se révèlent toujours payantes à qui sait attendre » !
Ces pages témoignent du goût de l’auteur. Chacune de ces 25 chroniques soulève un coin du voile d’indifférence qui étouffe les études littéraires en France depuis un bail. Un abandon que l’auteur regrette et qu’il refuse de prendre comme une cause perdue : les faits sont têtus, estime-t-il : « La littérature se répand partout, sauf dans les facultés des lettres » (p. 146). Ainsi se construit pas-à-pas son ouvrage, appuyé sur l’autorité des figures littéraires que cet hyper-mnésique connaît presque par cœur, il le confesse au fil du livre ; pour lui et contre toute prédestination, nous allons le découvrir : « la vraie vie, c’est la littérature » (p. 39).
Écrit à la première personne, ce texte déroge au style académique que l’auteur pratique depuis cinquante ans. Il illustre son propos par du vécu qu’il dépose, par petites touches, au fil des pages. Pour l’essentiel : il naquit dans une famille nombreuse. Son père était officier de carrière. Orphelin de mère à quatorze ans, il suivit la voie royale du prytanée militaire jusqu’à l’École polytechnique, puis au corps des Ponts & Chaussées. Gavé par le positivisme polytechnicien, il vira aux études littéraires et linguistiques, à l’ombre de Roland Barthes et de Julia Kristeva ; une mutation radicale mais réussie puisqu’il siégea quinze ans au Collège de France après avoir observé qu’une bonne moitié de ses étudiants en Sorbonne était « composée d’égarés […] victimes d’un mauvais aiguillage » (p. 140)!
Inutile de chercher dans ce livre un plan didactique ou un schéma directeur ; ce sont des « Variétés », des inventions originales, précieuses ou polémiques, comme celles de Valéry qui le précéda de plus d’un demi-siècle au Collège de France. Elles touchent l’art, la poésie et la littérature et font écho à l’ouvrage le plus caractéristique de l’auteur[1] et aux écrivains « antimodernes » qui furent ses « compagnons » – l’auto-dérision est de lui, p. 95 – pivots de ses travaux pendant un demi-siècle comme Proust et Barthes, déjà mentionné ; mais aussi Julien Benda, ingénieur passé par l’École Centrale et non par l’X, qui fut, lui aussi, un transfuge des sciences vers les lettres au sein desquelles il a brillé. Et Péguy, l’antimoderne colérique, trop tôt disparu, alors que Compagnon, lui, est calme ce qui fait différence. Une grande famille, diverse, parfois conservatrice, parfois progressiste, toujours littéraire, parfois presque libérale !
Quelques passages de ce livre sont des trouvailles : lorsque l’auteur réfléchit, heureuse surprise, au « business de l’enseignement » (p. 50 sq.) dans des termes que l’on partagerait presque ; lorsqu’il défend fermement la méritocratie républicaine et jette une pierre dans le jardin d’un autre prédécesseur au Collège de France, Pierre Bourdieu dont il taquine la mémoire en lui reprochant sa fixation sur « l’héritage » et son entêtement à « venger sa classe » (p. 78-79 & p. 88 sq.). Car, pour Antoine Compagnon, « les transfuges, dorénavant, ont honte de l’ambition dont ils ont fait preuve […] et la perçoivent comme une trahison » ! On ne saurait mieux dire. A propos de l’ascenseur social, Compagnon démonte les « lieux communs de la sociologie » (p. 83) car il « n’est pas en panne, mais trop exigu » constate-t-il (p. 87).
Autre réaction intéressante : il critique la déclinaison audiovisuelle du livre écrit, que l’on nomme : audio-livre ; Compagnon la traite comme une illusion car, comme la coupe d’un coiffeur pour homme, illustrée par Jean Fourastié[2], la lecture « n’est pas plus rentable aujourd’hui que dans l’antiquité » (p. 129). Une malédiction paradoxale car ce service, par nature, est insensible aux vertus de la productivité , un fait illustré par Baumol (cost decease de la représentation théâtrale ou musicale p. 158) et par Solow : « je vois des ordinateurs partout, sauf dans les indices de productivité ! », deux analyses familières pour l’auteur dont le bagage économique, j’insiste plus loin, est matheux d’abord, mais solide !
Dans le petit chapitre titré : « Tact et distinction » – termes proustiens – Antoine Compagnon observe aussi que médecins, ingénieurs, magistrats, biologistes etc. réussissent d’autant mieux leur vie professionnelle qu’ils savent tirer parti de leur « compétence lettrée », avantage comparatif qui leur permet de se faire comprendre et de s’exprimer pour tout le monde (p. 74). Malheureusement cet avantage, la sociologie contemporaine le dénigre car elle s’efforce d’escamoter la culture générale de nos programmes, avec l’assentiment du Landerneau politique, social et culturel français. L’auteur s’en désole car, quelle que soit l’activité pratiquée, les fonctions occupées et les responsabilités assumées « la culture générale, c’est une autre intelligence […] de la pénétration, du flair, comme chez un bon chien ou un renard » (p. 100-101).
Le savoir-faire littéraire trouve donc à s’employer partout – sauf, dit-il, dans les facultés des lettres! Cela perturbe notre époque où, pourtant, chacun prétend mettre de la rhétorique au cœur des relations sociales. Et le mot d’ordre n’est plus d’agir mais d’établir son propre récit du monde (p. 140-44); on n’étudie plus l’histoire, on l’écrit pour « changer le monde » ; ce récit prenant le pas sur le réel. Est-ce un triomphe de la communication sur l’action, pour satisfaire « des fins de propagande » ? Bien qu’imparfaites à mon goût, ces pages posent de vraies questions ; il est bon qu’elles existent, même si – pour éviter de froisser des lecteurs, sans doute – le propos soit affadi.
Terminons par deux surprises : ornée par un charmant dessin de Sempé illustrant l’attraction d’un livre sur un groupe d’enfants sages, la couverture est plaisante ! Mieux, une pépite se cache plus loin, réjouissante pour un libéral : Compagnon explique qu’en économie, en sociologie, en biologie ou même dans des sciences « dures », l’exposé, la démonstration, les conclusions rédigées ont au moins autant d’importance que la formalisation – même et surtout en mathématiques ; important, n’est-ce pas ? Ainsi, le talent littéraire et l’invention rhétorique des économistes ont contribué à leur gloire et diffusé leur pensée : pensez-à Constant ou à Stuart Mill, par exemple. Pour illustrer ses dire, qui cite-t-il (p. 155-159) ? La fable des abeilles de Mandeville, La vitre cassée et Ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas de Bastiat qu’il admire beaucoup ; la Vertu d’égoïsme et Atlas schrugged d’Ayn Rand ; Adam Smith et sa Sagesse des nations ; incidemment : le passager clandestin de Mancur Olson… auxquels il aurait pu ajouter : Nassim Taleb et son Cygne noir , qui ne lui sont pas étrangers!
Compagnon dit que certains antimodernes furent conservateurs, plutôt que réactionnaires ; il les qualifie de pessimistes, à l’inverse de l’optimisme progressiste des Lumières ; il décrivait Joseph de Maistre comme « un raisonneur délicat » (Antimodernes p. 28) ; et l’enivrement du dandy Baudelaire en 1848, qui n’en fit pas un révolutionnaire (Antimodernes p.30) car « l’anti-moderne n’est ni maurassien ni putschiste » (d° p. 37)!
Résumons : ce livre est curieux : son ton et les sujets qu’il aborde prouvent que l’auteur se souvient bien des problèmes de géométrie descriptive : il faut sortir de l’épure pour les résoudre : « Mandeville, Bastiat, Merton, Baumol, je pourrais en citer bien d’autres, poètes des sciences (économiques & sociales) que nous aurions oubliés sans leur génie littéraire » (p. 168) ; appréciation qu’il confirme plus loin : « les meilleurs économistes ou sociologues [..,] possèdent un talent de conteur » (p.172). Je pense à Michel Crozier et au talent que l’auteur accorde à Merton – pas à l’économiste nobélisé, spécialiste des marchés dérivés, mais au sociologue new-yorkais qui insistait sur la parabole et sur la prescription de l’évangéliste Matthieu (13, 10) : « je parle par paraboles pour qu’ils voient sans voir et entendent sans comprendre » !
Je termine : « Un économiste qui n’a pas un peu le génie de la langue n’ira pas loin » (p.155). Qui dit mieux ? Et par un regret : pourquoi n’a-t-il cité ni Turgot, ni J-B. Say, ni même son ancien de l’X, Jacques Rueff ? Nobody is perfect !
[1] Les antimodernes, Paris, NRF-Gallimard, 2005.
[2] cf. J. Fourastié : Productivité & richesse des Nations, Gallimard, Tel n°336, Paris 2005, p. 85.