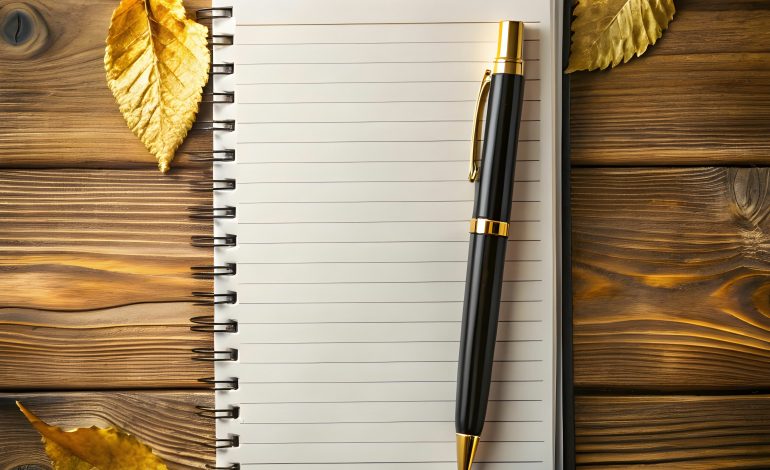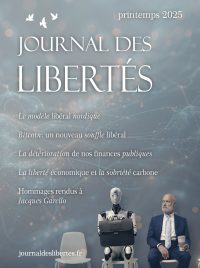de Pierre BENTATA
L’Observatoire, 2025, 238 p.
Ce cinquième ouvrage de Pierre Bentata est peut-être son meilleur. L’ouvrage est construit autour d’un paradoxe qu’il entend résoudre : L’Occident a triomphé d’une grande majorité des malheurs qui frappaient l’humanité ; il a connu un enrichissement qui va bien au-delà des plus folles espérances de nos ancêtres et il a surpassé dans cet exercice tous les pays qui n’ont pas emprunté le même chemin. Si donc l’Occident a vaincu, pourquoi ne cesse-t-on de clamer le déclin de l’Occident ? Pourquoi cette ambiance défaitiste ; ce malaise qui semble inonder le cœur et les pensées des heureux élus que sont les Occidentaux ?
Avec un thème aussi vaste on peut craindre que l’auteur se perde dans ses arguments, ou tout simplement ne parvienne pas à identifier les causes de ce malaise qui sans doute sont multiples. Mais il n’en est rien. Tout dans cet ouvrage est clair et bien construit, les contre-arguments sont pris au sérieux ; de sorte que, en refermant l’ouvrage, le paradoxe peut être considéré comme résolu.
La démonstration suit un plan annoncé clairement dans l’ouvrage.
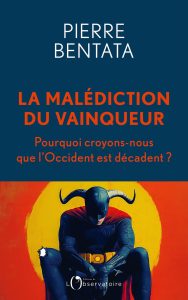
« Si tout va bien, pourquoi l’Occident pense-t-il que tout va mal ? A bien y regarder, trois petits défauts-psychologique, moral et philosophique –lui font confondre progrès et décadence. Rien de rédhibitoire. Car l’Occident a ceci de singulier : ses défauts sont ses chances ; plus il en a, mieux il avance. » (p. 66)
Comme toute démonstration, celle-ci nécessite que l’on soit clair sur les concepts ; à commencer par celui de l’Occident. Pour Bentata, l’Occident c’est « la démocratie libérale » à laquelle il donne une définition large – et sans doute un peu inhabituelle bien que non sans fondement. Une démocratie libérale est définie ici comme un régime qui place au-dessus de tout la défense de la dignité humaine. D’où, pour l’auteur, la supériorité morale de ce régime :
« les démocraties libérales, loin d’être ces sociétés matérialistes, dénuées de valeurs et décadentes, sont bien plus morales et même spirituelles que toutes les autres sociétés. » (p. 194).
Ou encore, à propos de l’Europe :
« Sa valeur cardinale n’est ni la tolérance ni l’hospitalité, mais la dignité humaine. Celles-là se déduisant de celle-ci » (p. 177).
Corollairement, la supériorité du monde occidental vient également du fait que les femmes y sont l’égal des hommes (pp. 51-53) ; il parle à son sujet d’un « havre du féminin ».
C’est pourquoi également l’Occident ne peut pas tout tolérer. Avec Voltaire et Popper – qu’il cite – il réclame l’intolérance pour les intolérants.
« Face aux menaces qui s’annoncent, on cède à l’angoisse. A tort. Car l’avenir réside à l’Ouest. Pour éviter le pire, il suffit d’en prendre conscience. Refuser les compromis, ne pas craindre la guerre, être inflexible sur ses valeurs. Bref, assumer son génie au lieu d’en avoir peur. » (p. 134)
Cette position le conduit à dénoncer le pacifisme prôné par les réalistes. Il s’explique :
« Pour qu’un conflit soit évité il faut que chaque partie reconnaisse le droit de l’autre à exister, accepte la légitimité de son gouvernement et de ses frontières, et accorde à la vie humaine une valeur inestimable. Dans le cas contraire, la stratégie pacifiste devient un blanc-seing pour une guerre qui n’épargnera que les bourreaux. »
Et à propos des mêmes « réalistes » en matière géopolitique :
« Voilà la véritable décadence. L’impossibilité de se réjouir d’être libre au milieu de femmes et d’hommes aussi libres que soi. L’inaptitude à voir ce que l’on voit. Le reniement de la grandeur d’une civilisation par peur du qu’en-dira-t-on… L’abdication de l’honneur d’être admiré autant que détesté, et l’abandon de la responsabilité. » (p. 210)
Ils sont incapables d’identifier les valeurs de l’Occident et donc prêts à les abandonner sans lutter.
Cette forme de réalisme n’est pas la seule cible de Pierre Bentata. Car nier le déclin ne veut pas dire affirmer que tout va bien. L’auteur a d’ailleurs dans ses ouvrages précédents (par exemple De l’esprit de servitude au XXIe siècle)dénoncé les travers de nos démocraties libérales – qui font qu’on doit plutôt les qualifier selon le contexte de social-démocraties. Comment ne pas déplorer, par exemple, la sclérose politique qui saisit de nombreuses démocraties libérales ?
A ce sujet, il remarque, non sans humour :
« En France, pays où Mirabeau ou Rousseau s’interrogeant sur la nature de l’Assemblée – doit-elle êtes composée des meilleurs où être un échantillon représentatif ? – les extrêmes ont choisi une troisième voie : faire élire les pires. » (p. 89)
C’est qu’en effet la démocratie libérale « est la plus fragile des organisations ; la plus lente aussi » (p. 126). Elle n’en est pas moins pour autant précieuse et c’est pourquoi nous devons prendre sa défense… C’est d’ailleurs là l’une des contributions importante de l’ouvrage : en fidèle disciple d’Hayek, Pierre Bentata dresse un parallèle passionnant entre l’ordre spontané du marché et l’ordre spontané d’une démocratie libérale. La décision autoritaire en démocratie devient le miroir du planificateur économique sur les marchés. Nous savons, par l’expérience et par la logique (voir les pages 135 à 147), que les institutions spontanées l’emportent sur les institutions dirigées ; mais nous savons aussi qu’elles ont plus d’opacité en comparaison de la claire verticalité de la solution autoritaire. Or, « on n’accepte pleinement que ce qu’on comprend. » (p. 135). C’est pourquoi ces systèmes complexes – marché, démocratie libérale – n’emportent jamais une entière adhésion parce qu’on ne les comprend pas pleinement. Est-il une idée qui a été plus tournée en dérision que celle de « la main invisible » ? Alors, si l’on ne veut pas que l’opinion rejette les institutions qui ont fait leur succès il nous faut sans cesse expliquer leur fonctionnement, leur richesse. C’est précisément ce qu’entreprend de faire Pierre Bentata dans cet ouvrage.
Et il le fait avec brio. On retrouve à travers ces pages la patte de l’économiste, celle de l’enseignant-chercheur (la précision des notes de bas de page est impressionnante). On retrouve aussi le passionné de philosophie, de littérature, l’observateur sérieux, curieux mais aussi parfois amusé de notre société :
« …ceux qui se présentent comme des « éveillés » (woke) finiront par éteindre les Lumières. » (p. 118) ou encore « tant que les hommes ne boiront pas de pétrole et ne mangeront pas de boulons, la Russie ne décollera pas. » (p. 41).
En bref, l’ouvrage défend une thèse, peut-être surprenante, mais claire, forte et vitale : « La force de l’Occident c’est de reconnaître ses faiblesses. » (p. 97) et il faut savoir en tirer les conséquences : « On n’abdique pas l’honneur d’être une cible. » Je vous invite donc à vous plonger dans la lecture de La malédiction du vainqueur. Vous ne ferez pas forcément vôtres toutes les opinions et analyses de l’auteur mais vous trouverez certainement dans ces pages de quoi nourrir votre réflexion.