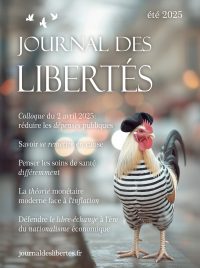Cet article reprend une communication présentée lors du colloque sur la réduction des dépenses publiques, organisé par l’IREF à Paris, le 2 avril 2025. Il présente brièvement les principaux arguments opposables à la planification écologique, pilier programmatique du candidat Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2022, dans le sillage de son premier mandat. Celle-ci engage la France dans une réduction à marche administrative forcée de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), à l’instar de l’ensemble des pays de l’Union européenne.

Cette politique souffre de deux défauts majeurs : celui, général, inhérent à toute planification publique, à savoir un défaut de compréhension de l’environnement socio-économique dans lequel ses intentions s’inscrivent. Et celui, spécifique, lié au flou conceptuel de l’épithète « écologique » qui lui est accolé. Une partie de cette dernière ambiguïté peut être levée en requalifiant la planification de « climatique », puisque c’est principalement de cela qu’il s‘agit. Mais alors, choisir – donc financer – telle « priorité » d’une politique climatique, c’est renoncer à d’autres, tout aussi recevables du seul point de vue de l’écologie.
Le coût d’opportunité de la planification écologique est plus grand encore, quand on le mesure à l’aune de ses conséquences socio-économiques. À cet égard, la récente remise en cause des « zones à faibles émissions » (ZFE) par le Parlement français constitue le dernier exemple d’une contestation protéiforme dont la révolte des gilets jaunes (2018-2019) ou les manifestations agricoles de 2024 sont emblématiques[1]. Ces soubresauts sont autant de contrefeux opposés à la planification écologique. Mais s’ils en diminuent la portée, ils en excitent aussi l’outrance. Dans cette veine, la Ministre de la Transition écologique a récemment pu qualifier « d’ennemis des Français » « ceux (d’entre eux) qui ne veulent pas agir contre le dérèglement (climatique) »[2]. Voici donc que le citoyen français deviendrait ennemi du peuple – anathème dont les pires dictateurs de l’Histoire contemporaine avaient jadis le monopole – dès lors qu’il continuerait justement de se comporter en citoyen, en exerçant simplement son droit de contester les motivations, les orientations et/ou les modalités d’une politique publique ? Il n’y a pas plus emblématique de la dérive théocratique du discours climatique que ce type de prise de position, plus proche de la Révolution culturelle maoïste que des principes républicains censés, jusqu’à nouvel ordre, guider l’action et la parole publiques.
Or, il y a justement lieu de remettre résolument en cause une politique publique dont l’objectif est inatteignable et le coût d’opportunité, démesuré. Afin de le montrer, cet article pourrait presque se limiter à renvoyer le lecteur au rapport de France Stratégies qui présente – avec une honnêteté bienvenue – les modalités et les implications de la planification écologique[3]. Que nous promet-il ? Une course contre la montre climatique ressemblant plus à une révolution qu’à une transition dans la mesure où nous devrons « faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en trente ans », au prix d’« investissements d’ampleur » qui « n’augmentent pas le potentiel de croissance » dans la mesure où ils induisent « un coût économique et social », une augmentation du ratio dette publique/PIB, une hausse des impôts sur les classes moyennes/supérieures et enfin, « un risque de configuration inflationniste » pour les années qui viennent (pp. 14-15).
Il y aurait lieu d’être passablement refroidi par un tel programme si ce grand sacrifice du bien-être national sur l’autel de la divinité climatique n’accouchait pas, à terme (non précisé), « d’une croissance verte plus forte que ne (…) l’aurait été la croissance brune » (p. 14). On n’est pas loin, ici, de « l’avenir radieux » de la propagande stalinienne. Enfin, il faudra bien entendu « continuer à investir dans l’amélioration des outils utilisés pour apprécier les incidences économiques de l’action climatique dans toutes (ses) dimensions » (p. 14), c’est-à-dire, entretenir un énième Frankenstein technocratique payé avec ce qui restera de richesse nationale pour nous convaincre de l’absolue nécessité de son œuvre sublime.
À l’heure où la Raison semble s’éloigner inexorablement de la conduite des affaires mondiales, l’état d’hypnose dans lequel le réchauffement climatique plonge les « élites » européennes est un sujet d’investigation psychosociologique en soi. On se contentera ici de montrer pourquoi la France, en particulier, devrait urgemment renoncer à une planification écologique qui frappe par son coût, son inconséquence et son inanité.
1. Le coût de la planification écologique
La planification écologique est d’autant plus coûteuse qu’elle repose sur une bureaucratie considérable, induite d’un autre fléau français : une législation inflationniste et bavarde, conçue explicitement comme outil politique plutôt que norme de droit, au sens substantiel de la notion[4].
En l’occurrence, l’inflation législative est aussi voire surtout d’origine européenne. Le « paquet énergie-climat » de 2009 consacre l’autorité tutélaire de la Commission européenne en matière énergétique et climatique et à partir de là, normes internationales et lois domestiques ne cesseront de s’enchaîner : accords de Paris (COP 21) puis loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015, jetant les bases de la « stratégie nationale bas carbone » (SNBC) et de la « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE) ; plan climat (2017) visant à assurer le respect, par la France, des accords de Paris ; loi 2019-1147 (2019) relative à l’énergie et au climat, chargée d’appliquer le plan climat menant le pays à la « neutralité carbone » en 2050 ; loi climat et résilience (2021) chargée, pour sa part, de mettre en œuvre le Green Deal, c’est-à-dire, la loi européenne sur le climat de 2021. À cette litanie normative, il faudrait ajouter cinq autres lois écologiques votées sous les deux mandats d’Emmanuel Macron, sans oublier l’imposante « loi biodiversité » adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande (2016).
Pour l’essentiel, cette ingénierie législative poursuit deux objectifs majeurs : (1) l’atteinte, par la France, de la neutralité carbone en 2050 ; (2) la réduction de 55 % de nos émissions actuelles par rapport à leur niveau de 1990, à l’horizon 2030 (objectif dit Fit for 55). Ce dernier objectif d’étape, issu du Green Deal, vise à accélérer le processus de décarbonation des économies européennes. Conformément à ce qu’en dit le rapport de France Stratégies (op. cit.), il s’agit de réduire les émissions européennes de gaz à effet de serre dans les mêmes proportions, en dix ans, que celles enregistrées entre 1990 et 2020 : environ 27 % sur chacune des deux périodes[5].
À cette fin, la planification écologique consacrée par le « droit » prescrit sous-objectifs et normes à tout crin, se dote d’administrations dédiées chargées d’en orchestrer l’application et, bien entendu, prévoit d’y consacrer des centaines voire milliers de milliards d’euros. Il est cependant difficile d’estimer le coût exact de la planification écologique, du fait de sa transversalité administrative et de son caractère largement prospectif, sans même parler de la distinction que n’opère jamais le débat public entre « coût » et « dépense ». En outre, l’estimation de celle-ci mêle fréquemment dépenses publiques et dépenses privées, ces dernières ne l’étant jamais vraiment au regard des « niches fiscales » et autres aides consacrées par le gouvernement à la rénovation des logements ou l’acquisition de véhicules électriques, notamment. Diverses évaluations que j’ai pu trouver font état d’une dépense actuelle comprise entre 20 et 80 Mds € par an ; mais l’on serait plus proche de 40 Mds €, en 2024. Les coûts prospectifs sont plus élevés : le rapport de France Stratégie évoque une soixantaine de milliards d’euros annuels en dépenses additionnelles, soit une centaine de milliards d’euros par an à partir de 2030. D’autres évaluations envisagent que ce dernier chiffre puisse être doublé[6].
Au-delà de son impact budgétaire, la planification écologique prête le flanc aux procès pour inaction climatique, eux-mêmes potentiellement coûteux pour les finances publiques. Implication somme toute logique du dévoiement du droit par la planification, une telle menace impose donc d’abroger les législations qui la sous-tendent, d’autant que celles-ci frappent par leur inconséquence.
2. L’inconséquence de la planification écologique
2-1. Inconséquence financière
Si cent milliards de ci de là peuvent aujourd’hui paraître peu de choses, le coût annuel de la planification écologique grèvera d’autant plus les finances publiques qu’elle implique, on l’a dit, une baisse de la croissance économique dans un pays – la France – souffrant déjà d’atonie en la matière. C’est pourquoi divers calculs prospectifs lui imputent une dégradation du ratio dette publique/PIB dans les prochaines années (+ 25 % en 2040 selon France Stratégies). L’horizon de la planification écologique suppose donc que, dans un pays saturé de dette publique, l’arbre de la dépense publique continuera de grimper jusqu’au ciel.
C’est en effet le cas à l’époque du Green Deal, soit les années 2019-2020 : le taux d’intérêt de l’obligation française à 10 ans (OAT 10 ans) est alors proche de zéro, voire négatif. Il n’est pas fortuit que la planification écologique se soit déployée à une époque d’illusion monétaire maximale accouchant d’un coût insignifiant de l’emprunt public. Depuis lors, le taux de l’OAT 10 ans est repassé au-dessus du chiffre symbolique de 3 % (1er décembre 2022), barre qu’il n’avait plus franchie depuis 2012. Si les turbulences géopolitiques des années 2020 continuent d’augmenter le coût du capital sur les marchés financiers, la valeur actuelle des divers engagements climatiques fondra comme neige au soleil (réchauffement ou pas) ce qui amènera à sérieusement reconsidérer les calculs prospectifs en la matière. Planifier est toujours périlleux mais le faire sous opium monétaire est particulièrement inconséquent.
2-2. Inconséquence téléologique
La planification écologique se pique d’objectifs chiffrés dont l’arbitraire évoque ceux du Gosplan soviétique : 40 % d’énergies renouvelables en France à l’horizon 2030 (42,5 % pour les autres pays européens), diminution de l’usage d’engrais, de pesticides, de terres affectées à l’agriculture bio, etc. Ces objectifs sortis de nulle part relèvent d’un « agenda inversé »[7] malheureusement inhérent à la planification impérative : il ne s’agit pas de calibrer l’objectif en fonction du réel – donc des ressources disponibles – mais de l’imposer à une société quoi qu’il en coûte.
À cet égard, l’objectif le plus étonnant porte sur la consommation nationale d’énergie : il s’agirait de passer d’environ 1600 Twh (térawatts/heure) annuels consommés aujourd’hui à quelques 1200 Twh en 2030 et 900 en 2050. Outre l’incohérence des chiffres issus de la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie[8], on se demande comment un pays ayant, il est vrai récemment, décidé de réindustrialiser son économie, parviendrait à diminuer sa consommation d’énergie de 25 % en quelques années. Cela implique, soit de contraindre les Français à une sobriété forcée, soit d’assumer la décroissance du PIB. Car en misant sur une croissance de la richesse nationale de l’ordre de 1 % l’an entre aujourd’hui et 2030, diminuer la consommation nationale d’énergie de 25% impliquerait d’améliorer notre efficience énergétique – le rapport entre consommation d’énergie et PIB annuel – à un rythme trois fois supérieur à celui enregistré entre 1990 et 2020 (- 4,5 % par an contre – 1,5 % par an). On ne voit pas bien de quel chapeau technocratique cette performance sortirait.
2-3. Inconséquence socio-économique
La nature kafkaïenne de la planification écologique n’est nulle part plus visible que dans les lubies réglementaires dont elle accouche. On a déjà évoqué le cas des ZFE. Mais que dire de cette réglementation européenne transposée en droit français, qui astreint les moyennes et grandes entreprises à un reporting social et environnemental babélien[9] ainsi qu’à l’immaculée conception de leur chaîne de valeur[10] ? Comment justifier que le Green Deal raye d’un trait de plume l’atout technologique principal d’un des fleurons de l’industrie européenne – le secteur automobile – en interdisant la commercialisation des voitures thermiques en 2035 ? Que dire, enfin, de cette politique de rationnement du logement dont procède le « zéro artificialisation nette » ou l’interdiction progressive de la mise en location des « passoires thermiques » ? De telles décisions se payent déjà de conséquences sociales considérables, à commencer par les difficultés de logement que rencontrent les jeunes ménages.
2-4. Inconséquence stratégique
Empêtrée dans les contradictions de son « agenda inversé », la planification écologique se heurte de plus en plus à la réalité socio-économique. On enseigne en stratégie d’entreprise que planifier suppose un environnement « stable ». Cette dernière notion est difficile à définir mais elle ne caractérise assurément pas la situation géopolitique des années 2020 : exacerbation des tensions politiques internationales, déséquilibres majeurs des balances des paiements, insoutenabilité de la monétisation des dettes publiques, polarisation des opinions publiques, gisements considérables d’innovations « disruptives » nourrissent une instabilité chronique bien peu propice à la planification.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la récente élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis semblent avoir (un peu) concouru à sortir l’Union européenne de son état d’hypnose climatique. D’abord en rappelant la technocratie européenne à l’opportunité de se doter d’une défense digne de ce nom ; c’est pourquoi l’Europe et la France ont inventé les giboulées budgétaires de mars 2025, en faisant subitement pleuvoir du ciel économique, les centaines de milliards d’euros affectés à cette nouvelle priorité alors que durant des années, les critères de moralité économique censés guider les décisions financières des investisseurs institutionnels – les fameux critères ESG – avaient conduit à ostraciser l’industrie d’armement.
Dans une veine analogue, le Commissaire européen de l’Industrie a récemment dévoilé 47 projets d’extraction minière sur le sol européen qui, bien qu’officiellement articulés à la « transition énergétique »[11], portent un nouveau coup de canif aux ambitions de pureté écologique du Green Deal du fait « d’une dimension d’urgence (…) qui n’existait pas il y a trois mois »[12]. On se pince à la lecture de cette « dimension d’urgence » quand on sait la tension chronique sur nombre de matières premières critiques qu’induisent les politiques de surinvestissement dans les divers équipements de la transition énergétique (véhicules électriques, éoliennes, etc.). Et l’on peut se demander ce que vaut le principe même d’une « planification » qu’une succession d’urgences au demeurant très prévisibles s’échine à remettre en cause.
Dernier avatar de cette inconséquence stratégique de la planification : on le sait, existe une tension très forte entre la France et l’Allemagne – pour laquelle est fondamentalement conçu le Green Deal européen – à propos de l’énergie nucléaire. C’est pourquoi la planification française a d’abord prétendu contenir la part du nucléaire dans la production nationale d’électricité à 50 % (loi de 2019) avant qu’un discours du président de la République (mars 2022) consacré par une loi de 2023 ne revienne sur cet objectif, en prévoyant la construction de 6 voire 14 EPR à l’horizon 2050.
En un mot comme en cent, la planification écologique française emprunte moins à la boussole qu’à la girouette. Mais plus encore que son inconséquence, c’est son inanité – la profonde vacuité de ses buts – qui frappe l’esprit.
3. L’inanité de la planification écologique
En « pensant contre soi-même », on pourrait soutenir que certaines modalités de l’interventionnisme public atteignent leurs objectifs : nos dispendieuses politiques sociales sont, par exemple, un facteur de réduction des inégalités de revenus (pour qui trouve cet objectif important). Et la « planification indicative » de l’après-guerre peut se targuer de quelques réussites dont les raisons seraient intéressantes à analyser : il en va notamment de l’électrification de la France dans les années 1950-1960, sous l’égide des « ingénieurs-économistes » qu’influença la pensée économique de Maurice Allais.
Rien de tout cela ne s’applique à la planification écologique, du moins dans son volet climatique. Celle-ci n’est pas de taille à lutter contre le problème qu’elle se propose d’affronter. Ce ne serait pas grave si ses préconisations contribuaient par ailleurs à améliorer nos institutions ou notre tissu économique ; hélas, elles contribueront plutôt à fragiliser ce dernier.
3-1. Inanité du problème :
Rappelons que la neutralité carbone suppose un effort de réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale visant, en calant l’objectif sur la modélisation climatique, à éviter que la température moyenne de la Terre n’augmente de plus d’ 1,5° C par rapport à son niveau pré-industriel. Passons sur le fait constamment ignoré du débat public qu’en décarbonant au rythme exigé par ce seuil des 1,5° C, il n’y aurait encore que 66 % de chances d’atteindre l’objectif, un pourcentage relativement faible au regard des sacrifices économiques demandés à la population mondiale pour y parvenir. Et comme chacun sait, il n’y a en l’espèce pas de « population mondiale » mais une multitude de pays dont les trajectoires de décarbonation sont très disparates, seule l’Union européenne se piquant réellement d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Or, l’Europe ne pèse que 6 % des émissions mondiales et la France, moins de 1 %.
J’ai calculé ce que « rapporterait » cette neutralité carbone européenne au monde, en comparant (très simplement) quelques trajectoires d’émissions à l’horizon 2100. J’obtiens qu’entre une trajectoire d’émissions répliquant le passé récent et le rythme de décarbonation exigé par le Green Deal, l’Europe économiserait environ 69 gigatonnes (Gt) de CO2eq sur les 75 prochaines années, soit environ un tiers de 0,1° C de réchauffement terrestre (soit un impact inférieur à la marge d’erreur des modèles) ; naturellement, la contribution de la France à cet effort serait plus insignifiante encore. Un tel calcul prospectif est bien sûr sensible à toutes les hypothèses, d’autant que peu de notions apparaissent plus spéculatives que celle de « budget carbone » à la base de ces projections. Mais de quelque manière qu’on tourne le problème, l’Europe n’a pas la main sur un problème aussi global que celui du « réchauffement climatique ». Autrement dit, dans son volet prépondérant d’atténuation du changement climatique, la planification écologique ne sert tout simplement à rien ce qu’au demeurant, personne ne conteste (les chiffres sont têtus). On a donc affaire à une sorte de dogme religieux réveillant le surmoi théocratique des « élites » européennes, au mépris de la rationalité la plus élémentaire.
3-2. Inanité des solutions
Pour revenir au cas de la France, il est bon de rappeler qu’en 1990 comme en 2022, notre pays affiche l’un des meilleurs ratios émissions de GES/PIB du monde (le deuxième plus performant parmi les pays grands émetteurs de GES). Il le doit à une transition énergétique réalisée plus précocement que les autres pays et fondée, dès la fin des années 1970, sur la construction (relativement rapide) d’un parc électronucléaire pourvoyant à environ 70 % de notre électricité, aujourd’hui.
L’hostilité doctrinale des mouvements écologiques – et, plus grave, de la Commission européenne – à l’énergie la plus décarbonée au monde (un kilowatt d’électricité nucléaire émet nettement moins de carbone que ce même kilowatt produit par une éolienne ou un panneau photovoltaïque) fait partie des apories majeures de la transition énergétique.
Il ne s’agit d’ailleurs pas d’opposer par principe une énergie nucléaire qui serait parée de toutes les vertus, à des énergies renouvelables qui seraient, au contraire, vouées aux gémonies[13]; à l’instar du débat public en général, la polarisation de la question énergétique ne rend pas justice à sa grande complexité. Approfondir ce sujet dépasserait le cadre de cet article. On se contentera d’en poser les termes généraux : le bon « mix » énergétique est celui qui calcule (et privatise) le coût marginal et les besoins en capitaux de chaque technologie ; qui adapte les solutions retenues aux technologies existantes ainsi qu’à l’état du réseau de distribution ; et qui institue un marché de l’électricité non en vertu de ce que requièrent les conditions d’une « concurrence pure et parfaite » mais de façon à permettre un système d’échanges de droits de propriété privée sur tous les actifs de la production électrique. Aucune de ces conditions ne caractérise l’économie de la production et de la distribution d’électricité, aujourd’hui, en Europe. Il faut donc apprécier la pertinence du mix énergétique européen en tâchant d’évaluer la politique publique dont il procède.
Or, imposer à la France une politique de décarbonation pensée pour l’Allemagne – le tout renouvelable – est absurde à la fois sur le plan écologique et économique. L’électricité renouvelable a ceci d’intéressant qu’elle peut opérer de façon décentralisée (près des sites de consommation) ; elle est bien adaptée aux « réseaux intelligents » (smart grids) dont une innovation technologique majeure – la blockchain – permet l’avènement. Enfin, sa production comme sa distribution peuvent être privatisées. En l’état, cependant, les énergies renouvelables sont conçues en tant que substitut plutôt que complément de l’électricité nucléaire. Or, elles ne sont pas adaptées à la fourniture d’un produit de gros – l’électricité – dont la demande est permanente et l’offre distribuée en flux tendus – passons également sur le fait qu’elles demeurent subventionnées – tout simplement parce qu’elles ne sont pas « pilotables ».
Conclusion
La planification écologique – que l’on doit requalifier de « climatique » – a ceci de navrant qu’elle augmente l’empreinte étatique de la France sans nécessairement réduire son empreinte écologique. Or, l’urgence est dans la réduction de la première, la seconde étant l’une des plus faibles du monde développé.
Il ne s’ensuit pas que la décarbonation soit, per se, une mauvaise chose. Il existe une tendance « naturelle » des économies de marché à décarboner leur production car cela procède d’une quête d’efficience économique qui est consubstantielle à leur fonctionnement. Mais décarboner au rythme de la liberté économique – donc en vertu d’une logique d’épargne et d’innovation – requiert d’autres réformes que celles envisagées par la planification écologique.
Or, l’hubris climatique qui se déploie en Occident depuis la Conférence de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement (1992) met l’accent sur de vaniteux efforts « d’atténuation » du changement climatique dont la logique est technocratique plutôt que libérale. Le coût d’opportunité de ces politiques d’atténuation est considérable, y compris sur le plan environnemental. Par exemple, s’il est vain de prétendre réduire nos émissions de GES à marche administrative forcée, il est en revanche pertinent de s’adapter aux conséquences prévisibles du « réchauffement climatique ». Or, ces conséquences se feront sentir à l’échelle locale. L’adaptation plaide donc pour une autonomisation et une responsabilisation fiscale des collectivités locales, notamment en matière d’infrastructure environnementale. Las, d’un point de vue idéologique, décentraliser la décision publique est nettement moins excitant que de travailler à l’avènement d’un Léviathan mondial qui, au nom du climat, ferait la pluie et le beau temps à sa place.
Terminons sur une dernière aporie de la planification écologique et pas des moindres. Cette planification, on l’a dit, consomme beaucoup d’argent public sous forme de subventions diverses et variées. Cela signifie qu’au travers des différents plans de réindustrialisation annoncés sous la présidence d’Emmanuel Macron – France 2030 et France Relance – des milliards d’euros serviront à cofinancer des usines privées et autres sites de production d’énergies renouvelables. Dans le même temps, la France affiche l’un des taux de prélèvement fiscal sur les entreprises les plus élevés du monde développé : environ 11,2 % du PIB contre 9,2 % en moyenne, en Europe. En ramenant ce taux d’imposition au niveau de la moyenne européenne, les entreprises françaises disposeraient donc d’une cinquantaine de milliards d’euros à investir en partie dans l’efficience et l’innovation énergétiques.
Cela n’aura cependant pas lieu. Car comme l’a écrit feu le Président des États-Unis Ronald Reagan : « les gouvernements ont une vision très sommaire de l’économie. Si ça bouge, taxez. Si ça bouge encore, réglementez. Si ça s’arrête de bouger, subventionnez ». Sinon que cette vision sommaire de l’économie cache un dessein politique lucide, dont la planification est le bras armé : asseoir le contrôle de l’État sur le corps social, au nom d’objectifs transcendantaux dont seule la bureaucratie publique sait interpréter les exigences. Quoi qu’il en coûte, naturellement.
[1] Précisons que les ZFE ne sont pas directement liées au climat. Elles visent à juguler la pollution de l’air par les « particules fines » qu’émettent les pots d’échappement des voitures de fabrication ancienne (dont il s’agit de pénaliser la circulation urbaine). En qualifiant cette disposition législative de loi anti-gueux (https://rebrand.ly/ygrqjfe), l’écrivain Alexandre Jardin lui a porté un coup vraisemblablement décisif.
[2] https://rebrand.ly/deaguiy
[3] J. Pisani-Ferry, S. Mahfouz (2023), « Les incidences économiques de l’action pour le climat », rapport de France Stratégies, mai, https://rebrand.ly/qnvt0yn.
[4] Sur la distinction entre droit et réglementation, voir F. A. Hayek, Droit, Législation et Liberté, Libre Échange, PUF, 1981.
[5] Concernant cette évaluation, le lecteur pourra ça et là trouver d’autres chiffres, concordants sans être identiques. Cela vient de ce que la quantification des émissions de GES est compliquée et, surtout, de ce que leur réduction (en France comme en Europe) est plus forte entre 1990 et 2020 qu’entre 1990 et 2022 – du fait de l’impact économique de la crise Covid-19 – ce qui complique encore le tableau général.
[6] https://rebrand.ly/qnd8vtq.
[7] Voir P. Charlez (2024), La transition énergétique est-elle soutenable ? Institut Sapiens.
[8] Voir https://rebrand.ly/85umgp6.
[9] CSRD, https://rebrand.ly/olzebdf.
[10] CS3D, https://rebrand.ly/zltxk9h.
[11] https://rebrand.ly/0fc5d7
[12] https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/l-europe-devoile-son-plan-pour-ouvrir-des-mines-sur-son-sol-et-les-47-sites-retenus-1021378.html
[13] Pour une critique intéressante du « tout nucléaire » voir D. Husson, Climat : de la confusion à la manipulation, L’Artilleur, 2024, chapitre 12.