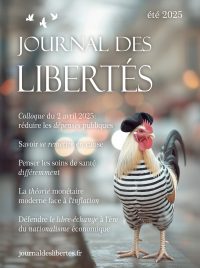1. Introduction
La Théorie Monétaire Moderne (TMM) a gagné en visibilité dans les cercles universitaires et politiques, en affirmant que les États souverains, émetteurs de leur propre monnaie, ne font face à aucune contrainte financière intrinsèque. Pour ses partisans, les déficits publics ne sont problématiques que lorsqu’ils provoquent de l’inflation (Kelton, 2020, p. 42). Tant que des ressources (travail, capital, capacité productive) restent inutilisées, la dépense publique peut et doit s’amplifier.
Dans ce cadre, la « stabilité des prix » devient la seule limite légitime à l’action budgétaire. Si les prix restent stables, un déficit ne peut être jugé excessif. Cette idée a gagné du terrain, notamment à la suite de la crise de 2008, et a été pleinement mobilisée lors de la pandémie de Covid-19. La hausse de l’inflation depuis 2022 semble néanmoins marquer un tournant, exactement comme le voudrait une lecture attentive de la TMM. L’inflation des prix est le signal d’alarme.
La TMM reconnaît ce risque : dès que l’économie approche de sa capacité maximale, elle recommande des mesures pour éviter l’emballement des prix, comme des hausses d’impôts ou des réductions de dépenses ciblées. Ainsi, la TMM ne nie pas les dangers de l’inflation ; elle les replace simplement dans un cadre où la priorité politique n’est plus la discipline budgétaire, mais la mobilisation des ressources réelles.
Cependant, cette vision repose sur une hypothèse implicite majeure : que l’inflation est une donnée observable, mesurable et contrôlable en temps réel. C’est précisément cette hypothèse que la tradition autrichienne remet en question. Car si l’inflation ne peut être identifiée avec précision, elle ne peut non plus constituer une borne crédible pour guider la dépense publique. L’enjeu de cet article est donc d’examiner cette faiblesse structurelle du raisonnement de la TMM à la lumière des enseignements de l’école autrichienne.

2. La mesure de l’inflation : entre construction statistique et réalités vécues
Dans une économie monétairement souveraine, selon la TMM, la seule limite à la dépense publique est l’inflation. Dès lors que les prix commencent à s’emballer, l’État doit réagir par des hausses d’impôts, une baisse des dépenses ou d’autres formes de contraction budgétaire. Mais cette mécanique suppose que l’inflation peut être mesurée de manière fiable, en temps réel, et qu’elle constitue un signal homogène, pertinent pour orienter l’action publique.
C’est précisément cette hypothèse que remet en cause la tradition autrichienne, notamment à travers l’analyse de Gottfried Haberler. Dans son ouvrage de 1927, Der Sinn der Indexzahlen, Haberler démontre que le « niveau général des prix » n’est pas une donnée objective, mais une construction statistique. La valeur informative des indices de prix comme ceux de Laspeyres ou de Paasche repose sur une série d’hypothèses rarement réunies en réalité : préférences constantes, disponibilité de tous les biens durant toute la période considérée, stabilité des qualités, conditions de libre-échange sur tous les marchés. Or, dans le monde réel, tout change en permanence : les goûts évoluent, de nouveaux produits apparaissent, d’autres disparaissent, les arbitrages des consommateurs se modifient, et de nouvelles interventions des gouvernements entravent le libre-échange.
Toute tentative de mesurer l’inflation repose en pratique sur une série de conventions : composition du panier de consommation, pondération des biens, fréquence des mises à jour, intégration des nouveaux produits, ajustements pour qualité. Ces choix techniques, loin d’être neutres, influencent sensiblement les résultats. Les ajustements dits hédoniques, appliqués notamment aux produits technologiques, tendent à neutraliser certaines hausses de prix imputées au progrès technique, tout en négligeant souvent les dégradations plus subtiles (durabilité, réparabilité, ergonomie). Ce déséquilibre peut introduire un biais structurel à la baisse dans les mesures officielles de l’inflation (Israel et Schnabl, 2024).
Mais le problème ne se limite pas à des questions méthodologiques. Il tient aussi à la nature fondamentalement subjective de l’expérience de l’inflation. Rothbard (1997) insiste sur le fait que les préférences sont individuelles, contextuelles, et non comparables d’un agent à l’autre. Un indice de prix repose nécessairement sur une agrégation qui gomme ces différences. Or, dans une société hétérogène, il n’existe pas de panier de consommation « moyen » qui refléterait fidèlement la réalité de tous.
Cette diversité est particulièrement manifeste lorsqu’on examine l’effet différencié de l’inflation selon les catégories de revenu. Un ménage modeste, dont les dépenses sont concentrées sur les biens de première nécessité (alimentation, énergie, logement), subira plus durement une hausse de prix sur ces postes qu’un ménage aisé, dont le budget est plus diversifié. Si les produits haut de gamme ou les services spécialisés voient leurs prix stagner ou même baisser, tandis que les produits de base flambent, l’indice moyen pourra rester stable, alors même que les ménages vulnérables s’appauvrissent.
Plus encore, la substitution de biens est souvent interprétée dans les statistiques comme un signe d’adaptation rationnelle. Si un consommateur délaisse les produits bio pour acheter des produits industriels moins chers, l’indice suivra son nouveau panier, sans prendre en compte la perte de qualité ou de satisfaction. L’adaptation est comptabilisée, mais la dégradation du niveau de vie ne l’est pas. Cela constitue un angle mort majeur des approches fondées sur les indices de prix.
Des études empiriques récentes confirment cette critique en montrant que les politiques monétaires expansionnistes ont des effets distributifs marqués. Au Japon, par exemple, les détenteurs d’actifs ont profité d’une hausse de la valeur de leur patrimoine, tandis que les revenus du travail stagnaient et que l’épargne des ménages modestes s’érodait (Israel et Latsos, 2020 ; Israel et al., 2022 ; 2023). L’inflation ressentie est donc inégalement répartie, et l’indice global ne reflète pas ces écarts.
Ces constats posent un défi majeur à la TMM. Si l’inflation est vécue de manière hétérogène et mesurée de façon incertaine, elle ne peut constituer un repère fiable pour déclencher une consolidation budgétaire. L’idée que l’État pourrait suivre une jauge d’inflation agrégée pour piloter la politique économique relève d’un optimisme méthodologique discutable. Elle suppose une capacité d’observation fine et immédiate que les instruments statistiques ne permettent pas.
En somme, la critique autrichienne n’ignore pas le phénomène inflationniste. Elle en souligne au contraire la complexité, la diversité et l’irréductibilité à une mesure unique. L’inflation n’est pas une simple augmentation moyenne des prix ; c’est une transformation continue des structures relatives de prix, de la qualité de vie, des comportements de consommation. En prétendant réguler l’inflation à partir d’une moyenne agrégée, la TMM néglige ces dynamiques profondes et risque de fonder ses décisions sur des signaux trompeurs.
3. L’illusion du contrôle politique de l’inflation
La TMM accorde un rôle central à l’inflation : c’est elle qui délimite le champ de la dépense publique légitime. En période de sous-utilisation des capacités économiques, l’État peut dépenser sans contraintes. Dès que l’inflation apparaît, il doit réagir : ajuster les impôts, réduire certaines dépenses, ou mettre en place des mécanismes de désinflation. Ce raisonnement est clairement exposé par Mosler (2010), Wray (2015) et Kelton (2020), qui insistent sur le fait que l’inflation constitue la seule vraie contrainte opérationnelle à laquelle doit se plier une politique monétaire ou budgétaire ambitieuse.
Toutefois, cette mécanique suppose que les autorités publiques sont en mesure non seulement d’observer l’inflation de manière fiable, mais aussi d’y répondre rapidement, efficacement et sans coûts politiques excessifs. Or, cette hypothèse repose sur une vision idéalisée du fonctionnement politique. Comme l’a montré l’école du Public choice, notamment à travers les travaux de Buchanan et Tullock (1962), les responsables publics agissent dans un contexte d’incitations électorales, de cycles politiques et de pressions d’intérêts. Ils ne sont pas des techniciens neutres, mais des acteurs soumis à des contraintes institutionnelles, médiatiques et partisanes. Dans ce cadre, l’ajustement rapide et rationnel des politiques budgétaires en réponse à l’inflation relève souvent de la fiction.
L’expérience empirique récente l’illustre clairement. Lorsque l’inflation s’est accélérée à partir de 2021–2022, de nombreuses banques centrales ont tardé à réagir, qualifiant le phénomène de « transitoire ». Les gouvernements, de leur côté, ont souvent refusé d’engager des politiques budgétaires restrictives, de peur d’affaiblir la reprise économique ou de mécontenter certaines catégories d’électeurs. Cette inertie est structurelle : les hausses d’impôts et les coupes budgétaires sont impopulaires, et peu compatibles avec les cycles électoraux.
Cette dynamique a une implication directe pour la TMM. Si l’inflation n’est pas seulement un phénomène économique, mais aussi un enjeu politique, alors sa régulation ne peut être traitée comme un simple mécanisme de rétroaction automatique. La croyance dans une autorité publique qui ajuste rapidement les impôts dès que l’inflation s’installe repose sur une hypothèse « héroïque » au sens où elle ignore les délais, les blocages institutionnels et les préférences électorales. Comme l’a souligné Milton Friedman (1961), les politiques économiques – en particulier monétaires et budgétaires – souffrent de décalages temporels importants entre le moment où un problème apparaît, celui où une décision est prise, et celui où ses effets se matérialisent. Ces délais réduisent considérablement l’efficacité des ajustements en temps réel.
De plus, même si les gouvernements agissaient rapidement, encore faudrait-il que les instruments mobilisables soient suffisamment précis. Or, les hausses d’impôts ou les baisses de dépenses ne touchent pas de manière uniforme les secteurs ou les groupes sociaux responsables des pressions inflationnistes. Par exemple, si l’inflation est alimentée par une hausse des prix de l’énergie ou des biens importés, augmenter les impôts sur les revenus du travail ne produira qu’un effet limité, tout en accentuant le mécontentement social.
Cette asymétrie des outils de politique budgétaire contraste avec la finesse théorique du mécanisme de régulation imaginé par la TMM. Dans la pratique, il est rare que les gouvernements disposent d’instruments suffisamment ciblés pour ajuster efficacement la demande globale sans provoquer de dommages collatéraux importants. La politique budgétaire, par définition, est lente à modifier, soumise au calendrier parlementaire, et fortement conditionnée par des considérations politiques.
La tradition autrichienne apporte ici une critique décisive. Pour Ludwig von Mises (1949), toute tentative de régulation macroéconomique fondée sur des agrégats cache les mécanismes réels à l’œuvre dans l’économie. Ce ne sont pas les masses monétaires ou les indices de prix qui déterminent les décisions économiques, mais les signaux transmis par les prix relatifs. Or, l’intervention politique perturbe ces signaux : elle introduit du bruit, retarde les ajustements nécessaires, et alimente les distorsions.
En d’autres termes, l’inflation n’est pas un phénomène linéaire et aisément maîtrisable, mais le résultat complexe d’une désorganisation du système de coordination par les prix. La réponse ne peut pas être centralisée et mécanique : elle suppose une compréhension fine des structures productives, des incitations et des arbitrages des acteurs économiques. Cette analyse va à l’encontre de la conception fonctionnaliste que la TMM propose de l’État, vu comme un gestionnaire rationnel d’une économie largement contrôlable.
De plus, la tradition autrichienne insiste sur le rôle des institutions dans la stabilité monétaire. Hayek, dans The Road to Serfdom (1944), rappelle que plus l’État intervient dans l’économie, plus il devient difficile d’en mesurer les effets et d’en maîtriser les conséquences. L’inflation devient alors non seulement un risque économique, mais aussi un symptôme d’un affaiblissement des mécanismes d’ajustement spontané du marché. La solution, selon cette perspective, ne réside pas dans une meilleure gestion de l’inflation par l’État, mais dans une réduction de l’emprise étatique sur les mécanismes de formation des prix.
Enfin, la promesse de la TMM – à savoir, utiliser la dépense publique comme levier central de la politique économique, tout en gardant l’inflation sous contrôle – revient à confier une double mission contradictoire à l’État : celle de stimuler la demande sans excès, tout en régulant cette demande dès que des tensions apparaissent. Une telle posture demande un niveau de réactivité, de précision et de neutralité institutionnelle que les démocraties réelles, traversées par des conflits d’intérêts et des rapports de force, ne peuvent offrir.
4. Conclusion
La Théorie Monétaire Moderne se veut une rupture dans la manière de concevoir les finances publiques : elle rejette la peur des déficits et place l’inflation au centre des préoccupations. L’État, selon cette vision, n’est pas contraint par un budget équilibré mais par la disponibilité des ressources réelles. Dès lors que l’inflation menace, il lui suffit d’agir – en relevant les impôts ou en réduisant les dépenses – pour maintenir la stabilité. C’est là une proposition séduisante, notamment en période de stagnation ou de crise.
Mais cette architecture repose sur des fondations instables. Comme l’a montré la tradition autrichienne, l’inflation n’est ni un phénomène univoque, ni un indicateur simple à observer et à interpréter. Elle reflète des dynamiques complexes de prix relatifs, de qualité perçue, de comportements d’ajustement, de niveaux de vie différenciés. La prétention à la réguler via des instruments macroéconomiques fondés sur des agrégats statistiquement fragiles relève d’un technocratisme illusoire.
Plus encore, l’idée que l’inflation serait efficacement maîtrisable par des gouvernements agissant rationnellement et rapidement est démentie par l’économie politique réelle. L’inertie institutionnelle, les coûts électoraux des mesures impopulaires, et les délais d’ajustement rendent improbable une régulation réactive, comme celle que suppose la TMM. Ce décalage entre le modèle et le monde réel rend ses recommandations risquées, voire contre-productives. La TMM suppose un État omniscient, bienveillant, agile – autant d’hypothèses difficilement compatibles avec la réalité des démocraties contemporaines. Elle sous-estime les effets distributifs, les distorsions structurelles et les risques d’instabilité qu’engendrent des politiques monétaires et budgétaires trop expansionnistes.
Reconnaître les limites de la TMM, c’est affirmer qu’une politique économique responsable doit s’ancrer dans la complexité du réel, et non dans la promesse de solutions simples. La vigilance face à l’inflation, la prudence dans l’utilisation de l’outil budgétaire, et le respect des signaux du marché restent des repères essentiels pour toute stratégie de long terme.
Bibliographie
Buchanan, J.M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. University of Michigan Press.
Friedman, M. (1961). “The Lag in Effect of Monetary Policy,” Journal of Political Economy, 69(5), 447–466.
Haberler, G. (1927). Der Sinn der Indexzahlen. Tübingen: Mohr.
Hayek, F.A. (1944). The Road to Serfdom. University of Chicago Press.
Israel, K.F., & Latsos, S. (2020). “The impact of (un) conventional expansionary monetary policy on income inequality–lessons from Japan,” Applied Economics, 52(40), 4403–4420.
Israel, K.F., Sepp, T.F., & Sonnenberg, N. (2022). “Japanese monetary policy and household saving,” Applied Economics, 54(21), 2373–2389.
Israel, K.F., & Schnabl, G. (2024). “Alternative measures of price inflation and the perception of real income in Germany,” The World Economy, 47(2), 618–636.
Israel, K. F. (2024). “Gottfried Haberler’s Contributions to the Theory of Index Numbers: A Blueprint for Revealed Preference Theory.” IREF Working Paper No. 2024-03.
Kelton, S. (2020). The Deficit Myth. PublicAffairs.
Mises, L. von (1949). Human Action. Yale University Press (repr. 1998, Mises Institute).
Mosler, W. (2010). The 7 Deadly Innocent Frauds of Economic Policy. Valance Co Inc.
Rothbard, M.N. (1997 [1956]). “Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics.” In The Logic of Action One, Edward Elgar. Wray, L.R. (2015). Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. Palgrave Macmillan.