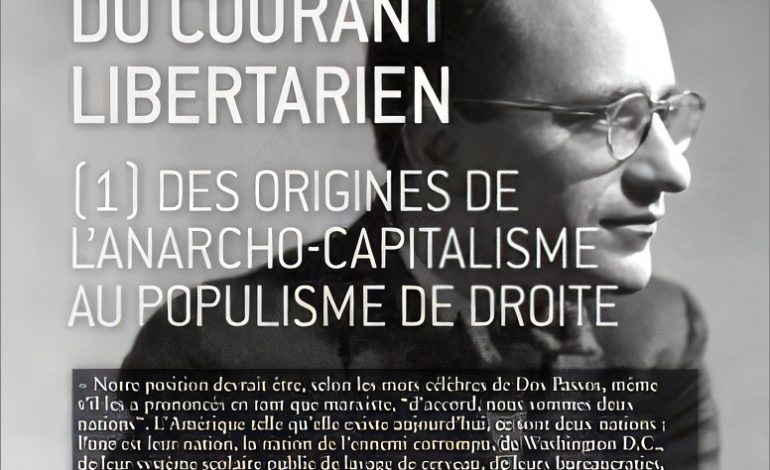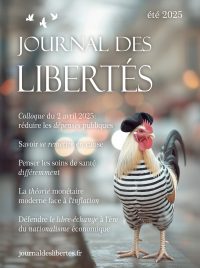Après la publication en 2015 du livre de philosophie des sciences économiques de Deirdre N. McCloskey, Les péchés secrets de la science économique, ces mêmes éditions proposent aux lecteurs francophones un autre livre de Deirdre N. McCloskey, Laissez-moi faire et je vous rendrai riche[1]. Ce livre est écrit avec le professeur Art Carden de l’université de Samford aux Etats-Unis. Art Carden est aussi membre de l’American Institute for Economic Research, du Fraser Institute ou l’Independent Institute. Éditer ce livre de 306 pages et 26 chapitres est une bonne idée, car il est une sorte de synthèse des trois très volumineux livres de Deirdre McCloskey, The Bourgeois Era (2006, 2010, 2016) qui montraient comment la liberté et la dignité bourgeoise avaient enrichi le monde et l’enrichissent encore. Cette recension propose de présenter un bref rappel de la thèse de Deirdre McCloskey et de résumer les trois principales propositions du livre. La première proposition est que le monde, contrairement à ce que prétendent tous les catastrophismes, tous les pessimistes, s’améliore (Partie 1. La pauvreté en fuite). La seconde proposition est qu’il ne continue pas de s’améliorer parce que les États planifient, subventionnent les industries et/ou garantissent les droits de propriété (Partie II. Les causes de l’enrichissement ne sont pas celles que vous croyez). Mais parce qu’un consensus minimum s’est constitué autour de l’éthique du commerce, des vertus bourgeoises (Partie III. Il s’est produit parce que les idées, l’éthique, la rhétorique et l’idéologie ont changé). C’est la troisième proposition défendue dans ce livre.
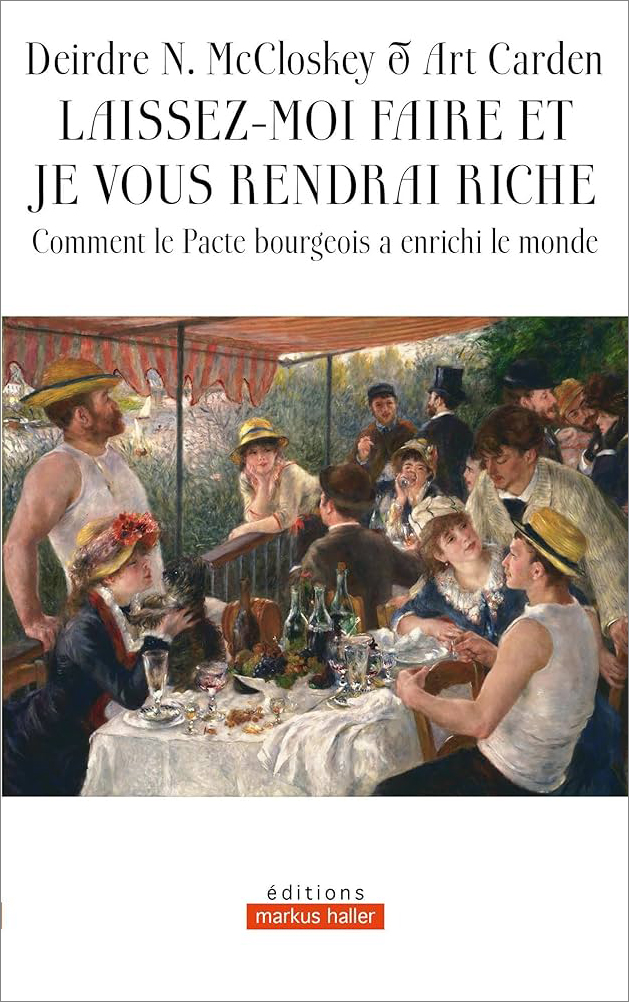
Les vertus bourgeoises
Bien que les bourgeois aient participé à l’effondrement de la féodalité et de la monarchie et à la disparition de ses privilèges, ce qu’ils représentent, et les valeurs qu’ils défendent sont critiquées, voire honnies. Le héros de McCloskey est Adam Smith et sa Théorie des sentiments moraux. Le grand enrichissement n’est pas fondamentalement la conséquence du progrès technique ou de la garantie des droits de propriété, mais plutôt de la diffusion dans le corps social d’une éthique construite autour d’un certain nombre de vertus, c’est-à-dire, de dispositions du caractère qui aident chaque individu à réaliser ses fins. Ces vertus sont les vertus bourgeoises. Ces vertus aident chacun à s’enrichir. Elles donnent les qualités morales qui conditionnent la confiance des employés vis-à-vis de leur patron et la volonté inébranlable des entrepreneurs de réaliser leur projet pour eux-mêmes bien évidemment, mais aussi pour le bonheur du plus grand nombre. Parmi ces vertus bourgeoises, il y a la modération, l’écoute, le sens de la justice, le courage, l’amour, la foi, l’espérance, mais aussi la prudence d’acheter bon marché et de vendre plus cher – c’est ainsi, nous explique Israel Kirzner ([1973] 2005), que l’entrepreneur réalise des profits d’arbitrage qui jouent un rôle essentiel dans la coordination marchande.
Lorsque prévalent ces vertus bourgeoises il est possible de diffuser ce message d’optimisme : Laissez-moi faire et je vous rendrai riche. Il n’y a pas à s’inquiéter sur l’avenir tant que le pacte bourgeois continue d’inspirer le monde et les principaux dirigeants de la planète. En revanche, ce qui peut menacer le monde et l’humanité c’est le pessimisme, la peur, la crainte des catastrophes ; les Cassandre qui annoncent le pire pour se rendre intéressants. C’est contre ces Cassandre que Deirdre McCloskey et Art Carden rédigent les onze premiers chapitres de la première partie du livre. Il s’agit de montrer que tous les pessimistes sont dans l’erreur, que leurs croyances sont mal fondées voire infondées.
Contre toutes les formes de pessimisme ; les anciens pessimismes comme les nouveaux
McCloskey et Carden critiquent le bien-fondé de sept vieux pessimismes et de trois nouveaux pessimismes. Les sept vieux pessimismes sont listés au chapitre 8 (p. 98) qui fait une sorte de synthèse des sept chapitres précédents, car l’une des caractéristiques de la première partie du livre est la répétition. Les trois jeunes pessimismes sont le catastrophisme environnemental, les inégalités extrêmes et l’intelligence artificielle (Chapitre 9 Aucun des trois nouveaux non plus). La principale leçon est alors qu’il faut rester optimiste. Cet optimisme gardant à l’esprit ce principe « pour s’améliorer, le monde a intérêt à préserver son sens de l’éthique » (Chapitre 10).
Le premier pessimisme est celui de Malthus. Les pauvres sont condamnés à rester pauvres. Le second pessimisme est que seuls les Européens sont génétiquement capables de sortir de la pauvreté à 3 dollars par jour. Le troisième pessimisme est marxiste. Il annonce la crise finale du capitalisme via des analyses erronées des grandes crises (1929, 1933, 1974, 1990 et évidemment 2008). Le quatrième pessimisme est néokeynésien. Il installe l’idée de la stagnation séculaire, de la fin de la croissance. Le cinquième pessimisme est sociologique et moral. Il pense que le consumérisme a corrompu l’humanité qui y a perdu son âme. Le sixième pessimisme est tiersmondiste. Les pays centraux s’enrichissent grâce à l’exploitation des pays périphériques, du sud global. Le septième pessimisme est décliniste. Les États-Unis et les pays de l’Union européenne sont condamnés au déclin, au recul dans le classement des nations lorsqu’elles sont hiérarchisées sur la base de leur production intérieure brute par habitant. La sentence est radicale. Pour McCloskey et Carden (2025, p. 98) « aucune de ces prédictions pessimistes ne s’est avérée. Pas une seule, jamais ».
Aux sept vieux pessimismes qui continuent d’inspirer l’intelligence éclairée avant d’être réfutées, tout aussi régulièrement, par l’histoire et l’économie, se sont récemment ajoutés trois nouveaux pessimismes : la dégradation de l’environnement, les inégalités extrêmes et l’intelligence artificielle (Chapitre 9 p.103).
Pour réfuter les thèses de l’écologie politique McCloskey et Carden mobilisent trois auteurs : Julian Simon ([1965] 1985 ), Matt Ridley (2011 ) et Ronald Bailey (2015 ). La mobilisation de ces trois ouvrages est cohérente avec le propos des auteurs. L’ouvrage de Julian Simon inspire largement la doctrine de la free ecology. Matt Ridley partage avec McCloskey et Carden deux de leurs thèses principales. Le monde va mieux aujourd’hui qu’hier. L’échange a permis cette amélioration de la condition humaine. Ridley (2011) soutient, en effet, après une longue fresque de l’histoire de l’humanité que ce qui a permis à l’espèce humaine d’améliorer sa condition est l’échange. L’échange est source d’efficience, mais aussi d’innovation et de spécialisation. On retrouve la manufacture d’épingle, les vertus de la division du travail de Smith, le héros de McCloskey et Carden. Pour Ridley la spécialisation est l’essence de l’humanité alors que l’autosuffisance est son pire cauchemar. L’autarcie est le retour assuré à l’âge de pierre. Cela ne signifie pas qu’il n’y est pas de difficultés et que l’histoire des hommes soit un « long fleuve tranquille ». Elle est marquée par des périodes d’essor et des périodes de stagnation et de crises. Mais l’optimisme croît qu’il s’agit de turbulences dans un économie prospère et non de la fin du monde. Car la cible de Ridley est la même que celle de McCloskey et Carden, les catastrophistes. Tous ceux qui pensent que « tout va de mal en pis ».
Comme McCloskey et Carden le soutiennent dans les 11 premiers chapitres de leur livre il y a plutôt dans le monde moins de pauvreté, moins d’esclaves (p.33, p.45), moins de guerres (p.36), moins d’analphabètes (p.71), moins de crimes (p.67), moins d’enlèvements d’enfants (p.68), plus d’instruments de musique (p.69), plus de livres écrits et vendus (Chapitre 5), plus d’hygiène, une nourriture digne des rois d’autrefois (p.71), les droits des femmes et des minorités LGBT sont mieux respectés (p.47), l’espérance de vie est plus longue, les catastrophes naturelles sont mêmes moins meurtrières (p.66) et finalement on peut affirmer que le bilan environnemental s’est amélioré, grâce à la réglementation et aux progrès du commerce (Chapitre 5 Rosling 2019). Le réchauffement climatique et l’origine humaine de ce dernier sont indéniables, mais cela ne doit pas conduire au catastrophisme. L’évolution du climat va bien réduire le rythme du développement économique, car il faudra engager des ressources pour s’y adapter, mais cela ne va pas casser la croissance économique. Car il n’y a pas de limites environnementales à la croissance. La croissance n’étant pas assise sur les ressources naturelles mais sur les qualités de créativité, d’imagination, sur l’intelligence de l’homme (Simon [1965] 1985, McCloskey et al. 2025, p.90).
L’autre catastrophisme est l’idée que les sociétés modernes et les États-Unis en particulier seraient vouées à connaître d’extrêmes conflits sociaux du fait de la montée des inégalités. McCloskey et Carden abordent ici un problème classique de la science économique, la juste répartition des richesses. Les deux auteurs doutent comme toute la tradition du Public Choice que les politiciens soient les mieux placés pour garantir une société juste. Ils placent alors le débat sur l’envie (p.104). Le problème n’est pas de s’irriter que d’autres soient mieux pourvus, mais d’atteindre un bon niveau de vie. Il est sans importance qu’un sportif gagne des millions. Il est éthiquement navrant en revanche que près de 10% des êtres humains vivent avec moins de 1,9 dollar par jour. Ce sont les revenus absolus, et non relatifs, qui importent d’un point de vue éthique (p.104).
Le dernier pessimisme à la mode serait la destruction du travail, des emplois par l’intelligence artificielle (p.106-109). L’argument ici est classique, ce n’est pas le capitalisme qu’il faut attaquer mais le progrès. Craindre l’amélioration technique, le progrès, c’est nuire aux pauvres car les pauvres sont les principaux bénéficiaires du grand enrichissement. Il est certain que les nouvelles technologies détruisent des emplois, mais il est vrai aussi qu’elles en créent. L’intelligence artificielle c’est comme le chemin de fer, le moteur à explosion ou l’électricité c’est un progrès. Elle va devenir « l’assistant de recherche le plus efficace du monde » sans devenir « jamais le meilleur chercheur du monde » (p.109 citation de Joel Mokyr 2018 ).
La principale leçon de cette première partie est donc que « le monde continue de s’améliorer. Laissons-le faire » (p.48) et que pour « s’améliorer, le monde a intérêt à préserver son sens de l’éthique » (Chapitre 10), ses vertus bourgeoises qui célèbrent une vie au-delà de la richesse et qui finalement ont été théorisées par le vrai libéralisme (Chapitre 11). Pour que le monde continue de s’améliorer il faut le protéger contre tous ceux qui veulent détruire le capitalisme autrement dit ce régime « de la propriété privée et du travail libre sans planification centrale, régulés par l’État de droit et un consensus éthique » (p.123). Il faut en quelque sorte dresser devant le catastrophisme un pare feu, l’exaltation du capitalisme (p.123). Un capitalisme qui n’est pas associé au mal, à la cupidité, mais à la créativité, à l’innovation et surtout à l’éthique du commerce. Toute la seconde partie du livre tente de montrer que la meilleure explication du grand enrichissement qui a sorti l’humanité de la misère est ce consensus éthique, la généralisation des vertus bourgeoise. Il s’agit de montrer que toutes les autres explications échouent à rendre compte du grand enrichissement (Partie II Les causes de l’enrichissement ne sont pas celles que vous croyez).
Contre les explications traditionnelles du grand enrichissement
La seconde partie de l’ouvrage est plus académique. Elle est l’occasion de faire un tour d’horizon des grandes théories du développement en présence et de préparer la défense de l’explication du grand enrichissement par la généralisation de l’éthique du commerce (Partie III et Partie IV Conclusion). L’occident et l’Europe en particulier ne se sont pas enrichis grâce à la guerre (Chapitre 12), au chemin de fer, aux ressources naturelles (charbon), à la garantie des droits de propriété (Chapitre 14), à la culture de la frugalité et au capitalisme (Chapitre 15 et Chapitre 13), à l’école et à la science (Chapitre 16), à l’impérialisme (Chapitre 17 Ce n’est pas l’impérialisme), à l’esclavage (Chapitre 18 ni l’esclavage), à l’action syndicale et des administrations publiques (Chapitre 19 Pas plus que l’esclavage salarié n’a été supprimé par les syndicats et par la réglementation), à sa conversion au christianisme (p.243), à la démocratie fort sélective de l’Athènes classique (p.243), etc. Les plus aguerris en théorie économique reconnaissent derrière chaque proposition un auteur ou une école de pensée.
McCloskey et Carden commencent par critiquer la thèse de l’historien conservateur, selon leur terminologie, Niall Ferguson (2020) qui dans son livre Civilisations : l’occident et le reste du monde défend que le grand enrichissement est la conséquence de plusieurs idées géniales : le droit de propriété, l’éthique du travail, la société de consommation, la concurrence, la médecine moderne et la science. McCloskey et Carden pensent que tous ces facteurs sont éminemment désirables, mais qu’ils n’expliquent par l’invention en Europe du développement économique.
Le plus surprenant est le refus de soutenir que la propriété ait un effet sous l’argument suivant. « Toutes les sociétés ont bénéficié de droits de propriété efficaces – lesquels, soit dit en passant, ne requièrent nullement un État-Léviathan, puisque sans ces droits, il ne s’agit plus d’une société mais d’une guerre de tous contre tous » (p.127).
Plus cohérents vis-à-vis de la doctrine libérale, les deux auteurs défendent l’idée que l’esclavage (p.129) et la colonisation (p.130) (empire) ont plutôt été à l’origine de la stagnation de l’Europe et des empires que de leur essor. Le Chapitre 13 propose de remplacer le mot capitalisme par le mot innovisme afin de dissocier développement et capitalisme, c’est-à-dire développement et accumulation du capital. Comme à chaque fois l’argument est de nature chronologique, Rome avait des droits de propriété et accumulait d’importantes richesses et pourtant, Rome n’a pas inventé le développement économique (p.137). On retrouve cette même position au chapitre 15 (ni à la frugalité ni au « capitalisme »). Ce chapitre est l’occasion d’une critique des positions de Ludwig von Mises et du rôle finalement que les économistes classiques accordent à l’épargne (p.155).
L’éducation n’est pas non plus cette poudre magique qui arrache l’homme à sa condition (p.165 Chapitre 16 ni l’école ni la science n’ont été la poudre magique). L’innovation, les nouvelles technologies sont bien favorables à la croissance de la production, mais il ne faut pas surestimer le rôle des scientifiques dans le nombre des améliorations cruciales des techniques de production. Le béton de masse, le béton armé, les freins à air comprimé, les ascenseurs, les marchés d’actifs, la logistique du commerce de détail, les entrepôts à forte rotation des stocks, le charbon de bois, l’acier, les lunettes, etc. sont des innovations entrepreneuriales qui ne doivent rien à la science. Il est même de nombreuses situations où la science s’inspire des machines (p.167). L’argument est de même nature lorsqu’il s’agit d’affirmer que l’amélioration de la condition ouvrière (temps de travail, cadence, salaire, etc.) n’est que marginalement la conséquence des luttes dites sociales, de l’action des syndicats et des organisations ouvrières (p.187). Ni les lois ni les grèves n’augmentent le salaire réel. L’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre est la conséquence de la généralisation des échanges, de l’éthique du commerce.
Le ressort ne tient donc pas au capital accumulé, à de vieilles institutions, à la présence de charbon exploitable ou autres prétendues nécessités, mais au « vaste et noble plan d’égalité, de liberté et de justice de Smith » (p.158 et Chapitre 26 C’est alors que du pacte bourgeois/ Adam Smith les vertus révéla). C’est ce que défendent les parties III et IV du livre.
Grand enrichissement et réhabilitation morale du commerce
Le grand enrichissement de l’Europe devient la conséquence de la réhabilitation morale du commerce (Chapitre 21 A vrai dire, ce sont l’éthique et la rhétorique qui ont changé). C’est parce que les vertus bourgeoises se sont généralisées dans le corps social que l’Europe a sorti le plus grand nombre de la pauvreté. Leur méthode pour convaincre de la pertinence de leur position est l’histoire des idées ou plutôt l’histoire de la littérature. Ils décrivent à la fois l’évolution des mots, mais aussi la manière dont les bourgeois, les commerçants sont qualifiés dans les arts et les lettres, les romans, les nouvelles, les essais philosophiques, etc. Ils développent bien une théorie idéologique de la transformation sociale et économique. Ils laissent voir le mépris que les aristocrates, les élites d’anciens régimes avaient vis-à-vis des commerçants (p.209). Mais aussi leur réhabilitation (p.211) et le rôle central que jouent les dissidents dans l’évolution des normes, de l’éthique sociale qui relève n’ont pas de la philosophie morale des individus, mais du consensus social, le langage créant les significations (p.213). Le consensus moral évolue et pour s’en convaincre, il suffit de suivre la définition des mots, car « les idées changent et les mots reflètent ce changement » (p.221). L’économie est bien pilotée par l’idéologie (p.239). Le chapitre 22 (l’honnêteté n’est plus ce qu’elle était) applique cette méthode aux mots : honnête (p.216-220), vrai, innovation (p.220) et nouveauté (p.221). Les deux auteurs présentent les définitions des dictionnaires et leur usage dans les grandes œuvres de la littérature européenne dans différentes langues (anglais, espagnol, néerlandais, français). Le mot bonheur est le sujet du Chapitre 23 (Et le bonheur même a changé). Le grand enrichissement devient ainsi la conséquence de la lecture, de la réforme, de la révolte et de la révolution, mais aussi du hasard qui aurait joué un rôle majeur.
Conclusion
Le livre de McCloskey & Carden ne laisse pas indifférent, car il a de la malice, de la provocation, il est d’une grande érudition. L’édition proposé par la maison Markus Haller est aussi très soignée, ce qui en facilite la lecture. Il porte, cependant, des thèses qui sont parfois affirmées et non démontrées et qui peuvent dérouter le camp des libéraux comme celui des socialistes, des écologistes et des dirigistes. Lorsque l’on sait que McCloskey est post-moderne on comprend les nombreuses attaques dont fait l’objet Donald Trump. Trump est qualifié d’étatiste, comme Elisabeth Warren (p.25), menacé par le culte du moi qui fait de lui-même une sorte de petit dieu (p.264). Les deux auteurs se dressent finalement contre tout le monde. Seul Smith trouve finalement grâce à leurs yeux. On peut évidemment regretter qu’il n’y ait aucune trace d’auteurs français contemporains et plus généralement aucune discussion de fonds sur la théorie économique. L’argument se veut chronologique. Il n’est pas possible d’expliquer le grand enrichissement par tel ou tel facteur car ce facteur existait déjà et n’a pas été à l’origine du grand enrichissement (mais « ce qui existe déjà » peut être une illusion lexicale : on appelle « droit de propriété » ce qui existe dans la Rome antique et ce que consacre les constitutions modernes. Mais sont-ce les mêmes notions ? Implicitement, cela implique que les normes de droit sont les mêmes selon les époques. Or, le droit romain ne connaît pas l’individualisme et le droit de propriété contemporain est individuel). Mais un facteur peut exister en tant que germe, il existe mais n’a pas encore pris toute son importance. L’argument chronologique est utilisé en particulier pour écarter les explications par la conversion au christianisme, les droits de propriété et l’empire. Cela s’entend mais exigerait quelques approfondissements car dire, par exemple, que le régime de propriété des Romains était efficace alors qu’il justifiait l’esclavage ou ne pas distinguer le régime de la propriété féodale du régime de propriété de l’ordre post révolutionnaire et du XIX° siècle paraît curieux pour une spécialiste d’histoire économique. Comment ne pas s’interroger sur l’histoire du droit lorsque l’on veut discuter en particulier avec des auteurs comme North ou Hayek sur la dynamique des institutions ? Comment ne pas chercher à mieux articuler les institutions informelles et formelles lorsque l’on cherche à défendre la thèse que l’idéologie est première ? Comment ne pas aborder sérieusement l’opposition en histoire économique et plus généralement en histoire entre les idéalistes et les matérialistes, discussion abordée par North (1992) qui a sur ce point une proximité avec Marx et le matérialisme ?
[1] Deirdre N. McCloskey et Art Carden 2025. Laissez-moi faire et je vous rendrai riche. Comment le Pacte Bourgeois a enrichi le monde, traduit de l’anglais par Patrick Hersant, éditions Markus Haller. Titre original : Leave me alone and I’ll make you rich. How the Bourgeois deal enriched the world, 2020, University of Chicago Press. Chicago et Londres.