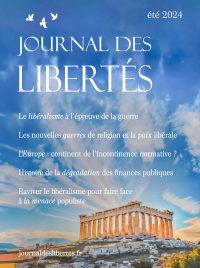« La volonté d’être libre s’éteint en cas de péril et
se ranime une fois satisfait le besoin de sécurité. »
Bertrand de Jouvenel, 1945[1].

Prolégomènes: pourquoi cet essai
Lors d’une rencontre de l’Institut Libéral de Lausanne autour du thème : « Faut-il tolérer l’intolérance ? » j’évoquais, incidemment, l’objet qu’aborde la présente chronique. Je concluais mon propos par un constat que je reprends ici, presque mot par mot :
« L’initiative privée se déploie d’autant mieux que les temps sont pacifiques : ainsi, au cours des années 1970, la démocratie forte et paisible qu’offrit Valéry Giscard d’Estaing aux français[2] promettait à chacun de vaquer à ses affaires et de poursuivre cette quête du bonheur pacifique que les constituants américains promirent à leur peuple en fondant cette grande République qui, depuis deux siècles et demi, conjugue l’épanouissement des hommes, la reconnaissance de leurs talents et l’art politique de pacifier la vie sociale.
Bien au contraire et de tous temps, les relations entre États sont dictées par des rapports de puissance. Selon les lieux, selon les circonstances et selon l’époque, les relations étatiques peuvent déboucher : soit sur une coopération active, soit sur une rivalité pacifique ; soit, au pire, sur un conflit ouvert. Dès lors, les règles qui régissent les relations pacifiques ne s’appliquent plus. » (Jutzet, 2022 p. 165-182)
Mon texte a pu surprendre, notamment du fait qu’il ne faisait guère référence à une pensée libérale au sens plein, telle que l’entend, à tout le moins, la doctrine depuis bientôt trois siècles[3]. J’évoquais surtout la ferme pensée du sociologue Raymond Aron (1905-1983), éminent analyste français des relations internationales, germaniste entraîné depuis sa jeunesse à comprendre et commenter la sociologie allemande, commentateur de Clausewitz. Aron fut reconnu bien au-delà de la France, tout au long de la période tourmentée qui débuta avec la République de Weimar (1918-1933) et s’acheva avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1989, événement dont il n’a pas été le témoin vivant.
Bien que sa plume ait souvent usé des termes « libéral » ou « libéralisme », j’admets qu’Aron ne fut pas un libéral au sens classique ; mais sa longue carrière, particulièrement à sa maturité, fut attachée aux libertés civiques et politiques ; il s’opposa fermement aux tyrannies. A ce titre, au moins, Aron fut respectable, qu’on le considère comme libéral ou pas !
C’est pourquoi j’endosse certaines de ses vues, particulièrement sur la guerre et la paix. On les comprend d’autant mieux qu’elles furent conçues et exprimées dans notre propre langue !
En préparant cet essai, je me suis tourné vers un autre contemporain disparu dont une sentence est en exergue : talent original, assez inclassable, Bertrand de Jouvenel vécut les deux grandes guerres. Il en tira des leçons réunies dans son « livre de guerre » publié à Genève en 1945, réédité à Paris trente ans plus tard: Du Pouvoir. En partie rédigé en 1943, l’ouvrage est ponctué d’aphorismes : « L’histoire est lutte de pouvoirs » ; puis, après quelques lignes : « Entre pouvoirs de la même espèce, l’état naturel est la guerre » (p. 169) ; un peu plus loin : « Tout est jeté dans la guerre, parce que le Pouvoir dispose de tout » (p. 187).
Sceptique ou désabusé, l’auteur concluait : « La négation libérale (de la guerre) est … utopique » (p. 436) ! Or, Jouvenel estimait Benjamin Constant, ce « libéral en tout »[4] dont il appréciait le trait qui raille « les hommes de cabinet » (comme Voltaire) flattant un tyran qui servait leurs desseins : « L’auteur, paisiblement assis à son bureau, lance de tous côtés l’arbitraire… Pauvre imbécile ! » (Constant cité par Jouvenel, 1972 p. 167).
Il me faut donc revenir à Constant, surtout à ses Écrits politiques et à son traité, De l’esprit de conquête et de l’usurpation, d’une lecture aisée ; quinze courts chapitres de sa première partie, consacrés à l’esprit de conquête, abordent explicitement la guerre, sa place et son rôle dans l’histoire et dans l’État moderne. Le chapitre premier s’ouvre ainsi « Il n’est pas vrai que la guerre soit toujours un mal… elle est dans la nature de l’homme… lui enseigne des dévouements héroïques… l’unit à sa patrie (et) à ses compagnons d’armes. » (Constant, 1997 p. 127) Ce raisonnement distingue les guerres héroïques du passé de la guerre de conquête présente ; il légitime le conflit défensif, pas la conquête ; il prévient contre le militarisme, énumère les risques indissociables de la conquête: dès que « l’armée, distincte du peuple par son esprit, se confond avec lui » (d°, p.142) l’esprit belliqueux multiplie les sophismes pour justifier ses agression !
L’invasion russe de l’Ukraine est exactement du type que stigmatisait Constant en 1813 : « ce gouvernement attaque ses voisins les plus paisibles… leur suppose des projets hostiles et… des agressions méditées… vous le voyez, s’écrie-t-il, ils voulaient la guerre puisqu’ils se défendent. » ! Constant prévoit toutefois l’effondrement, inévitable à terme, d’une conquête qui assujettit un peuple, sous quelque prétexte que ce soit. Ces pages prophétiques éclairent les événements présents. Nul mieux que lui n’a, à ma connaissance, posé, avec autant de clarté que de raison, le dilemme que pose la guerre au libéral : rendre coup pour coup dans un conflit défensif, en abandonnant l’échange ; ou accepter d’être asservi sous prétexte que « l’époque du commerce … remplace celle de la guerre » .
« De la guerre »[5]
Je reviens à Aron: entre 1970 et 1972, c’est dans ses leçons au Collège de France qu’il affina sa compréhension de la guerre. Ces leçons prolongeaient Clausewitz qu’Aron avait déjà disséqué lors de ses premiers séjours en Allemagne d’avant-guerre. Il contribua ainsi à faire connaître cet auteur en France car sa richesse et sa subtilité ne peuvent se résumer au lieu commun : « la guerre continue la politique par d’autres moyens » qui inspira les stratèges du Reich allemand[6]. Aron soulignait les deux idées maîtresses du stratège prussien :
- le temps de guerre instaure la primauté absolue du politique sur le militaire, et
- il existe deux formes de guerre : a/ la guerre totale, rare mais absolue, qui est un duel à mort pour anéantir l’adversaire ; et b/ la guerre mesurée (ou demi-guerre) poursuivant un objectif rationnel, par exemple, rectifier une frontière que l’on n’a pas su modifier par la négociation[7] .
Cette seconde possibilité correspond-elle au cas de la guerre engagée par les Russes en Ukraine aujourd’hui ? Difficile à dire puisque ce dicton ne couvre pas le duel à mort que semble avoir choisi Poutine !
La guerre, en fin de compte, serait donc une « montée aux extrêmes » de l’art politique, un paroxysme qui déclenche l’usage de la force brute entre puissances souveraines. C’est un affrontement politique par essence qui ne peut se régler, pour un temps du moins, par aucun compromis. De très nombreux travaux d’Aron dissèquent ce continuum entre temps de paix et de guerre : il expliqua, sous de multiples formes, qu’une paix (même armée) est fort différente de la guerre ouverte[8] car, à cette extrémité : « la sociabilité industrielle se heurte à des traditions séculaires [9]» et les espoirs de médiation s’effacent devant les armes des belligérants.
Tous ceux qui ont rêvé d’une république mondiale des échanges, d’une internationale socialiste apaisée, de l’économisme qui pense que l’instinct militaire plie devant le bien-être individuel, ce qu’affirmait le Président Wilson[10], sont également utopiques : « les hommes trouvent dans la puissance (collective) des satisfactions qui balayent le calcul économique et donnent un sens au sacrifice » ! Cette conclusion s’appuie sur l’histoire : aucune volonté de puissance ne peut être mieux assouvie que par une collectivité politique[11].
D’où mon constat : ceux qui assimilent les relations entre États à des relations interpersonnelles, font fausse route. Au sein d’une même nation, l’art politique peut certes viser à la concorde civile ; mais il en va différemment des relations entre États car, entre puissances souveraines, la coopération est rarement et durablement béate. A bien des égards, la longue période de paix dont a bénéficié le monde occidental depuis huit décennies nous a endormis. De nombreux personnages de notre temps l’ont oublié : la guerre fait partie de la vie.
Un libéral peut-il « penser la guerre » ?
Fidèle à Max Weber, l’un de ses maîtres à penser de jeunesse, Raymond Aron tenta de repérer et de décrire des situations – ou des situations-types – qui peuvent déboucher sur un conflit ouvert ; comme « spectateur engagé »[12], il cherchait à juguler l’effet délétère que pourrait produire le débordement d’un conflit est/ouest, d’un accident porteur de hauts risques pendant que les deux grands (les États-Unis et l’URSS) étaient en « guerre froide », sous la menace d’un feu nucléaire. Il disséqua les traités de l’OTAN pour l’Europe et les alliances américano-coréenne et américano-japonaise en Asie, afin d’estimer ce qu’ils impliquent réellement pour les signataires : d’ordre purement politique, toutes ces conventions envisagent l’engagement éventuel de forces multi ou bilatérales et un recours à la force armée qui peut être – ou pas – associé à des frappes nucléaires.
Or, depuis Hiroshima, « la foi dans l’effort de défense s’est perdue » [chez les européens] écrivait, il y a plus d’un demi-siècle, un général français dans son introduction à la stratégie (Beauffre 1964, p. 5 & 177). Il craignait que cet abandon augmente après l’effondrement du rideau de fer. Avec clairvoyance, Beauffre admettait que « le desserrement de l’emprise soviétique » sur l’Europe centrale et orientale posera un vrai problème futur : celui d’apparaître comme une défaite pour l’URSS ». Visionnaire, il craignait donc que naisse plus tard en Russie un esprit de revanche (sic) ; c’est bien cette volonté revancharde qu’expriment, quatre-vingts ans après la seconde guerre mondiale, le tyran russe et son entourage au pouvoir à Moscou.
Au cours des premières décennies qui suivirent l’armistice de 1945, les « deux Grands » furent souvent tentés de magnifier verbalement leurs enjeux de souveraineté ; mais ils maîtrisaient leurs instincts guerriers de plusieurs manières. Aron intégra ce tragique historique [13] : la lutte armée bouleverse les mœurs et la façon de vivre chez les belligérants, bien plus profondément qu’envisagé à l’avance. Un libéral doit par conséquent admettre que, par sa seule existence, la guerre engendre des comportements liberticides, à l’antipode absolu d’une société de liberté. Quelques exemples:
- l’État réquisitionne les biens, l’épargne et les hommes nécessaires à la guerre, action attentatoire à la propriété, à la libre disposition des biens et à l’autonomie de chacun ;
- tout pays en guerre restreint les déplacements, préempte importations, exportations et matières premières, portant atteinte aux libertés et aux droits de propriété ;
- l’État militarise les infrastructures ; réquisitionne des manufactures afin d’y produire armes, équipements militaires ou munitions; contingente les victuailles pour nourrir ses troupes etc.
Tout cela dénie la société libérale et l’organisation de marchés. Bien que nous n’en soyons pas encore à ce point, la montée en puissance du conflit ouvert par les russes depuis 2014 – occupation de la Crimée et du Donbass oubliée quelque peu par les occidentaux pendant huit ans –, nous impose de « mettre nos pendules à l’heure ». Cette guerre touche aux frontières de plusieurs pays-membres de l’Union européenne : Baltes, Finlande, Pologne, Roumanie, Slovaquie et même Allemagne, Bulgarie et Suède qui considèrent effectivement ce conflit comme une menace à leur porte puisque leurs frontières et leurs rivages sont à portée de canon des navires, des missiles ou des aéronefs russes ou de leurs alliés comme les Biélorusses !
Des européens réveillés dans leur quiétude
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu’aucun de ces pays exposés ne pourraient guère se défendre par lui-même si, par malheur, les choses empiraient à ses frontières ou sur leurs atterrages. Il faut aussi admettre qu’à l’exception de la Pologne qui entretient une réelle armée ; et de la Suède qui maintint son statut de pays-neutre depuis des lustres[14], les autres pays d’Europe n’ont guère de défense crédible, hormis peut-être la Grande Bretagne et la France. Soyons donc lucides : seules l’alliance atlantique et le « parapluie américain », peuvent donner à tous ces pays le sentiment qu’ils ne risquent pas grand-chose[15].
Principalement équipé par les États-Unis , le dispositif atlantique fut conçu aux lendemains de la seconde guerre mondiale ; il exprimait principalement la volonté américaine de cantonner l’ours soviétique, ce qui réussit pendant la longue période (1946-1989) au cours de laquelle, à l’exception à nouveau de la Grande Bretagne et de la France, la réflexion stratégique et l’hypothèse d’un affrontement avec l’est soviétique, n’ont passionné ni la Commission de Bruxelles, ni les foules européennes, ni la majorité des représentants politiques nationaux, à de très rares exceptions près.
Rythmé par la vie de Soljenitsyne qui est son fil conducteur, l’essai remarquable de Rigoulot (2019) explique que les deux grands (URSS & États-Unis) conservèrent un équilibre métastable entre eux pendant quarante-cinq ans. Il souligne que les soviétiques (comme les Chinois) ont soigneusement évité d’affronter directement les troupes de l’occident, tant en Afrique, qu’en Asie ou en Amérique latine pendant cette longue période. Les chocs directs furent verbaux ; et les combats ne s’engagèrent que par procuration (en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, en Angola, au Mozambique etc. ) sans que s’opposent directement les corps occidentaux aux russes ni aux chinois, nulle part dans le monde.
La situation présente est toute différente: en Ukraine, la Russie fait désormais face à un pays-candidat à l’Union européenne ; ses armes, ses aéronefs et ses missiles tangentent le territoire de deux pays-membres de l’Union, au moins (Pologne & Roumanie) ; c’est une nouveauté, tant pour les autres européens que pour notre doctrine de dissuasion nucléaire qu’elle bouleverse. Cela n’est pas nouveau, en revanche, pour les Américains !
Dans ce contexte, je ne peux oublier que le Marché commun initial (RFA, Italie, France et Benelux) souhaitait éradiquer les démons de la discorde qui aboutirent, sur notre sol et au-delà, aux conflagrations mondiales du XXème siècle. En formant une communauté ouest-européenne, nos pays espéraient conforter durablement des relations pacifiques entre eux. Ainsi, avant l’Acte unique européen, instaurer la libre circulation des personnes et des biens en Europe occidentale poursuivait explicitement un objectif libéral et pacifique, au profit des peuples et des pays qui la composaient.
A mon grand regret, la réécriture ultérieure des traités européens a profondément remodelé l’Europe communautaire : le périmètre de l’Union s’est considérablement élargi, bien au-delà du noyau fondateur qui était assez homogène. Dans le même temps, le principe de subsidiarité que les fondateurs avaient à peu près admis, disparut des règlements qui se multiplient et créent des organes qui gravitent autour de la Commission ; de plus, l’élargissement des compétences communautaires entraîne une centralisation accrue[16].
Disposant d’un pouvoir d’initiative très étendu, la Commission exprime aussi, de plus en plus souvent, une volonté de puissance. Plus elle s’élargit, plus l’Union devient hétérogène et plus elle tente d’harmoniser tout et partout ! Cela n’annonce plus le temps calme qu’espérait promouvoir l’esprit conciliant des pays fondateurs… Les faits politiques illustrent également que l’ambition universaliste et l’individualisme admis depuis presque trois siècles en Europe occidentale ne sont pas aussi largement répandus que nous l’avions cru, particulièrement en Europe centrale et aux Balkans. Est-il possible, est-il même souhaitable, d’unifier la vie des Maltais avec celle des hollandais ? La politique publique bulgare répond-elle aux conventions sociales de la Finlande ? Face à ce « grand écart », la diversité des coutumes et des traditions politiques stimule-t-elle le risque de contentieux entre pays-membres ou entre groupes de membres ?
Au-delà des services communautaires et des juges européens, surtout en temps agités et contrairement au rêve de nos pères fondateurs, des différends peuvent, à tout moment, déboucher sur un incident politique grave dont la crise russo-ukrainienne n’est qu’un premier exemple. L’élargissement désordonnée de l’Union prépare, je le crains, des jours difficiles. Et, pour parler clair : à une date qui n’est peut-être pas éloignée, la redistribution organisée par Bruxelles pourra-t-elle se poursuivre ? Surtout si la défense, grosse consommatrice de budgets, devient une priorité communautaire. Plus critiques qu’ils ne l’ont jamais été, les pays-membres qui touchent de forts subsides regarderont bientôt Bruxelles avec moins de chaleur qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent ; d’autant qu’ils seront probablement sollicités par l’Amérique ou par l’Otan ; voire par la Russie ou par la Chine. Pourquoi ne contesteraient-ils pas alors la communauté et ses obligations qui les dérangent ? Des pays-membres proches de la zone de conflit pourraient aussi être tentés, soit de transiger avec les belligérants, soit de prendre parti, comme au temps où américains, soviétiques ou chinois soutenaient, en sous-main, la révolte contre l’autre camp. Il est déjà patent que tous ceux qui combattent autour de Kharkov, d’Odessa, du Don et du Dniepr reçoivent de l’aide extérieure et que cela entretient le conflit :
- l’Ukraine est aidée par plusieurs pays de l’OTAN, principalement par les États-Unis ; cette aide qui irrite l’adversaire, n’est pourtant pas différente de celle que soviétiques et chinois apportaient aux rebelles communistes du Vietnam ou de Corée ;
- les Russes reçoivent aussi des matériels et des munitions fournies par l’Iran, par la Corée du nord, par la Chine (peut-être par d’autres) ce qui ne passe pas inaperçu à l’ouest ;
- la République islamique d’Iran, petit Poucet de la guerre des pauvres, fournit, en même temps, russes et milices palestiniennes qui menacent Israël, ainsi que rebelles houthis de mer Rouge, avec des équipements frustes mais suffisants pour menacer ces théâtres d’opération, un soutien qui dérange tant l’Oncle Sam que les occidentaux.
- Quant à la Turquie, elle est ambidextre : membre de l’OTAN, elle livre des bricoles à l’Ukraine mais acquiert des missiles russes incompatibles avec les normes de l’OTAN: que pense-t-elle en faire, et pour quel usage ?
Trente ans après la fin du soviétisme, les « conflits par procuration » renaissent : entre occidentaux et orientaux ; entre alliés des États-Unis et « non-alignés » d’un nouveau style qui refusent l’alliance occidentale. Des blocs multilatéraux se reconstituent. Le paysage mondial se militarise, les relations marchandes et la finance globale en souffrent, l’ouverture des marchés recule comme l’investissement productif, alors que beaucoup reste à faire pour conjurer la misère qui recommence à prospérer partout.
Ce constat est attristant : depuis février 2022, les bruits de bottes menacent nos sociétés, les graves troubles de Calédonie le prouvent ; l’apaisement s’éloigne ; l’instinct souverain se réveille, même au sein de l’Union européenne qui est tiraillée par ses contradictions. Ce cadre est antinomique avec la vue progressiste de nos générations[17]. Longtemps oubliés (en Europe, notamment) grâce à des relations pacifiées, les instincts belliqueux reprennent vie : l’utopique démocratie forte et paisible giscardienne que j’évoquais au début de cet essai, est en voie d’abandon. Et notre Union européenne fanfaronne tout en laissant nos libertés en jachère. L’inquiétude qui renaît m’évoque celle qui gagna nos parents lorsque savants, marchands, philosophes, médecins ou économistes quittèrent l’Allemagne, l’Autriche ou la Hongrie, à la veille de la dernière guerre…
Le libéralisme au colloque Lippman (26-30 août 1938)
L’édition française de l’essai intitulé The Good Society (Lippman, 1938) venait de paraître. Largement diffusé en Amérique et en Europe, ce livre servit de prétexte au colloque que je vais brièvement évoquer à présent. Rassemblés autour du chroniqueur américain Walter Lippmann pour quatre jours d’échange contradictoire, une trentaine de personnalités s’interrogèrent sur « le déclin du libéralisme et sur son (éventuel) retour »[18]. La moitié des invités étaient des Français qui agirent comme la puissance invitante. Se côtoyaient entre égaux des étrangers qui furent, bien après-guerre, des porte-paroles emblématiques d’un libéralisme à facettes multiples : ordo-libéraux allemands, libertariens américains, démocrates-chrétiens, radicaux européens etc. Au-delà de leurs divergences, ces personnalités s’adressaient clairement aux « grands de ce monde », au nom de leur attachement commun, profond et sincère, aux libertés individuelles.
Tous tirèrent des leçons qui méritent d’être rappelées. La plupart des participants ont survécu à la guerre ; plusieurs ont marqué la vie publique jusqu’à leur mort ; et tous laissent des traces durables : Aron en était ; Hayek et Mises aussi ; la société du Mont Pellerin, temple du libéralisme occidental depuis 1947, naquit plus ou moins dans le sillage de cette rencontre. L’enjeu de la guerre qui éclata l’an d’après, y fut sérieusement analysé et il est utile de s’en souvenir car, même bien que l’histoire ne se réplique pas, nous pouvons en tirer des leçons, près d’un siècle plus tard[19].
Ce colloque prouva qu’une même philosophie politique pouvait inspirer, à cette époque, des intellectuels aussi différents que le conservateur britannique Lord Robbins (1898-1984), le démocrate américain Walter Lippmann (1889-1974), le polytechnicien Jacques Rueff (1896-1978) et l’autrichien Friedrich Hayek (1899-1992). Peut-être cette convergence fut-elle aussi stimulée, en cet immédiat avant-guerre, par le fait que tous ressentaient le danger du national-socialisme qui avait conquis l’Allemagne, du fascisme qui prenait racine en Italie et de la chape qui pesait sur la péninsule ibérique avec Franco (1898-1984) et Salazar (1889-1970). Tous étaient préoccupés par le spectre du marxisme qui séduisit effectivement une bonne partie de l’intelligentzia française, britannique et italienne, pour ne citer qu’elles, jusqu’à la chute du soviétisme en 1989.
Ce rassemblement œcuménique ne dura pas. Les Autrichiens et les Allemands qui avaient déjà quitté leur pays se réfugièrent en divers lieux : en Suisse, comme Röpke (1899-1966) qui mourut à Genève, ou pour beaucoup en Angleterre et aux Amériques. Quant aux treize français, ils durent subir les profonds stigmates provoqués successivement par la « drôle de guerre » de 1939-1940, par l’occupation allemande, par la résistance française, de l’intérieur comme de l’extérieur, et par le gaullisme. Étienne Mantoux, mourra pour la France en 1944, en mission de reconnaissance aérienne en Allemagne, à la veille de la victoire. Parmi les douze autres, je retiens trois profils hors norme :
- Parti très tôt à Londres, Raymond Aron n’a cessé, je l’ai dit, de disséquer la scène politique mondiale jusqu’à sa disparition en 1983 ; sa sagacité, son analyse et de sa méthode sociologique éclairaient bien le rapport dialectique entre paix et guerre.
- Libéral en paroles mais étatiste d’esprit, Jacques Rueff, déjà repéré par ses pairs avant le Colloque de 1938, fut ensuite connu pour sa défense de l’étalon-or; il émergea aux marges du gaullisme. Son penchant ordolibéral (partagé avec Louis Armand, par exemple) fut apprécié en France. Son classicisme monétaire prônait une vision que la finance moderne a fait tomber en désuétude[20].
- Initiateur du colloque, le philosophe Louis Rougier (1889-1982), libre-penseur positiviste, porta jusqu’à son dernier jour la marque d’une « collaboration vichyssoise » qui fut sans doute exagérée par ses adversaires. Démis de ses fonctions enseignantes en 1948, sanction rarissime pour un fonctionnaire français présumé inamovible, il fut condamné à l’opprobre pour avoir été missionné par le maréchal Pétain afin de sonder Churchill à Londres en 1940, hors la vue du Général de Gaulle qui ne pratiquait guère le pardon des offenses ! Il bretta aussi avec les chrétiens progressistes de l’après-guerre et paya leur hostilité au prix fort : ses adversaires l’excommunièrent, stigmatisant à la fois le fait qu’il avait frayé avec Pétain, son paganisme revendiqué et, pour couronner le tout, sa proximité avec la nouvelle droite athée des années 1970.
Libéralisme et « économie de guerre »[21]
Introduite par Louis Rougier, une demi-journée fut consacrée à ce thème : le colloque constatait que, sous divers prétextes, le nationalisme rejette le libéralisme ; que la sécurité nationale imposerait « l’économie de guerre » (Wehrwirtschaft) afin de garantir l’auto-suffisance – en matière alimentaire, par exemple – et la maîtrise des approvisionnements dès que s’ouvre la guerre. Rapporteur de cette session, Possony soulevait deux questions centrales que nous évoquons de nouveau ces derniers temps :
- celle des matières premières nécessaires à la production nationale en temps de guerre (hier, le caoutchouc des pneumatiques; aujourd’hui le lithium et les carburants)
- et celle des ersatz (substituts éventuels de certains produits) qui pourraient remplacer, le moment venu, les carburants pétroliers (comme l’essence synthétique allemande en 1943) ou des composants actuels comme les puces électroniques, aujourd’hui.
Nécessairement entachée de fortes incertitudes, la prévision se trompe toujours, estimait le rapporteur : comment prévoir les manques et y parer d’avance ? Certes, l’économie de guerre impose de constituer des stocks de précaution (carburants, matériels, projectiles, rations alimentaires, équipements sanitaires, etc.). Mais organiser d’avance des productions industrielles et agro-alimentaires pour répondre aux besoins du combat, à la subsistance des combattants et aux besoins de la population civile est entaché d’erreurs grossières, comme l’est toute tentative planiste.
Possony disait, en revanche, que la concurrence entraîne l’entreprise privée à répondre vite aux aléa du marché, et que cet entraînement l’aide à s’adapter aux circonstances, bien mieux qu’un arsenal d’État, pataud et bureaucratique. L’économie concurrentielle conserverait ainsi ses avantages et les exploiterait fort bien en temps de guerre[22] : l’entrepreneur étant à l’affût du changement, l’économie de guerre n’est, pour lui, qu’un défi de plus à relever ; faut-il néanmoins le soutenir pour qu’il réussisse ? Deux ressources sont précieuses en temps de guerre: le capital d’une part et les approvisionnements d’autre part. Ces ressources sont plus rapidement reconfigurées par une entreprise concurrentielle que par les budgets publics et par les arsenaux qui fascinaient les militaires français ou allemands des deux grandes guerres. Possony concluait que l’économie dirigée – dont les idéaux-type sont l’arsenal et l’atelier d’État – ont montré leurs limites, tant en termes d’innovation que de productivité. Et il concluait, en toute logique, que, pendant la guerre, l’économie privée reste la meilleure option pour surmonter les difficultés et pour gérer l’incertitude. Le libéralisme serait ainsi nécessaire pour résister et pour préparer la victoire qui conclut la guerre. Restent d’autres interrogations auxquelles il faut aussi répondre :
- faut-il instaurer un contrôle des prix, en temps de guerre ? Et, si oui, à quelles conditions ?
- comment financer l’effort de guerre : par l’impôt ou par l’emprunt ?
- comment, quand, où et pourquoi constituer ou entretenir des stocks stratégiques ?
- pour quelle durée et dans quels domaines?
Le débat qui prolongea cette session insista sur le fait que ceux qui habituent leur peuple à une économie dirigée, encadrée et « tutellée », auront des lendemains difficiles après la fin du conflit. Les gouvernants sont en effet rarement portés à rétablir les pratiques concurrentielles. Tous les intervenants insistèrent sur les travers et sur la perversité d’une économie qui habitue l’entrepreneur à jouir d’une rente en temps de guerre. Le débat déboucha sur ce constat : de mauvaises habitudes s’installent lorsque les industries jouissent d’un monopsone[23]. Deux autres points sont à retenir :
- D’abord celui que résuma Ludwig von Mises à propos de l’Allemagne hitlérienne et de sa conception de l’industrie en guerre (le Blitzkrieg). Persuadé que sa guerre sera courte, qu’elle surprendra l’adversaire et le prendra de court, l’État totalitaire organisa sa production guerrière par et pour le Reich. Il comptait assurer ainsi son hégémonie future mais, prévoyait Mises, le totalitarisme se trompe aussi lui-même : « ces mesures seront jugées très sévèrement lors d’une guerre future (sic) »[24].
- Le rapporteur Possony conclut, en substance : « une économie menant à l’appauvrissement n’est pas compatible avec la guerre moderne… La Wehrwirtschaft n’est qu’un prétexte pour excuser les méfaits de l’interventionnisme ». (Or) « le capital est la condition même de la guerre moderne ». Et Possony ajouta: « tant que l’État ne recourt qu’aux impôts et aux emprunts, nous restons dans le libéralisme ; mais s’il recourt à d’autre moyens (contrôle des changes, ou inflation, par exemple) nous sortons du cadre libéral (…) Dévorant les richesses d’une façon fulgurante, la guerre moderne est une guerre d’usure. (C’est pourquoi) il convient d’adopter les méthodes d’intervention les moins coûteuses.» Sous-entendu : ce sont celles des entreprises compétitives.
En guise d’épilogue
Reprenons ce propos bien pesé qui complète la citation que j’ai mise en exergue : « la liberté n’est qu’un besoin secondaire par rapport au besoin primaire de sécurité » (Jouvenel, 1972, p. 413) ; et ce sentiment, plus sociologique, que je résume ainsi[25] : les États jonglent entre paix et guerre ; deux idéaux-types accompagnent l’action politique : le diplomate et le soldat. L’un et l’autre administre une partie des relations souveraines. Ils agissent tour-à-tour : l’ambassadeur pour conclure la paix qui suit nécessairement toute guerre et pour empêcher qu’elle ne s’effondre ; quant au stratège, il fourbit les armes « de dernier recours ». Après avoir conduit la guerre décidée par son autorité souveraine ; le stratège s’efforce aussi de préparer l’avenir, afin d’être prêt lorsque reviendra le temps des armes… Si vis pacem para bellum !
Dans toute ces circonstances critiques, les principes libéraux n’ont guère cours. Antinomique avec l’état de droit, avec la libre expression et avec de vraies libertés, la force évacue l’échange : nos libertés reculent devant le souverain qui les suspend, qui les encadre et qui impose à chacun de servir sa guerre : c’est ce qui marque aujourd’hui l’Ukraine, face à l’invasion russe, et Israël, face au terrorisme du Hamas et, accessoirement, face au Hezbollah. Pour autant, il ne faut jamais faire l’impasse sur les ressources que les entreprises privées peuvent mettre au service du souverain : car, comme Possony, nous savons par expérience qu’une guerre stimule la créativité inventive, d’abord au profit des armes, de l’intelligence tactique et de la stratégie (recherche opérationnelle, théorie des jeux, simulation, détection et contre-mesures etc.) La guerre prépare parfois l’innovation qui explosera pendant la paix ultérieure.
Ce n’est pas tout : les vieilles démocraties comme la Grande Bretagne, la France ou les États-Unis, ont tiré parti, depuis un quart de siècle, de quasi-conflits (comme le terrorisme) pour restreindre subrepticement nos libertés : profitant des circonstances, notre État élargit son champ d’action et ses prérogatives pour servir d’autres vues que celle qu’il dit poursuivre, sans que les contraintes et les charges qu’il nous impose limitent vraiment le danger contre lequel il prétend lutter. Ainsi, après les attentats qui ensanglantèrent les États-Unis en septembre 2001, le Patriot Act effaça un demi-siècle de libertés individuelles, comme pendant la « guerre froide » des années cinquante. Les services fédéraux sont à nouveau omnipotents. Puissante et sournoise, difficilement repérable par le bon peuple, cette tendance est toujours inquiétante.
Grâce au numérique, les services surveillent en effet nos échanges à une échelle qui est incommensurable avec celle du passé. En France, des mesures liberticides, en partie imposées par ce Patriot Act 2001, se sont multipliées depuis 2001 : par ricochets successifs, de nombreuses inquisitions, restreignent fortement la liberté individuelle – celle d’aller et venir, par exemple – dans trop de pays, en matière aérienne, notamment. Ces contraintes qui naissent sous le prétexte de faire la guerre au terrorisme, rebondissent sur d’autres prétextes, comme celui, abusivement large, de faire la guerre à la pandémie.
Je ne suis pas seul à noter qu’à l’image regrettable de la Chine, le contrôle social d’État s’élargit partout. Personnalisée traditionnellement par le percepteur, par le douanier, par le policier des frontières, cette mainmise sournoise repose sur les multiples branches d’une autre forme d’administration qui échappe à l’exécutif et qui substitue en partie le judiciaire. Je veux parler de ces organismes que l’on nomme, depuis les années 1980, « régulateurs » et qui tissent partout leur toile[26]. Leur tutelle, prétendument protectrice, surveille peu à peu bien des aspects de notre vie : si le temps de guerre revient, l’effet croisé d’un exécutif autoritaire et de ces « autorités », aussi indépendantes du législatif que de l’exécutif, pourraient parfaitement menacer, elles aussi, des libertés séculaires qui semblent se déliter au fil du temps[27].
Voilà un sujet à saisir pour les libéraux, avant qu’il ne soit trop tard et que l’on nous dissuade d’allumer des contre-feux contre l’inquisition d’État qui s’infiltre partout. A l’époque du Colloque Lippmann, des esprits clairvoyants eurent, eux aussi, la préscience d’une telle menace de tyrannie:
« La (grande) guerre est venue ; à sa suite s’est ouvert ce que j’appelle l’ère des tyrannies. Y aura-t-il généralisation de la tyrannie, propagation de cette forme de gouvernement ? Au mot romain de dictature j’ai préféré le mot hellénique de tyrannie qui désigne un régime durable né, pour des raison que la « sociologie » de Platon et d’Aristote tenta de définir : la dégénérescence de la démocratie ! » (Halévy, 1938 pp. 232 & 243)[28] .
Bibliographie sommaire
Raymond. Aron : Mémoire, 50 ans de réflexion politique, Julliard, Paris, 1983.
Denise Artaud: La fin de l’innocence, Armand Colin, Paris, 1985.
Serge Audier : Le colloque Lippmann, Aux origines du néo-libéralisme, Ed. Le bord de l’eau, Paris 2008
Général Beauffre : Dissuasion & Stratégie, Armand Colin, Paris 1964.
Christophe Bédier & Marwan Lahoud (dir.) : Sécurité intérieure, sécurité extérieure : à la recherche de nouveaux repères, Publisud, Paris 2006.
Pierre Bessard & Olivier Meuwly (dir): Libéral en tout, actualité de Benjamin Constant, Institut Libéral & Cercle démocratique, Genève & Lausanne 2017.
Jean-Pierre Chamoux (éd.) : L’ère du numérique 3, des mœurs & des usages, ISTE-Wiley, Londres 2021.
Jean-Pierre Chamoux : L’information sans frontière, Documentation française, Paris 1980.
Carl von Clausewitz : De la guerre, Préface de Camille Rougeron, Édition de Minuit, Paris 1955.
Colloque Walter Lippmann, (Centre international d’études pour la rénovation du libéralisme), Librairie Médicis, Paris 1938.
Benjamin Constant: Écrits politiques, textes choisis & annotés par Marcel. Gauchet, Folio essais-Gallimard, Paris, 1997.
Valéry Giscard d’Estaing : Démocratie française, Fayard, Paris 1976.
Élie Halévy : L’ère des tyrannies, NRF-Gallimard, Paris, 5° éd. 1938.
Friedrich Hayek: La route de la servitude, PUF-Quadrige n°69, Paris 1985 [1946, Librairie de Médicis]
Bertrand de Jouvenel : Du Pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, Le Cheval ailé, Genève 1945 (ré-éd. Hachette, Paris 1972.)
Nicolas Jutzet (dir.) : Faut-il tolérer l’intolérance ? Institut Libéral, Lausanne 2022.
Walter Lippmann : La Cité libre, Librairie Médicis, Paris 1938
Pierre Rigoulot : Points chauds de la guerre froide (1946-1989), L’Archipel, Paris 2019. Jacques Rueff : L’age de l’inflation, Payot, Paris 1963.
[1] Jouvenel, 1972 [1945], p. 413. Je renvoie dans tout cet article à l’édition française, plus courante que la princeps éditée à Genève. Les deux éditions ne diffèrent que peu l’une de l’autre; leur pagination est toutefois différente.
[2] V. Giscard d’Estaing,1976 p. 157.
[3] Trois dates symboliques : Gournay naquit en 1712, Adam Smith en 1723 et Anne-Robert Turgot en 1727.
[4] Titre du livre qui honora le 250ème anniversaire de sa naissance à Lausanne (Bessard & al., 2017). L’expression autographe est à la Préface aux Mélanges de littérature et de politique (Constant, 1997 p. 623) : « J’ai défendu quarante ans le même principe: liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique. »
[5] Grand œuvre de Clausewitz, 1827, (trad.1955)
[6] Soviétiques d’hier et russes d’aujourd’hui prétendirent s’en inspirer ; mais en trahissant Clausewitz, pensait Aron.
[7] Aron rapprochait le recours aux armes de l’ultime recours qu’offrent les Banques centrales aux financiers lorsque les déposants réclament le remboursement de leur dépôt, comme cela s’est fait en 2008 et, plus récemment, en 2022. Prêteurs en dernier ressort les banques centrales tentent d’éviter les faillites bancaires, sans toujours réussir.
[8] Résumée dans un passage de ses Mémoires (p. 665) cette méthode impose de prendre l’événement de haut : l’histoire je l’épure, je la stylise, j’en retiens les grandes lignes, j’en omets le scandale, les bagarres disait-il.
[9] Les réflexions qui suivent s’appuient aussi sur les Mémoires (principalement p. 469).
[10] Doctrine fort bien résumée ainsi: « Wilson énonce solennellement au Congrès les quatorze points qui constituent le programme de paix des États-Unis : liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes, liberté des mers, désarmement douanier et militaire, création d’une organisation internationale pour veiller au maintien de la paix… le 12 janvier 1919 à l’hôtel Crillon, (il) impose à ses partenaires (le) projet de Société des Nations » (Artaud, 1985 p. 30).
[11] Mon article (Jutzet, 2022, p.166) faisait référence à Héraclite, philosophe d’Éphèse : « Polémos [la guerre] est la loi même de l’univers ! ». Voir aussi (Jouvenel, 1972, p. 436) cité supra.
[12] Titre du volume de ses entretiens avec J-L. Missika & D. Wolton, Julliard, 1981.
[13] Mémoires, (p. 658).
[14] Neutralité que ce royaume abandonna en 2023, à mon avis à tort.
[15] L’importance qu’accordent les Américains à la Norvège révèle leur vision stratégique : limitrophe de la Russie arctique, ce pays verrouille les flottes russes du nord. Il n’est donc pas surprenant que l’actuel secrétaire général de l’OTAN, M. Rassmussen, très présent sur les ondes, soit un ancien premier ministre norvégien.
[16] Comités, conseils, fonds de soutien, entreprises communes, projets d’intérêt européen etc. Nouvel avatar de la politique industrielle, l’initiative « semi-conducteurs pour l’Europe » en est un parfait exemple : le « Règlement européen sur les puces électroniques » est entré en vigueur le 21 septembre 2023. Une note de l’IFRI souligne son ambition prométhéenne, sans doute hors de portée : ce projet quasi-impérial de l’Union décalque, avec beaucoup moins de moyens, le Chips Act Grants américain. Cf. A. Ebrahimi: “Ground-breaking Chip Sovereignty, Europe’s Strategic Push in the Semi-conductors Race”, IFRI-Memo, 31 mai 2024, Paris.
[17] Élargie au reste du monde pendant près de quarante ans, ma vie professionnelle a dévoilé d’innombrables retombées favorables des échanges transfrontières, en termes de services, de savoir, de santé, de durée de vie etc. Mais les « hommes de bonne volonté », comme disait Jules Romain, ne sont pas seuls au monde (Chamoux, 1980).
[18] Thèmes résumés par le philosophe français Louis Rougier, initiateur de ce colloque, le 26 août 1938.
[19] Les actes publiés par le Centre international d’études pour la rénovation du libéralisme (1938) sont désormais introuvables. Les textes conservés sont intégralement reproduits par Serge Audier (2008, pp. 245-344).
[20] Comme ses camarades d’X-crise des années trente, Rueff évoquait W. Röpke. En termes constructivistes, il écrivait en 1953 dans la Revue des deux mondes : « La liberté n’est jamais un don de la nature. Elle ne peut être que le produit d’un état institutionnel » (sic). (Rueff, 1963 p. 120).
[21] Audier, 2008, session du 27 août 1938 consacrée au libéralisme en cas de guerre. Rapporteur de cette session, l’économiste autrichien Stephan Possony (1913-1995) temporairement exilé à Paris, rejoindra les États-Unis où il fit carrière comme enseignant et consultant en stratégie : sous l’autorité du président Reagan, Possony inspira l’IDS (Initiative américaine de Défense Stratégique) dite : « guerre des étoiles », abandonnée en 1993.
[22] Deux exemples américains: 1/ au cours de la période 1941-1945, les constructeurs automobiles, GMC en particulier, produisirent vite, en masse et avec un effet d’échelle extraordinaire, les véhicules qui débarquèrent en Normandie et poussèrent jusqu’en Allemagne à partir de juin 1944; 2/ confiée à des chantiers navals privés, la construction des Liberty-ships profita de l’effet de série dont l’industrie américaine fut, et reste, le champion mondial.
[23] L’industrie du médicament illustre ce travers que mit en évidence la pénurie des vaccins COVID.
[24] Paroles prophétiques que l’on pourrait aujourd’hui reprendre à propos de l’armée russe en Ukraine.
[25] Aron, 1983 p. 454-461.
[26] Banques, assurances, communication, consommation, médicament, transports, numérique, discrimination etc. Avant 1990, la France comptait cinq autorités administratives indépendantes : la CNIL (Informatique & Libertés), le CSA (audiovisuel), la COB (bourse des valeurs), le Conseil de la concurrence et le Médiateur de la République (inspiré de l’Ombudsman suédois). On en comptait une cinquantaine en 2022! Deux observations : 1/ beaucoup de ces autorités sont animées par un membre du Conseil d’État qui conseille le gouvernement, délibère sur les lois et arbitre le contentieux administratif ; 2/ ces institutions relaient des normes européennes que le Conseil d’État privilégie désormais. Que reste-t-il d’indépendant dans ces autorités non-exécutives ?
[27] Le comportement d’une autorité comme l’ARCOM, en est une illustration, parmi d’autres.
[28] Extrait d’un débat de la Société française de philosophie du 28 novembre 1936, publié par Raymond Aron sous l’impulsion de Célestin Bouglé, philosophe positiviste qui dirigeait l’École normale supérieure, préfacier du livre et qui présentait ainsi l’auteur post mortem : « Libéral jusqu’aux moelles, autant par tempérament personnel que par tradition de famille, il avait horreur des empiétements de l’État » (Halévy, 1938 p. 8). Friedrich Hayek cita aussi Halévy : « Les socialistes croient à deux choses qui sont absolument différentes et peut-être contradictoires : la liberté et l’organisation ». Et il précisait : « le socialisme … a (aussi) persuadé des esprits libéraux de se soumettre à la réglementation de la vie économique qu’ils avaient renversée. » (Hayek, 1986, pp. 30-31).