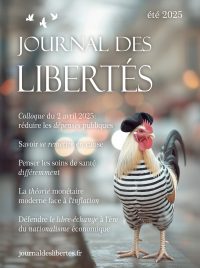La Suisse est reconnue pour son système fédéral. Cette décentralisation se manifeste en particulier dans le domaine de la santé, un secteur qui relève principalement de la compétence des cantons.

Les cantons aux manettes
En Suisse, la Confédération, soit l’État fédéral, possède uniquement trois compétences dans le domaine de la santé : la fixation des prix des médicaments, la reconnaissance des professions médicales et la supervision de l’assurance-maladie obligatoire. Tout le reste est du ressort des cantons, qui sont responsables de fournir et garantir l’accès aux soins.
A ce titre, ils sont par exemple responsables d’établir une planification hospitalière à travers la publication d’une liste des établissements autorisés à facturer leurs prestations. Ils ont également la charge de fournir les soins de longue durée (soins à domicile et EHPAD).
Par ailleurs, les cantons jouent un rôle dans le financement des soins. Ils prennent en charge une grande partie du financement des prestations stationnaires (avec nuitée à l’hôpital ou en EHPAD), le reste étant pris en charge par une assurance-maladie privée obligatoire. Les cantons ont en outre la possibilité de verser des subventions pour des « prestations d’intérêt général » dont la fonction est de maintenir les capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, comme un service de secours local, ou la recherche et la formation universitaire. Enfin, les cantons peuvent octroyer des réductions individuelles de prime-maladie pour soulager financièrement les ménages plus modestes. Les cantons suisses sont donc bien aux manettes du système de santé.
Concurrence régulée : le bon compromis suisse ?
La Suisse est aussi louée, ou critiquée selon le public, pour sa culture du compromis. Celle-ci se manifeste par exemple dans le fonctionnement de l’assurance-maladie, qui repose sur le principe hybride de concurrence régulée.
Citons trois caractéristiques remarquables de cette dernière. Premièrement, les assurés (et les patients) peuvent librement choisir leur médecin ou leur hôpital. Ils sont également libres de s’assurer auprès de l’un des 50 assureurs-maladie actifs dans le pays. Ces mêmes assureurs sont tenus d’accepter toute personne, indépendamment du profil de risque (personne âgée, fumeur), et doivent rembourser un catalogue de prestations identique fixé par la loi. La concurrence joue donc sur le prix et les services (service client, application mobile) plutôt que sur les prestations.
Deuxièmement, le système exige une participation aux frais des assurés relativement élevée en comparaison internationale, via une franchise que chaque assuré peut choisir (entre 300 et 2500 francs suisses par an). Le financement « out of pocket » des patients représente 22 % des coûts de la santé, contre 9 % en France et 11 % en Allemagne. En revanche, il existe une « solidarité » entre les personnes plutôt en bonne santé et les personnes malades. La prime-maladie au sein d’une assurance ne dépend pas de l’âge ni du profil de risque mais est identique pour les assurés adultes (dès 26 ans) résidant dans un même canton.
Troisièmement, les tarifs sont négociés librement entre les assureurs et les fournisseurs de prestations dans chaque canton. Toutefois, les assureurs sont soumis à une obligation de contracter avec tout prestataire de soins autorisé par le canton, qui doit valider les tarifs.
La décentralisation produit des résultats différents pour des besoins différents
L’organisation des soins décentralisée permet aux 26 cantons suisses d’adopter des politiques de santé différentes qui se répercutent dans le montant des primes maladies.
Ainsi, la prime-maladie moyenne varie fortement selon les cantons. À Appenzell Rhodes-Intérieures, un petit canton germanophone de Suisse orientale, elle s’élève à 258 francs par mois en moyenne en 2025. A Genève, canton urbain francophone, à 478 francs, soit près du double.
Ces différences de prime reflètent les réalités locales comme la structure démographique et socio-économique, la densité médicale ou encore le nombre d’hôpitaux. La situation dans une ville comme Genève ou Zurich n’est certes pas la même que dans un canton montagnard comme les Grisons ou le Jura.
Tenir compte des priorités locales
Le fédéralisme permet aussi des réponses en termes de politiques financières et sociales différentes. Par exemple, le canton de Vaud limite les dépenses de primes-maladie à 10 % du revenu des ménages. Ainsi, près de 36 % de la population vaudoise (contre 28 % en moyenne suisse) profitaient en 2023 des subsides d’assurance-maladie. D’autres cantons comme celui de Bâle-Campagne préfèrent octroyer des subsides de manière plus ciblée : seulement 20 % des personnes en bénéficiaient, mais les montants sont plus élevés. Les décisions sont ainsi prises au plus près de la population en tenant mieux compte des particularités locales.
Le fédéralisme n’est toutefois pas exempt de défis. Les cantons, propriétaires d’hôpitaux publics, font l’objet de conflits d’intérêt. En effet, les autorités politiques sont tiraillées entre la maximisation des revenus de leur établissement (qui nécessite des tarifs élevés) et l’intérêt des citoyens payeurs (qui exige des tarifs bas). Le poids électoral et la mobilisation des employés de l’hôpital fait souvent pencher la balance en faveur des hôpitaux. En conséquence, des structures inefficientes ou désuètes sont maintenues.
L’enjeu réside donc dans la correction des faiblesses du système sans renoncer aux avantages d’une organisation décentralisée. L’amélioration de la gouvernance des hôpitaux pour limiter les interférences politiques, les coopérations intercantonales et la transparence sur la qualité des soins sont des pistes à explorer.
Ainsi, même si le fédéralisme risque d’entretenir artificiellement des structures superflues, il permet non seulement de mieux répondre aux priorités locales, mais aussi de s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur au-delà des frontières cantonales.