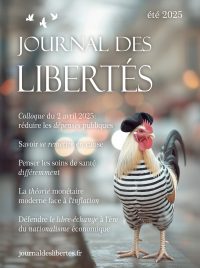Pourquoi ralentir ? Plus précisément, pourquoi diminuer l’activité économique des pays développés ? De nos jours, les questions environnementales et celles des ressources naturelles incitent beaucoup de gens à penser que nos sociétés doivent baisser leur niveau de production et de consommation. Ne pas le faire conduirait à une catastrophe écologique et sociétale. Cette perspective s’accompagne souvent d’une image, celle d’une voiture qui risque de se prendre un mur. Ralentir a donc pour objectif d’éviter l’accident. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas considérer que notre devoir est d’éviter cette issue et donc de ralentir, voire de s’arrêter.
On peut toutefois douter de la pertinence de cette métaphore. L’évolution d’une société est déjà un processus plus complexe que le déplacement d’un objet sur une trajectoire. Puis, que signifie se prendre un mur pour une société ? Ce n’est pas très clair. En outre, est-on certain qu’il existe un mur sur la trajectoire de la société ? Autrement dit, l’accident, dont la nature est à déterminer, est-il une certitude ou juste un risque ? Enfin, si la société avance « comme une voiture » ne serait-ce pas parce qu’elle a intérêt à le faire ? Dans ce cas, ne serait-il pas problématique de ralentir trop tôt et encore plus de s’arrêter ? Autant de questions qu’il faut adresser pour prendre un peu de recul avec la supposée évidence que nos sociétés doivent ralentir.

Les bienfaits de la vitesse
Pour rester dans la métaphore de la vitesse, on peut dire que les sociétés ont presque toujours fonctionné au ralenti. La signification de cette dynamique n’est pas rose. Pendant la plus grande partie de son histoire, l’humanité a en effet vécu dans la misère. N’oublions pas que, dans toutes les sociétés du passé, la plupart des enfants mouraient avant l’âge de cinq ans. Puis, la plupart des pépins médicaux (blessures et maladies) se traitaient mal et s’accompagnaient de grandes souffrances. La nourriture venait souvent à manquer. Les aléas climatiques pouvaient avoir des effets dévastateurs. Les écarts aux normes sociales étaient souvent punis très sévèrement. Et ainsi de suite. La vie du passé n’était vraiment pas facile.
Cette situation a commencé à changer il y a environ deux siècles, du moins en Europe. La révolution industrielle, même si elle n’a pas toujours été heureuse, a quand même entraîné une grande amélioration des conditions de vie. On a appris à mieux lutter contre le froid. Les pénuries alimentaires se sont réduites. La médecine a fait des progrès cruciaux. L’alphabétisation a progressé. La population s’est mise à moins travailler. Les normes sociales se sont assouplies. Et ainsi de suite.
Deux siècles d’accélération, surtout depuis les années 1945, ont donc eu des conséquences très positives sur les conditions de vie. D’ailleurs, tous ceux qui en appellent au ralentissement ne veulent pas remettre en cause les fruits de cette accélération. D’une certaine manière, ils disent que toutes les avancées jusqu’à ces dernières années étaient utiles, voire nécessaires pour vivre dans des conditions décentes, mais que l’on devrait maintenant arrêter d’avancer. Or cette position repose sur une incapacité à imaginer tous les bienfaits possibles des prochaines avancées.
De fait, on peut très bien imaginer que les développements futurs soient aussi importants que ceux du passé, si ce n’est bien davantage, surtout si l’on se place dans un futur lointain. On pourrait certes se dire que nous n’avons plus besoin d’augmenter notre confort matériel. Mais ce serait oublier que les progrès technologiques permettent de rendre les machines moins polluantes, les métiers physiques moins éprouvants, la médecine plus performante, etc. Est-ce vraiment futile ? Dès lors, priver nos enfants, nos petits-enfants et les générations d’après de ces bienfaits soulève un problème éthique.
Imaginez d’ailleurs ce que serait notre société si, il y a un ou deux siècles, nos ancêtres avaient décidé de ralentir l’activité économique, de peur d’épuiser les ressources trop rapidement ou de trop polluer ? Imaginez tout ce que nous n’aurions pas développé. Les pénuries alimentaires seraient courantes, la mortalité infantile n’aurait pas autant baissé, la médecine ne soignerait pas autant de maladies, notre capacité à résister aux aléas climatiques serait bien plus faible et ainsi de suite. Rétrospectivement, on peut penser que ce ralentissement aurait été problématique. Pourquoi n’en serait-il pas de même avec le ralentissement que l’on entreprendrait de nos jours ?
En outre, on oublie aussi souvent que ralentir comporte de grands risques. Concrètement, une diminution de l’activité économique entraîne une diminution des revenus autant des citoyens que de l’État. Ralentir signifie donc une augmentation de la pauvreté, une diminution des soins, une réduction des innovations, etc. Qui plus est, ralentir signifie que l’on ne cherche plus à faire mieux. Le professeur ne doit plus chercher à pousser ses élèves, l’ingénieur ne doit plus essayer d’innover, le commercial ne doit plus partir à la recherche de nouveaux clients, etc. Rapidement, les sociétés risquent donc de tomber dans une spirale du déclin. Si retrousser ses manches n’est plus une vertu cardinale, comment en effet stopper la lente dégradation des conditions matérielles de l’existence ? Bref, ralentir peut conduire à la misère généralisée.
Bien sûr, ce risque d’un ralentissement global ne signifie pas que nos sociétés ne doivent pas ralentir certaines activités, en particulier celles qui sont le plus polluantes ou dont la contribution au bien-être de la population est discutable. Mais c’est ce que font depuis toujours nos sociétés : au cours du temps, elles se détournent de certaines activités et en développent d’autres. Pour autant, depuis deux siècles, ces ralentissements partiels n’empêchent pas une accélération globale. Remettre en cause l’idée qu’il faudrait ralentir ne veut donc pas dire qu’il faut maintenir en l’état toutes les activités.
Malgré cette concession, les partisans d’un ralentissement global ne sont pas sensibles à l’argument que, en ralentissant globalement, les générations futures seront privées des bienfaits de la croissance. La raison est que, selon eux, nous vivrions à une époque charnière : en particulier, nous serions en train à la fois d’épuiser les ressources et de dégrader l’environnement à un point tel qu’il serait désormais dangereux de continuer sur notre lancée. Ces deux perspectives sont toutefois discutables.
Des limites éventuellement lointaines
Regardons la première. L’humanité est-elle en train d’épuiser les ressources ? En abordant cette question, il ne faut pas oublier que c’est une vieille crainte. Par le passé, il a régulièrement été prédit que telle ou telle ressource allait bientôt venir à manquer. Ce furent des erreurs. La raison est simple. Plus la disponibilité d’une ressource s’amenuise, plus on recherche au-delà des réserves identifiées et plus on essaye de trouver des substituts à cette ressource. À ce jour, on a toujours trouvé. Malgré toutes les annonces d’épuisement imminent, nos sociétés n’ont jamais été stoppées dans leurs activités à cause de la fin d’une ressource.
Cela étant dit, il se peut effectivement que telle ou telle ressource en vienne un jour à être épuisée, disons dans 30, 50 ou 100 ans. Est-ce pour autant qu’il faut ralentir dès aujourd’hui ? Ce n’est pas clair. Une ressource n’est pas comme un gâteau qu’il faut manger le plus lentement possible pour qu’il dure le plus longtemps. Le rythme d’extraction d’une ressource reflète en effet le niveau d’activité d’une société et sa capacité à innover. Ralentir peut donc nuire à la recherche de substituts à cette ressource. Au bout du compte, on finirait par épuiser la ressource en question, même si c’est moins rapidement que si l’on n’avait pas ralenti, tout en diminuant ses chances de trouver des substituts. Il n’y a donc pas grand-chose à gagner à ralentir et beaucoup à perdre.
Une dégradation relative
Regardons maintenant le supposé second problème, la dégradation de l’environnement. D’abord, il faut se méfier de l’idée que l’activité économique dégrade l’environnement. Elle le transforme et, souvent, le rend plus accueillant. N’oublions pas que la vie est loin d’être facile dans les espaces sauvages. Un environnement peut ainsi devenir plus accueillant parce qu’il a été fortement impacté, c’est-à-dire transformé. Par exemple, quand nos ancêtres rasaient un hectare de forêt pour en faire un champ, ils rendaient leur environnement plus à même de fournir la nourriture dont ils avaient besoin.
Bien sûr, il y a incontestablement des activités économiques dont les externalités nous nuisent. Sans aller jusqu’à l’exemple de Tchernobyl, il existe des usines dont les rejets polluent l’atmosphère et les rivières. Mais on oublie souvent que, plus le développement économique progresse, plus ces externalités sont mieux contrôlées. Ainsi, dans les pays riches, les usines, les moyens de transport, les équipements de chauffage et autres technologies polluent moins de nos jours qu’il y a 50 ans, et elles polluent aussi moins que dans les pays pauvres. Dire que nos sociétés dégradent de plus en plus l’environnement n’est donc pas correct.
Les déclinistes rétorqueront toutefois que la biodiversité est en train de s’effondrer, signe s’il en est que l’environnement se dégrade. Mais ce serait commettre une erreur similaire. S’il est évident que la biodiversité diminue, bien que pas autant que ne le disent parfois les discours catastrophistes, ce phénomène de diminution ne reflète pas nécessairement une crise. Il faut en effet comprendre que la biodiversité n’est pas une bonne chose en soi. C’est bien pour cela que nous ne voulons pas que nos maisons grouillent d’insectes et que la végétation envahisse nos villes. Il est donc tout à fait compréhensible que la biodiversité se réduise au fur et à mesure que nos sociétés se développent. Bien sûr, il ne faudrait pas qu’elle baisse trop. Nous avons besoin d’un certain niveau de biodiversité pour notre bien-être. Mais nous sommes encore loin d’une baisse de la biodiversité qui menacerait nos sociétés.
D’aucuns rétorqueront encore que le réchauffement climatique nous conduit quand même dans le mur. Il est évident que l’activité économique actuelle génère des gaz à effet de serre. D’où le désir de certains de ralentir pour moins en émettre. Mais cette solution est très probablement naïve. Parmi les énergies à notre disposition, les énergies fossiles sont les plus faciles à manier. Elles demandent le moins de technologie pour rendre les services que l’on attend. Ce n’est pas pour rien qu’elles se sont développées avant les autres sources d’énergie. Les pays les moins développés recourront donc encore massivement aux énergies fossiles pour justement se développer, comme on le remarque de nos jours. Le ralentissement risque donc d’être contre-productif.
En outre, ralentir, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir parer à d’éventuels événements catastrophiques. Déjà, n’oublions pas que c’est le développement économique qui a permis aux sociétés humaines de mieux résister aux aléas du climat. Il fut un temps où une sécheresse ou une inondation pouvait générer des famines. Ce n’est plus le cas. Puis, dans le futur, ce sont les sociétés développées qui résisteront le mieux aux effets délétères du réchauffement climatique. Certes, d’un côté, c’est le développement technologique qui augmente le réchauffement climatique. Mais, d’un autre côté, sans développement technologique, on n’empêchera pas les sociétés d’utiliser les énergies fossiles. Le développement économique est donc ce qui permet à la fois de moins contribuer au réchauffement climatique et de mieux se protéger de ses effets délétères inéluctables.
Enfin, l’humanité n’est pas à l’abri d’une catastrophe planétaire, que ce soit une réduction de la fertilité, une pandémie sévère ou un astéroïde qui viendrait percuter la Terre. Or il n’y a que le développement technologique qui permettra de se protéger de ces possibles fléaux. Contrairement à l’interprétation usuelle du film Don’t look up (2021), celui-ci n’indique pas qu’il faut ralentir l’activité économique. En effet, comment dévier un astéroïde sans une technologie spatiale ultra performante ? Ce n’est possible que si nos sociétés restent toujours dans une sorte de course à l’innovation. Autrement dit, ralentir l’activité économique, c’est prendre le risque de condamner l’humanité à être victime d’une future catastrophe planétaire.
Pour autant, affirmer que nos sociétés n’ont pas à ralentir ne signifie pas qu’elles pourront continuer à développer indéfiniment leurs activités économiques. De fait, il se peut qu’elles ne puissent pas continuer à croître sans fin. Il ne faudrait en effet pas tomber dans un optimisme béat. Si l’on met de côté les scénarios de science-fiction où l’humanité irait continuer son aventure dans les astres et disposerait de ressources en quantité à proprement parler astronomiques, on peut imaginer que nos sociétés verront un jour leur économie se contracter en raison d’un épuisement des ressources. Mais cela n’arrivera peut-être pas avant des lustres. Or, comme nous l’avons vu, ce serait probablement une erreur éthique de volontairement contracter l’économie, alors que l’on a encore les moyens d’améliorer nos conditions de vie, ainsi que celles de nos descendants. Il est donc préférable d’attendre avant de commencer à ralentir.
Ce délai dont dispose l’humanité avant une éventuelle contraction économique est d’autant plus grand que son développement repose moins sur la découverte de nouvelles ressources que sur sa capacité à utiliser les ressources à sa disposition. C’est en effet avant tout par son ingéniosité que l’humanité a surmonté les défis auxquels elle était confrontée. Elle pourrait donc repousser les limites terrestres pendant des décennies, voire des siècles, grâce à cette capacité d’invention. En un sens, il se pourrait même que la notion de « limites planétaires » soit une illusion. Dès lors, en limitant le développement des connaissances par le ralentissement de ses activités, l’humanité commettrait une grave erreur.
D’une métaphore à l’autre Finalement, après analyse, que reste-t-il de la métaphore qui compare la société à une voiture fonçant sur un mur ? Elle n’est manifestement pas pertinente. C’est plutôt l’image d’un « transformer » qu’il faut prendre, c’est-à-dire d’un de ces robots extraterrestres, issus de la série cinématographique éponyme et qui peuvent à tout moment se transformer en objets divers ou en véhicules. De fait, l’humanité n’est pas une entité définie une fois pour toutes et qui suit, sans se modifier, une unique route sans issue, barrée par un mur. Elle est plutôt un être multiforme, fondamentalement associé à la technique et à la recherche permanente d’innovations. Elle se transforme donc régulièrement, trouve de nouvelles sources d’énergie, élimine les obstacles, change de direction, se métamorphose, se réinvente. Bien sûr, même les « transformers » peuvent être à court d’énergie et sont mortels. Donc, même cette nouvelle métaphore ne doit pas nous laisser penser que nous n’avons pas, en tant que société, à faire attention à notre résilience. Cela étant dit, au lieu d’assigner à nos sociétés non seulement la perspective d’un déclin inéluctable, mais aussi d’un effondrement presque certain, cette nouvelle métaphore ouvre les possibilités en ce qui concerne le futur. Elle peut ainsi nous redonner goût à l’aventure humaine. En nous laissant entendre que nous avons les moyens de nous transformer et de transformer le monde, elle nous redonne l’espoir que nous pouvons encore réaliser plein de belles choses.