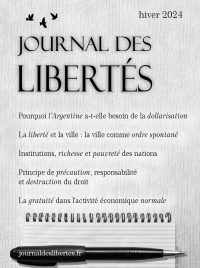Note de la rédaction : Les deux textes présentés ici ont été rédigés dans les années 1990 et ils n’ont malheureusement pris aucune ride. Les évolutions qu’ils anticipaient sont bien celles que nos sociétés ont suivies. Ce qui prouve la justesse de l’analyse et la nécessité de la prendre au sérieux.

Avec le principe de précaution nous arrivons au point d’orgue d’un processus engagé depuis le début du XXème siècle qui conduit à pervertir et inverser peu à peu le sens de tous les concepts les plus fondamentaux associés à une société de liberté. Le socialisme a changé la nature du concept d’égalité. Les marxistes ont retourné le sens du mot liberté. Le positivisme juridique a tellement élargi le domaine des « droits fondamentaux » que l’expression est aujourd’hui vidée de tout véritable contenu ( les « droits » ne sont plus que l’expression de désirs subjectifs faisant l’objet d’une apparente demande majoritaire). Il est normal que ce soit au tour du concept de « responsabilité » de subir à son tour une évolution de même type.
L’évolution est certes en cours depuis déjà pas mal de temps avec la tendance du droit de la responsabilité civile à céder la place à la notion de « responsabilité objective » : c’est-à-dire l’abandon de la faute comme critère d’incrimination (voir, par exemple, l’évolution de la législation qui concerne la responsabilité du producteur pour les risques inhérents aux produits vendus, la responsabilité concernant le transports des produits toxiques, la pollution des nappes d’eaux souterraines…). Il y a une vingtaine d’années, le Professeur Baudoin Bouckaert a écrit un remarquable article – Responsabilité civile : objective ou subjective ?[1] – où il montre comment la tendance contemporaine est de faire que c’est l’État lui-même qui, de plus en plus, par la loi ou le règlement, détermine a priori qui devra payer en cas d’accident portant dommage à des tiers, et cela indépendamment de savoir si celui dont on fait ainsi jouer la responsabilité civile a bien pris toutes les précautions possibles, s’il a agi avec prudence ou non, et donc s’il a commis ou non une faute. L’affaire du pétrolier Erika (1999) en est un bel exemple puisque le cœur du problème se trouve dans la ratification du protocole de 1992 qui a redistribué d’autorité les responsabilités entre les différentes parties prenantes possibles lorsqu’il y a naufrage. Les habitants du petit village de Bretagne qui a été débouté alors qu’il demandait à Elf de lui rembourser ses frais de nettoyage ont eu raison de se dire scandalisés par cette décision. Mais le juge n’avait fait qu’appliquer la loi telle qu’elle avait été refaite par les pouvoirs publics (et non « le droit »). Leurs protestations traduisent les contradictions et le malaise inévitables auxquels conduisent une telle approche du droit.
La théorie de la faute comme condition de la responsabilité
Le professeur Bouckaert démontre les conséquences d’une telle évolution. Tout accident est la conséquence d’une chaîne de causalités qui, à la limite, peut être presque infinie. « Chaque accident, écrit-il, est le produit d’une chaîne causale qu’on peut reconstituer, si on veut, jusqu’au « big bang » qui a donné naissance à notre univers ». Si un gosse, un jour de 14 juillet, fait éclater un pétard qui met le feu à la grange du maire, pourquoi ne pas remonter jusqu’au Chinois qui a inventé la poudre il y a plus d’un milliers d’année ? N’est-ce pas à cause de son invention qu’un tel événement a pu se produire ? Pour que la responsabilité soit un concept utile, il faut interrompre la chaîne des causalités quelque part, et disposer pour cela d’un critère. Dans la tradition occidentale du droit, ce critère est celui de la faute – que celle-ci soit appréciée en fonction d’attributs objectifs comme « l’invasion de propriété » (l’emissio romain), ou qu’elle résulte d’une évaluation subjective des faits de nature jurisprudentielle.
« La théorie de la faute, précise Baudoin Bouckaert, permet de s’arrêter à un maillon de la chaîne, en donnant à ce maillon une signification morale. La faute est dès lors considérée du point de vue juridique comme la fin de la chaîne. Toutes les causes précédentes sont alors effacées et deviennent invalides. »
Bouckaert décrit ce qui se passe lorsqu’on élimine la faute comme condition de responsabilité. « Tous les maillons de la chaîne reçoivent la même qualification morale. » Pourquoi s’arrêter là plutôt qu’ailleurs ? Pourquoi s’en tenir au gosse et ne pas condamner l’inventeur chinois ? Pourquoi pas le maire qui a « omis » d’interdire les pétards à moins de 50 mètres de toute habitation ? Pourquoi pas 500 mètres ? (Ce serait encore plus sûr). Pourquoi ne pas les interdire totalement ? Dès lors qu’il manque ce critère moral, il n’y a plus qu’une solution : c’est au législateur qu’il appartient de choisir, et de décider sur les épaules de qui retombera le devoir de responsabilité. Le législateur devient celui qui distribue le risque par décret. On passe dans un nouveau type de régime juridique où « une certaine activité se trouve légalement qualifiée comme risquée et un certain acteur dans le déroulement de cette activité est purement et simplement désigné comme l’auteur du risque, et donc comme coupable, chaque fois que l’accident se réalise ». La responsabilité ne devient plus qu’un terme générique pour toutes sortes de distributions de risque imposées par les autorités politiques.
Une telle évolution est profondément dommageable. Pour deux raisons. La première tient à ce qu’elle introduit dans le domaine de la responsabilité civile un élément inévitable d’instabilité, contraire à la tradition du droit, et à la fonction même du droit. Si c’est le législateur qui décide de la répartition des risques, ce qu’une législature fait, pourquoi la prochaine ne le déferait-elle pas, si la majorité des citoyens ont entre-temps changé d’avis ? Si l’instabilité de la législation économique, avec l’incertitude qu’elle crée, est déjà quelque chose que l’on peut regretter (ça n’aide pas à attirer les investisseurs étrangers), que dire dès lors que cette incertitude s’étend à un domaine aussi essentiel à l’organisation pacifique des rapports humains que la responsabilité juridique ?
Le retour du « Fatum » de l’Antiquité
La seconde raison est tout simplement que le choix du législateur ne peut qu’être arbitraire (puisqu’il n’y a plus l’élément « moral » qui permet de faire le tri entre les différents niveaux de causalité possible). L’attribution du risque va se faire en fonction de critères « politiques » dominés par des processus de lobbying. Le fait que celui-ci plutôt que tel autre soit désigné comme « responsable » – du moins aux yeux de la loi – sera d’abord et avant tout le reflet d’un rapport de force politique.
On deviendra « responsable » non pas en fonction d’une conception morale fondée sur des valeurs universelles ayant subi le test d’une longue histoire philosophique et jurisprudentielle, mais parce qu’on se trouve, à une certaine époque, dans des circonstances que l’on ne contrôle pas, plutôt du mauvais côté du manche. Question de malchance ! Et si c’est de la malchance, la responsabilité est donc quelque chose sur laquelle, à l’envers de toute la tradition philosophique et juridique sur laquelle s’est fondé le développement de l’Occident, je ne peux exercer aucune influence. Je dois m’y soumettre comme à toute fatalité. C’est quelque chose qui m’échappe, qui m’est totalement extérieur. Voilà revenu le « fatum » de l’Antiquité ! Exit l’idée même de « responsabilité individuelle », l’idée que les hommes conservent une certaine part de contrôle sur leur destinée, que l’exercice de leur « responsabilité civile » est précisément l’un des éléments les plus importants de ce contrôle moral sur leur vie.
On passe dans un autre univers. Un univers qui conduit directement à une pratique de la responsabilité conçue comme un instrument mécanique de contrôle social : il s’agit de susciter chez l’individu les bons stimuli – comme pour les souris de laboratoire –, de manière à lui inculquer les bons réflexes, ceux qui sont nécessaires à la réalisation des plans formés par le législateur. Le communisme a vécu, mais le socialisme, lui, est loin d’être mort ! Avec une telle évolution du droit il s’installe plus que jamais au fond même de nos esprits.
Une troisième conséquence du passage à une conception «_objective » de la responsabilité est – en conformité d’ailleurs avec la doctrine marxiste – d’instiller la discorde, le conflit au cœur même des rapports juridiques, alors qu’en toute logique la fonction du droit est au contraire d’être un facteur de concorde. C’est la raison pour laquelle les juristes – du moins les bons, les vrais – insistent su l’exigence de stabilité des règles de droit. Dès lors que la décision du législateur de faire retomber le risque sur une catégorie particulière d’individus ne peut plus s’expliquer par référence à des valeurs morales stables, il est normal qu’elle soit ressentie comme arbitraire, et donc contestable par ceux-là même qui se sentent ainsi visés. Le droit perd sa fonction fondamentale de cohésion, pour devenir un instrument de politisation généralisée de la société. Ce qui correspond d’ailleurs bien à la finalité de ceux qui se font les apôtres les plus ardents du principe de précaution : le « tout politique! ».
Le point d’orgue d’une dégradation fondamentale du droit
C’est dans cette perspective de dégradation fondamentale du droit qu’il faut replacer le problème du principe de précaution. La dynamique a connu une forte accélération avec l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 et l’esprit qu’ils ont introduit dans la rédaction des lois (rappelons-nous la loi Quillot par exemple ; la création des nouveaux mécanismes d’indemnisation des victimes d’accidents, etc.). La judiciarisation du principe de précaution représente en quelque sorte l’achèvement, l’apothéose de cette dérive, son point d’orgue.
Pourquoi ? Comment ? de quelle manière ? Le premier point sur lequel il convient d’insister est l’inanité du concept de « responsabilité collective » dont découle le principe de précaution. Par définition, le principe de précaution découle de la responsabilité que l’humanité présente aurait vis-à-vis des générations futures d’assurer qu’elle leur transmettra un monde encore vivable. L’idée est jolie, elle séduit. Mais ce ne sont que des mots. « Le Principe Responsabilité » relève du galimatias de philosophes en quête d’audience. Ce ne peut être un concept juridique, un concept fondateur de droit. Tout simplement parce que si les mots ont un sens, si les concepts ne sont pas des vases creux que l’on peut remplir avec n’importe quoi au gré des humeurs politiques de majorités changeantes, parler de « responsabilité collective » est une incohérence sémantique, c’est une contradiction dans les termes.
En raison même de la nécessité d’une « faute » comme condition nécessaire de déclenchement de la responsabilité, la notion même de responsabilité ne peut qu’être individuelle. La responsabilité ne peut être qu’un attribut de personnes dotées de conscience, et donc d’un sens moral. Or, sauf à être pleinement marxiste, au sens philosophique du terme, la notion de conscience – et donc de responsabilité – ne saurait s’appliquer à des entités collectives. Donc la formulation du principe de précaution est viciée à la base. On ne peut attendre d’une collectivité qu’elle soit dotée ni d’une conscience, ni d’un sens moral, autres que ceux attachés aux individus qui en font partie.
Certains diront que ce n’est qu’une question de définition. Que c’était peut-être ce qui se faisait autrefois. Mais qu’aujourd’hui tout est différent. Qu’après tout, les mots n’ont que le sens qu’on y met, et que si, aujourd’hui, la majorité de nos concitoyens y mettent quelque chose de différent, eh bien il faut nous y soumettre. Fort bien. Mais alors il faut en accepter toutes les conséquences, admettre qu’on ne peut pas tenir ce discours et s’attacher autour du cou une étiquette « libérale » dans la mesure où l’adopter revient à se rendre complice d’un processus inévitable de subversion radicale des valeurs centrales d’une conception libérale des rapports en société.
Indépendamment de ce que le principe de précaution est un concept vicié à la base (un « faux concept » comme dirait François Guillaumat), se pose également le problème de sa praticabilité ; des conséquences du passage à l’acte, de sa mise en application dans le cadre d’un système juridique concret. C’est ainsi que le principe de précaution aboutit à placer la notion de risque comme élément central de déclenchement d’une action juridique alors que la notion même de « risque objectif » n’existe pas.
On nous propose un système intellectuel qui nous donne une apparence réconfortante d’objectivité : il suffit d’évaluer, de mesurer les risques, et de comparer pour prendre des décisions. L’évaluation, la mesure, c’est le travail de la science, des savants. Puis, ensuite, viennent les politiques qui vont prendre la décision en fonction de ce que leurs diront les agences spécialement créées.
Une première difficulté vient de ce qu’adopter ce positionnement revient implicitement à faire des savants des sortes d’astrologues modernes à qui les dirigeants politiques demanderaient de rendre les oracles à la manière de l’antique Pythie d’Athènes. C’est une drôle de conception du rôle du politique, mais aussi de la science !
Mais le plus grave n’est pas là. Il est lié à ce que ce raisonnement confère au risque les attributs d’une grandeur susceptible de faire l’objet de mesures répondant à tous les critères d’objectivité qui sont aujourd’hui considérés comme l’apanage d’une démarche scientifique. Or c’est loin d’être le cas. Ce n’est même pas du tout le cas. Le « risque objectif » n’existe pas. Ce qui existe, ce sont des espérances individuelles qui font que, ex ante, nous gérons nos actes en fonction d’anticipations de gains ou de pertes. Le risque n’apparaît qu’ex post lorsque nous essayons a posteriori de reconstituer les probabilités statistiques que nous avions de réaliser ou non nos espérances. Comme cette distinction subtile passe au-dessus de la tête de la plupart des gens, même des juges, faire du principe de précaution un critère de responsabilité conduit à confier aux tribunaux le soin de juger, ou de trancher les conflits en responsabilité, en fonction d’une information qui, par définition, n’existait pas au moment où les décisions qui ont déclenché le dommage étaient prises. Autrement dit, on va demander aux juges de vous sanctionner en décidant a posteriori de ce que vous auriez dû faire (ou ne pas faire) en fonction d’un ensemble d’informations qui n’étaient pas disponibles au moment où vous aviez à prendre la décision. On entre dans un univers qu’il faut bien qualifier de délirant !
La tâche n’était déjà pas facile depuis qu’au milieu du XIXème siècle, comme le raconte Baudoin Bouckaert, on avait abandonné la doctrine de l’emissio romain, et avec elle le critère de la propriété comme élément d’établissement de la preuve d’une faute. Mais désormais, c’est autre chose. Comment savoir quels éléments seront pris en compte par le tribunal ? Comment seront calculées les soi-disantes probabilités « objectives » qui guideront sa décision et dont on assumera que vous auriez dû en tenir compte dans l’élaboration de votre décision ? Apparemment la démarche d’une cour de justice restera en principe la même : reconstituer l’univers de celui que l’on accuse au moment des faits afin de déterminer s’il y a eu faute de sa part. Mais au lieu de se référer à un élément stable et « objectif » – car faisant partie d’un corps de valeurs universelles reconnues par tous et dont l’usage a été poli par la jurisprudence : l’élément « moral » évoqué plus haut –, le débat sera désormais essentiellement informé par des arguments de type scientifique dont on sait, avec les querelles en cours autour de phénomènes comme l’effet de serre et le réchauffement climatique, à quel point ils sont souvent de nature contingente, et même politique, et sujets à fréquentes contestations et révisions.
Si l’on veut vraiment détruire la justice, il n’y a donc sans doute pas meilleure bombe ! On ne peut pas faire d’un concept aussi flou et aussi aisément manipulable la pierre de touche du régime juridique de demain. Sauf si le véritable objectif est de nous faire définitivement sauter le pas d’un autre ordre social. Pris au sérieux, le principe de précaution ne conduirait à rien moins qu’à la négation pure et simple du libre arbitre individuel dans la mesure où ce n’est plus la conscience qui présidera à la prise de risque (l’information personnelle éclairée et tempérée par la conscience), mais l’application de règles et de critères imposés en fonction de l’idée qu’une opinion dominante – médiatisée par ses prêtres – se fera de ce à quoi correspond le savoir scientifique du moment.
Un simulacre de justice
Paradoxalement, le mouvement de plus en plus accentué vers la responsabilité sans faute s’accompagne d’une exigence croissante de transparence, et donc de responsabilité – au sens classique du terme : des responsabilités individuelles (de qui est-ce la faute ? A qui, et non à quoi, doit-on notre malheur ? Qui rendre responsable ?) – de la part de l’opinion publique. Ce mouvement est en soi une saine réaction, une preuve a contrario de l’inanité de l’évolution juridique enclenchée depuis déjà de nombreuses années. Il crée une demande du public qui contraint à rechercher – ou tout au moins à désigner – les responsables. La médiatisation (et la politisation) de ces problèmes de risque nous ramène donc au problème de la fameuse chaîne : où faut-il s’arrêter ? Qui sera le coupable ?
Mais comment identifier, sur quels critères, un coupable dès lors qu’on a sorti la morale universelle du droit. L’attribution d’une culpabilité devient alors un artifice, un simulacre de justice qui consiste à désigner en définitive quel est le morceau de la chaîne qui fera le meilleur coupable, selon les objectifs économiques ou politiques poursuivis. Suivant les circonstances, on cherchera en priorité quel est celui qui est le mieux à même de payer (la politique de « deep pocket » des tribunaux américains), ou tout simplement la tête à couper la plus médiatique, celle qui fera le plus d’effet, et permettra d’orienter l’opinion publique « dans la bonne direction ». Et autant que possible chacun cherchera à faire en sorte que la victime désignée – le bouc émissaire de René Girard ? – appartienne à l’autre camp.
On retrouve l’état d’esprit des chasses aux sorcières d’autrefois. Ce n’est pas une simple métaphore. On sort clairement du Droit, tel qu’il a été conçu et développé par nos ancêtres comme instrument de civilisation et de civilité. On rentre dans ce qu’il faut bien appeler un univers de « non-Droit ».
Marché et risque technologique
Les nouvelles technologies font apparaître de nouveaux risques. Pas seulement d’extermination de l’humanité (nucléaire). Elles mettent en cause la survie même de l’homme. Cette situation, selon le philosophe allemand Hans Jonas, ferait apparaître une nouvelle obligation : l’obligation, à l’égard de la postérité, de l’existence d’une humanité future. Ce principe aboutirait à conférer aux générations futures des droits sur nous, et à nous confier, à nous, une responsabilité collective à leur égard.
Ces nouveaux droits de l’homme ont une particularité : ceux qui en sont les propriétaires n’existent pas encore et ne peuvent donc pas faire de procès à ceux qui ne les respecteraient pas. Il en résulte, selon Jonas, que l’organisation concrète de cette responsabilité collective à l’égard des générations futures ne peut se faire que par l’intervention réglementaire de l’État.
Il s’agit là d’un problème très actuel. A la conférence de Rio, en Juin1993, cela s’est traduit par la proposition de rendre obligatoire la réalisation d’études d’impact sur les technologies nouvelles, avant leur utilisation généralisée.
La logique de ces propositions est très simple. Les nouveaux produits (ou nouvelles technologies) peuvent apporter le meilleur comme le pire. Il s’agit de trouver des règles de décision qui permettent, d’une part, d’identifier et de classifier comme dangereux tous les produits réellement dangereux ; d’autre part, d’identifier et de classifier tous les produits offensifs comme inoffensifs. L’idéal est de ne laisser passer que les bons produits – ou, à la rigueur, les produits réellement inoffensifs –, et d’éliminer tous les produits dangereux.
Question : comment y arriver ? La réponse généralement proposée consiste à demander la création de comités de contrôle où siègent des experts, des politiques, des citoyens, des représentants des administrations, des entreprises, des milieux scientifiques, etc.
En réalité, il n’y a pas une solution, mais deux. L’autre solution possible est celle du marché, fondée sur le jeu de la responsabilité civile individuelle. Nous vivons dans un univers imparfait où nous commettons tous des erreurs. En ce qui concerne la technologie, il y a deux types d’erreurs possibles :
- le risque de laisser passer trop de mauvais produits, (aller trop vite) ;
- le risque d’arrêter le progrès en étant trop rigoureux, trop exigeant, trop conservateur (aller trop lentement).
Ces deux risques comportent des coûts humains et sociaux. Pour le premier, rappelons-nous le précédent de la thalidomide, et des bébés mal formés. Pour illustrer le second, on pourrait prendre l’exemple du SIDA et de tous ceux qui meurent du fait des lenteurs ou réticences de l’administration à homologuer de nouveaux médicaments.
Le fait d’aller trop vite est la cause d’accidents non prévus. Mais aller trop lentement implique que des malades ne sont pas soignés qui auraient pu l’être si l’on n’avait pas freiné volontairement le progrès en raison du risque; ou encore que des problèmes restent sans solution alors que des progrès pouvaient être faits qui auraient apporté les moyens de leur solution.
La bonne technique de contrôle est celle qui, consciente de ces deux options, établit un équilibre en fonction d’un choix argumenté et raisonné.
La solution réglementaire et politique favorise les choix les plus conservateurs. Pour trois raisons :
1. la rémunération et la carrière de ceux qui prennent les décisions sont exclusivement fonction du nombre de produits dangereux détectés et refusés;
2. à l’inverse, ils ne bénéficient d’aucune motivation particulière à bien veiller à ce que ne soient pas rejetés des produits bons ou inoffensifs, au nom de ce qu’ils seraient dangereux ;
3. par ailleurs, les risques de sanctions sont plus grands dans le premier cas que dans le second puisque les victimes d’une décision erronée sont plus facilement identifiables, alors que dans le second elles resteront inconnues à jamais.
Autrement dit, la caractéristique du processus de décision politique est qu’un produit est rejeté tant qu’il n’a pas prouvé son innocence. Tout y est dominé par le souci unilatéral et exclusif de diminuer les risques liés à la présence de produits dangereux qui auraient échappé à l’intention des censeurs.
Ce phénomène est encore renforcé par la composition des comités d’examen et de surveillance. S’agissant des représentants du public : qui est prêt à donner son temps ? Plutôt ceux qui sont idéologiquement motivés, et donc, dans les circonstances présentes, plutôt a priori hostiles à la science et aux entreprises. S’agissant des représentants du secteur public : il y a toutes chances qu’y dominent des lobbies plutôt anti-technologie (dès lors qu’il ne s’agit pas de secteurs industriels appartenant au secteur public). Enfin, les représentants des entreprises : ils viendront plutôt des firmes les moins innovantes, à qui l’on confiera le soin de réguler la concurrence.
Les adversaires des solutions libérales affirment qu’avec le marché, c’est le danger inverse qui domine. Cela n’est pas nécessairement vrai. Toutes les entreprises sont prisonnières de contraintes de prudence. Aucune entreprise ne peut se permettre de lancer sur le marché n’importe quel produit. Les entreprises restent soumises au jeu de la responsabilité juridique (sauf là où l’État les en dispense).
Ces impératifs de prudence sont paradoxalement beaucoup plus forts dans le monde des oligopoles industriels contemporains, que sur le marché politique. C’est la conséquence du rôle de plus en plus important qu’y jouent les effets de réputation. Des milliards sont chaque jour engloutis par les firmes dans des actions de prestige ou de communication pour établir et maintenir une réputation qui, au moindre pépin, peut se trouver ruinée du jour au lendemain.
Cette simple discipline financière signifie que les entreprises sont contraintes d’employer des gens dont le seul rôle est en permanence de se faire les « avocats du diable », et d’expliquer pourquoi il ne serait pas sage de faire ceci ou cela. Résultat : dans les entreprises modernes, les forces de résistance au changement et à l’innovation ne sont en réalité pas moins fortes que dans les autres organisations.
Sauf qu’il y a une différence. Ces firmes fonctionnent en milieu concurrentiel, et restent soumises à la loi du profit. Elles subissent une contrainte de survie que les organismes bureaucratiques et politiques ne connaissent pas. Ce qui signifie que, malgré toutes les contraintes de prudence auxquelles elles sont obligées d’obéir, elles sont également forcées d’innover et de faire appel à d’autres gens dont le rôle est, cette fois-ci, de se faire les avocats internes de l’innovation et du progrès.
La caractéristique de la firme moderne est ainsi d’organiser un dialogue permanent entre les pour et les contre ; un dialogue qui n’existe pas, pour les raisons évoquées plus haut, dans les organisations étatiques.
Le monde étant ce qu’il est, le problème n’est pas d’éliminer le risque car, par définition, cela n’est dans le pouvoir de personne. Ce qui compte, en revanche, est de découvrir le processus décisionnel en mesure de garantir que les décisions prises le seront après un débat aussi argumenté, rationnel et équilibré que possible. C’est précisément ce que rend possible la structure institutionnelle de l’entreprise libre.
Nous retrouvons ici toutes les propriétés dynamiques du calcul économique. C’est à dire la double présence d’impératifs de prudence et de risque qui poussent à une analyse non pas aussi objective que possible (l’objectivité n’existe pas), mais aussi équilibrée, argumentée et rationnelle que possible.
C’est ce que permet de réaliser le système de marché, et qui n’est pas possible dans les structures de dialogue et de délibération publiques.
[1] Document ICREI téléchargeable à https://bit.ly/3DZsvKV