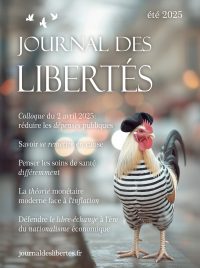Table ronde: La retraite par capitalisation, enfin !
animée par Erwan Queinnec avec la participation de :
- Bertrand Martinot, Institut Montaigne
- Nicolas Marques, Institut Molinari
- Jean-Philippe Delsol, IREF
Une des raisons de l’incapacité à rétablir les finances de l’État en France est l’envol des dépenses contraintes liées aux erreurs du passé. Les dépenses de retraite de l’État représentaient 66 Mds € en 2024, soit 38 % du déficit public (170 Mds). Quand on ajoute la charge d’intérêt associée à la dette publique (63 Mds), le coût du passé explique 3/4 du déficit public en 2024.

Pour des raisons historiques, les retraites versées par l’État employeur ne sont pas provisionnées et sont à la charge du budget. L’État gère en dehors de la répartition les retraites de ses fonctionnaires. Elles représentent des masses significatives, l’État étant le troisième pourvoyeur de retraites de France derrière la CNAV et l’Agirc-Arrco. Les retraites de l’État sont versées sans mécanisme permettant de prévenir l’envol des dépenses, sans réserve financière et leur financement repose sur budget, c’est-à-dire sur le contribuable.
Avec la dégradation du ratio retraité par cotisant liée à l’arrivée à maturité de la taille de l’État, les retraites des fonctionnaires civils de l’État devraient représenter 89 % de leurs traitements indiciaires en 2025. Elles sont trois fois plus coûteuses que celles du secteur privé, financées avec 28 % de cotisations sur les salaires bruts. Ce phénomène, masqué dans les travaux du Conseil d’orientation des retraites, creuse le besoin de financement de l’État et contribue au caractère systématique de ses déficits depuis 1981.
Depuis plusieurs décennies, la stratégie publique a été de rapprocher le régime de retraite des fonctionnaires d’État de celui du secteur privé dans l’espoir de le fusionner avec celui des salariés du privé. Cette stratégie a échoué en 2020, la mise en place du régime universel de retraite étant ajournée sine die. Par conséquent, les comptes de l’État resteront structurellement déséquilibrés si rien n’est entrepris. En effet, les mesures traditionnelles visant à reculer l’âge de la retraite ou réduire les différences public/privé ont un effet limité, l’essentiel des besoins de financement découlant du ratio retraité par cotisant dans la Fonction publique d’État.
Cette contrainte peut être transformée en opportunité. Provisionner les retraites des fonctionnaires – c’est-à-dire, placer des capitaux pour financer leurs retraites – permettrait d’alléger significativement la facture pour les finances publiques. Au lieu d’être intégralement financées par des prélèvements obligatoires et des déficits, les retraites des fonctionnaires seraient financées par le rendement de l’épargne, à l’image de ce que fait la Banque de France avec sa capitalisation retraite.
La banque centrale française a placé 14 Mds € permettant de provisionner intégralement les retraites de ses personnels, mais aussi de restituer à l’État 2,6 Mds € correspondant aux excédents de provisionnement depuis 2020. Si l’État avait provisionné l’intégralité des retraites, il aurait auto-financé ses retraites sur les 8 dernières années. Bien sûr, se mettre au niveau de la Banque de France n’est pas une opération anodine. Pour faire comme elle, l’État devrait placer 1 640 Mds ou 64 % du PIB correspondant à la valorisation des promesses de retraites faites aux fonctionnaires d’État.
L’objection traditionnelle au provisionnement est qu’il faudrait « payer deux fois » dans la phase transitoire pour assumer les pensions promises aux retraités et en même temps constituer un fonds pour autofinancer les retraites futures. Pour certains, cela ne serait faisable qu’à condition de rééquilibrer les finances publiques. Ce raisonnement présente deux lacunes majeures. D’une part, il inverse les causalités. Sans réduction significative de charge liée aux retraites, une remise en ordre des finances publiques est improbable. Surtout, même financé par de l’endettement, le provisionnement est un investissement particulièrement rentable.
Aussi, nous avons simulé un provisionnement intégral des retraites des fonctionnaires d’État par endettement avec un jeu standard d’hypothèses (taux d’intérêt OAT 10 ans à 3,6 %, rendement de la capitalisation 6,3 %, inflation 2,1 % et croissance 0,8 % par an). Si l’État empruntait et plaçait 1 % du PIB par an il disposerait d’une capitalisation retraite représentant 64 % du PIB au bout de 35 ans. Comme la dette générée par la montée en puissance de la capitalisation (1 % du PIB par an) représenterait 39 % du PIB futur, la création de richesse nette serait de 25 % du PIB. Une partie des recettes générées par l’épargne permettrait d’autofinancer les retraites des fonctionnaires d’État. Le reste des gains permettrait de maintenir constants par rapport au PIB le fonds de pension et la dette ayant financé sa montée en puissance.
Si le choix était fait d’alimenter ce fonds sur 42 ans, les résultats seraient encore plus spectaculaires. La capitalisation représenterait à terme 88 % du PIB. La dette générée par sa montée en puissance représenterait 48 % du PIB et la création de valeur nette serait de 40 % du PIB. L’épargne retraite générerait plus de 2 % de PIB par an de gains nets d’inflation, ce qui permettrait d’autofinancer l’intégralité des retraites des fonctionnaires d’État. L’État serait dans la situation de la Banque de France qui autofinance les pensions de ses personnels grâce à la capitalisation.
Même dans une perspective de remontée des taux, cette opération serait gagnante, sauf à penser que le différentiel entre le rendement associé aux placements à long terme et le coût de la dette pourrait disparaitre structurellement. Ajoutons que provisionner augmenterait la qualité de la dette française. Cette démarche enrichirait patrimonialement l’État et offrirait de la visibilité aux détenteurs de dette, les engagements implicites liés aux retraites étant réduits à néant.
Pour en savoir plus : Marques, Nicolas (2025). Provisionner les retraites des fonctionnaires pour restaurer les finances publiques (36 p). Paris-Bruxelles : Institut économique Molinari.