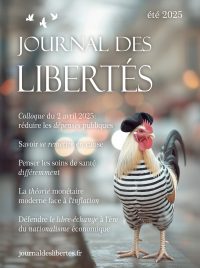Parmi l’ensemble des questions associées à l’immigration – enjeu devenu majeur dans le débat public en France –, celle de son bilan économique et budgétaire fait certainement partie des plus débattues. Tandis que les enquêtes sondagières attestent d’un souhait de réduction des flux migratoires largement majoritaire dans l’opinion publique, nos compatriotes apparaissent plus partagés sur cet aspect spécifique du sujet : 38 % des sondés considèrent ainsi que « l’immigration rapporte plus à la France qu’elle ne lui coûte », selon une étude Ifop-Fiducial parue en 2023.

Å cette aune, de précieuses bases de données ont été rendues publiques par l’OCDE, dans le cadre de sa plus récente publication sur « les indicateurs de l’intégration des immigrés ». Leur analyse comparative permet de dresser un constat frappant, qui doit nécessairement servir de base à notre analyse sur le sujet du jour : l’immigration accueillie en France est globalement moins intégrée au marché du travail et plus « pauvre » qu’ailleurs en Europe.
Seule la moitié (51,6 %) des étrangers extra-européens en âge de travailler occupaient un emploi en France en 2020, soit un taux inférieur de 14 points à celui des citoyens français – mais aussi 15 points de moins que les étrangers extra-européens au Royaume-Uni, 9 points de moins qu’au Danemark, 6 points de moins qu’en Allemagne. Le taux de chômage des étrangers extra-européens en France était, quant à lui, plus du double de celui des Français : 19,5 % contre 8 %.
Par ailleurs, le taux de pauvreté relative (calculé par rapport au salaire médian de chaque pays) des ressortissants extra-européens vivant en France est le plus élevé d’Europe, à égalité avec l’Espagne : 47,6 % d’entre eux vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020, soit une part quatre fois supérieure à celle des citoyens français (11,5 %) .
Pour mieux comprendre ces constats saisissants, plusieurs éclairages méritent d’être pris en compte. Le premier réside dans la répartition des raisons légales d’installation sur le territoire : la part des entrées d’immigrés (toutes origines confondues) effectuées sur le fondement d’un motif « Famille » est la plus élevée en France parmi toute l’Europe de l’Ouest. Elle a représenté 41,2 % des entrées d’immigrés permanents sur la période 2005-2020, soit un taux trois fois supérieur à celui constaté en Allemagne, contre 10,5 % pour le motif « Travail ».
D’autre part, 42,6 % des étrangers extra-européens en âge actif et sortis du système scolaire n’avaient aucun diplôme ou seulement un niveau brevet en 2020 – soit une proportion supérieure de 26 points à celle des Français (16,7 %).
La France accueille l’immigration la plus africaine parmi tous les pays développés, avec un différentiel très marqué par rapport à nos voisins : 61 % des immigrés de 15 à 64 ans vivant en France en 2020 étaient originaires du continent africain (Maghreb et hors-Maghreb), soit une part trois fois supérieure à la moyenne de l’UE.
Les difficultés de la « deuxième génération » issue de l’immigration apparaissent plus marquées dans notre pays qu’ailleurs : la part des jeunes nés en France de parents immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en scolarité ni en formation (24 %) se trouve être la deuxième plus élevée d’Europe – et même du monde occidental. Seule la Belgique connaît des chiffres plus mauvais dans ce domaine.
Si les réussites individuelles issues de cette immigration sont nombreuses et qu’une approche nuancée mérite d’être déployée, il n’en demeure pas moins que l’analyse rationnelle dessine une réalité marquée par une forte prévalence des profils de « consommateurs fiscaux nets », sur-bénéficiaires et sous-contributeurs des dispositifs de solidarité collective.
Il est important de souligner que lesdits profils ne se résument pas aux chômeurs et aux inactifs : un immigré ou un étranger qui travaille dans un emploi peu qualifié – et rémunéré – a toutes les chances de consommer plus de dépenses publiques qu’il n’y contribue.
Ce différentiel de consommation est spécialement marqué dans certains champs de dépenses publiques. Prenons un seul exemple – celui de la santé, qui représente au moins 250 Mds € de dépenses publiques chaque année.
Au niveau mondial, les travaux scientifiques ont longtemps considéré que les personnes immigrées étaient généralement en meilleure santé que les populations natives des pays d’accueil – car globalement plus jeunes et en meilleure forme physique. C’est ce qu’on appelle le healthy immigrant effect (« phénomène de l’immigré en bonne santé »), qui est toujours observable aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, en Australie…
En France, l’analyse des données disponibles permet d’établir un constat inverse : l’état de santé général des immigrés dans notre pays est aujourd’hui significativement moins bon que celui des non-immigrés, ce qui les conduit à consommer plus de soins dans notre système de santé (notamment hospitalier), tout en contribuant moins au financement de celui-ci du fait de leurs plus faibles niveaux d’emploi et de revenus. Il s’agit là d’une véritable « dette de santé » importée en France, qui internalise largement les défaillances des systèmes de santé existant dans les pays d’origine.
Ce déséquilibre de la contribution financière de l’immigration au système de santé est particulièrement marqué sur deux catégories quasi intégralement financées par la solidarité nationale : l’aide médicale de l’État (AME) et le « séjour pour soins ». L’AME, réservée aux étrangers en situation irrégulière sous condition de ressources, est une exception en Europe, par l’ampleur du panier de soins qu’elle prend en charge à 100 %. Dès 2019, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a relevé que plus d’un quart des étrangers en situation irrégulière citaient les soins parmi les raisons de leur migration. Le budget de l’AME a augmenté de 65 % en dix ans, et son nombre de bénéficiaires a triplé en 20 ans – ce qui atteste de la dynamique plus globale de l’immigration clandestine.
Le sujet des titres de séjour pour soins est moins fréquemment médiatisé. Il s’agit pourtant d’une disposition unique au monde, consistant à accorder le droit au séjour en France à des étrangers malades qui ne peuvent bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Les différents rapports de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pointent de manière récurrente son caractère opaque et particulièrement onéreux, car sans restriction de plafond ni limitation de durée – avec des traitements médicamenteux pouvant coûter jusqu’à 1 million € par an pour un seul patient étranger, sans même parler du coût strictement hospitalier.
Pour ce qui est des dépenses publiques en général : l’estimation du « bilan fiscal » ou du « coût net » de l’immigration pour les finances publiques est un exercice techniquement délicat, qui dépend notablement du « périmètre » retenu dans les estimations : quel éventail de dépenses et de contributions, quelles populations issues de l’immigration (seulement la première ou aussi la deuxième génération, etc.). Il n’en demeure pas moins qu’aucun scénario sérieux ne paraît aujourd’hui pouvoir aboutir à un bilan positif.
L’entrepreneur Pierre Danon a produit une étude remarquable à ce sujet pour l’Observatoire de l’immigration et de la démographie en début d’année. En retenant seulement le critère de la nationalité étrangère, l’immigration (régulière et irrégulière inclues) représente un coût annuel net estimé à 41 Mds € – une fois retranchées les contributions des étrangers. Les principaux coûts de l’immigration sont dus aux dépenses de santé, aux pensions de retraites et aux allocations chômage, aux prestations de solidarité, aux dépenses d’hébergement et de logement. Ce déficit provient principalement des étrangers extraeuropéens qui ne sont pas en emploi.
Il faut prendre la mesure d’un tel manque à gagner pour l’État – et donc pour les contribuables : cette somme équivaut à un tiers des recettes de l’impôt sur le revenu, ou à tout le budget du ministère de l’Intérieur. Un tel constat ne peut évidemment laisser place à l’inaction. Pour réduire vraiment ce coût de l’immigration pour les finances publiques, deux temps d’action sont envisageables.
Le premier se situe à court et moyen terme, à cadre constitutionnel et conventionnel constant – c’est-à-dire, sans toucher aux traités internationaux et européens, par exemple. Dans son étude que je citais précédemment, Pierre Danon met en lumière une série de mesures directement applicables qui permettraient d’économiser jusqu’à 7 Mds € par an :
- Des conditions plus exigeantes pour bénéficier du regroupement familial, comme l’allongement de la durée minimale de résidence préalablement à la demande et le fait de disposer de ressources au moins équivalentes au salaire médian en France.
- Le recentrement des filières universitaires ouvertes aux étudiants étrangers sur les études scientifiques et de médecine pour lesquelles les besoins de main d’œuvre future sont prioritaires (a-t-on vraiment besoin d’avoir des centaines ou des milliers d’étudiants algériens en sciences sociales dans nos universités ?).
- Instaurer un délai de carence de plusieurs années pour l’accès des étrangers extra-européens aux prestations sociales non-contributives. Aujourd’hui, si l’on prend l’exemple des prestations familiales : celles-ci sont accessibles dès 9 mois après l’installation en France, sans aucune limitation selon la nationalité.
- Des conditions plus restrictives pour bénéficier du titre de séjour « étranger malade », afin de mettre fin aux dérives observées au cours des dernières années.
- Supprimer les droits à l’AME et à l’hébergement d’urgence dès lors qu’une OQTF est prononcée. Sait-on que 40 à 60 % des places d’hébergement d’urgence du parc de l’État sont aujourd’hui occupées par des immigrés en situation irrégulière, pour un coût annuel chiffré à un 1 Mds € par la Cour des comptes ?
Mais au-delà de ces mesures concrètes et relativement rapides à mettre en œuvre, le fond structurel du sujet implique de retrouver notre capacité politique à choisir réellement l’immigration que nous recevons, tant dans son nombre que dans sa nature. Et cela implique de lever un certain nombre des lourdes contraintes juridiques accumulées par ce qu’il faut bien appeler le « gouvernement des juges », au niveau constitutionnel, européen et international. Il s’agirait de considérer l’immigration comme n’importe quelle autre politique publique, ayant pour objectif de minimiser les coûts et de maximiser les bénéfices pour la société française. La tâche d’engager cette révolution copernicienne est bien sûr immense, mais sa nécessité urgente apparaît plus évidente que jamais.