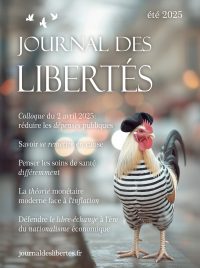Faisons un petit retour historique sur la situation du Canada au milieu des années 90. À cette époque, le Canada avait un taux d’endettement public – si l’on combine le gouvernement fédéral et les provinces – d’à peu près 100 % du PIB. La situation était si dégradée que, dans l’un de ses éditoriaux, le Wall Street Journal était allé jusqu’à qualifier le Canada de membre honoraire du tiers monde – l’éditorial étant titré « Le peso canadien », en référence au peso mexicain. Alors donc que notre dette se montait à 100 % du PIB, un revirement assez spectaculaire fut opéré sous le gouvernement de Jean Chrétien, membre du Parti libéral du Canada. (« Libéral » au Canada n’a pas la même signification qu’en France : le parti libéral canadien est un parti plutôt centriste.) Ce qu’il est intéressant de noter est la rhétorique sur laquelle s’appuyait ce revirement dans la gestion des finances publiques : il ne s’agissait pas d’opérer une révolution libérale au sens de free market, mais plutôt de sauver les services publics ; l’argument consistant à dire que nos finances publiques sont en tellement mauvais état que si rien n’est fait, on ne sera plus capable d’assurer les mêmes services publics dans l’avenir.

Si vous êtes un authentique libéral, telle n’est sans doute pas votre rhétorique préférée, mais il faut avouer qu’elle n’est pas sans mérite : entre 1995 et 1999 les dépenses du gouvernement fédéral ont baissé de 19 % en terme absolu avec une réduction de 14 % des effectifs de la fonction publique. Parmi les exemples les plus spectaculaires de réduction de dépenses, il y a eu Transport Canada qui a vu son budget réduit de 50 %. Globalement, les subventions aux entreprises ont été réduites de 60 % et de grandes entreprises publiques ont été privatisées (à l’instar de la société de transport ferroviaire Canadien National) ; l’État fédéral se recentrant dans le même temps sur ses missions essentielles.
Ce qui est intéressant, et souvent ignoré, c’est qu’avant la fameuse période des mandats de Jean Chrétien (1993-2003) puis Paul Martin (2003-2006), il y a eu le bref gouvernement conservateur de Kim Campbell. Si celui-ci n’a duré pas plus de 8 ou 10 mois, ils ont quand même supprimé 9 ministères, 80 postes de hauts fonctionnaires, 50 000 postes de la fonction publique ; le tout pour des économies récurrentes annuelles de 30 milliards canadiens. Kim Campbell ne reçoit généralement pas de crédit pour ça.
Pour revenir au revirement, celui-ci a été déclenché par une combinaison de facteurs. Tout d’abord, un large consensus autour du constat que le modèle canadien, tel que pratiqué à l’époque, ne pouvait plus fonctionner ; de là des pressions populaires pour réformer. Autre facteur clé : les activités de plusieurs instituts et think-tanks qui poussaient dans cette direction (l’Institut C.C Howe, le Fraser Institute, l’Institut Économique de Montréal). Les médias ont également été de la partie, y compris ceux qui ne sont pas tellement favorables aux idées libérales. Tous s’accordaient pour dire que, si le Canada continuait ainsi, il ne serait pas en mesure de maintenir ses services publics. Il y avait donc un assez large consensus gauche-droite, mais aussi de l’opposition officielle au gouvernement fédéral d’Ottawa qui était un parti à l’époque très conservateur économiquement et donc on pourrait dire plutôt libéral au sens classique du terme, ceci à tout le moins sur le plan des politiques fiscales. Le fait que la principale opposition politique appelait de ses vœux des réformes encore plus ambitieuses que celles proposées par le gouvernement a donc aidé le gouvernement en place.
Le contexte fiscal a, lui aussi, participé au revirement. Il est en effet faux de croire qu’il y a eu uniquement une réduction des dépenses publiques. Quand on regarde les choses de plus près, on constate que la réduction des dépenses publiques représentait 2/3, voire seulement 60 % du redressement, l’augmentation de recettes fiscales constituant les autres 40%. Le gouvernement précédent, celui du Premier ministre Brian Mulroney (1984-1993), avait mis en place une TVA de 7 % – plus précisément la TPS, Taxe sur les produits et services – parce qu’il n’y avait pas de TVA fédérale au Canada à l’époque. Cela s’est traduit par des recettes fiscales supplémentaires. Le Canada a donc pu tirer parti du fait que son assiette fiscale, à l’époque, n’était pas complètement utilisée. Une « chance » que tous les pays n’ont pas.
Si le bilan de ce redressement fut globalement positif, quelques zones d’ombre sont toutefois à déplorer ; en commençant par le recours à des pratiques comptables trompe l’œil laissant paraître les choses meilleures qu’elles ne l’étaient (dépenses publiques artificiellement sorties des comptes fédéraux, création de fondations privées financées par l’État…). Il y a eu aussi l’appropriation des surplus de l’assurance chômage – qu’on appelle aujourd’hui assurance emploi. Cette assurance, financée par les employeurs et les employés et non pas les contribuables, est un fond dédié ; un fond prudentiel sans lien avec l’État. Le gouvernement fédéral a pourtant mis la main sur ses surplus afin de financer sa réduction du déficit fédéral. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême qui a finalement validé la manœuvre par une décision pour le moins discutable. Rappelons enfin que la réduction des dépenses fédérales s’est faite en partie par la réduction ou le gel des transferts aux provinces, augmentant ainsi les déficits de ces dernières.
Puis vint le gouvernement de Justin Trudeau et avec lui le retour à des déficits importants – ce qui le rapproche des politiques suivies par son père dans les années 70-80. Pourtant, même avec la mauvaise gestion du gouvernement libéral actuel, les dépenses publiques du Canada, en incluant les dépenses des provinces, s’élèvent à 69 % du PIB. Ce chiffre était tombé jusqu’à 54 % ; il révèle donc une situation encore viable mais néanmoins préoccupante.
Quelle leçon tirer de ces expériences ? Évidemment, nous sommes nombreux à rêver d’une authentique révolution libérale, et il est vrai que l’Argentine est en train de nous montrer que c’est possible. Nous pouvons donc continuer d’espérer une telle révolution pour la France ou le Canada. Mais cela me semblant peu probable, je voudrais terminer par un plaidoyer en faveur de ce que j’appellerais un « centrisme intelligent » qui permettra de maintenir la viabilité de l’État canadien –et mon intuition me dit que ce serait sans doute également valable pour la France. Si on y réfléchit, nul n’est besoin de réduire les dépenses publiques ; il suffit de limiter leur croissance. Dans le cas du Canada, cette stratégie fonctionne à condition d’appliquer la bonne formule. Si, par exemple, la hausse des dépenses publiques est limitée à la croissance de la population plus inflation et que cette discipline fiscale est maintenue sur une longue période, alors l’effet est absolument spectaculaire : les simulations réalisées pour le Canada montrent que l’on passe rapidement de déficits récurrents à des surplus importants[1]. Encore une fois, je compte plutôt parmi ces minarchistes qui auraient bien envie de voir les dépenses publiques diminuer de 90 %. Mais il est bon de savoir que si l’on parvient à établir un consensus national sur le contrôle des dépenses à long terme alors, en général, et plus encore si des politiques qui favorisent la croissance économique sont mises en place, un réalignement des finances publiques absolument spectaculaire s’opère. Le problème auquel il faut urgemment s’attaquer est celui de la croissance effrénée des dépenses publiques. Et il y a fort à parier que ce qui est vrai pour le Canada et d’autres pays pour lesquels les simulations ont été faites, soit également vrai pour la France.
[1] Les deux études suivantes donnent de plus amples détails sur cette stratégie et ces simulations : « Les surplus de 15 Mds que le Québec aurait pu avoir », IEDM, juin 2014 (https://www.iedm.org/files/lepoint0414_fr.pdf), « Budget provincial : une croissance des dépenses insoutenable », IEDM, mars 2022 (https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2022/03/note042022_fr.pdf ).