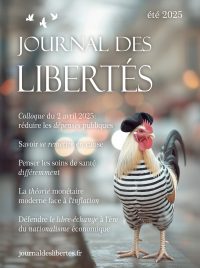Retour sur la polémique autour de la comptabilisation du « déficit des retraites »
Il n’existe pas en comptabilité nationale d’agrégat comptable « solde des retraites ». En effet, la comptabilité nationale fonctionne de manière institutionnelle : l’État, les administrations publiques locales, les administrations de sécurité sociale, etc. Mais comme les dépenses et les recettes dédiées aux pensions se retrouvent un peu dans tous les secteurs, il est très difficile d’établir un solde.
Pour préciser les choses : il n’est pas très difficile de retracer les dépenses car on sait précisément, et heureusement, identifier ce qu’est un euro de pension… ! Ce sont un peu plus de 400 Mds € tous régimes confondus en 2024.

Le problème est beaucoup plus compliqué quand il faut attribuer telle ou telle recette au « système de retraite ». En effet :
- Les recettes sont entremêlées : par exemple, environ 30 % des recettes du régime général sont en fait des transferts d’impôts, de taxe et de subventions diverses de l’État ou d’autres organismes sociaux (branche famille, assurance chômage, etc.)
- Les pensions versées par l’État aux anciens fonctionnaires sont « à l’équilibre » par construction puisqu’il n’y a pas de « caisse de retraite » pour l’État.
- L’État et la Cour des comptes retiennent un mode de calcul qui fait que (i) les retraites de la sphère publique sont par construction à l’équilibre et que (ii) tous les transferts et subventions vers le régime général (celui des salariés du secteur privé et assimilés) sont comptabilisés comme de véritables recettes. Cette approche, qui aboutit par exemple à un déficit prévisionnel de « seulement » 6,5 Mds € pour 2025 tous régimes confondus (à comparer aux quelques 170 Mds € de déficit de l’État…), est très certainement une façon de compter qui embellit les choses.
En procédant à un travail comptable très méticuleux distinguant les recettes qui doivent être effectivement comptabilisées et celles qui ne sont que des sortes de subventions d’équilibre, Jean-Pascal Beaufret, aboutit à un « déficit des retraites » de 81 Mds € en 2024.
En réalité, je ne crois pas qu’il y ait de « vérité comptable ». Je me bornerai à un raisonnement un peu fruste mais qui a une certaine pertinence économique : si les dépenses de retraite représentent un quart de la totalité des dépenses publiques, on peut considérer qu’elles doivent contribuer à environ un quart à la formation du déficit public dans son ensemble, soit un quart de 170 Mds, soit presque 45 Mds €.
Au-delà de ces quelques remarques, je pense que le sujet des retraites doit être abordé du côté des dépenses. Considérer le solde revient à laisser penser qu’il suffirait de transférer davantage de recettes de l’État ou d’autres administrations publiques vers la sphère « retraites » pour régler le problème. Bien entendu, cela reviendrait très exactement à boucher un trou en en creusant un autre ailleurs. Ce raisonnement est inaudible, et il ne manque pas de responsables syndicaux pour utiliser le mode de calcul retenu par la cour des comptes pour minimiser le problème.
2. Les modalités de création d’un pilier de retraite par capitalisation
Il y a un consensus assez général parmi les économistes pour considérer que l’introduction d’un pilier par capitalisation dans notre système public de retraite (aujourd’hui quasiment à 100 % par répartition) irait à la fois dans le sens de l’efficacité économique et de l’équité. Je ne reviens pas sur les raisons qui ont été rappelées par les autres intervenants.
Bien entendu, la question qui se pose est celle de la phase de transition, longue période durant laquelle il faut à la fois accumuler du capital, commencer à verser des pensions par capitalisation et, bien entendu, honorer les pensions par répartition existantes. Le risque est donc de faire subir aux actifs (et aux entreprises) une hausse importante des cotisations pesant sur le travail, alors même que nous partons du niveau le plus élevé de l’OCDE (28 % du salaire brut).
En outre, la capitalisation ne résout en rien les déséquilibres financiers du régime par répartition. Mieux, créer un pilier capitalisation, donc accumuler des actifs financiers dédiés, tout en laissant le pilier par répartition dériver, serait assez absurde.
Dans ces conditions, les conditions de réussite d’une telle opération sont, il faut bien le dire, très exigeantes. J’en cite quelques-unes :
- Il faut trouver du capital pour amorcer le fonds, par exemple en mobilisant des actifs existants (l’État pourrait y placer certains de ses actifs, ou en acheter sur le marché).
- Il faut accélérer la baisse des cotisations dédiée à la répartition, ce qui suppose d’accélérer la baisse des dépenses sur le pilier répartition, donc des réformes douloureuses dont je donne des exemples dans ma note récente pour la Fondapol[1] .
- Faire contribuer les retraités actuels à l’amorçage du système, via par exemple une désindexation temporaire des pensions actuelles ou encore une suppression de l’abattement de 10 % sur les pensions.
Pour résumer, la capitalisation a d’immense vertus sur le long terme. Mais elle suppose des sacrifices sur le court terme pour les générations actuelles, car il faut épargner plus et travailler plus. L’enjeu en vaut la peine, mais il serait illusoire de penser qu’une telle opération serait politiquement facile.
C’est pourquoi la seule voie de passage est de convaincre les politiques que continuer le rafistolage permanent du système actuel sans toucher à ses fondamentaux nécessiterait lui aussi des sacrifices (déclin inéluctable des pensions), avec l’inconvénient supplémentaire de sacrifier les générations futures…
Comme souvent en politique, pour citer Raymond Aron, nous n’avons ici le choix qu’entre le préférable et le détestable… !
[1] « Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation », Fondapol, Mars 2025 : https://rebrand.ly/yl99h0eFondapol.