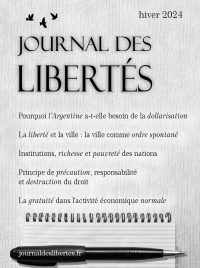Acemoglu, Johnson & Robinson ont été conjointement désignés en octobre comme lauréats 2024 du Prix de science économique que remet annuellement la Banque de Suède, en mémoire d’Alfred Nobel. Le communiqué de la Fondation Nobel annonce que cette médaille récompense les travaux que ces trois lauréats ont conduits depuis un quart de siècle sur les institutions politiques, économiques et sociales qui conditionnent la prospérité des nations. Cette récompense n’est pas vraiment une surprise : j’en veux pour preuve que le « chapeau » de l’entretien accordé en novembre 2023 par Daron Acemoglu au magazine Le Point présentait déjà ce professeur du MIT, d’ascendance turque et arménienne, comme l’un de ceux dont le nom était « régulièrement cité dans la liste des nobélisables »[1]. Sa consécration en 2024 n’est donc pas étonnante.
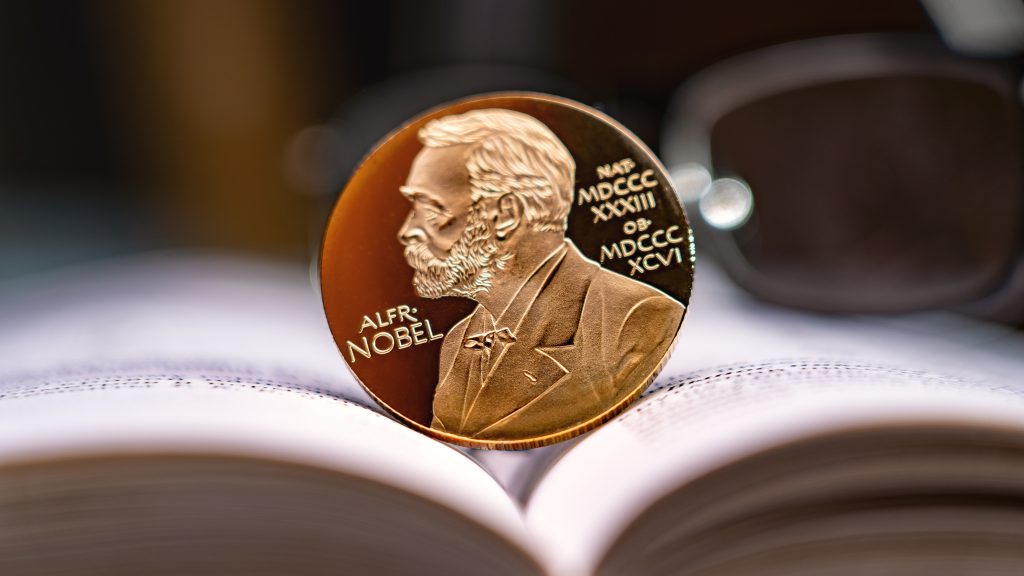
Il est assez naturel que le britannique James Robinson, qui enseigne l’économie politique à l’Université de Chicago depuis des décennies, partage cette reconnaissance avec Acemoglu : ils sont en effet co-auteurs, seuls ou avec d’autres collaborateurs, de nombreuses publications qui ont tenté de corréler, historiquement et empiriquement, les institutions politiques et juridiques de diverses nations avec leur niveau de développement passé ou présent. Traduits en plusieurs langues et largement diffusés, deux importants essais, parus en 2012 et en 2019, les ont fait connaître à un public élargi[2] ; j’y reviens plus loin.
A la fin du siècle dernier, le troisième lauréat, Simon Johnson a significativement contribué aux travaux économétriques comparatifs menés par Acemoglu et Robinson, recherches qui portaient sur l’évolution et sur le développement d’anciennes colonies européennes d’Afrique, d’Amérique ou d’Australie. Ils poursuivaient un objectif clairement affiché dans leurs publications communes, résumé par l’expression anglaise : Institutions matter !
Comme James Robinson, Simon Johnson est d’origine britannique. Il est titulaire d’une chaire d’entrepreneuriat à l’École Sloan de management du MIT ; c’est aussi un spécialiste des crises économiques qu’il eut à connaître de près lors de son détachement comme directeur des études au Fonds Monétaire International (FMI) de Washington en 2007 et 2008, époque de la grande crise financière qui troubla le monde entier, on ne peut l’oublier. Cela peut laisser entendre que, depuis une vingtaine d’années, ses centres d’intérêt et son expertise académique se sont éloignés des travaux économétriques qu’honore ce nouveau Prix Nobel. Je ne crois pas qu’il faille s’en étonner, d’autant que, chacun le sait, les questions monétaires sont très liées aux institutions qui les encadrent !
Le diable, on le sait, se cache souvent dans les détails : ainsi, l’un des articles publié en 2001 par les trois lauréat d’aujourd’hui, synthétisant leur démarche économétrique, a soulevé des critiques non seulement sur des détails techniques, toujours discutables ; mais aussi en raison de la longue (peut-être fragile) chaîne de causalités sur laquelle repose l’analyse de ces trois auteurs qui en admettaient la stabilité et la validité séculaire[3].
Toutefois, il me paraîtrait puéril de contester l’attribution de cette haute distinction à ce savant trio car leurs travaux respectifs sont tous respectables. J’en apporte pour preuve deux importants ouvrages d’Acemoglu et Robinson qui, avant de partager avec Johnson la gloire du Nobel, avaient déjà largement retenu l’attention ; je tenterai, en conclusion, d’apprécier ce Nobel 2024, à l’aune d’une pensée libérale.
2012 : Sur quoi la richesse des nations trébuche-t-elle ?
L’essai Why Nations Fail fut conçu en 2011, au lendemain des printemps arabes. On imagine sans peine l’espoir qui naquit, aussi bien chez Daron Acemoglu, originaire de Turquie, imprégné par conséquent par l’histoire turbulente du proche et du moyen Orient, que chez James Robinson, britannique hispanophone installé lui aussi aux Etats-Unis, dont les principaux centres d’intérêt étaient déjà en Afrique et en Amérique latine où il travaille souvent[4]. Cet ouvrage d’Acemoglu et Robinson (ci-après : A & R), de loin, la plus diffusée de leurs œuvres communes, s’appuie sur de nombreuses études de cas, sur des analyses historiques et sur des études empiriques qui concernent, en particulier, l’Afrique et l’Amérique latine.
A & R s’inscrivent en faux contre les théories du climat qui remontent, pour l’essentiel, à Montesquieu (pp. 49 sq.). A partir d’un vaste corpus historique, ils tentent de montrer qu’il y eut – et qu’il y a encore – des institutions, des circonstances et des lieux favorables à l’éclosion de la richesse, même en zone intertropicale : khmers, chinois, indiens hier ; Taïwan et Singapour aujourd’hui, en sont des preuves.
Ils soulignent aussi que seuls des facteurs institutionnels peuvent expliquer l’extraordinaire clivage entre le sous-développement qui distingue de nos jours la Corée du nord de celle du sud ; et que ces mêmes facteurs institutionnels expliquent la longue paralysie de la République démocratique allemande pendant quarante-cinq ans, contrastant avec l’expansion miraculeuse de la République fédérale d’Allemagne, jusqu’à leur réunification en 1989. Dans ces deux cas, allemand et coréen, même langue, même peuple, même histoire, même climat ; seuls leurs institutions, antinomiques, distinguent une république populaire d’une république libérale : les institutions communistes sont extractives ; elles sont inclusives du coté occidental ! Ce distinguo est au cœur des travaux communs d’Acemoglu, Johnson & Robinson : ce sont bien les institutions qui conditionnent le succès d’une nation ; leur stabilité permet de parier sur l’avenir et d’investir et leur équilibre permet la diffusion du bien-être (pp. 73 sq).
Parfois, soulignent toutefois A & R, de petits écarts, des hasards de la nature, des événements ou le contexte peuvent faire basculer les comportements politiques et sociaux du bon (ou du mauvais) côté de l’histoire et du développement. Principalement sélectionnés aux XIXe et XXe siècles, de multiples exemples l’illustrent : au Japon, en Chine, en Afrique, en Asie du sud et de l’est ou en Océanie… Les auteurs exploitent des sources d’une très grande diversité.
A défaut d’un modèle explicatif plus savant, qu’ils estiment hors de portée, A & R se contentent du schéma rustique précédent sur lequel repose tout leur livre : aux institutions extractives (fondées notamment sur des rentes qui caractérisèrent par exemple l’empire Ottoman des années 1840) s’opposent les institutions inclusives qui associent, si l’on peut dire, une large fraction de la population aux retombées du progrès ; cette démarche vertueuse provoque ce que d’autres ont appelé le ruissellement du bien-être sur la société civile (pp. 115 sq.). Si quelques sociétés extractives ont pu bénéficier d’un développement notable, comme l’ont vécu parfois la société soviétique et le communisme chinois, ce ne fut pour elles qu’un moment temporaire, transitoire, nécessairement fragile car la dégradation de telles sociétés est inscrite dans les faits, à plus ou moins long terme.
Quatre chapitres (pp. 152-273) illustrent ces fragilités ainsi que les revirements de fortune ou de destin national qui vont de pair avec elles : le délitement de l’Empire romain, celui de la République de Venise, l’implosion de nombreux pays d’Amérique latine et celle d’une partie de l’Afrique centrale ou australe, toutes ces circonstances furent marquées par des retours en arrière brutaux, parfois même dramatiques.
La diffusion progressive de la prospérité résulterait donc, expliquent A & R, d’un processus délicat que décrivent les chapitres qui concernent l’Europe occidentale (pp. 275-334). Au « cercle vertueux » qui s’est engagé vers la fin du XVIIIe siècle, propre à la modernité occidentale qui caractérise les deux rives de l’océan Atlantique, A & R opposent le « cercle vicieux » qui condamne, par exemple, la majorité de l’Amérique latine et une bonne partie de l’Afrique à la désespérance, au sous-développement et à la tyrannie qui accompagne les régimes extractifs[5]. La Colombie (chère à Robinson), l’Argentine, le Zimbabwe, la Somalie, le Sierra Leone et la Corée du nord illustrent l’absolutisme dictatorial qui enferme toutes ces nations dans la pauvreté.
En définitive, l’histoire n’étant jamais écrite d’avance, les nations vivent, meurent, se transforment ; les romains prévenaient leurs consuls que le Capitole, lieu où se consacrait alors le pouvoir, n’est qu’à deux pas de la Roche tarpéienne d’où l’on précipitait les traîtres condamnés à mourir. A & R considèrent qu’il en irait de même des nations qui faillissent. Telle est la leçon de cet essai à l’emporte-pièces, conçu et écrit bien avant que la Chine ne retourne à ses vieux démons, que le Venezuela de Maduro n’implose et que n’apparaisse le sursaut, inespéré, mais peut-être prometteur, d’une Argentine qui pourrait sortir de la désespérance si la « tronçonneuse » de Milei produit les résultats qu’il espère.
2019 : « Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé… »[6]
Encouragés, semble-t-il, par le succès du livre précédent, A & R s’engagèrent, huit ans plus tard, dans un second essai grand public dont l’objectif est ainsi exprimé aux premières lignes de leur Préface qui affirme : « ce livre traite de la liberté (sic)… et du sort que lui réservent les sociétés humaines » (p. xi). A & R s’inspirent d’un aphorisme de John Locke[7] : « Personne ne doit nuire à autrui, à sa vie, à sa santé, à sa liberté ou à ses biens » qu’ils reformulent ainsi : « les gens doivent être protégés contre la violence, les menaces et tout autre acte dégradant » (p. XII, n/trad.) .
Leur diagnostic est sans ambiguïté : seules des institutions solides peuvent maintenir une société dans l’étroit « chemin de la liberté ». L’effondrement de la Syrie après 2011 leur sert de parabole introductive : le despotisme de Bachar-el-Assad, le Califat islamique, assassin et sanguinaire, combiné à un pataquès international provoquèrent l’effondrement absolu des institutions de ce pays-martyr. Résultat : en moins de quatre ans, un demi-million de morts, le déplacement du tiers des 18 millions de Syriens et l’émigration incontrôlée d’un autre tiers de cette population plutôt éduquée et travailleuse, vers l’Europe et ailleurs : la Syrie est durablement sortie de la route.
Dans leur essai précédent, A & R s’étaient tenus à un certain économisme ; dans ce second essai, ils s’efforcent de tenir l’économie à distance et concentrent leurs feux sur la dynamique institutionnelle qui débouche parfois sur la liberté ; ils considèrent cependant que cette harmonie peut partir en vrille lorsque le fragile équilibre des institutions et du pouvoir politique se déglingue.
Après le chapitre introductif qui explicite le propos du livre et sa structure, les chapitres 2 à 5 décrivent des situations typiques soit de la présence, soit de l’absence d’un Léviathan qui s’avère despotique ou bridé, selon les époques et selon les lieux. Centré sur notre Europe, le chapitre 6 décrit à grands traits l’émergence, parfois hésitante, des contre-pouvoirs qui encadrent plus ou moins l’État-nation sur notre continent, composantes d’un « Léviathan enchaîné[8] », c’est-à-dire, d’une puissance publique encadrée par des contre-pouvoirs judiciaires, politiques ou administratifs.
Les chapitres 7 et 8 portent respectivement sur le monde chinois et sur le monde indien : A & R estiment que la probabilité qu’apparaisse en Chine une forme de « Léviathan enchaîné » est faible ; il serait plus naturel que se maintienne à moyen terme une tradition assez despotique au sein de la Chine communiste, conforme à son histoire. Porté par une tradition différente, le sous-continent indien, malgré son système de castes, paraît en revanche aux auteurs beaucoup plus perméable à la liberté et à la diversité des normes politiques et comportementales que ne l’a jamais été, jusqu’à présent, l’Empire du milieu.
Le chapitre 9 revient sur l’Europe et sur sa diversité institutionnelle ; il insiste sur l’ancienne et solide capacité des institutions décentralisées de la Confédération helvétique qui a maintenu son Léviathan sous un étroit contrôle démocratique, alors que son voisin Prussien s’est livré au despotisme au cours des temps modernes. Le chapitre 10 concerne l’Amérique, plus précisément les États-Unis qui hésitent encore entre le compromis fédéraliste et les traditions divergentes d’États fédérés aussi différents que la Californie, le Texas ou la Nouvelle-Angleterre…
On retrouve aux chapitres 11 et 12 le produit des recherches conduites par les auteurs, Simon Johnson et d’autres collaborateurs, sur d’anciennes colonies dont l’abandon, depuis le milieu du XXe siècle, fit éclore de nombreux Léviathans despotiques, presque aussi divers que le sont les traditions, les religions, les ethnies, les coutumes et l’histoire de ces territoires. Quant aux chapitres 13 à 15, ils constituent une sorte « d’essai dans l’essai » : A & R y formulent leur synthèse des multiples pièces du puzzle rassemblées dans cet ouvrage encyclopédique.
2024 : des difficultés structurelles menacent-elles les sociétés « équilibrées » ?
Pour les auteurs, la liberté n’est ni dans l’ordre ni dans la nature des choses ; il est donc ardu de la faire éclore ; elle ne peut prospérer qu’à partir d’un terreau qui serait constamment favorable à son émergence, ainsi qu’à une constante volonté de l’entretenir, faute de quoi, le poids des habitudes et celui des normes établies, qu’elles soient religieuses, magiques ou philosophiques, reprennent le dessus. Pour conserver des institutions libres, une nation devrait se maintenir, avec circonspection et constance, dans l’étroit couloir de la liberté ; c’est-à-dire, encadrer son Léviathan avec détermination ; ce qui implique, pour les auteurs : un État juste, fort, équilibré et régulé[9].
A quoi pourrait-on attribuer ce constat, plutôt pessimiste pour un libéral ? Acemoglu, je l’ai signalé plus haut, est d’ascendance turque et partiellement arménienne ; l’observation de la Turquie moderne pourrait l’avoir cantonné dans un profond scepticisme, pour ne rien dire, à ce stade, du retour récent d’un islamisme pan-turkiste plus explicite encore qu’il ne le fût aux temps des Ottomans. Quant à Robinson, ses investissements en Haïti, en Colombie, au Congo (ex-belge) comme en Bolivie, ne l’ont sans doute pas encouragé à penser que la liberté politique pourrait éclore aussi spontanément qu’une fleur au soleil !
Le long développement du Narrow Corridor consacré à la désagrégation des institutions allemandes entre 1919 et 1933 (Out of Control, Chapitre 13, pp. 390-405) n’est évidemment pas porteur d’optimisme ! En contrepartie, le chapitre 14 du livre (Into the Corridor, pp. 427 sq.) souligne que l’expérience « Arc en ciel » de l’Afrique du sud la libéra temporairement de son joug ; ce pays, estiment-ils, risque de quitter l’étroit couloir de la liberté : soit en faveur d’un despotisme non-éclairé ; soit en abandonnant l’équilibre au profit du laissez-faire (voir : fig. 6, p. 435). Rapidement brossé (pp. 339-343) l’exemple de la Turquie moderne démontrerait, lui aussi, la difficulté d’entretenir cet équilibre institutionnel auquel les auteurs accordent une trop grande importance, me semble-t-il, afin qu’une nation se maintienne dans l’étroit corridor de la liberté.
Cinq ans après la publication de cet essai, je ne peux omettre trois autres sorties de route, analogues à celle de la Syrie qui préoccupa tant les auteurs (pp. xii sq.). Tous ces déraillements institutionnels vont de pair avec l’effondrement complet des institutions de ces trois pays :
– le Venezuela de Maduro confirme et accentue l’implosion de cette nation que vérole depuis longtemps sa rente pétrolière ; la férule de Chavez avait déjà sorti les Vénézuéliens de l’étroit chemin de la liberté, selon les termes d’A & R; ils s’en éloignent chaque jour un peu plus ;
– l’implosion nationale du Liban : après l’épouvantable guerre civile qui coupa déjà ce pays en deux territoires ennemis (1975-1990), l’explosion du port de Beyrouth en août 2020 ruina les quartiers actifs proches du port, tandis que le Liban-sud, soumis au Hezbollah, confirmait sa sécession et que de multiples factions rivales persistaient dans leur folie suicidaire ; ce pays poursuit sa descente aux enfers dans un parfait cahot institutionnel : les incursions israéliennes récentes accentuent cette dérive ;
– enfin, les capacités potentielles de la société algérienne sont minées de l’intérieur par des institutions extractives, socialistes et islamisées et par un régime aussi dégradé qu’ont pu l’être, au XXe siècle, celles de l’Égypte du roi Farouk et l’Union soviétique de Gorbatchev, malgré sa Perestroïka et sa Glasnost[10] plus récemment…
Le futur : mirage d’un new deal à la suédoise ?
Il n’est pas innocent que The Narrow Corridor se termine (Living with the Leviathan, Chapitre 15) sur une pique que lancent A & R à Friedrich Hayek (pp. 464-467) : après avoir rappelé le rôle historique qu’il avait tenu dans l’immédiat après-guerre, tant en raison de ses échanges avec William Beveridge qu’avec le succès de son maître-ouvrage The Road to Serfdom (« l’un des plus importants ouvrages des sciences sociales au XXe siècle » disent justement A & R p. 465), ils lui reprochent d’avoir négligé le rôle organisateur de la puissance publique et l’importance du planisme pendant la reconstruction qu’accompagna le Plan Marshall ; bref, d’avoir dédaigné les ingrédients dirigistes qui marquèrent cette période que Jean Fourastié baptisa en France : « les Trente Glorieuses ». A & R insistent sur le fait que le planisme d’État « reconstruisit l’essentiel de l’Europe (en Angleterre et ailleurs) après la seconde guerre mondiale » (p. 466, n. trad.).
A mon avis, cette banderille signifie qu’au-delà de leur plaidoyer subtil en faveur du Léviathan apprivoisé et de ses avatars européens, leur diagnostic tend à revigorer ce que j’appellerai, en anglais : a tamed Leviathan. Une hypothèse qui conduirait la société (occidentale?) à s’aligner sur la voie improbable d’un « Léviathan entravé » (shackled Leviathan). Hypothèse sans doute compatible à leurs yeux avec un New Deal modernisé (p. 493) ou avec une social-démocratie scandinave qu’ A & R regardent volontiers avec les yeux de Chimène (pp. 467-474)[11]. Les mots-clés qui parsèment ce livre – équilibre, régulation, protection ou harmonie etc. – évoquent tous la stabilité plutôt que le mouvement, la prudence plutôt que le risque, la protection plutôt que l’innovation. Ils sont donc assez éloignés du libéralisme moderne.
En définitive, Acemoglu & Robinson sont, probablement, des économistes sceptiques, classiques et prudents : leur pondération et leur appel constant à l’équilibre en sont la preuve. Il est, au surplus, curieux qu’ils aient organisé leur essai autour d’une allégorie mise en place dès le chapitre 2 (p. 41): la « Reine Rouge » – reine du jeu d’échecs – tente de déstabiliser Alice, l’héroïne de Lewis Carroll, qui lui échappe dès son réveil pour revenir au monde réel. Cette métaphore du « chemin étroit » qui faciliterait le développement économique, parcourt tout l’essai ; elle m’est parue forcée, moins subtile, en tout cas, que les allusions élégantes de Dennis Robertson, célèbre émule de Keynes au Kings College de Cambridge[12].
« De l’autre côté du miroir », là où tout se déroule à l’envers de la réalité objective, la fillette Alice, héroïne mythique de la période victorienne, résiste intelligemment à l’emprise de la Reine rouge qui tente pourtant de la désarçonner. Mais, dès son réveil, tout se remet en bonne place. J’espère – sans trop y croire! – qu’il en sera de même pour nos trois lauréats du « Nobel d’économie 2024 » : la récompense qu’ils toucheront n’est plus un rêve, mais une réalité tangible. Ils devraient donc se réveiller, cesser de courir après un monde idéal ; admettre, par conséquent, que l’analyse politique de Hayek, dont ils reconnaissent heureusement le courage politique, était moins inexacte que ne l’affirme leur dernier chapitre intitulé bizarrement : « Vivre avec le Léviathan », un paradoxe pour des amoureux de la liberté!
[1] Le Point, n°2676, 16 novembre 2023, pp. 146-7.
[2] Why Nations Fail, Crown Business-Random House, New York, 2012; et The Narrow Corridor, Penguin Press, New York, 2019.
[3] “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review 91 (5), 1369-1401. Le raisonnement des auteurs s’appuie sur des régressions entre paramètres (économiques, historiques, démographiques, institutionnels) propres aux colonisateurs européens, et d’autres facteurs présumés représentatifs des institutions post-coloniales instaurées après l’indépendance ; ainsi, la mortalité initiale des colons européens expatriés serait un paramètre explicatif essentiel de la durée de la colonisation, des institutions coloniales, des institutions nouvelles et de la performance actuelle de ces anciennes colonies. cf. Mazhar, U. : “The Colonial Origins of Comparative Developments : A Skeptikal Note,” Historical Social Research, 37 (2), 362-370, 2012.
[4] C’est à Ejan Mackaay que je dois d’avoir découvert ce binôme et leurs travaux ; qu’il en soit ici remercié.
[5] Brève note sémantique : les auteurs n’ont sûrement pas choisi au hasard l’adjectif extractif pour qualifier l’administration des empires coloniaux (britanniques, espagnols, français, belges, néerlandais) sur lesquels portaient leurs premières recherches : les colonies sont souvent considérées comme une exploitation abusive du territoire colonisé et de sa population. Dans ce contexte, exploitation et extraction sont de quasi-synonymes !
[6] Ce premier vers de la fable « Le Coche et la Mouche » me paraît bienvenu : semé d’embûches, le « chemin étroit » (The Narrow Corridor) qui conduit vers la prospérité est mal pavé, démontrent nos auteurs : La Fontaine, Fables VII, 9 (1678).
[7] Citation de Locke, p. xi : « no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions ».
[8] Traduction inspirée par le Gulliver de Swift ; on pourrait aussi dire: entravé, soumis, encadré ou même apprivoisé!
[9] Avec plus de précaution oratoire que ne l’a fait Stiglitz, cette vision n’est finalement pas très éloignée de la « société bonne » pour laquelle plaide The Road to Freedom, recensé dans le n° 24 du présent Journal.
[10] Qui signifient, respectivement : reconstruction et transparence.
[11] Ce dernier chapitre comporte des allusions laudatives à la social-démocratie suédoise et au libéralisme de ce pays : tradition de vieille souche qui respecte autant l’effort que les droits de propriété, qu’apprécient tout particulièrement A & R. Leur jugement n’a pas dû laisser les dirigeants de la Banque royale de Suède indifférents, je présume (cf. p. ex. pp 474 sq. : « vital lessons from the Swedish experience for understanding the balance between the state and the market etc. » (n/ trad : « l’expérience suédoise illustre parfaitement l’équilibre entre l’État et le marché », etc.)
[12] Éminent spécialiste de la monnaie et de la finance, Dennis H. Robertson (1890-1963) émaillait ses livres d’évocations d’Alice in Wonderland, (1865) et de Through the Looking Glass (1871). Postée par l’université de Cambridge (https://bit.ly/4hfNBD0) sa biographie officielle écrit avec finesse : « Il pimentait ses livres et ses essais d’allusions et de citations de l’Alice de Lewis Carroll ; ce fut sa marque de fabrique ». La métaphore de la Red Queen s’inspire évidemment de ce précédent qu’A & R ne citent pas ; dommage ! cf. Gordon Fletcher : Understanding Dennis Robertson, The Man and His Work, Elgar, Chettenham, 2000.