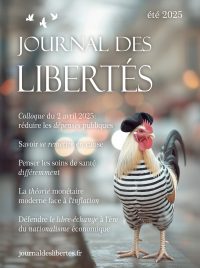Nous reproduisons dans ce dossier spécial une grande partie des interventions qui ont été faites dans le cadre du Colloque sur la réduction des dépenses publiques organisé le 2 avril dernier par l’IREF. Le public s’y est rendu nombreux et les échanges ont été d’une grande qualité. Cette introduction se propose en quelques touches de vous donner la tonalité des débats.
Pierre Garello et François Facchini ont introduit le sujet de la dépense publique. Nous ne voulons pas la réduire, égoïstement, pour payer moins d’impôt, même si nous ne sommes pas ennemis de nos intérêts. Le paternalisme public, sous ses diverses formes, l’État-providence transforment nos droits-libertés, ceux d’un état de droit, en droits-créances qui par nature sont illimités, toujours plus, au nom d’un égalitarisme qui est le tonneau des Danaïdes des dépenses publiques.
Que les dépenses publiques représentent 56 à 58% du PIB signifie qu’une large majorité des dépenses sociales, politiques et économiques sont le fait de l’État ou des collectivités publiques. Le secteur public domine alors le secteur privé, lui impose ses modes de fonctionnement, administratifs, limite sa liberté, l’entrave. L’intervention excessive de l’État modifie, de manière coercitive ou incitative, les comportements individuels et la répartition des ressources entre les individus de manière arbitraire. Elle supprime les signaux du marché, fausse la concurrence, favorise des canards boiteux au détriment des entreprises saines.
Comme l’a expliqué François Facchini dans son ouvrage Les dépenses publiques en France, « en deçà d’un certain seuil, la dépense publique a un effet positif, mais au-delà de ce seuil, son impact sur la croissance est négatif » (de Boeck 2021, p. 189). La raison en est notamment que, contrairement à ce que soutiennent les keynésiens, l’accroissement de la dépense publique n’a pas toujours – loin de là – une effet multiplicateur positif. En outre, l’augmentation de la dépense réduit l’épargne qui est un facteur de croissance et oblige à une augmentation des impôts qui crée un effet d’éviction fiscale : « Un euro de dépense publique financé par l’impôt, ce n’est pas seulement un euro de dépense privée en moins, mais peut-être deux ou trois euros en moins, car l’impôt réduit l’incitation au travail et finalement baisse les revenus et le niveau globale de la dépense privée » (ibidem, p. 207). Ce qui explique sans doute que dans notre pays keynésien par idéologie, depuis des décennies les dépenses publiques augmentent sans cesse et la croissance baisse à due proportion.
Certes, sans État, c’est le chaos. Mais trop d’État tue l’État. Alors qu’un État régalien crée les conditions de la prospérité. Il faut amplifier les dépenses régaliennes pour consolider l’état de droit, qui favorise la croissance, garantir la qualité de l’éduction et de la santé, sans que l’État se mêle nécessairement de leur exécution, ne conserver que les dépenses de redistribution indispensables à l’égard de ceux qui ne sont pas capables de se prendre en charge tout en veillant à ce que ces dépenses publiques ne les enfoncent pas dans l’assistance mais les aide à recouvre leur responsabilité d’eux-mêmes.
La liberté n’est pas une fin en soi pour les individus mais plutôt le moyen pour eux de chercher leur propre fin. Mais la fin de tout gouvernement n’est-elle pas de permettre à ses citoyens de vivre comme ils le souhaitent, ce qui ne saurait mieux être satisfaite qu’en leur garantissant la liberté. Dans sa leçon De l’histoire de la liberté dans l’antiquité, Lord Acton note que pour les pouvoirs publics « La liberté n’est pas qu’un moyen servant à atteindre un objectif politique plus noble. Elle est elle-même cet objectif politique le plus noble qui soit… [1]». Ce qui ne veut pas dire que la politique n’a plus d’objet, mais qu’elle est moins faite pour s’approprier le pouvoir que pour permettre que chacun l’exerce à son niveau, moins pour intervenir que pour s’assurer des équilibres nécessaires à toute société, c’est-à-dire, faire régner la justice, la sécurité et la paix. Son objet, disait encore Lord Acton « n’est pas de confirmer la prééminence de tout intérêt que ce soit, mais d’y faire obstacle ; de […] veiller avec un soin égal à l’indépendance du travail et à la sécurité de la propriété ; de protéger les riches de l’envie et les pauvres de l’oppression ».
Voilà pourquoi, fondamentalement, nous croyons souhaitable de réduire le poids de l’État, pour qu’il puisse mieux exercer ses vraies missions. Aujourd’hui croulant sous le poids des dépenses sociales (près de 2/3 des dépenses publiques) et de la dette, l’État est incapable d’assurer ses fonctions régaliennes. Il faut lui en rendre la capacité.
Avec Javier Fernández-Lasquetty, Michel Kelly-Gagnon et Nicolas Jutzet, divers exemples étrangers nous ont démontré que la réduction des dépenses publiques était possible.
- L’Espagne a su sabrer dans ses dépenses sociales dans les années 2000. Les socialistes ont réintroduit une culture de l’impôt, notamment avec un impôt fortune sur la fortune pouvant aller jusqu’à 4% par an, mais les régions sont autonomes et peuvent résister. Ce qu’a fait la région de Madrid dont la politique fiscale et de dépense raisonnable a été l’une des raisons de son essor économique.
- Le Canada a eu il y a quarante ans une politique courageuse et déterminée de réduction de son administration.
- La Suisse conserve un niveau de dépenses publiques très bas grâce à la subsidiarité de son système confédéral et à son frein à l’endettement.
Nous aurions pu évoquer d’autres pays :
- La Suède affichait en 1993 un déficit public de 11% du PIB. Il était réduit à 0,8% 5 ans plus tard. Elle y est parvenue notamment en transférant de nombreuses fonctions non régaliennes à des agences avec des salariés embauchés sous statut privé. En faisant aussi une vaste réforme des retraites corrélées désormais à la durée effective du travail et soumises pour partie au régime de capitalisation.
- La Grèce a su réduire ses dépenses sous la contrainte du FMI. Mais elle a retrouvé désormais un budget en excédent primaire.
- Sous la contrainte économique (plus de 10% de chômage et un déficit public de 4%), l’Allemagne avait également revisité son modèle social au début des années 200O, ce qui lui a redonné une vraie puissance avant que Mme Merkel la mette à bas par des politiques déraisonnées en matière d’immigration et énergétique.
- Le Portugal a remis en cause son État-providence à partir de 2006 en alignant le régime des retraites de la fonction publique sur celles du privé, en rehaussant l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans, puis en privatisant, en supprimant les 13ème et 14ème mois des fonctionnaires…
- Dans un pays ruiné, Xavier Milei a mis en œuvre une thérapie de choc. Après des coupes sombres dans les dépenses publiques, la croissance a flanché mais en peu de mois elle revient. Elle a été de 5% en février. Souhaitons qu’il réussisse.
Jean-Philippe Feldman nous a dit les vertus de la règle d’or pour limiter les dépenses publiques et les limites, voire le vice, d’un frein à la dépense.
Le Sénateur Etienne Blanc nous a montré ce que coutait la drogue au-delà même des aspects moraux et de santé.
David Lisnard a ouvert la voie à une politique nouvelle en faveur d’une société libre et ouverte.
Thomas Lam, Rafik Smati et François-Xavier Oliveau ont souligné, dans leur débat, animé par Nathalie Janson, les coûts indirects des subventions publiques aux entreprises et combien nous serions gagnants à en réduire la voilure tout en réduisant les charges, fiscales et sociales notamment, qui pèsent sur elles.
Lionel Devic a rappelé que l’école privée coute moins cher à l’État et combien celui-ci y gagnerait à supprimera les quotas de fait (20% d’écoliers privés) et le monopole de droit de la collation des grades et titres universitaires.
Dans une table ronde sur les finances locales modéréé par Yves Bourdillon, Christelle Morançais, Vincent Delahaye et Jean Coldefy ont plaidé pour la subsidiarité :
- La présidente Morançais a amputé le denier budget de sa région des pays de la Loire de 82 M€, plus que les 40 requis par l’État. Elle veut sortir du mode guichet dit-elle et considère que la région n’est pas un carnet de chèques ambulant.
- Jean Coldefy nous a dit que les transports en TER coutaient plus cher que la voiture et polluaient plus. Il s’est insurgé contre une augmentation du versement mobilité qui a déjà été multiplié par quatre en vingt ans, soit 8Md€ de plus à la charge des entreprises. Il considère que les usagers ne payent pas suffisamment leur part des transports urbains (25%).
- Le Sénateur Vincent Delahaye nous a rappelé l’importance de réduire bien des dépenses publiques inutiles.
Nicolas Pouvreau-Monti a évoqué comment réduire les coûts de l’immigration.
Dans une quatrième table ronde présidée par Nicolas Lecaussin, nos intervenants sur la santé – Diego Taboada, Sandrine Gorreri et Guillaume Moukala Same – ont montré qu’en pensant les soins différemment, il serait possible d’en abaisser le coût public tout en favorisant une meilleure prise en charge.
J’en profite pour rapporter les mots récents de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) selon lesquels « Le secteur privé ne perçoit que 17% des financements hospitaliers alors qu’il assure 35% de l’activité hospitalière en France, dont 60% de la chirurgie, 40% des traitements du cancer ou encore 28% de la psychiatrie ».
Patrick Coquart a fait comprendre combien les dépenses publiques pour l’emploi étaient peu utiles à l’emploi. Je note que les seuls dispositifs d’exonération de charges en faveur de l’emploi ont couté plus de 80 Md€ en 2023, notamment sous forme d’exemption d’assiette, d’allégement et d’exonération de cotisation. Sans que l’emploi en profite !
Introduits par Pierre Garello, Erwan Queinnec et Vincent Bénard ont imaginé une autre écologie, vertueuse, faisant confiance aux individus plutôt qu’à la prolifération des normes.
Puis c’était au tour d’Erwan Queinnec d’animer une table ronde sur les retraites dans laquelle intervenaient Nicolas Marques, Bertrand Martinot et moi-même. A trois voix, nous avons exposé l’impasse de la répartition et les bienfaits de la capitalisation. Chacun a évoqué une solution pour mettre en œuvre une transition vers plus de capitalisation.
Notre ami et ancien ministre Alain Madelin nous a ensuite entrainé dans de nouveaux chemins, ceux d’un libéralisme intelligent, avec le brio qu’il a conservé intact et plaisant.
Enfin, Monsieur Guillaume Kasbarian, dont nous avons tous apprécié le courage pendant son ministère, nous a ouvert des voies pour une réforme de la fonction publique. Merci Monsieur le Ministre.
Beaucoup d’intervenants sont venus de l’étranger ou de la province, des élus ont pris de leur temps pour nous rejoindre, les représentants de think tanks amis (IFRAP, Molinari, Avenir Suisse, Institut Économique de Montréal, Institut Libéral, Observatoire de l’immigration, Fondation pour l’École, Asterès…) nous ont accompagné comme de nombreux économistes, essayistes, enseignants…
Il y aurait eu bien d’autre interventions possibles dans des domaines où bien des économies sont possibles :
- En 2023, 13,9 Md€ ont été consacrés par la France à l’Aide Publique au Développement investie très largement (47% en 2021/22) dans la promotion de l’égalité des genres ! La France a contribué pour près de 3 Md€ à l’APD européenne dont la Cour des comptes européenne a dit tout le mal possible. On mentionnera parmi ses dépenses des dons de mixeurs à des écoles dépourvues d’électricité, des bénéficiaires fantômes, des projets comptabilisés plusieurs fois, des infrastructures inutilisées, etc.
- Dans Le Figaro, François-Xavier Bellamy et Pierre Danon ont évalué qu’ « au moins 1,1 million sur 5,6 d’agents publics que compte notre pays » font partie de l’administration administrante, dont pensent-ils, il faudrait se séparer en grande partie, ce qui pourrait se faire en ne renouvelant pas les 400 000 d’entre eux qui doivent partir à la retraite dans les dix prochaines années.
- Les organismes parallèles, agences, associations ou sociétés publiques, opérateurs divers… : il y aurait environ 1200 organismes qui représenteraient, selon le Sénat, qui a lancé une commission d’enquête sur le sujet, des dépenses de 80 à 85 Md€. Certains sont utiles, beaucoup sont redondants et leur empilement comme leur dispersion augmentent les frictions, les dysfonctionnements et les coûts.
- La Cour des comptes s’est inquiétée pour sa part de la continuation inutile et injustifiée depuis 2022 de dispositifs mis en place lors du « Quoi qu’il en coûte ». Elle y voit des économies possibles de 4 Md€ dès à présent et 6 Md€ à horizon de 2027, voire plus (+1,5 Md€) en annulant certains crédits ouverts non consommés. Elle s’interroge sur les aides à la planification écologique, sur nombre de mesures pour aider l’agriculture, pour le renouvellement forestier, le plan haies… Elle évoque des économies possibles de 600 M€ par an.
- La politique de la ville « est un mystère embarrassant » dit l’ancien préfet Michel Aubouin. Il s’agit dit-il encore « d’un important écosystème formé d’administrations et d’associations financées par l’argent public et un argument pour les défenseurs des quartiers dits “populaires” » (Le Figaro 03/02/2025). Dans la politique de la Ville, 10cMd€ par an sont investis depuis 40 ans sans résultat (selon la Cour des comptes). Une large majorité des emplois aidés représente des aubaines pour ceux qui auraient procédé à ces embauches mêmes sans subvention (cf. rapport DARES juillet 2023).
Je pourrai poursuivre ma litanie, mais je m’arrête là en laissant les lecteurs du Journal des libertés découvrir le contenu des interventions du colloque.
[1] Acton, Lord (2001) « Histoire de la liberté dans l’Antiquité, » Journal des Économistes et des Études Humaines: Vol. 11: No. 4, DOI: 10.2202/1145-6396.1039