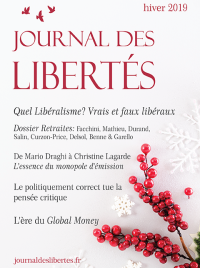La force – et en même temps le point faible – de la pensée libérale est d’être imprégnée de doutes, ce qui l’amène, dans un perpétuel mouvement, à remettre constamment en question ce qui semble être ses points forts.
Si ce n’était pas une contradiction intrinsèque, on pourrait dire que la pensée critique est naturellement libérale, puisque équivalente à la liberté de pensée. Contradictoire parce que l’une des essences du libéralisme est de ne pas revendiquer le monopole de la vérité, quel que soit le sens que l’on souhaite donner à ce terme.
Cela ne veut en aucun cas dire que la pensée libérale serait une sorte d’éclectisme insipide, essentiellement dépourvu de principes et adaptable selon les circonstances.
Alors que les idéologies – à travers les siècles, et cela inclut donc les religions – établissent un chemin à travers lequel on devrait et on doit concevoir le monde, et s’attacher à changer ce dernier en cohérence avec ses principes, le libéralisme s’est créé en prenant ses distances par rapport au dogmatisme. Pour cette raison, il n’impose pas, et ne peut pas imposer une nouvelle forme de dogmatisme, entendu comme des conclusions, qui, une fois atteintes, ne sauraient être remises en question sans tomber dans l’hérésie et courir le risque de l’anathème.
Le « politiquement correct » est précisément une forme de dogmatisme, d’autant plus odieux à la pensée libérale qu’il se développe prétendument sur un terrain libéral mais en pervertit sa signification et trahit son sens intime. Il transforme une méthode ouverte en un credo fermé. Il voit ceux qui pensent différemment – j’insiste, « pensent » – comme des ennemis contre lesquels un combat mortel doit être livré. Il utilise les méthodes les plus typiques de l’il-libéralisme : étiqueter ses opposants, les qualifier d’inaptes à une société civilisée, pour les mieux bannir, les éviter, les exclure en s’interdisant tout contact avec eux. Ce sont là exactement les méthodes contre lesquelles la pensée critique s’est dressée pour donner naissance au libéralisme philosophique et politique.
Dans les pages suivantes, j’essaierai de présenter quelques sujets d’actualité dominés par le « politiquement correct », ce qui fait qu’il est pratiquement impossible d’en discuter sérieusement, et que ces sujets deviennent semblables à des dogmes théologiques. En parler est tabou et tout juste peut-on en mentionner les noms. Mon intention toutefois n’est pas de provoquer, mais plus simplement de rappeler que la pensée libérale n’a jamais hésité au fil des siècles à remettre en question ce qui semble être la sagesse commune, en signalant les erreurs et les truismes.
Avant de débuter, une mise en garde importante – qui n’est pas sans conséquences logiques – s’impose : je discuterai ici de ces sujets en prenant pour point de départ la façon dont ils sont abordés à l’intérieur des systèmes démocratiques occidentaux, non seulement parce que le « politiquement correct » est, nous le verrons, le produit des sociétés occidentales, mais aussi parce qu’il n’a de sens que dans ce contexte.
- Racisme
Dans l’univers du « politiquement correct », l’un des plus grands ennemis – si ce n’est l’ennemi public n°1 – est le racisme. Toute référence à des caractéristiques raciales, ethniques, linguistiques ou d’ascendance est, si elle est exprimée dans un contexte (même hypothétiquement) négatif, considérée comme une forme de racisme parce que – tel est le chef d’accusation – on associe à des aspects externes, visibles ou apparents d’une personne des évaluations négatives créant, ou plus exactement, renforçant par-là des stéréotypes néfastes.
Le racisme se heurte clairement au principe de l’égalité de tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe ou de croyance. Un raciste est quelqu’un qui nie le principe fondamental d’une société démocratique et ouvre la voie à la discrimination et à la persécution. C’est pourquoi être traité de « raciste » est une insulte pire encore que celles de « fasciste » ou de « criminel ».
Le problème qu’il y a à procéder de la sorte est que l’omniprésence du terme finit par en diluer le sens : tout le monde est raciste. Mais, plus important encore, ces utilisations abusives ne tiennent pas compte d’un aspect anthropologique fondamental. Toutes les communautés humaines, où qu’elles se trouvent de par le monde, ont été, sont et continueront probablement d’être xénophobes. Une communauté se protège elle-même (ou croit se protéger) en identifiant tout à la fois ses membres et ceux qui n’en sont pas.
Bien que la xénophobie soit autre chose que le racisme, le « politiquement correct » assimile ceux – et ils constituent bien souvent la majorité de la population – qui craignent, pour des raisons légitimes ou non, une « invasion » d’étrangers, à des racistes. Le xénophobe est ainsi confondu avec ceux qui revendiquent la supériorité d’une « race » (quel que soit le sens donné à ce terme) sur les autres races et encouragent ou approuvent des politiques de ségrégation, de discrimination et même d’élimination physique.
Est-ce à dire que, puisque (presque) tout le monde est « xénophobe » ou se comporte comme tel, nous nous devons d’être complaisants à l’égard de ces comportements ? La réponse est évidemment NON, mais les facteurs suivants doivent être pris en compte.
a) Alors que la xénophobie (et sa dégénérescence dans le racisme) est mondiale, seul le monde occidental a développé une théorie philosophique, politique et psychologique profonde de la xénophobie, du racisme et de leurs maux ; seul le monde occidental a essayé de prendre des mesures visant à combattre la xénophobie et le racisme ; dans le monde occidental seulement, l’incitation à la xénophobie et à la haine raciale est un crime. Cela a des raisons historiques très claires : des millions de Noirs réduits en esclavage pendant plus d’un siècle aux États-Unis, privés de tout droit et de toute dignité humaine, avec des conséquences immédiatement perceptibles pour quiconque voyage aux États-Unis. En Europe, six millions d’êtres humains ont été exterminés pour leur prétendue identité juive (ce qui est encore plus monstrueux que le racisme fondé sur la couleur de la peau).
b) Le fait que les civilisations occidentales aient réagi à l’esclavage et à l’holocauste d’une manière aussi forte ne doit cependant pas être interprété comme si le racisme était une caractéristique exclusive du monde occidental, et sa honte. Ce serait comme si les pays les plus soucieux de protéger l’environnement, de lutter contre la corruption ou encore de limiter les erreurs médicales étaient pointés du doigt comme les pays les plus polluants, les plus corrompues, et les plus dépourvus de compétences professionnelles. Certes ce n’est pas parce que les autres — tous les autres — sont racistes, que nous devons fermer les yeux ou tolérer nos errements. Mais en même temps nous ne pouvons accepter, d’un point de vue critique, que le racisme soit présenté comme une caractéristique typique des communautés « blanches » (quel que soit le sens que nous donnions à une notion aussi large). Seuls les « blancs » sont racistes : les autres groupes ethniques ne peuvent être victimes que du racisme « blanc ».
c) Il y a une autre conséquence du traitement « politiquement correct » du racisme. D’une part on est appelé à promouvoir des sociétés multiculturelles / multiethniques, mais il est par contre interdit d’indiquer une quelconque préférence parce que cela est, explicitement ou implicitement, raciste. On ne peut même pas simplement exposer – y compris sur une base sociologique rigoureuse – quelles sont les caractéristiques de certaines communautés. Tout le monde, tous les groupes sont égaux, non seulement d’un point de vue juridique, mais surtout dans leur identité sociale. Les différences sont éliminées simplement parce qu’on ne peut en parler sans être accusé de tenir un « discours raciste ».
d) Dans cette perspective, les minorités (ethniques, linguistiques, religieuses) qui s’enorgueillissent de leur identité et font de leur mieux pour la préserver et la promouvoir et se distinguer du reste de la nation, ne peuvent être critiquées sous certains aspects, car de telles critiques seraient encore qualifiées de « racistes ». La majorité, et seulement la majorité, est raciste et doit être terrassée par des centaines de minorités lilliputiennes. Seules les minorités peuvent se moquer d’elles-mêmes ; seuls les Juifs peuvent exprimer leur witz (ce que Woody Allen fait si magistralement). Qu’un Gentil se risque à l’exercice, il sera traité d’antisémite.
En conclusion, le racisme a été un fléau horrible pour les sociétés occidentales. Mais faire mémoire des innombrables victimes de l’esclavage et de la persécution ne peut être une malédiction qui conduise à étouffer toute critique identitaire.
2. Colonialisme
Se déplacer à l’étranger, établir des comptoirs commerciaux, occuper des terres inhabitées ou déjà habitées et par la suite établir la souveraineté de la patrie sur les nouveaux territoires fait partie de l’évolution de l’humanité. En Méditerranée, les Phéniciens et les Grecs se sont déplacés à l’Ouest et à l’Est. Évidemment, l’Empire romain a étendu ses frontières à travers ses colonies. Le terme est révélateur : le colonus est un agriculteur qui cultive la terre. La ville allemande de Cologne porte encore la marque de son origine : Colonia Agrippina.
Ce phénomène n’est pas unique au monde occidental. D’autres civilisations et empires, en particulier en Extrême-Orient, se sont développés de la même manière. Avec la découverte du Nouveau Monde, la colonisation prend un tournant dramatique : l’occupation des nouveaux territoires passe, sur le continent américain, par l’éradication des cultures antérieures et l’extermination des populations indigènes. Un processus qui s’étend du XVIe au XIXe siècle et qui, en Amérique du Nord, est glorifié par des centaines de films sur la conquête du Far West.
En Afrique, la colonisation a une nature différente : au début il y a eu la création de comptoirs et ce n’est qu’au XIXe siècle, du fait d’une concurrence croissante entre les nations européennes, que l’on est passé à l’occupation politique d’immenses territoires par les Anglais et les Français, et dans une moindre mesure par les colonies espagnoles, portugaises, allemandes, belges et italiennes.
Le contrôle de ces régions et de ces gens visait à exploiter les ressources naturelles, créer et protéger des moyens de communication et freiner l’expansion des concurrents. Nul désir de mener à bien une politique d’extermination, mais simplement la superposition de la société occidentale sur ce qui était considéré comme des populations non civilisées et sauvages.
L’histoire de la colonisation occidentale en Orient et en Extrême-Orient est encore différente. L’Australie suit une voie semblable à celle empruntée en Amérique du Nord. Mais en Inde, en Indochine, en Indonésie, aux Philippines, les puissances occidentales doivent tenir compte du niveau de développement des sociétés existantes. En Inde en particulier, l’histoire des présences portugaise, néerlandaise, française et anglaise est celle d’une recherche continue d’équilibre entre les sociétés existantes et les États souverains avec, en toile de fond, la nécessité de contrôler les ressources naturelles, la production et le commerce. Dans d’autres régions – comme la Chine – la pénétration occidentale est purement nominale et les « colonies » (Hong Kong, Macao…) ne sont que de petits comptoirs sous contrôle occidental.
Il existe donc de nombreuses formes de colonialisme, et le colonialisme est loin d’être mort, surtout dans un monde globalisé.
Dans le vocabulaire politiquement correct, le « colonialisme » est un autre de ces crimes impardonnables, dont seules les sociétés occidentales sont responsables. Seuls les Blancs sont racistes, seuls les pays occidentaux, principalement européens, ont un comportement colonisateur. On met ainsi de côté la pensée critique qui consiste à raisonner sur des faits et des événements, à regarder ce qui s’est passé, ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer. En particulier, on s’interdit toute distinction. Ainsi, si l’histoire de la colonisation occidentale des Amériques est impardonnable, quelles que soient les normes appliquées (ajoutant à l’extermination des populations et cultures autochtones le fléau de l’esclavage), dans d’autres parties du monde, il est, et devrait être, largement contestable que le bilan ne puisse être que négatif. Mais déjà suggérer un tel doute est tenu pour criminel aux yeux du politiquement correct. Pourtant ces doutes doivent être levés, non pas pour clore un débat théorique, mais parce que cela est nécessaire à notre compréhension du monde d’aujourd’hui.
S’agissant en particulier des pays africains, dont la plupart sont devenus indépendants dans les années 60 du siècle dernier, il convient de s’interroger sur l’usage que la plupart de ces nations ont fait de leur souveraineté. Il ne s’agit pas ici de débattre autour de la mise en place, par des procédures parfois douteuses, d’un système démocratique – nous aborderons ce point dans un autre paragraphe. Plus simplement il s’agit de comprendre l’état actuel des conditions nécessaires à une vie décente : santé, éducation et infrastructures. Peut-on raisonnablement affirmer que la situation lamentable dans laquelle se trouvent encore nombre de ces pays à cet égard soit l’amer héritage d’un passé colonial pour lequel les pays européens doivent être tenus responsables ? Peut-on comparer l’exploitation des ressources naturelles par les puissances coloniales et les entreprises internationales à celle mise en place par les classes dirigeantes indépendantes ? En d’autres termes, le fait que, du moins en Afrique, les pays occidentaux aient colonisé, pendant un siècle et demi au plus, le continent, ne peut devenir un prétexte pour rejeter toute critique des formes d’administration domestiques qui sont bien en deçà des normes occidentales et qui sont sans aucun doute responsables de l’émigration massive de millions de personnes. Le paradoxe est le suivant : d’un côté, suivant les principes d’indépendance et d’autodétermination, l’ère coloniale doit être jugée – et condamnée – quels que soient les mérites éventuels de son action. Parallèlement, quiconque s’aventure à ne serait-ce que suggérer que ce qui se passe aujourd’hui dans ces pays – guerres continuelles, internes et externes, massacres, extermination ethnique, crimes déchaînés, déprédations systématiques par les classes dirigeantes – n’a jamais été mis en place par aucune puissance occidentale sera réduit au silence pour néocolonialisme avéré.
La stigmatisation idéologique que le politiquement correct met sur le terme colonialisme empêche tout débat raisonné et documenté sur les événements historiques. Il empêche même de s’interroger, non pas de manière provocatrice mais parce que l’on veut tirer les leçons des erreurs du passé, sur ce qui a mal tourné dans le processus que l’on nomme décolonisation.
Mais il y a pire encore. La pensée « correcte » n’autorise pas une discussion sérieuse sur les formes que revêt le colonialisme – qui est une caractéristique immanente des sociétés avancées – dans notre XXIe siècle. En particulier, elle force à fermer les yeux de l’Occident sur la colonisation chinoise contemporaine de l’Afrique, au Nord comme au Sud du Sahara. Le politiquement correct – qui est une idéologie pour les somnambules – ne comprend pas que dans l’ordre mondial, que l’on se place un millénaire avant Jésus-Christ ou deux millénaires après Jésus-Christ, lorsque le siège du pouvoir est vaquant (dans ce cas suite au départ des pays occidentaux « coloniaux »), il ne le reste pas longtemps.
De ce point de vue, le politiquement correct est très proche du populisme. Il part du principe que les relations internationales devraient être gérées comme l’on gère des relations personnelles, et non sur la base d’une analyse complexe et multiforme qui doit examiner certains aspects qui échapperont fort probablement à un jugement naïf (au sens d’inexpérimenté). L’intérêt national est perçu comme une insulte ; la recherche d’un équilibre géopolitique et les alliances comme des crimes.
3. Droits de l’homme
Le système héliocentrique du politiquement correct tourne autour du soleil des droits de l’homme considérés non pas comme une notion en constante évolution, mais comme un concept éternel revêtant une dimension théologique. Les droits de l’homme sont absolus : non seulement ils ne peuvent être réduits et ne peuvent qu’être étendus, mais ils sont aussi la norme à partir de laquelle le passé doit être jugé.
Ainsi, en appliquant les méthodes politiquement correctes est-on amené à conclure que l’Empire romain était méprisable et doit être considéré comme l’un des exemples flagrants de violation des droits de l’homme parce qu’il a admis et fait largement usage de l’esclavage. De même, la Renaissance est une époque façonnée par une élite sexiste où les femmes sont représentées – depuis les Madones jusqu’aux peintures de Léda et du Cygne – uniquement pour leurs traits sexuels (seins, mamelons, fesses) et selon les stéréotypes masculins. La révolution industrielle, quant à elle, n’est pas une évolution – bien que douloureuse – de la société vers une prospérité généralisée, mais une histoire de violation constante des droits fondamentaux de la classe ouvrière.
Ces exemples sont simplement donnés pour souligner l’absence totale de perspective historique chez ceux qui épousent l’idéologie du politiquement correct ; une idéologie qui vénère des principes non discutables qui doivent être observés si l’on veut être admis au ciel des croyants authentiques. Chercher de juger les événements historiques avec les valeurs d’aujourd’hui est aussi ridicule qu’affirmer que Napoléon était un médiocre général parce que à Waterloo il aurait dû rappeler les troupes de Grouchy en lui téléphonant sur son portable…
Tenter de souligner que la notion de droits de l’homme est typiquement occidentale, qu’elle n’existe pas – et ne peut pas exister sauf au prix de grands efforts d’adaptation – dans d’autres cultures, qu’elle est le résultat d’un processus laborieux qui a connu d’innombrables défaites pour peu de victoires, qu’elle varie à travers le temps, les espaces, les sociétés, qu’un équilibre entre ces droits doive sans cesse être trouvé : tout cela est parfaitement irrecevable pour les authentiques pratiquants du politiquement correct.
Soulignons au passage ce qui rapproche ici le politiquement correct de la foi religieuse : le credo des droits de l’homme a en commun avec la foi son universalité autoproclamée. Et, tout comme la divinité ne saurait changer dans le temps et sous des cieux différents, les droits de l’homme seront immuables et éternels.
La religion des Droits de l’Homme exige des missionnaires dont le but est de convertir les infidèles à ses commandements : démocratie, égalité, non-discrimination, liberté d’expression, etc.
Cette croisade inédite est poussée par la ferme conviction qu’en adoptant la religion des droits de l’homme les païens laisseront derrière eux l’injustice, la pauvreté et la peur. Les missionnaires sauveront leurs âmes politiques. Et quiconque doutera qu’il s’agit là de la bonne façon de traiter d’énormes problèmes enracinés dans des siècles et des millénaires d’une histoire qui est complètement différente de celle de l’Occident, devra rejoindre les rangs des opposants hérétiques et des blasphémateurs.
Un trait caractéristique du politiquement correct, quel que soit le domaine où il s’applique, est qu’il châtie volontiers ceux qu’il perçoit comme ses ennemis, mais ne remet presque jamais en cause les conséquences et résultats de ses propres agissements. On pourrait à ce titre s’interroger sur l’existence, à un niveau de gravité certes inférieur à celui des crimes contre l’humanité que nous sommes moralement et juridiquement tenus de combattre, d’une autre catégorie de crimes : les crimes humanitaires. Je veux parler ici de ces drames qui se déroulent comme conséquence d’une incompréhension totale de la complexité du monde et, surtout, des différences qui, fort heureusement, y prévalent ; différences qui, précisément, excluent le recours à une seule et même approche et solution pour traiter de tous les problèmes. Si l’on voulait donner aux missionnaires du politiquement correct un avant-goût de leur propre médecine, on pourrait souligner que l’affirmation selon laquelle les droits de l’homme doivent être respectés à travers le monde entier – par des moyens pacifiques ou si nécessaire par la force (interventions dites humanitaires) – n’est qu’une version moderne du colonialisme politique.
Il y a un autre revers de la médaille que l’idéologie absolutiste et universaliste des droits de l’homme ignore. Comme cela a été rappelé, les droits de l’homme sont le résultat d’une longue évolution de la civilisation occidentale qui s’est étalée sur plus de trois millénaires. Ces droits ont été forgés à partir des principes religieux et éthiques judéo-chrétiens et de la philosophie grecque et romaine (et de toute la pensée qui en découle). Ces idées ont été constamment remises en question dans le monde occidental et n’ont émergé que très, mais très lentement. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et des dictatures qui l’ont provoquée sont entièrement occidentales, et l’affirmation et la protection des droits de l’homme sont la réponse que le monde occidental voudrait donner pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.
Mais une fois sorti du monde occidental, comment espérer – si ce n’est en utilisant un impérialisme intellectuel typique du politiquement correct – que d’autres cultures, civilisations, nations adoptent les mêmes principes ? Inversons les rôles : que ressentirions-nous, nous, Occidentaux, si nous devions abandonner notre système basé sur l’individualisme (et les droits de l’homme appartiennent à l’individu) pour épouser une approche communautaire – si commune en Extrême-Orient et profondément enracinée dans une religion et une philosophie – qui place l’intérêt collectif et sa sauvegarde au-dessus des goûts, des aversions, des besoins et des revendications de l’individu ?
Reconnaitre les limites historiques et géographiques de la doctrine des droits de l’homme aura deux avantages. D’une part, cela favorisera l’application de cette doctrine dans le monde occidental, en en faisant un élément essentiel du « droit du pays », droit que les minorités ethniques et religieuses ne peuvent contourner. D’autre part, cela apportera du pragmatique dans la diffusion de ces valeurs vers des régions qui nous sont assez étrangères et qui ne peuvent les absorber que très lentement et, espérons-le, sans passer par les mêmes épreuves qu’a connu le monde occidental ; épreuves au travers desquelles ces valeurs ont été forgées.
4. Religion
Les Lumières – qui ont donné naissance aussi au libéralisme – ont mené une guerre implacable contre la superstition et son institutionnalisation, représentée par les religions établies.
Comme dans toutes les guerres, elle a eu ses excès et ses dommages collatéraux, mais sans elle la voie vers d’extraordinaires découvertes scientifiques (sciences naturelles, physique, médecine) n’aurait pas été ouverte ; et la bannière de l’éducation gratuite et laïque, pour tous, sans distinction d’âge, de sexe ou de classe sociale, n’aurait pas été levée.
Le libéralisme a tenté de mettre en pratique le principe évangélique « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a eu, à juste titre, de nombreuses traductions de ce principe dans la réalité, selon les pays et les développements historiques, allant de la séparation complète (comme en France et aux États-Unis), à une religion d’État tempérée par une grande liberté religieuse (comme en Angleterre) et en passant par des accords entre l’État et l’Église dominante (les concordats en Italie, Allemagne, Espagne et dans d’autres pays encore).
Mais ce résultat ne peut être compris que comme un développement de la civilisation occidentale, et même un athée convaincu – comme l’est l’auteur de ces pages – sait que la religion judéo-chrétienne est à l’origine de cette évolution et que l’une des caractéristiques communes à toutes les branches de cette civilisation occidentale est précisément le rôle que le christianisme, dans ses multiples facettes, a joué, pour le meilleur et pour le pire, dans leur formation. Le libéralisme a combattu la bigoterie mais a toujours reconnu l’importance de la liberté de religion. Cette approche équilibrée est cependant déformée par le politiquement correct qui, étant intellectuellement faible et sans perspective historique, est incapable de distinguer entre la religion et d’autres formes d’expression sociale, telles que la mode, la nourriture, le style de vie, ou encore le mode de pensée.
Cette approche plutôt primitive s’exprime très clairement dans l’attitude politiquement correcte face à une croissance rapide et inédite de l’islam en Europe. L’islam est une religion extrêmement forte, non seulement sur le plan théologique, mais aussi parce qu’elle résiste aux influences extérieures.
C’est là une caractéristique que l’on retrouvait chez les deux autres religions monothéistes, juive et chrétienne, dont la rigidité et l’absolutisme ont toutefois été adoucis par les développements politiques et intellectuels que nous avons connus en Europe et outre-Atlantique et, cela doit être souligné, par l’entremise des gouvernements libéraux.
Le politiquement correct, face à cette réalité, a eu pour effet de réintroduire par la fenêtre ce qui avait été chassé par la grande porte à partir du XVIIIe siècle : la bigoterie, les superstitions et les fanatismes.
Le politiquement correct ne comprend pas que les religions, et l’islam en particulier, ne sont pas du même ordre que le véganisme, l’astrologie ou le soutien apporté à des équipes sportives. La religion est à l’origine de l’humanité et répond à des besoins transcendants de l’être humain, à la recherche de réponses qui ne sont pas rationnelles (d’un point de vue strictement philosophique) ; la religion est incommensurable dans sa puissance et dans ses dimensions où l’on peut et l’on veut se perdre.
Nos sociétés laïques et tolérantes ne peuvent résister à des enclaves organisées où nos valeurs ne seraient pas acceptées ou seraient méprisées. Encore une fois, le politiquement correct amène à un paradoxe : il rejette ou méprise le fait d’être chrétien et d’exprimer sa croyance par des voies traditionnelles, respectueuses des autres sensibilités, au prétexte que cela est offensant pour les autres. Mais simultanément, il considère répressive et discriminatoire toute tentative visant à contrôler des expressions similaires – mais généralement beaucoup plus radicales – émanant d’autres religions.
Ce que le politiquement correct ne comprend pas, c’est que la démocratie est le résultat d’un équilibre extrêmement complexe entre des valeurs concurrentes, qui acceptent d’être limitées pour que chacun puisse vivre et prospérer. La réciprocité joue ici un rôle fondamental, et y renoncer conduira inexorablement à la victoire de l’intolérance sur la tolérance, et cette intolérance appellera à davantage d’intolérance de la part des autres groupes.
5. Sexisme
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire des communautés, nous ne pouvons que relever une constante dans les habitudes humaines, présente en tout temps et sous tous les cieux : les prévarications et la violence des hommes envers les femmes. Dans les sociétés occidentales, cela a suscité une révolte très lente qui commença au XVIIIe siècle avec la revendication de l’égalité des droits et s’orienta progressivement (surtout dans le dernier quart du XXe siècle) vers une demande de reconnaissance de la diversité des statuts. Le principe que l’on veut affirmer est que les femmes ne sont pas égales aux hommes et il ne suffit pas pour affirmer leurs droits de leur octroyer les droits légaux et les opportunités sociales et économiques qui sont communément accordés aux hommes.
Dans ce contexte très complexe – où il n’est pas facile de déterminer quand l’égalité est essentielle et quand les différences doivent au contraire être respectées et garanties – l’approche politiquement correcte est dramatiquement simpliste, reposant pour l’essentiel sur des slogans idéologiques.
L’anathème que l’on adresse à tout ce que l’on oppose (qu’il s’agisse d’une loi ou d’un panneau indicateur, d’un mot ou d’un film, d’un élément architectural ou d’un vêtement) est que c’est « sexiste », ou l’expression du « sexisme ».
Selon l’accusation, le « sexisme » perpétue dans les discussions sur le rôle social de la femme une certaine image stéréotypée de celle-ci, basée sur son sexe, et soulignant que cette seule spécificité sexuelle est destinée à satisfaire le plaisir des hommes. Une telle représentation porte atteinte à la dignité des femmes et renforce les préjugés individuels et sociaux à leur égard.
En la matière, le politiquement correct omet cependant de noter que le rôle auquel il s’oppose avec tant de véhémence est, dans la grande majorité des cas, librement choisi par les femmes, en particulier pour ce qui concerne leur apparence extérieure.
A tel point que la croisade anti-sexiste finit par être la bataille d’une minorité, très petite mais extrêmement bruyante, qui veut d’abord imposer ses vues à toutes les femmes qu’elle prétend représenter. Si l’on évaluait de façon honnête – par exemple dans le cadre d’un référendum ouvert uniquement aux électrices – le soutien dont bénéficient les militantes anti-sexistes, il y a fort à parier que celui-ci serait au mieux marginal. Qui plus est, en suivant les opinions anti-sexistes, nous retournerions probablement, dans le domaine de l’habillement en tous les cas, à l’époque victorienne où une cheville nue était considérée comme une forme d’exhibition sexuelle. L’anti-sexisme finit par être une autre forme de sexophobie, où le sexe est luxure et perversion diabolique.
Un paradoxe qui se transforme en parodie involontaire lorsque le politiquement correct, au nom de la lutte qu’il prétend mener contre le sexisme, appelle à l’adoption – sous peine de sanctions – de « l’écriture inclusive ».
* * *
La principale objection au politiquement correct d’un point de vue libéral est qu’il restreint une liberté qui a été péniblement conquise après des siècles d’oppression et de répression : la liberté d’expression. Au cœur du politiquement correct nous trouvons le désir de contraindre la façon dont les idées sont exprimées, présentées, dépeintes, racontées. C’est un retour de la censure religieuse dont on croyait s’être débarrassé avec le siècle des Lumières.
De nouveaux tabous sont créés. Mais alors que par le passé ces tabous avaient une justification transcendantale, qui ne pouvait manifestement pas être contestée sans tomber dans l’hérésie ou l’apostasie, le politiquement correct ne possède en rien la dignité et la profondeur d’une religion. Il s’agit plutôt d’une posture intellectuelle aux bases théoriques fragiles, que chacun peut interpréter à sa manière, selon le temps, le lieu, les circonstances. Peut-on ajouter que c’est là l’une des caractéristiques de l’arène politique et sociale anglo-américaine. Il est en effet paradoxal que sur le lieu de naissance du libéralisme et de la démocratie aient été engendrées de telles idées antilibérales et antidémocratiques.
Le politiquement correct est une création du monde anglo-américain qui a du mal à se diffuser en Europe continentale, en particulier dans cette partie de l’Europe qui regarde la Méditerranée.
Pourquoi en est-il ainsi ? Manque d’intérêt de certains Européens à l’égard de sujets qui préoccupent profondément ailleurs ? Le fait est qu’il y a au moins deux « Occidents », qui, s’ils partagent de nombreuses valeurs, restent toutefois divisés sur certaines autres. Un nouveau coup est ainsi porté à la prétendue universalité des mots d’ordre du politiquement correct : ces mots d’ordre s’exportent mal vers des pays différents de ceux où ils ont été inventés.
D’un point de vue sociologique, le politiquement correct du monde anglo-saxon pourrait être considéré comme l’expression séculaire d’un radicalisme moral qui s’est autrefois exprimé par le canal des dizaines de confessions chrétiennes qui ont vu le jour après la réforme protestante et qui ont trouvé refuge aux États-Unis, terre promise de la dissidence religieuse et dont les institutions ont été profondément influencées par cette empreinte. Sans vouloir être irrespectueux, on peut comparer le mouvement du politiquement correct aux Quakers, aux Sabbatariens (des Chrétiens qui voulaient, au XIXe siècle, imposer un repos absolu le dimanche) ou encore aux partisans de la prohibition de l’alcool.
Une autre hypothèse pourrait cependant être avancée. Le politiquement correct, dans la perspective des sciences politiques, pourrait être perçu comme un oxymoron : une sorte de maccarthysme libéral. Elle place en tête de son agenda certains thèmes sans se soucier de savoir s’ils sont partagés par d’autres citoyens et dans quelle mesure.
Il est clair que la politique est imprégnée d’idéalisme, et le libéralisme n’y échappe pas. Les choses se corsent toutefois lorsque l’idéalisme prend une posture morale : quiconque ne partage pas les bonnes idées rejoint le camp des immoraux – les immoraux étant la version politiquement correcte des pécheurs. Le libéralisme, au contraire, est et doit rester tolérant : il doit accepter une diversité des opinions, des habitudes et des approches et doit constamment rechercher un équilibre entre ces expressions individuelles concurrentes pour protéger le bien commun.
Ce qui conduit à considérer une autre interprétation de l’évolution actuelle du discours public et des tendances politiques.
Le politiquement correct ne serait pas une réaction extrême – et d’une certaine façon justifiée – à un extrémisme auquel il faut faire front. Il serait plutôt le facteur irritant qui encourage la montée du racisme, d’un sentiment de « suprématie occidentale », et de postures sexistes. Ainsi qu’on le constate fréquemment chez ceux qui nourrissent peu de doutes quant à la pertinence de leurs croyances – les seules qui puissent être correctes –, les personnes politiquement correctes s’intéressent nullement aux conséquences de leurs actes ou de leurs paroles.
En particulier, les groupes minoritaires ne tiennent pas compte du fait qu’un nombre considérable – si ce n’est une majorité – de citoyens peuvent s’opposer à leurs opinions et exprimer leur désaccord de manière démocratique. C’est ainsi qu’ils n’hésiteront pas parfois à voter pour ceux qui prennent les positions diamétralement opposées. L’extrémisme nourrit l’extrémisme.
Cette approche condamne inévitablement le libéralisme à rester minoritaire, voire sectaire ; un club auquel seuls quelques-uns – les bons et les justes – peuvent prétendre. Ceux qui prêchent le politiquement correct sauveront ainsi leur âme politique dans un monde d’infidèles et de renégats. Et on s’engage alors sur une pente élitiste qui fera du libéralisme une proie facile pour les vagues actuelles de populisme démagogique, comme l’on peut le constater à travers les évènements récents qui se déroulent aux États-Unis.
Ainsi, au lieu d’être une théorie politique majoritaire ; une théorie capable de rassembler de plus en plus de gens persuadés que leur liberté et leur bien-être peuvent grandir avec celui du reste de la communauté, dans une quête constante de compromis et d’arrangements, le libéralisme devient un mouvement d’avant-garde facilement méprisable.
À long terme, les partisans du politiquement correct réaliseront peut-être que les libéraux étaient dans le vrai. Mais gardons en mémoire ces mots de John Maynard Keynes : « À long terme, nous serons tous morts ». Le libéralisme sera-t-il mort avec nous ?