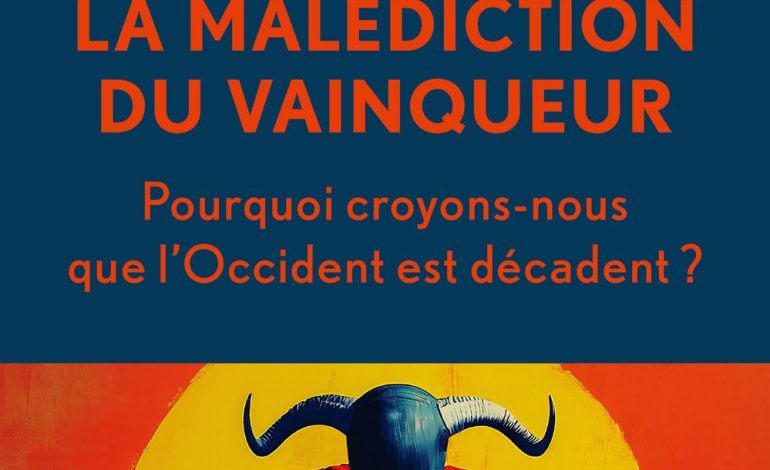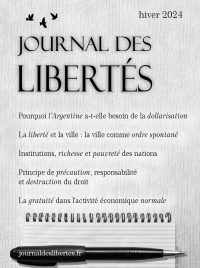Chez beaucoup de nos concitoyens le moral n’est pas au beau fixe en ce début d’année 2025[1]. Il faut dire que la situation n’est pas très brillante. Les finances publiques sont dans un état pitoyable et nos élus semblent bien plus préoccupés de se positionner pour les prochaines échéances électorales que par la nécessité de voter un budget qui tienne un tant soit peu la route. Les Français semblent avoir perdu, au moins pour certains d’entre eux, goût au travail ; le fait que leur pouvoir d’achat soit en berne, grevé par de lourds prélèvements obligatoires, un coût des énergies élevé et des loyers anormalement élevés, y est sans doute pour quelque chose. Peut-être aussi que l’épisode du Covid a fait croire à certains que « dans le monde d’après » nous n’aurions plus à travailler aussi dur. Les entreprises ont d’ailleurs parfois bien du mal à trouver les compétences dont elles auraient besoin pour se développer ; lorsqu’elles ne font pas le choix de s’expatrier…
C’est justement dans des situations de ce type qu’il importe de penser juste. Et « penser juste » suppose de la réflexion, de la sagesse et de la connaissance. Connaissances et sages réflexions : c’est précisément ce que nous avons l’ambition de vous proposer dans les pages de ce numéro. Pour reprendre une sentence de notre ami Pascal Salin : « il n’y a rien de plus pratique que la théorie ! » Si nous voulons écrire une nouvelle page en 2025 qui soit moins déprimante que celle de 2024, nous ne pouvons faire l’économie d’une telle réflexion.
Quels enseignements, par exemple, pouvons-nous tirer de l’expérience de l’Argentine qui nous soient utiles pour écrire cette nouvelle page ? Nous abordons ici cette question à travers deux contributions. Dans un premier temps, Nathalie Janson et Nikolai Wenzel retracent l’histoire chaotique de cette nation, tantôt leader de la classe des nations mais aussi bien souvent le mauvais élève. Ils soulignent le parallèle – en fait le lien de causalité – entre qualité des institutions et qualité du développement économique et social. Emilio Ocampo de son côté analyse l’histoire plus récente du pays et les réformes engagées par Milei. Ces réformes bien inspirées seront-elles couronnées de succès ? Si les libéraux comme tous les gens de bon sens le souhaitent ardemment, la réponse dépendra en large partie, nous explique Ocampo, de la crédibilité dont ses réformes jouiront, en Argentine mais aussi à l’étranger ; et cette crédibilité se construit, selon lui, par des engagements forts et irréversibles dans le domaine de la politique monétaire. Une leçon à garder à l’esprit en écrivant notre page pour 2025.
Si nous voulons prendre un nouveau départ il faudra encore savoir remettre en question des choix qui, à l’expérience, s’avèrent paralysants, pour ne pas dire désastreux. Les dernières décennies du XXème siècle ont vu la montée en puissance du principe de précaution. Pour une large majorité de nos concitoyens et de leurs représentants élus, ce principe permet l’avènement d’une société plus sécurisée, en écartant les catastrophes irréversibles. Aussi l’a-t-on inscrit dans nos lois et notre Constitution. Sa mise en œuvre s’est toutefois avérée bien plus complexe et coûteuse que prévu. Henri Lepage et Jean-Philippe Feldman retracent ici la genèse de ce principe en soulignant sa nature illibérale puisqu’il vient bouleverser la conception de la responsabilité qui avait été forgée tout au long de notre histoire et avait contribué au développement de l’occident. Il n’est dès lors pas surprenant qu’en prêtant allégeance à ce nouveau principe nous nous soyons aussi écartés des sentiers du progrès… et de la sécurité. Mais il est toujours possible de faire machine arrière.
Une question revient de façon récurrente alors que nous tentons d’écrire de plus belles pages pour notre société : les relations marchandes ne sont-elles pas « appauvrissantes » d’un point de vue humain ? N’encouragent-elles pas un biais égoïste ? N’est-il pas temps d’entrer dans l’ère d’un capitalisme plus social, plus généreux ? D’Aristote au pape François, en pensant par les réflexion de myriades de philosophes, de juristes et d’économistes, nombreux sont ceux qui se sont penchés sur cette question fondamentale. Guido Hülsmann et Jean-Philippe Delsol apportent des éléments de réponse intéressants ; le premier en examinant de plus près la nature des relations marchandes dont les effets secondaires positifs sont méconnus ; le second en reparcourant les grandes étapes du débat tout en prêtant une attention particulière au point de vue de la doctrine sociale de l’Église catholique pour en conclure que cette dernière ne remet pas en cause l’ordre marchand tout en appelant de ses vœux à des comportements individuels plus vertueux. Nul besoin donc de rectifier les piliers fondateurs de la société envisagée par les penseurs classiques libéraux. Si notre humanité a sans aucun doute une immense marge de progression, un tel changement serait un recul plus qu’une avancée.
A l’inverse, alors que nous réfléchissons au futur de nos sociétés, le changement technologique est une donnée que nous ne saurions écarter sans courir de graves dangers. L’incident survenu au cours des récentes élections en Roumanie nous le rappelle avec gravité : l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux qui y ont largement recours exercent désormais une forte influence sur l’issue des élections. Si les libéraux voient en général d’un œil favorable le développement et la concurrence entre de multiples médias, cette épisode roumain nous montre également que nos démocraties – sociales plus que libérales – pourraient en un rien de temps être balayées par des régimes autoritaires, voire totalitaires. Le récit détaillé des événements que nous proposent Diana et Christian Năsulea permet de mieux apprécier les enjeux. Nous y reviendrons dans les prochains numéros.
Les réflexions que nous menons aujourd’hui s’inscrivent bien sûr dans une tradition et bénéficient des travaux menés par d’autres. Nous revenons ici, avec Jean-Pierre Chamoux, sur les contributions des prix Nobel 2024 d’économie qui nous ont légué des contributions riches – en particulier sur le lien, souligné plus haut, entre les institutions de la liberté et le développement – mais aussi parfois discutables. Nous rendons également hommage à des économistes et entrepreneurs récemment décédés. Le premier, Jean-Dominique Lafay, a été un pionnier de l’école du Public Choice en France, s’attachant à comprendre le fonctionnement de nos démocraties et, dans de le cas du Professeur de Paris 2, les comportements des électeurs. Le second, Fred Smith, fondateur du Competitive Enterprise Institute à Washington D.C., a été un entrepreneur hors norme dans le monde des idées. Passionné par les questions environnementales, il a été l’un des grands promoteurs de l’écologie de marché montrant de quelle façon le respect de la propriété était un vecteur essentiel de la préservation de nos environnements. Son Institut fut également l’un des premiers à sensibiliser l’opinion sur le coût faramineux de la réglementation (Les milles commandements). Souhaitons que 2025 voit percer de jeunes entrepreneurs intellectuels de la trempe d’un Fred Smith !
Je termine en évoquant la contribution du Professeur Ikeda qui apporte de précieux éléments à travers son étude sur les villes. Il explique en effet que le développement d’une ville est déterminé par le mélange de planifié et de spontané qu’elle propose. La « ville vivante et harmonieuse » est celle où les décideurs publics ont imposé un cadre pour les interactions qui n’est ni trop étendu ni trop détaillé afin que puisse s’exprimer le génie créatif de ses habitants et germer des coopérations. En ce début d’année 2025, souhaitons-nous de chercher et de trouver ensemble le bon dosage d’ordre créé et d’ordre spontané qui nous permettra d’écrire une belle page de notre histoire.
[1] Une impression que confirme l’enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages réalisée par l’INSEE pour décembre 2024 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8319418.