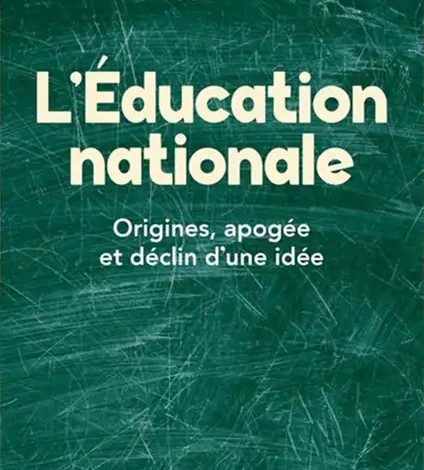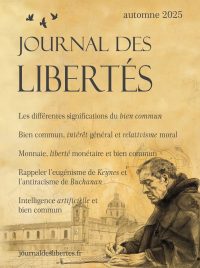de Geoffroy Legentilhomme
Éditions Alphil-Presses universitaires suisses 2024, 317 pages
C’est entre les années 1846 et 1912 que l’assurance-maladie est apparue en Suisse. Concordia, l’une des plus importantes mutuelles helvétiques d’aujourd’hui, remonte à une Caisse d’assistance catholique de Zürich fondée en 1879, reliée un peu plus tard à la Fédération des caisses-maladie catholiques de Suisse alémanique. Au début de la période que couvre l’ouvrage de Geoffroy Legentilhomme (principalement de 1846 à 1974) de nombreuses caisses-maladie s’organisèrent à l’échelle locale, autour de métiers comme les « fabricants de ressorts de Genève », mais aussi au sein d’entreprises ou d’organismes proto-syndicaux qui se multipliaient à cause de l’industrialisation. Des initiatives mutualistes furent soutenues par des personnalités et par des notables qui animaient, par exemple, le radicalisme politique, très actif en pays de Vaud au milieu du XIXe siècle.
Certaines caisses d’entreprise auxquelles l’adhésion des employés était obligatoire, furent inspirées par des préoccupations hygiénistes ou philanthropiques, voire par du pur paternalisme. Quelques secteurs marqués par le syndicalisme (brodeuses, commis-voyageurs ou hôtellerie) ont vu naître des caisses mutuelles couvrant leurs membres ou des compagnons itinérants qualifiés. Reposant sur le volontariat, ces caisses étaient administrées par des pairs, sauf celles qui dépendaient d’une entreprise, gérées par l’employeur.

Un livre solide, bien organisé & accessible
De propos historique, édité avec grand soin, ce livre est issu d’une thèse de doctorat soutenue par l’auteur à l’Institut des Hautes Études Internationales de Genève (IHEID). Il comporte tout le dispositif qui permet de valider une recherche académique solide : sources, bibliographies, tableaux, graphiques, schémas etc. Toutes ces références sont claires et parfaitement exploitables[1]. Les citations qui émaillent les dix chapitres de l’ouvrage, bien choisies, illustrent une époque, un enjeu économique, social ou politique ou des faits saillants d’une période.
L’introduction générale (pp. 13 à 32) précise l’approche historique et l’organisation de cet ouvrage en trois parties qui abordent, par ordre chronologique :
– I/ les prémisses du mutualisme (p. 35 sq.) et sa rencontre avec un État social naissant (1846 à 1912) ;
– II/ le quasi-marché de l’assurance-maladie (p. 95 sq.) ainsi que l’évolution des mutuelles et de l’assurance médicale (1912 à 1936) ;
– III/ la diversification de l’assurance-maladie (p. 179 sq.), longue transition (1936 à 1974) qui prépara le régime contemporain, obligatoire en Suisse depuis 1994.
Partie I : de l’entraide à l’État social
Très nombreuses dans la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés d’entraide mutuelle, souvent purement locales, existaient dans l’ensemble des cantons alémaniques et romands (Chapitre 1). Pour illustrer leur parcours historique, le livre décrit à grands traits au Chapitre 2 la naissance et la vie sociale de la Société vaudoise de secours mutuel (SVSM) issue du « radicalisme » qui tentait de contrer le fédéralisme de l’époque en exigeant « plus d’État » et un « pacte national » ! Nettement anticlérical, le parti radical (et ses émanations comme la SVSM) portait donc, après 1845, un projet politique : multiplier les institutions politiques du Pays de Vaud : banque & caisse d’épargne cantonale, hospice public pour infirmes, vieillards et indigents etc. Les animateurs de la SVSM quadrillaient leur territoire en liaison avec les prestations de la Société fédérale de secours mutuel fondée à Genève avec une ambition nationale ! La SVSM fut un outil pour quadriller le canton vaudois et soutenir le parti radical et son influence politique ; influence qui diminua nettement plus tard. Il s’agissait aussi de contrer l’influence du patronat conservateur.
Autour de 1900, les circonstances politiques conduisirent la confédération – qui siège à Berne – à intervenir dans le domaine des prestations maladie et accidents. Pendant une trentaine d’années, les thèses centralisatrices, d’origines socialiste et syndicale, tentaient de limiter l’effet de la subsidiarité qui inspirait communes et cantons suisses, depuis des siècles et dans leur majorité. Avec l’industrialisation du territoire, l’idée de socialisation progressait ; inspirés par la « lutte des classes », syndicalistes et socialistes animaient la politique intérieure. Le Chapitre 3 évoque ces influences et le climat politique agité de l’époque. Il souligne que les dispositions impériales prises en Allemagne faisaient émerger un « État social ». Mais il fallut une bonne dizaine d’années avant que le Parlement de Berne accouche d’un projet de loi fédérale qui devait encadrer l’assurance-maladie suisse pendant 80 ans !
Partie II : croissance d’un quasi-marché
Votée en 1911, entrée en vigueur un an plus tard, la Loi fédérale sur l’assurance maladie et les accidents (acronyme : LAMA, par la suite) fut l’un de ces exercices de compromis et d’équilibre politique métastable dont les helvétiques détiennent le secret : placées dans un cadre nouveau conçu pour encadrer – et donc protéger –, les sociétés de secours mutuel du XIXe siècle, très nombreuses (2000 environ en 1903, p. 51), ont peu à peu découvert des règles de prudence et de gestion, inspirées ou dérivées de celles des actuaires de l’assurance, afin de durer et de prospérer. Les Chapitres 4 & 5 décrivent cette évolution et ses conséquences sur le secteur mutualiste suisse.
Car, pendant plus de trois-quarts de siècle, le tissu mutualiste antérieur, celui du secours-mutuel, s’est professionnalisé. On redécouvrit, par exemple, le besoin de réassurer le risque des caisses locales afin de lisser ce risque et de garantir la couverture des membres d’une caisse. Il faut aussi dire que, dans le même temps, les compagnies d’assurance-vie expérimentèrent, de leur côté, des compléments aux polices-vie, pour une clientèle de professions libérales et de bourgeois qui découvrait l’assurance-maladie !
En substance : la LAMA solidifia le mutualisme antérieur et le força à s’affermir alors que les assureurs privés restaient en marge de cette branche qu’ils n’apprivoisèrent que plus tard, avec circonspection, sans marcher sur les plates-bandes des mutuelles ! Pour ces dernières, le paiement des frais médicaux et pharmaceutiques devint rapidement crucial : le paiement direct des frais et honoraires par les mutuelles fut une cause de tension permanente entre caisses et corps médical. Car, instruites par le précédent allemand, les caisses mutuelles voulaient contrôler le prix des prestations, ce qui menaçait le libre choix du médecin par le patient suisse.
De leur côté, les médecins libéraux étaient partagés ; certains – à Bâle en 1863 et à Zürich en 1901 – avaient déjà fondé une caisse remboursant les frais médicaux à leurs patients. Mais la majorité du corps médical craignait une socialisation de leur art et l’intervention de l’État entre le médecin et son patient (air bien connu de nos jours!) Car, dans les faits, la LAMA interdisait depuis 1912 toute discrimination de cotisation et de prestation entre mutualistes d’une même caisse : « les taxes doivent être les mêmes pour tous les membres » (p. 107). On verra, un quart de siècle plus tard, que les assurances privées prospérèrent en appliquant la politique inverse : multiplier les options et les choix concernant la franchise, les risques couverts, le couplage vie & maladie, les contrats de groupe avec des employeurs etc.
La période de l’entre-deux guerres (Chapitre 6, 1920 à 1940) fut marquée, en Suisse comme ailleurs en Europe, par l’avènement des assurances-sociales sous de multiples formes : Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas etc. Legentilhomme explique le rôle que prit l’Organisation Internationale du Travail (OIT, fondée en 1919) et surtout le Bureau International du Travail (BIT) pour élargir et uniformiser la couverture sociale des pays-membres du BIT (Genève, juin 1927). L’objectif était double : rendre obligatoire la couverture-maladie, d’une part ; et l’étendre à la famille du cotisant, d’autre part (p. 133)[2] .
Le livre résume aussi (pp. 133-137) comment le BIT préempta la coordination internationale voulue par les Caisses mutuelles, afin : 1/ que l’assurance-maladie devienne un « instrument … d’hygiène sociale », 2/ de « promouvoir (le BIT) », et 3/ de réorienter la doctrine : l’assurance-maladie doit être une fin, pas un moyen car : « l’accès aux soins … détermine(e) la santé des masses [sans] considération d’économie [3] ! » (p. 137). Réunie à Zürich en 1929, une autre Conférence du BIT engagea les mutuelles à investir dans des centres de soin, de diagnostic, de traitement (hôpitaux, dispensaires, sanatoriums…) afin de contourner les réticences du monde médical (libéral) à leur égard ! Le mutualisme, dans ce cadre international, est donc devenu un moyen de promouvoir la socialisation des cotisations, formule dérangeante pour la plupart des caisses suisses ; les commentaires du corps médical ne furent pas tendres : le Chapitre 7 est consacré à ces rapports entre médecins et caisses-maladie car : « le mutualisme suisse mutait et convergeait avec [l’assurance] » ; l’auteur s’appesantit sur trois points de friction séculaires :
– « l’odieux système du tiers-payant » (p. 146 sq.),
– « l’inexorable hausse du coût des soins et des traitements » (p. 157 sq.)
– et « le caractère illusoire d’un mécanisme comme le ticket-modérateur » incapable de stopper l’accroissement des dépenses qui est inéluctable (p. 167 sq.) !
En 1936, fin de cette seconde partie du livre, le rapport des Caisses mutuelles aux médecins était tendu. L’assurance-sociale ayant touché presque toute la population, la clientèle aisée des cabinets médicaux s’atrophiait ; mais des polices d’assurance-maladie, couplées avec d’autres garanties, échappaient aux contraintes de la LAMA et prenaient leur essor.
Partie III : diversification de l’assurance-maladie
Cette dernière partie couvre surtout les années d’après-guerre, période que Jean Fourastié baptisa « Les trente glorieuses » dans son essai éponyme[4]. Comme en France et pratiquement au même moment, la vie économique de la Confédération helvétique se transforma profondément. Le Chapitre 8 résume la manière dont les caisses mutuelles suisses ont tenté de s’adapter au climat économique et social de ces années très actives, parfois turbulentes : les caisses renforcèrent leur professionnalisme. Et malgré de nombreuses tentatives d’amender la LAMA, les mutuelles ont grandi et prospéré à réglementation constante ; poussées à la concentration, leur nombre diminuait : 1 100 caisses en 1950 et seulement 700 en 1974 (p. 195). L’importance des caisses publiques diminua (20% des caisses-maladie en 1945, contre 8% en 1974). De plus, les caisses privées reconnues à l’échelle nationale prospérèrent, : elles servaient 53% des assurés en 1974, contre un tiers seulement trente ans auparavant !
Le chapitre 9 décrit la montée en puissance de l’assurance-maladie privée en Suisse : comme dans la France dépeinte par Fourastié, la classe moyenne croissait et s’embourgeoisait, ouvrait des comptes bancaires et souscrivait des polices d’assurance. Avec une croissance nationale moyenne de + 3% l’an et une monnaie stable, le franc suisse dont le pouvoir d’achat se maintenait, les compagnies d’assurances « jettent leur dévolu sur les classes moyennes » (p. 200). Leurs polices-maladie, dont l’expérimentation à petite échelle remonte au début du XXe siècle (Cie. La Suisse, Lausanne, 1892), avaient exploré ce segment nouveau de l’assurance, étudié attentivement la vie sociale des mutuelles et leurs pratiques actuarielles[5]. Elles en tirèrent parti.
Autre point important, plus politique : les bonnes relations entretenues par les assurances avec le corps médical (et à plusieurs titres) permirent aux compagnies de recevoir l’appui des médecins et de leurs instances représentatives. Les assureurs écartèrent délibérément le tiers-payant, laissèrent aux patients le soin de régler les actes médicaux, sur la base de prix libres. Soumis à la réglementation de l’assurance, les polices maladie privées furent présentées au corps médical sous des couleurs libérales et avantageuses pour les médecins ! L’entrée très réussie des assurances privées dans la couverture de l’assurance-maladie fut donc un jeu à somme triplement positive : bonne pour les assureurs, satisfaisante pour le corps médical, approuvées par les assurés qui les ont souscrites en grand nombre !
Le cas de VITA, branche-vie de la Zürich, cas d’espèce résumé dans ce chapitre 9, est illustratif du succès des assureurs-vie (pp. 206 sq.). Les polices de l’Union (Genève) et d’Helvetia (Zürich) ne couvraient initialement que des risques-santé « catastrophiques » pour l’assuré (p. ex. l’hospitalisation lourde) ; elles excluaient nommément les « bagatelles » de la vie quotidienne que les assurés supportaient eux-mêmes, tout au contraire des mutuelles-santé qui n’excluaient aucun « petit-risque ». Ravi de cette liberté tarifaire retrouvée, le corps médical s’en félicita : « seules les maladies graves et longues perturbent le budget des ménages », constatait la VITA en 1943. L’assurance privée offrait donc une « alternative à l’assurance-sociale » qui était optionnelle (p. 214). De plus, ces compagnies proposaient des contrats de groupe et de prévoyance-vieillesse, eux aussi hors du champ de la LAMA. La rentabilité de ces polices se confirma (Graphique 6, p. 223) : dès la fin des Trente Glorieuses suisses, elle dépassait celle de la branche-vie (1974).
Les caisses-mutuelles réagirent vivement à ce succès (Chapitre 10). Leur contre-offensive prit deux formes : une réorganisation de la mutualité à l’échelle nationale, d’une part ; et le renforcement d’une réassurance proprement mutualiste, d’autre part (p. 248 sq.). La Caisse de réassurance pour longues maladies (CLM, fondée en 1943) en était la préfiguration. Dans le même temps, la mutualité suisse confirmait sa doctrine : « il faut renforcer les compétences de nos personnels et faire triompher l’idée mutualiste » expliquait la Mutualité romande en 1964 (p. 264). Ce prosélytisme rappelle l’engagement du Crédit mutuel, autant en Allemagne qu’en France ou qu’en Suisse[6], engagement toujours vivace aujourd’hui dans l’assurance et la banque de dépôt de ces pays, qui s’appuie sur une doctrine dont il reste des traces dans la chronique contemporaine, résumée par l’expression passe-partout : l’économie sociale et solidaire !
Principaux résultats de l’étude
La Conclusion générale de l’ouvrage (pp. 271 à 282) est une bonne synthèse des enjeux que pose l’assurance-maladie, non seulement en Suisse mais aussi dans beaucoup d’autres pays cités çà et là par l’auteur (Europe occidentale & États-Unis) : enjeu politique pour la population et pour le secteur de la santé ; diversité et coût croissant des prestations ; besoins extensifs de diagnostic, de cure, de traitement, d’instrumentation, de prévention etc., autant de besoins qui débordent les pronostics budgétaires, sans qu’aucune solution rationnelle en stoppe l’envol ! Legentilhomme évoque aussi des abcès de fixation qui, en Europe, aux États-Unis, en Corée ou au Japon, paralysent l’action publique et cristallisent les tensions (entre médecins et caisses-maladie, entre assurances et mutuelles, entre subsidiarité et centralisme etc.) : aucun pays moderne ne semble capable de les réduire, même pas la Confédération helvétique malgré son sens du compromis, sa bonne gestion de la monnaie, de l’économie, des relations sociales et sa vieille tradition de subsidiarité politique…
En définitive, cette synthèse finale prouve que le mutualisme suisse, malgré la puissance des compagnies d’assurances qui lui ont taillé des croupières, a tenu son cap séculaire et répondu aux défis des deux derniers siècles : en maladie, une quasi-entente entre assureurs et mutualistes (cf. pp.118-123), parfois bancale, est apparue au fil du temps. Depuis la refonte du système-maladie en 1994 (acronyme actuel : LAMaL) les assureurs jouent leur jeu avec finesse tandis que la mutualité qui intégra peu à peu le savoir-faire assuranciel au cours du XXe siècle, reste durable. Il en résulte ce que j’appelle, faute de mieux, un quasi-marché, mâtiné par l’esprit de cartel qui n’est pas rare dans un secteur oligopolistique comme l’est l’assurance-maladie : système fortement réglementé, partagé entre des prestataires organisés, concentrés, interconnectés et solidement réassurés !
Enseignements de cette recherche historique
La décentralisation institutionnelle et la subsidiarité confédérale furent un terrain fertile pour démultiplier l’expérience des caisses du secours-mutuel helvétique qui protégeaient, à l’origine, leurs associés contre la perte de revenu d’un journalier temporairement incapable de travailler ; pour l’essentiel, sa caisse de secours versait des indemnités à son foyer.
La mutualité suisse accumula ainsi, pendant plus d’un demi-siècle, une vaste expérience ; elle explora de nombreuses options, selon les lieux, les besoins et le milieu social des associés-mutualistes. Cette entraide allait de pair avec de strictes règles de conduite, une auto-surveillance des membres et l’implication de chacun d’entre eux dans la vie sociale de leur caisse : les assemblées étaient suivies, actives ; elles s’accompagnaient d’un certain folklore, d’inspiration religieuse, philanthropique ou corporative. L’illustration reproduite en couverture de l’ouvrage de G. Legentilhomme en donne un aperçu !
Le vote d’une nouvelle loi fédérale, le 4 décembre 1994, scella la fin de la longue période que décrit l’ouvrage de Geoffroy Legentilhomme : l’expérimentation et la découverte empirique de modes divers pour se garantir contre le risque-maladie en Suisse sont terminées. Entrée en vigueur en 1996, la présente loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaL) instaure un régime obligatoire[7] qui remplace le régime facultatif antérieur, d’inspiration personnaliste et déconcentré, qui laissait chacun choisir comment se garantir contre la maladie et décider avec qui et comment se soigner [8]!
La LAMaL prend acte d’un fait politique et social : ce que l’on appelait, il n’y a pas si longtemps, « assurance médicale et pharmaceutique » n’est plus du tout une assurance car elle ne garantit pas contre l’effet délétère d’événements aléatoires susceptibles de porter tort à un assuré, objet précis de l’assurance ! Au surplus, puisque les « primes » sont désormais insensibles et à la personne et aux risques particuliers qu’elle peut prendre (p. 276), volontairement ou pas, plus aucun calcul actuariel n’est possible.
Il faut alors se rendre à l’évidence : du fait de son caractère obligatoire et des conditions de sa mise en œuvre, la LAMaL socialise la prise en charge de la consommation médicale de tout le monde en Suisse. Au surplus, elle généralise une situation de « hasard moral » qui suscite des effets d’aubaine, de la fraude et d’autres abus, semblables à ceux qui minent la sécurité sociale française et bien d’autre régimes socialisés, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis notamment ; des faits qu’illustrent quotidiennement le comportement de nos peuples depuis les années quarante [9] !
L’auteur note également que, malgré la longue et prudente maturation des caisses-mutuelles suisses, la Confédération n’évite aucune des chausse-trappes qui provoquent la dérive incontrôlée de la dépense et l’appel ultime à l’impôt pour combler le déficit structurel de cette action publique. En cette matière, la Suisse ne garde qu’une de ses anciennes particularités : les ménages y supportent directement une partie plus significative des coûts supplémentaires que partout ailleurs : son assurance-maladie de base ne couvre que 30% des soins effectivement dispensés (p. 281) !
Loin de satisfaire « le peuple » et son corps médical, la LAMaL suscite constamment des débats et de multiples « initiatives populaires » [10], tant à l’échelle locale que fédérale. Cela n’empêche nullement la « praxis » de progresser, l’instrumentation et la pharmacopée d’innover et les besoins nouveaux de s’exprimer ! Mais, étant donné le vieillissement de la population qui caractérise notre époque, je crains qu’il faille encore bien d’autres thèses et d’autres événements politiques pour faire revenir les garanties maladies dans les clous budgétaires.
L’ouvrage que je viens de décrire et de commenter pose remarquablement bien des questions qui risquent de rester au cœur de l’actualité très longtemps, en Suisse comme ailleurs en Europe !
[1] Actuellement attaché au centre d’histoire économique et sociale de l’Université de Zürich, Geoffroy Legentilhomme a été invité à l’Université d’Utrecht et primé pour la « meilleure thèse historique défendue » en 2021.
[2] La Suisse ne ratifia pas les conventions établies par le BIT en 1927 au motif que l’assurance obligatoire n’était pas compatible avec le système suisse qui ne prévoyait pas le paiement des cotisations par les employeurs (p. 134).
[3] Souligné par nous.
[4] Les Trente Glorieuses, révolution de l’invisible (1946 à 1975), Fayard, Paris 1979.
[5] NB : établies en Suisse en 1937, les tables de morbidité éclairaient bien la couverture des frais médicaux (p. 202).
[6] Le remarquable centre de séminaires et de formation du Bischenberg, proche de Strasbourg, en témoigne !
[7] Voir note 2 supra rappelant le refus de la Confédération de ratifier la Convention BIT 1927 sur l’assurance obligatoire.
[8] Ces questions, qui ne sont plus d’ordre historique, sortent du propos du livre ; l’auteur y fait toutefois allusion, tant dans son propos introductif (p. 14-15) que dans ses conclusions générales (pp. 276-277).
[9] Pourrait-on aller plus loin en comparant la situation des caisses-maladie d’aujourd’hui à celle des banques couvertes, depuis des décennies, par la garantie que leur offre l’État en cas de « panique bancaire » ? Pour les banques comme pour les caisses-maladie, l’État est un « assureur en dernier ressort » !
[10] Projets de référendum. Cf. p. 14 : résumé des initiatives relevée lors de la publication du livre.