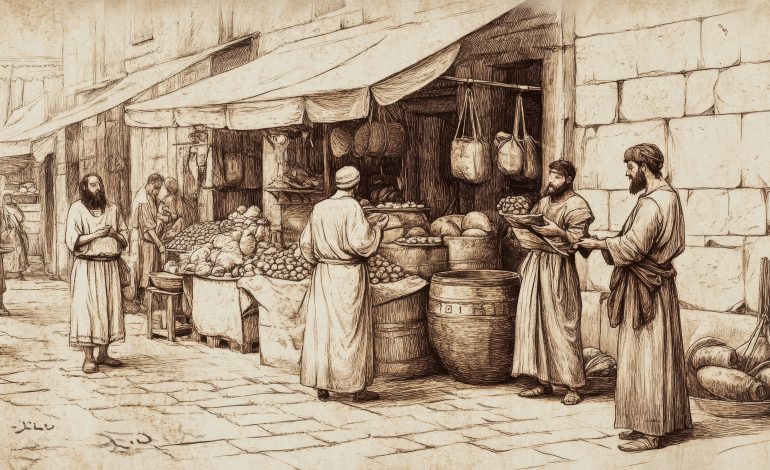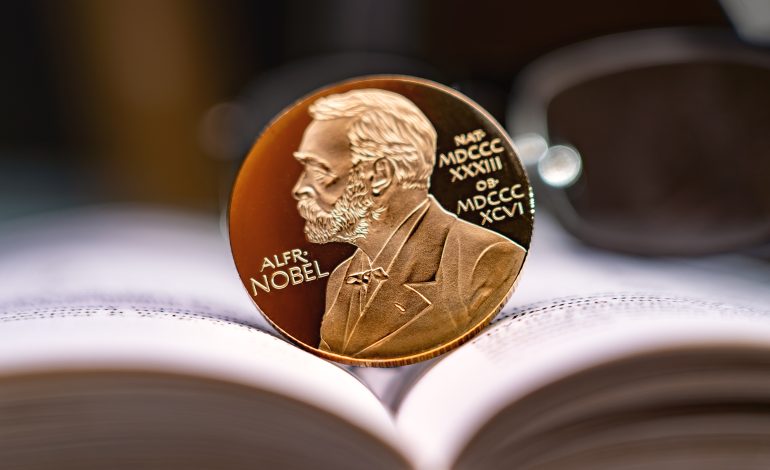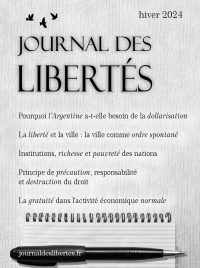« A la différence du conseiller du prince ou du décideur de terrain, qui doivent souvent trancher très rapidement, le milieu académique dispose de temps. A lui de savoir profiter de cet avantage comparatif pour proposer des politiques publiques réellement meilleures… au bénéfice de tous ».
Jean-Dominique Lafay, 1993.

Introduction
Avoir le privilège de rendre hommage à Jean-Dominique Lafay c’est d’abord évoquer quelques souvenirs personnels. C’est le souvenir d’avoir souhaité intégrer le DEA Analyse des décisions publiques et le laboratoire d’Économie Publique de Paris 1 dirigés par Jean Bénard que Jean-Dominique Lafay venait tout juste de rejoindre. Cette volonté était motivée par un intérêt certain pour le lien entre économie et vote mais aussi par la lecture de l’article de la Revue économique « Les interactions entre économie et politique : synthèse des analyses théoriques et empiriques » co-écrit par Friedrich Schneider, Werner Pommerehne et Jean-Dominique Lafay. L’école de Zürich et celle de Poitiers réunies en un seul papier, en somme. C’est ensuite la chance d’avoir appartenu au noyau de doctorants ayant participé à la refondation du LEP en nouveau LAEP (Laboratoire d’Économie Publique) dont Jean-Dominique Lafay prendra la direction. L’économie publique normative côtoiera dès lors l’économie publique positive avec sa vision Public Choice du comportement des décideurs publics. Ou plutôt l’Analyse économique de la politique comme Jean-Dominique Lafay aimait à l’appeler.
C’est aussi l’opportunité et le plaisir d’avoir travaillé avec lui sur la première fonction de vote des municipales françaises et le premier modèle de vote prédictif régionalisé des législatives de 1993. Puis ce sera une thèse et une habilitation à diriger des recherches soutenues sous sa direction. C’est enfin le souvenir ému d’une dernière rencontre à l’occasion d’un jury de thèse à Panthéon-Assas en 2016.
Rendre hommage à Jean-Dominique Lafay c’est enfin évoquer dans cet article des travaux atypiques au sein de la communauté des économistes français. Avec un choix résolu de raisonner en termes d’interactions politico-économiques et de dépasser le modèle d’un État « despote bienveillant ». Nous évoquerons ainsi son ancrage dans la théorie des Choix Publics et les travaux qui l’ont inspiré et qu’il intégrera dans son analyse économique de la politique. Nous verrons aussi son intérêt pour les fonctions de vote et la prévision électorale avant de se remémorer le grand expert de la gouvernance des institutions qu’il fût, en théorie comme en pratique, avec ce souci permanent de dépeindre l’État tel qu’il est et non tel qu’il devrait être.
1. Un ancrage dans la théorie des Choix Publics
L’analyse économique de la politique de Jean-Dominique Lafay s’inscrit dans le courant des Choix Publics[1] au sens où il critique les insuffisances d’une théorie où l’État serait considéré comme un « despote bienveillant ». Ce courant a véritablement émergé à la suite de la publication en 1962 du Calculus of Consent, ouvrage référence de Buchanan et Tullock qui développe un nouveau programme de recherche portant sur l’« analyse économique des processus de décision non-marchands ». Le paradigme des choix publics repose sur trois postulats : l’individualisme méthodologique, les choix rationnels et la politique comme processus d’échange. Les inspirateurs ou précurseurs du courant sont aussi divers qu’Adam Smith, Knut Wicksell, Joseph Schumpeter, Kenneth Arrow, Duncan Black ou encore Anthony Downs.
Ce positionnement rompt avec les approches normatives dominantes des années 1950-1960 à plusieurs titres. Que ce soit la théorie de la politique économique de Jan Tinbergen, la macroéconomie keynésienne ou la théorie néoclassique, toutes à leur manière idéalisent un État qui se comporterait tel un « despote bienveillant » pour reprendre la formule de Wicksell. Son unique objectif serait de maximiser le bien-être collectif ou d’atteindre l’intérêt général à l’aide d’outils de politique économique appropriés (impôts, dépenses publiques) ou de mécanismes régulateurs optimaux corrigeant le marché lorsque celui-ci est en situation d’échec. Dans tous les cas, l’État n’a pas de fonction de comportement autonome et fait face à des agents économiques passifs, privés de choix, et dont on cherche parfois à faire le bonheur malgré eux.
Ces approches ignorent donc les mécanismes relatifs à la formation des choix dans une démocratie au sein de laquelle la fonction « objectif » du gouvernement doit tenir compte du calendrier électoral et où les agents économiques sont aussi des électeurs réactifs maximisant leur utilité à travers leur vote.
D’où l’importance de regarder l’État tel qu’il est dans le cadre d’une approche positive et non tel qu’il devrait être en vertu d’une approche purement normative. C’est vrai lorsque l’on considère le comportement des hommes politiques mais aussi celui des bureaucrates, qui sont pourtant censés assister les premiers, tout comme ils devraient servir l’intérêt général (Voir Niskanen, 1971). C’est aussi de cette façon qu’il faut analyser les groupes de pression (Olson, 1965) qui cherchent à négocier des politiques favorables aux intérêts de leurs membres. Enfin, dans ce cadre d’analyse, les électeurs jugent et évaluent les performances des gouvernants à travers leur vote. L’électeur devenant même un « dictateur positionnel » lorsqu’il occupe une position médiane et que les partis en compétition cherchent à obtenir sa voix décisive (Downs, 1957).
L’État est par conséquent un conglomérat, sans fonction de comportement stable, au sein duquel chaque entité agit en vue de maximiser ses intérêts propres. L’État doit enfin s’accommoder du marché politique (Tullock, 1976), sur lequel son offre de politique est confrontée à la demande de politique des citoyens. Si bien qu’à l’instar de Tufte (1978), on doit considérer que « lorsqu’on pense économie on doit penser élections, et lorsqu’on pense élections, on doit penser économie ». Pour toutes ces raisons, Buchanan (1999) considérera que l’approche Public Choice revient en définitive à une « approche économique de la science politique ».
Pour autant, l’économiste peut-il rester constamment dans une posture positiviste à la Robbins ou à la Friedman, se comportant à la façon d’un expert et empiriste qui se garderait bien de délivrer, tel un docteur, des prescriptions normatives. A cet égard, la théorie des Choix Publics autorise plusieurs approches. Elle constitue en premier lieu une véritable boîte à outil dans laquelle on peut emprunter pour analyser tout sujet où la sphère économique entre en interaction avec la sphère politique. Mais elle peut aussi constituer une position idéologique dès lors qu’elle soutient – contrairement à Keynes ou aux théoriciens du bien-être – que les « défauts » de l’État sont supérieurs aux « défauts » du marché (Lafay, 1986). La théorie des choix publics peut alors se concevoir comme une approche normative aussi bien que positive.
La Public Choice Society sera lancée en 1963 en même temps qu’une première conférence et une revue qui portera le nom de Public Choice, sous l’égide de James Buchanan et Gordon Tullock. Jean-Dominique Lafay fera partie du Comité d’administration de la revue à partir d’octobre 1990. La Public Choice Society promeut à ses débuts des travaux plutôt formalisés offrant une large place au raisonnement et aux outils microéconomiques.
Quelques années plus tard, en 1972, sous l’impulsion de Bruno Frey et Friedrich Schneider, du danois Martin Paldam et du français Pierre Salmon, est lancée la European Public Choice Society dont les premières conférences se dérouleront à Bâle jusqu’en 1979. C’est précisément à cette école que Jean-Dominique Lafay adhérera. Outre les travaux formalisés, l’EPCS sera très largement ouverte aux travaux de validation empirique par l’économétrie.
Tout comme Pierre Salmon en 1980 (Florence) et en 1991 (Beaune), Jean-Dominique Lafay organisera par deux fois le colloque de la European Public Choice Society à Poitiers (1982) et à Paris (2001)[2]. Il a aussi été partie prenante à la conférence sur le vote économique organisée en 1999 par Martin Paldam et Michael Lewis-Beck à Sanjberg (Danemark) qui permit à toute une génération de jeunes chercheurs[3] de présenter leurs travaux à de grandes figures du Public Choice.
2. Lafay, un diffuseur du Public Choice et de la nouvelle économie politique en France
En France, le contexte se prêtait mal à la diffusion des travaux des auteurs du Public Choice. Début 1960, le pays n’est sorti du plan Marshall que depuis sept ans à peine et l’économie s’ouvre à nouveau dans le cadre du 3ème plan. Il va de soi que la théorie macroéconomique, la théorie de la politique économique et l’économie publique normative (y compris le calcul économique public) règnent en maîtres. Il faudra attendre la seconde moitié des années 1970 et la crise de l’État providence pour voir cette suprématie contestée.
Néanmoins, au milieu des années 1970, quelques économistes français libéraux, ou à penchant libéral, vont s’intéresser aux Choix Publics. On y retrouve notamment, Pierre Salmon, Jean-Jacques Rosa, Jacques Lecaillon, Alain Wolfelsperger, François Seurot, Louis Levy-Garboua, Bertrand Lemennicier, Henri Lepage, Gérard Bramoullé, Guy Gilbert et bien entendu Jean-Dominique Lafay. Tous remettent en question l’aspect quelque peu irréaliste et angélique du traitement de l’État dans les approches dominantes. Ils se veulent également très critiques sur la liaison a priori vertueuse unissant expansion de l’État (et donc de la dépense publique) et prospérité économique telle qu’elle est décrite dans le mécanisme du multiplicateur keynésien. Selon eux, l’inexorable croissance du secteur public (formule de Lecaillon, 1988) se traduit au contraire par plus de pression fiscale et moins de croissance ; une analyse également développée par Arthur Laffer au début des années 1980. Enfin, ces économistes considèrent que l’on ne peut envisager la politique économique sans tenir compte du fonctionnement des règles de décision en démocratie, ce qui implique d’endogénéiser les décisions publiques, non seulement compte tenu du cycle politico-économique, mais aussi en considérant des agents économiques-électeurs réactifs, capables de récompenser ou de sanctionner l’action des politiques sortants.
En réalité, ces chercheurs français s’inscrivent dans un vaste courant qui entend dépasser le débat normatif sur la politique économique alors cantonné à la querelle entre monétaristes et keynésiens, et à l’efficacité relative des instruments monétaires et budgétaires. Outre le Public Choice, ce dépassement viendra aussi de l’école de Chicago avec Gary Becker, George Stigler ou Sam Peltzman mais aussi de l’émergence de la nouvelle économie politique préfigurée par les travaux de William Nordhaus (1975, 1989) sur le cycle économique électoral ou encore Douglas Hibbs (1977, 1994) sur le cycle partisan.
Ces développements nourriront la réflexion de Jean-Dominique Lafay qui observera et diffusera toujours l’avancée des travaux de la Nouvelle économie politique à côté de ceux des Choix Publics. En effet, les travaux de Nordhaus prennent en compte la propension des hommes politiques à vouloir se maintenir au pouvoir en manipulant l’économie pour maximiser les votes d’électeurs myopes, peu partisan, et aux anticipations essentiellement extrapolatives. Cette critique de l’électoralisme, facteur de dégradation de l’économie à long terme, aboutit cependant à des prescriptions normatives visant à écarter le politique au profit de l’expert pour conduire les politiques économiques. Nordhaus anticipe simplement ce qui sera par exemple appliqué en matière de gouvernance de l’Europe en général et de la Banque Centrale Européenne en particulier. De son côté, Hibbs mesure que les cycles où alternent inflation et chômage aux Etats-Unis sont directement impactés par l’alternance entre Républicains et Démocrates. Alberto Alesina (1987, 1991) modernisera le cycle économique électoral de Nordhaus en ajoutant la dimension partisane de partis en compétition qui font face à des agents économiques électeurs dotés d’une faculté d’anticiper leurs actions, mais en rationalité limitée[4].
3. L’analyse économique de la politique de Lafay
Sans jamais renier le vocable de Choix Publics, Lafay utilisera souvent un équivalent, celui d’Analyse économique de la politique ou encore celui d’Économie publique positive. Peut-être était-ce pour se libérer un tant soit peu de ceux qui parmi les économistes français avançaient que la théorie des Choix Publics était trop ancrée dans la critique systématique de l’État, voire dans l’ « ultra libéralisme ». En toute méfiance des étiquettes que l’on pouvait coller sur tel ou tel, Lafay affirmait toujours, non sans un art consommé de la litote, qu’il faisait néanmoins partie du camp des « non interventionnistes ».
C’est ainsi qu’il dirigera pendant un peu plus de dix ans, et ce jusqu’en 1992, l’IRAPE (Institut de Recherche et d’Analyse Politico-économique) de Poitiers autour d’une équipe composée notamment de Jean-Pierre Berdot, Christian Aubin et Daniel Goyeau. Ce groupe de recherche qualifié d’École de Poitiers par Jean Bénard (1995), produira un nombre significatif de travaux innovants, le plus souvent à base de validations empiriques, dans le domaine des interactions entre la sphère politique et la sphère économique. Lafay va mettre à profit toute l’expérience qu’il a tiré d’une collaboration à la fin des années 1980 avec l’École de Zürich de Bruno Frey, Friedrich Schneider, Werner Pommerehne et Gebhard Kirchgässner. Il s’inspirera notamment du programme de recherche de Frey (1978) développé dans un ouvrage dont la traduction est Économie Politique Moderne.
Lafay, Schneider et Pommerehne (1981) proposeront une synthèse des travaux portant sur le modèle politico-économique de Zürich dans le cas de sept pays (France, RFA, Etats-Unis, Australie, Suède et Royaume-Uni). Ce modèle inverse la logique du cycle économique électoral de Nordhaus. Ce n’est plus le politique qui influence en premier l’économie mais l’économie qui influence d’abord le politique. On définira ainsi une fonction d’évaluation de la politique économique par les citoyens électeurs et une fonction dite « de réaction » des gouvernants au pouvoir. Par ailleurs, le modèle autorise les tests économétriques alors que ce n’était pas le cas avec le modèle plus théorique de Nordhaus.
Dans la fonction dite d’évaluation de la politique économique, les citoyens-électeurs évaluent les performances du gouvernement. Dans la mesure où il n’y a pas d’élections nationales intra-mandat, le jugement sur l’état de l’économie (taux de chômage, taux inflation, taux de croissance, taux de croissance du revenu par tête) et ses conséquences sur le bien-être, est mesuré à travers la cote de popularité ou le taux d’approbation du chef de l’exécutif. Si la popularité du gouvernement (POP) est inférieure à une certaine valeur critique (POP*) assurant la réélection, celui-ci tentera de restaurer sa popularité auprès des électeurs. L’amplitude de l’effort, autrement dit, de la manipulation de l’économie, qu’il devra développer sera fonction du déficit de popularité (POP-POP*) et de la proximité ou non des échéances électorales. A l’évidence, plus on est proche de l’échéance et plus il est urgent de réduire le déficit de popularité. Pour ce faire, le gouvernement jouera sur sa fonction de réaction en manipulant les instruments de politique économique (dépenses publiques, transferts sociaux, impôts) dont il dispose.
Néanmoins, si le gouvernement bénéficie d’un excédent de popularité, son élection s’en trouvera facilitée. II pourra alors se concentrer sur ses objectifs idéologiques. Dans ce registre, s’agissant de la politique budgétaire, on peut penser qu’un gouvernement de droite tentera de réduire les dépenses publiques et les impôts tandis qu’un gouvernement de gauche œuvrera dans le sens opposé. La mécanique de ce modèle change diamétralement la vision que l’on peut avoir de la conduite des politiques économiques qui sont, si nécessaire, détournées opportunément au service de la réélection. Mais sa logique est si implacable que l’on peut se demander si la manipulation n’aboutira pas inexorablement à une réélection assurée.
Lafay et l’IRAPE partent du postulat selon lequel la modélisation des fonctions d’évaluation et de réaction testées par l’École de Zürich offre une simplification trop importante du comportement des décideurs publics. Ils vont ainsi tempérer les résultats du modèle de Zürich en se lançant dans la construction du modèle politico-économique de la France dans le cadre d’un rapport pour le Commissariat général au plan. Fort de ses 60 équations testées sur la période 1966-1982, le modèle de l’IRAPE est construit sur données désagrégées[5]. Alors que la plupart des modèles se sont polarisés sur les objectifs macroéconomiques traditionnels, chômage, inflation et croissance, l’accent sera aussi porté sur l’aspect redistribution de la politique économique conformément aux travaux de J. Lecaillon (1981). Le modèle essaie de montrer que l’État cherche à capter, au plan microéconomique, le soutien de certains groupes.
Contrairement aux travaux de Frey et al., le gouvernement ne poursuit pas uniquement des objectifs politiques ou idéologiques, au demeurant fort importants. En plus de la logique politique, le gouvernement poursuit une logique de stabilisation économique, une logique d’équilibre budgétaire et enfin, une logique bureaucratique. Il existera donc toujours un compromis entre les objectifs idéologiques du gouvernement, les préférences de la bureaucratie (Breton et Wintrobe, 1982) et la stricte logique économique. Ajoutons que le gouvernement ne peut échapper à ses responsabilités économiques et plus précisément à ses responsabilités budgétaires, même si son intérêt politique en dépend. Ceci démontre bien que la politique économique n’est pas uniquement une affaire de bénéfices politiques à court terme. Cela étant, sur l’ensemble d’un mandat, le gouvernement aura tendance à se comporter en gestionnaire sur la première partie et se glissera dans les habits du politique en campagne dans la seconde partie.
Enfin, le modèle tient compte du comportement du secteur privé. On considère que le secteur public n’a pas, à lui seul, le monopole de l’information. Si les agents privés forment des anticipations (relativement) rationnelles, ils anticiperont les mesures économiques en fonction du climat politique et de la situation du pouvoir en place. Les variables politiques peuvent donc influencer le comportement du secteur privé. Ce troisième point a été peu traité, voire souvent oublié, par la littérature portant sur les modèles politico-économiques.
Il existe un dernier apport des travaux de Lafay et de l’IRAPE et il porte sur la mesure de la crédibilité. La nouvelle macroéconomie de la fin des années 1970 et du début des années 1980 développe avec Fellner (1979), Kydland et Prescott (1977), Barro et Gordon (1983) ou Cohen et Michel (1991) le concept de crédibilité de la politique économique dans le cadre d’un jeu opposant autorités et agents privés. Ainsi, face à des agents économiques réactifs et rationnels, un gouvernement ou une autorité monétaire aura plutôt intérêt à annoncer des objectifs de politique économique crédibles (inflation, taux d’intérêt, croissance) sous peine de voir ces agents n’accorder aucune crédibilité aux annonces que fera ultérieurement le gouvernement. En un mot, la prescription normative qui est avancée est qu’une politique crédible et conduite de façon cohérente dans le temps (sans renoncer aux engagements pris) réduit le coût social de ladite politique. Par exemple, le coût en termes de chômage d’une politique de désinflation sera moindre lorsque cette politique est crédible.
Dans la pratique, cependant, un gouvernement peut être contraint à, ou faire le choix de se renier. Dans une optique désintéressée, les engagements pris peuvent être déjoués par un choc exogène ruinant ainsi la cohérence temporelle et la crédibilité. Dans une optique plus cynique, le reniement peut être voulu, avec deux cas de figure. Un gouvernement peut être tenté de se renier en annonçant un passage de la rigueur à l’expansionnisme budgétaire pour « amadouer » l’opinion pensant bénéficier ainsi d’un choc de demande qui relancera l’activité économique. Mais il peut aussi se renier pour optimiser ses chances de réélection. Le degré de succès de ce « mensonge » – qui n’est autre qu’une manipulation –, et ses conséquences sur la gouvernance future, dépendront des hypothèses faites sur la mémoire, la myopie des agents et sur la nature asymétrique ou non de l’information détenue par les agents et par le politique. La plupart des travaux sur le sujet ont eu recours à la théorie des jeux sans tentative de validation empirique.
C’est pourquoi, fort justement, Lafay et ses co-auteurs analyseront le lien empirique entre la popularité de l’exécutif et la crédibilité. La popularité est analysable en termes de flux et de stock. Celle-ci se présente sous forme d’un indice – compris entre 0% et 100% – fonction de la popularité, mesurée par le pourcentage de mécontents de l’exécutif. La crédibilité est de 100% tant que les mécontents n’excèdent pas 30%. Entre 30% et 46% de mécontents la crédibilité décline linéairement de 100% à 0%. Elle devient en effet nulle à partir du seuil de 46% de mécontents. L’écart de popularité entre le moment de l’annonce d’une mesure et le moment de sa concrétisation donne l’évolution du stock de crédibilité.
Cependant, l’équipe de l’IRAPE va mettre en évidence un véritable paradoxe de la crédibilité développé par Goyeau (1985). En effet, un gouvernement ayant un soutien politique important pourrait manipuler les anticipations privées, mais il n’a théoriquement pas besoin de le faire dès lors que son niveau élevé de popularité est toujours corrélé avec un état satisfaisant de l’économie. A l’opposé, un gouvernement pourrait vouloir manipuler les anticipations lorsque sa popularité est faible. Mais, cela s’avérera inefficace puisque son manque de crédibilité fait que les agents ne tiendront pas compte des prévisions officielles. Finalement, la manipulation des anticipations des ménages ne pourrait voir le jour que dans des situations intermédiaires où la popularité du gouvernement est moyenne et les difficultés économiques peu importantes.
Si l’on tient compte du calendrier électoral, il ne sert à rien de manipuler les anticipations tant que les échéances électorales sont encore éloignées. En revanche, conformément aux enseignements de l’École de Zürich et au modèle politico-économique de la France, il convient d’avoir une bonne popularité avant les élections.
Les fonctions de popularité deviendront un sujet de recherche à part entière pour Jean-Dominique Lafay. Elles mesurent l’impact de la situation économique sur la popularité des gouvernants (Lafay, 1977, 1985) entendue comme leur crédibilité comme nous l’avons évoqué plus haut. Lafay et Lecaillon (1990) montreront que l’économie en France détermine au moins la moitié de la popularité de l’exécutif, devant les affaires intérieures et la politique étrangère. Il sera également montré qu’il est nécessaire, sous la Vème république, de distinguer la part de responsabilité imputée au Président de celle imputée au Premier ministre : le Président est considéré comme le principal responsable des résultats de la politique économique conduite sauf en cas de cohabitation (Lafay, 1991).
La littérature sur les fonctions de popularité fait partie du corpus théorique des fonctions VP (vote-popularité) (voir Nannestad et Paldam, 1994 et Lewis-Beck et Stegmaier, 2013). Les deux types de fonctions sont construites de la même manière et soulèvent tout un ensemble de questions. Quelles sont les variables économiques les plus susceptibles d’influencer le vote ou la popularité ? Les variables « objectif » comme le chômage, la croissance ou l’inflation ou bien les variables « instruments » comme les taxes, les dépenses publiques, les transferts sociaux ou les taux d’intérêt ? Les citoyens-électeurs sont-ils myopes ? Choisissent-ils de façon rationnelle ou en rationalité limitée ? Leur jugement est-il prospectif ou rétrospectif ? Le vote ou la popularité dépendent-ils de la perception de la situation économique globale (attitude socio-tropique) ou de la situation individuelle (attitude ego-tropique) ? Les citoyens-électeurs récompensent-ils les gouvernants pour de bons résultats avec autant d’intensité qu’ils les punissent en cas de mauvais bilan (concept d’asymétrie du blâme) ? Quelle est la durée de l’« état de grâce » et à partir de quand un gouvernement subit-il le coût de l’usure du pouvoir (cost of ruling) ? Autant de questions sur lesquelles Jean-Dominique Lafay s’est penché ce qui l’a conduit à enrichir notre compréhension en notant, par exemple, que Vote et Popularité sont des variables endogènes de natures différentes. Le vote sanctionne un bilan de manière couperet en entraînant parfois l’alternance. En revanche, les déterminants de la popularité sont mesurables sur l’ensemble d’un mandat, celle-ci servant d’outil d’évaluation des politiques annoncées pendant la campagne électorale. Mais surtout, la popularité enregistre le jugement subjectif à court terme des agents-électeurs. Enfin, la popularité n’est pas intégralement assimilable au vote au sens ou un gouvernement populaire possède un stock de crédibilité propice à sa réélection mais le vote dépend aussi de variables purement politiques (idéologie, affaires intérieures et extérieures, système de vote, appartenance à un bastion politique, alliances électorales, etc.) ainsi que de l’évolution des grandeurs macroéconomiques de long terme, voire de déterminants socio-démographiques.
De 1980 à 2000, de nombreuses études sur les fonctions de popularité furent publiées dans divers ouvrages collectifs dédiés au lien entre économie et politique. Jean-Dominique Lafay a publié ses travaux sur l’impact des variables économiques sur les comportements politiques dans Hibbs et Fassbender (1981) puis ceux sur la stabilité des fonctions de popularité dans Eulau et Lewis-Beck (1985) et enfin l’étude des fonctions de popularité en période de cohabitation dans un ouvrage qu’il co-édita intitulé Economics and Politics : The Calculus of Support (Norpoth, Lewis-Beck et Lafay, 1991).
Néanmoins, ces études vont progressivement entamer un lent déclin en laissant la place aux travaux sur les fonctions de vote[6]. Selon Jérôme et Jérôme-Speziari (2010), sur 10 articles consacrés aux fonctions VP en 1980 deux étaient consacrés aux fonctions de vote contre six en 2000. Cette montée en puissance des fonctions de vote s’explique par le nombre toujours plus grand de points d’observations, avec le temps, la disponibilité des bases de données électorales de toutes strates géographiques et l’intérêt grandissant d’en faire un outil de prévision électorale en complément des sondages d’intentions de vote.
4. Fonctions de vote et prévision électorales
Jean-Dominique Lafay a très tôt songé à prévoir les élections à l’aide de modèles statistiques. Il essaie notamment de prévoir l’issue des législatives de 1978 (Lafay, 1977) à l’aide de variables macroéconomiques. Il constate que le nombre de points d’observation est trop faible et doit se replier sur les cotes de popularité, non sans avoir fourni une réflexion sur le passage de la popularité au vote[7].
Les premières fonctions de vote ont été élaborées par le politologue Kramer (1971) sur les élections au Congrès américain. Les économistes Stigler (1973), Niskanen (1975) et Fair (1978) enchaineront en traitant tour à tour le cas du Congrès et de la présidentielle américaine.
Dans le cas français, la première étude sera menée par Rosa et Amson (1976) sur les législatives françaises. Les politologues Lewis-Beck et Bellucci (1982) analyseront de leur côté les déterminants du vote aux législatives françaises et italiennes.
Jusque-là purement explicatives, les fonctions de vote vont évoluer vers la prévision à l’occasion des législatives de 1986 (Lewis-Beck, 1985). Le taux de croissance du PIB est alors le principal prédicteur économique du vote, ceci au niveau agrégé et sur un ensemble de points d’observations restreint. Le modèle indique néanmoins la bonne tendance, en l’occurrence la défaite de la gauche sortante.
En 1993, Jérôme, Lewis-Beck et Lafay modélisent pour la première fois le vote aux législatives françaises en utilisant des données régionalisées (emploi des données sur panel ou pooled time series) avec la variation du chômage un trimestre avant l’élection comme prédicteur économique du vote. La popularité, considérée comme une mesure subjective de la performance économique et politique du gouvernement à court terme, est ajoutée parmi les facteurs explicatifs. Le modèle intègre aussi des variables politiques telles que les zones de force régionales des partis politiques. La prévision politico-économique anticipera la défaite historique de la gauche en se trompant de 18 sièges.
Lafay et Jérôme (1991) seront aussi les premiers à construire une fonction de vote municipal ex-post à l’occasion du scrutin de 1989. Dans cette modélisation, le vote est expliqué par le vote aux précédentes élections et différents indicateurs de qualité de gestion établis par le magazine l’Expansion sur un panel de 100 villes de plus de 10000 habitants. Les variables de qualité de gestion n’autorisent cependant pas la prévision ni la reproduction du modèle.
Il faudra attendre la fonction de vote de Jérôme-Speziari et Jérôme (2002), construite à l’occasion des municipales de 2001, pour renouveler l’approche. La fonction de vote est assise sur 236 communes de plus de 30000 habitants sur la période 1989-2001. A côté des variables explicatives représentatives des stratégies et de l’implantation électorales, on adopte l’hypothèse selon laquelle le vote municipal en France reposerait sur des déterminants économiques et politiques à la fois locaux et nationaux. On montre finalement que les municipales (dans les villes de la taille considérée) ne sont jamais des élections totalement locales, même si l’on peut admettre que leur « degré de localisme » est variable en fonction de la proximité des échéances nationales. La conséquence est alors directe : le vote municipal comporte une part de vote récompense ou de vote sanction pour le gouvernement en place par l’intermédiaire des maires qui le soutiennent[8]. En fin de compte, la prévision s’est avérée fiable dans 198 cas sur 236, soit un taux de réussite de 83,9%.
Il n’en reste pas moins que Lafay et Jérôme (1991) dressent les bases d’une méthode de transposition des fonctions de vote nationales sur le plan local. Ainsi :
- la mobilité électorale toujours plus forte sur le plan local qu’au plan national, introduisant toujours une part de volatilité entre deux élections, notamment lorsque les agents économiques changent de commune (en votant avec les pieds) suite à une modification de leurs conditions initiales de bien-être (emploi, modification de la fiscalité, évolution des conditions de logement, qualité de l’environnement, insécurité, etc.),
- le vote pour la majorité municipale sortante est fortement dépendant du score qu’elle a réalisé six ans plus tôt. Cependant, compte tenu de la mobilité de l’électorat, le poids des résultats passés devrait être plus faible que celui estimé pour les élections nationales.
- le coût de l’information est moindre au niveau municipal, car le lien entre les instruments et les objectifs des politiques publiques municipales est immédiat, l’électeur a donc toutes les chances d’adopter un comportement plutôt ego-tropique. Ajoutons que les comparaisons avec les municipalités environnantes sont plus lisibles (aspects yardstick competition). Dans ces conditions, la rationalité est moins « limitée » et les choix électoraux correspondent mieux à une appréciation « objective », tant des résultats de la politique économique municipale, que de la conjoncture économique locale.
- Les électeurs punissent avec plus d’intensité les sortants en cas de mauvaises performances qu’ils ne les récompensent en cas de retombées positives des politiques économiques locales. On retrouve l’hypothèse d’asymétrie du blâme (grievance asymmetry).
Une interrogation subsiste toutefois à propos du caractère plutôt prospectif ou plutôt rétrospectif du vote municipal. Les investissements réalisés sur le plan local, et la politique fiscale qui en découle, sont des éléments extrêmement concrets pour les citoyens. Les élus locaux jouent sur le cycle de l’investissement et ne cessent de faire état de l’avancement des projets (voirie, équipements collectifs, qualité de l’environnement, etc.), une à deux années avant la fin de leur mandat. Ils jouent donc a priori leur réélection sur leur bilan. Pour sa part, l’opposition a plus de chances de rassembler sur la critique de la gestion passée que sur la promesse de nouvelles dépenses d’investissement (ce qui serait interprété comme plus d’impôts) ou sur les économies draconiennes qu’il faudrait réaliser, lorsque l’équipe précédente s’est montrée trop dépensière. Le vote municipal a donc toutes les chances d’être plutôt rétrospectif et, bien souvent, l’arrivée au pouvoir de l’opposition procède plus du rejet de la politique passée des sortants que d’une analyse prospective coût-avantage[9].
En 2007, en vue de l’élection présidentielle Lafay, Facchini et Auberger (2007) vont utiliser la popularité des partis politiques pour prévoir le résultat de la présidentielle. En prenant en compte la popularité du parti socialiste comme principal facteur du vote de gauche, les auteurs estimeront que Nicolas Sarkozy l’emporterait au second tour de la présidentielle, ce qui s’est avéré réaliste. On notera que le modèle donne une prévision rétrospective correcte des présidentielle de 1981 à 2002. Cette équation sera réutilisée en 2022 sans le succès escompté (Facchini, 2022 in Nadeau, Jérôme et Lewis-Beck, 2022). En réalité, il devra sans doute être modifié pour tenir compte de la tripolarisation voire de la quadri-polarisation[10] de la politique française.
Enfin, Lafay (1992) fera une incursion dans la théorie formelle du vote à travers le vote probabiliste. La prise en compte de facteurs politiques en économie pose de nombreux problèmes d’ordre méthodologique. La sphère politique semble être le symbole du déséquilibre à un point tel que Riker (1982) parlera de la science politique comme étant une science obscure. Selon Salmon et Wolfelsperger (1991), le concept d’équilibre utilisé en économie n’est pas a priori adapté à la théorie politique. Lafay montre que l’introduction de l’incertitude a progressivement radicalement modifié cette vision pessimiste de telle sorte que la théorie du vote rationnel ressemble de plus en plus à la microéconomie traditionnelle et à la théorie de l’équilibre général. En effet, si les électeurs récompensent un candidat leur promettant une plus grande satisfaction, ce qui accroit la probabilité de voter pour lui, alors la concurrence électorale pour les voix conduira les candidats à proposer des programmes qui maximisent le bien-être collectif, et ce à la manière de la « main invisible ». On ne peut plus dès lors rejeter l’analogie entre le marché politique et le marché en économie pure.
5. Un spécialiste de la gouvernance des institutions : de la théorie à la pratique
Jean-Dominique Lafay a été un théoricien du fonctionnement des institutions, qu’elles soient nationales ou internationales, et toujours sous l’angle d’une approche positive où chaque acteur cherche à imposer ses propres intérêts.
Lafay (2005) précise sa pensée dans un numéro de la revue Sociétal consacré au thème « Qu’est-ce qu’un bon gouvernement ? ». Il invoque ce que devraient être les bonnes pratiques d’un point de vue normatif mais souligne la nécessité une fois encore d’ « endogénéiser le comportement des décideurs publics sous peine de passer à côté d’une analyse réaliste de l’action de l’État, des gouvernements ou des entreprises publiques. Lafay (1985) reprochera toujours à l’économie politique traditionnelle d’essence normative de peu s’intéresser aux coûts d’intervention de l’État. Elle aura ainsi beaucoup de mal à expliquer les raisons positives de l’appropriation publique et à analyser le fonctionnement effectif des entreprises publiques. A l’inverse, La théorie économique de la politique permet dans un premier lieu un examen systématique des avantages et coûts politiques de la production publique. Et ceci met en relief le rôle déterminant joué par les motifs de revenu, de distribution et de stabilisation, alors que la théorie traditionnelle insiste à tort sur les motifs d’affectation des ressources.
La théorie économique de la politique permet aussi de poser le problème du contrôle de l’administration ou de l’entreprise publique par le gouvernement. C’est ainsi que Lafay, un temps en concurrence avec Greffe (1981) dans ce domaine, popularisera l’analyse économique de la Bureaucratie. Cette branche des Choix Publics a eu pour initiateur Niskanen (1971) qui décrit le bureaucrate comme une entité interne à l’État, en monopole, au service de lui-même et non pas au service de l’intérêt général. En cela, il a pour objectif de maximiser la quantité de biens collectifs offerts et le budget qui lui est associé. La fonction d’utilité du bureaucrate comprend le niveau des rémunérations, les avantages du poste, la réputation, le pouvoir, le patronage et la production du bureau. Migué et Bélanger (1974) objecteront que certains objectifs sont contradictoires, par exemple, la recherche du statut ou de privilèges peut se faire au détriment de l’augmentation du produit. Ils introduisent donc la notion de budget discrétionnaire composé des ressources sous contrôle du manager public qui pourront être alternativement utilisées pour prolonger la production ou accroitre les avantages personnels du bureaucrate.
Ajoutons que le manager bureaucrate en situation de monopole profite d’une asymétrie d’information par rapport à son tuteur. Il est donc le seul à connaître les « vrais » coûts de son bureau. La conséquence en est une production de biens collectifs supérieure à celle qui est socialement optimale, engendrant bien entendu un gaspillage des dépenses publiques, avec pour effet ultime la hausse des impôts.
Breton et Wintrobe (1982) enrichiront l’analyse d’éléments empruntés à la théorie de l’agence. Le mandant (le tuteur, qui est bien souvent un élu) est en asymétrie d’information vis-à-vis du mandataire (le bureaucrate) ce qui lui pose des problèmes de contrôle. Le bureaucrate peut effectivement adopter un comportement sélectif à l’endroit du tuteur, et ce de manière d’autant plus stratégique que l’on se rapproche des échéances électorales. Le contrôle de l’information devient dès lors une donnée essentielle. Les auteurs insistent sur les « relations de confiance », horizontales comme verticales, avec la bureaucratie, comme mécanisme d’incitation à coopérer. Comme l’affirme Lafay, la prise en compte de la théorie économique de la politique permet d’analyser de façon plus pertinente le problème du fonctionnement effectif de l’État. Lafay produira un article très complet sur la théorie de la bureaucratie dans le dictionnaire de sciences économiques (Jessua et alii, 2001).
L’analyse de la gouvernance des institutions conduira Lafay à s’intéresser au partage des rôles entre secteur privé et secteur public, autrement dit à l’économie mixte. Si l’on se fie à la typologie de Samuelson (1954), les biens et services caractérisés par la non-exclusion d’usage, la non-rivalité et l’indivisibilité de consommation doivent être gérés et produits par l’État. Il se trouve néanmoins que la plupart des biens publics sont plus « mixtes » ou « flous » que purs. Dès lors c’est l’autorité centrale qui, selon sa conception de l’intérêt général, décide de déplacer le curseur entre gestion publique et gestion privée en vertu du principe de « concernement » (Bénard, 1985). Lafay et Lecaillon (2015) expliquent que le recours à l’économie mixte est devenu une sorte de compromis doctrinal tenant compte aussi bien des défaillances du marché que de celles de l’État. En quelque sorte, un état de coopération idéal gardant le meilleur de la gestion privée et de la gestion publique. Les auteurs posent alors trois questions. En voulant associer les avantages, ne risque-t-on pas de cumuler les inconvénients ? Peut-on parier sur le partenariat privé-public sans avoir analysé leurs rationalités respectives ? Enfin, quel est le bon dosage entre privé et public dans le cadre d’une gestion commune ?
Loin des stéréotypes positifs, Lafay et Lecaillon ont recours à l’analyse Public Choice pour démontrer qu’on ne peut pas mixer les deux secteurs sans avoir analysé préalablement les conséquences de leurs sources d’inefficacités respectives.
Après s’être attaqué aux interactions politico-économiques dans les pays de l’Est (1979) et à l’économie des révolutions (1991), Lafay va montrer l’intérêt d’étudier les problèmes de développement sous l’angle des Choix Publics (Lafay, 1993). L’économie du développement est moins éloignée de l’analyse économique de la politique qu’il n’y parait à condition de changer de paradigme. L’économie du développement a d’abord négligé l’analyse des systèmes étatiques. L’État agit souvent comme une machinerie parfaite appliquant des plans optimaux. Une approche positive montrera au contraire que l’État est un lieu de coopération ou d’absence de coopération entre ses composantes. Ensuite, les experts chargés de mettre en place les politiques de développement affirment toujours rester au niveau normatif au nom de la neutralité politique. Pour des raisons analogues, les organisations internationales préfèrent s’en tenir à l’allocation des ressources et à l’équité sociale. Enfin, les gouvernements nationaux récipiendaires des aides estiment être les seuls à devoir gérer la question politique. Selon Lafay cette « pudeur » à prendre en compte les déterminants politiques vient du fait que l’on confond « faire de la politique » et « analyser le politique ». D’où une incompréhension, voire une colère de la part des populations concernées par les plans d’ajustement structurels (voir Alesina et Drazen, 1991) qui sont souvent vendus comme étant désincarnés et « politiquement neutres », alors qu’ils sont initiés par des politiques influencés par une orientation politique (consensus de Washington par exemple) avec des conséquences politiques.
Selon Lafay et Lecaillon (1993), le problème de faisabilité politique ne consiste pas en une redistribution « juste » des revenus mais en une redistribution qui minimise la violence des protestations anticipées des différents groupes sociaux.
Un approche Choix Publics permet donc d’expliquer pourquoi les décisions effectives (les choix positifs) divergeront sensiblement des politiques optimales. La divergence sera d’autant plus forte que le choix final résultera d’une négociation stratégique entre les différents membres du gouvernement et l’administration (la bureaucratie) chargée de la mise en œuvre, ceci sous la pression des groupes d’intérêt. Les auteurs de conclure que, sur un strict plan empirique, même s’il faut s’adapter à des données économiques et politiques moins nombreuses et de moindre qualité, la construction de modèles politico-économiques adaptés aux pays en développement s’avère être pleinement réalisable.
Jean-Dominique Lafay qui a souvent travaillé sur le rôle de l’expert universitaire en politique va souvent passer de la théorie à la pratique. Cette question, qui relève parfois de la dissonance cognitive, a fort bien été décrite par Niskanen (1998). En tant qu’analyste politique il a dû se focaliser sur l’activité gouvernementale en pensant avec optimisme qu’une bonne analyse conduirait à de bonnes politiques. Mais en tant que polito-économiste (political-economist) des choix publics, l’étude des contraintes et incitations qui affectent les décisions des électeurs, des hommes politiques et des bureaucrates conduit à un certain pessimisme sur le fonctionnement des institutions. De quoi naviguer entre deux sentiments, être optimiste quant à ce qui est possible mais être pessimiste sur ce qui est probable. En passant de la théorie à la pratique Jean-Dominique Lafay a dû souvent repenser aux mots de Niskanen.
Ainsi en tant qu’expert lorsqu’il dirigeait encore l’IRAPE, Lafay a dirigé deux rapports pour le commissariat général au plan, Le modèle politico-économique de la France (1966-1982) en 1985 et Les déterminants de la croissance des dépenses publiques en France en 1987.
A l’époque où il était directeur du LAEP de Paris 1, il sera le co-auteur des rapports La faisabilité politique de l’ajustement en Afrique (1980-1990) (Morrisson, Lafay et Dessus, 1993) et de La dimension politique de l’ajustement économique (Lafay et Lecaillon, 1993) pour le Centre de développement de l’OCDE. Il intégrera par la suite le Cercle des économistes créé par Jean-Hervé Lorenzi en 1992.
Il occupera enfin le poste de directeur scientifique droit, économie, gestion au ministère de l’Éducation nationale, de vice-chancelier des Universités de Paris puis de directeur du Centre national des œuvres universitaires (Cnous).
6. L’héritage de Jean-Dominique Lafay
La contribution de Jean-Dominique Lafay à la théorie des choix publics et plus particulièrement à l’analyse économique de la politique – appellation qu’il privilégiait – est considérable.
Il a contribué à populariser une grille d’analyse peu développée et peu enseignée en France, longtemps considérée comme n’étant pas suffisamment mainstream et probablement trop « marquée » par les tenants français de l’analyse macroéconomique comme par ceux de l’analyse microéconomique. Il a encadré près de 35 thèses et celles et ceux dont il a été le directeur dans les années 1990 se souviendront qu’il les a souvent avertis des risques encourus en choisissant des sujets trop Public Choice, notamment s’ils envisageaient une carrière universitaire. L’avenir des polito-économistes en France était par conséquent hautement incertain. Ainsi disait-il souvent que les politologues français (surtout les non-quantitativistes) nous considéreraient toujours comme des économistes et que les économistes (plutôt « orthodoxes ») nous rejetteraient dans le camp de la science politique. Ceci expliquait peut-être sa méfiance des « étiquettes » et pourquoi il n’a jamais pu ou voulu prendre la tête d’un courant français des Choix Publics. Jean-Dominique Lafay a néanmoins permis aux premiers doctorants du nouveau LAEP[11] de Paris 1 de rencontrer Albert Breton, Stéphane Dion, Douglass Hibbs, Michael Lewis-Beck, Werner Pommerehne, Howard Rosenthal, ou encore Gordon Tullock (liste non exhaustive).
Fort heureusement, cette période délicate semble révolue. Sur le plan théorique, les économistes de la nouvelle économie politique inspirés par Nordhaus, Fair, Hibbs puis Alesina ont progressivement intégré les facteurs politiques dans le cadre de l’analyse des politiques économiques. Ceci a permis, au demeurant, à de nombreux chercheurs en macroéconomie d’utiliser les outils communs aux choix publics sans se réclamer ouvertement de ce courant de pensée. Depuis quelques 20 ans, les candidats à la qualification en économie au Conseil National des Universités ne risquent plus d’avoir une carrière quelque peu compliquée en présentant des travaux orientés Choix Publics ou Nouvelle Économie Politique. A cet égard, une publication dans Public Choice ou dans la European Review of Political Economy est aujourd’hui très prisée.
En espérant qu’il ne s’agisse pas là d’une parenthèse, le plus beau symbole de cet esprit de pluralisme entre les différentes approches de l’économie politique en général et de l’analyse de l’État en particulier est sans doute la collaboration entre Stiglitz, Lafay et Walsh (2014) puis Stiglitz, Lafay et Rosengard (2018) qui co-produiront respectivement les Principes d’économie moderne et L’économie du secteur public.
Quoiqu’il advienne, tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Dominique Lafay ou reçu ses enseignements se rappelleront que l’on ne peut envisager l’économie sans la politique et la politique sans l’économie.
Références
Alesina A. (1991), “Evaluating Rational Partisan Business Cycle Theory: A Response,” Economics and Politics, vol 3, n°1, March, pp 63-71
Alesina A., Cohen G.D. & Roubini N. (1992), “Macroeconomic Policy and Elections in OECD Democracies,” Economics and Politics, Vol 4, n°1: 1-30.
Alesina, A. (1987), “Economic Policy in a two-Party System as a repeated Games,” Quarterly Journal of Economics, pp 651-678.
Alesina, A. & Drazen, A. (1991), “Why are Stabilizations Delayed?” American Economic Review, Vol.81, N°5, pp.1170-1188.
Aubin Ch., Berdot, J-P., Goyeau, D. et Lafay J-D. (1985), Un modèle politico-économique de la France 1966-1982, Rapport pour la Direction Générale à la Recherche Scientifique et Technique, Irape, Université de Poitiers.
Aubin Ch., Berdot, J-P., Goyeau, D. et Lafay J-D. (1987), Les déterminants de la croissance des dépenses publiques en France, Rapport pour le Commissariat Général au Plan, Irape, Université de Poitiers.
Barro, R.J. & Gordon, D.B. (1983), “Rules, Discretion and Reputation, in a Model of Monetary Policy,” Journal of Monetary Economics, 12, 101-121, North-Holland
Bénard, J. (1985), Économie publique, Economica.
Breton, A. & Wintrobe, R. (1982), The Logic of Bureaucratic Conduct: An Economic Analysis of Competition Exchange, and Efficiency in Private and Public Organizations. New York: Cambridge University Press.
Buchanan, J. et Tullock, G. (1962), The calculus of consent. The logical foundation of constitutional Democracy. Ann Arbor. The University of Michigan Press.
Buchanan, J.M. (1999), “An Economist’s Approach to Scientific Politics,” in Politics as Public Choice, The Collected Works of J.M. Buchanan. Vol. 13. Liberty Fund: 3-13.
Cohen, D. & Michel, Ph. (1990), « Crédibilité de la politique économique », Cahiers Économiques et Monétaires, n°37 p. 175-181.
Downs, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row.
Eulau, H. et Lewis-Beck, M.S. (1985), Economic Conditions and Electoral Outcomes: The United States and Western Europe, New York, Agathon Press.
Facchini, F. (2022), “Party Ratings and Electoral Forecasting: The Case of the French Presidential Election of 2022,” PS: Political Science & Politics, Vol. 55, (4), October.
Facchini, F., Foucault, M., François, A., Magni-Berton, R. & Melki. M. (2010), Choix Publics. Analyse économique des décisions publiques, De Boeck supérieur.
Fair, R. (1975), “On Controlling the Enemy to win Elections,” Cowles Foundation, discussion Paper 397.
Fellner, W. (1979), “The Credibility Effect and Rational Expectations: Implications of the Gramlich Study,” Brooking papers on Economic Activity, 167-89.
Frey, B.S. (1978), Modern Political Economy, London: Martin Robertson
Goyeau, D. (1985), “Impact of Official Forecasts on Private Expectations: The Paradox of Manipulation (the French Case: 1965-1982). », European Journal of Political Economy, 1/3, 343-358.
Greffe, X. (1981), Analyse économique de la bureaucratie, Janvier, Paris, Economica
Hibbs A. (1977), “Political parties and macroeconomic policy,” American Political Science Review, december: 1467-1487.
Hibbs, D. & Fassbender, H. (1981), Contemporary Political Economy, Amsterdam, North Holland Publishing Company.
Hibbs, D. (1992), “Partisan Theory after Fifteen Years,” European Journal of Political Economy, 8, pp 361-373.
Jérôme B., Lewis-Beck M.S. et Lafay J.D. (1993), « Les prévisions des modèles politico-économiques», in Lafay, Cheminement du futur, Le Figaro Économie, (19 mars).
Jérôme, B. & Jérôme-Speziari, V. (2010), Analyse économique des élections. Economica.
Jérôme-Speziari, V. & Jérôme, B. (2002), « Les municipales de mars 2001 : vote récompense ou vote sanction ? Les réponses de l’analyse politico-économique », Revue Française de Science Politique, (2), Vol 52, pp.251-272.
Jessua, C., Labrousse, Ch., Vitry, D. et Gaumont, D. (2001), Dictionnaire des sciences économiques., Presses Universitaires de France.
Kramer, G. (1971), “Short-term Fluctuations in US Voting Behaviour: 1896-1964,” American Political Science Review, 65:131.
Kydland, F. & Prescott, E.C. (1977), “Rules rather than Discretion: The Time Inconsistency of Optimal Plan,” Journal of Political Economy, June, (85): 473-91.
Lafay, J.D. (1985), “Political Change and Stability of the Popularity Function: The French General Election of 1981 », in Eulau H. et Lewis-Beck M.S. (eds), Economic conditions and electoral outcomes: the United States and the Western Europe, p.78-97, New York, Agathon Press.
Lafay, J.D. (1986), « L’aide au développement des analyses normatives aux theories politico-économiques”, Revue d’économie politique, Vol.96, N°4, juillet-août, pp.384-397.
Lafay, J.D. (1991), “Political Dyarchy and Popularity Functions: Lessons from the 1986 French Experience,” in Economics and Politics: The Calculus of Support, eds H. Norpoth, M.S. Lewis-Beck and J.D. Lafay. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Lafay, J.D. & Jérôme, B. (1991), « Les déterminants politico-économiques du vote municipal en France. Analyse empirique des élections municipales de 1989 », Revue économie, Université de Perpignan, 1991, p. 35-50.
Lafay, J.-D. & Lecaillon, J. (1993), La dimension politique de l’ajustement économique, Paris, OCDE, Centre de développement.
Lafay, J.-D. & Lecaillon, J. (2015), L’économie mixte, Que sais-je? N°1051 décembre, (Réédition).
Lafay, J.-D. (1977), « Les conséquences électorales de la conjoncture économique : essais de prévision chiffrée pour mars 1978 », Vie et Sciences économiques, 75, 1-7.
Lafay, J.-D. (1981), “Empirical analysis of politico-economic interaction in the East European Countries”, Soviet Studies, 33(3), 386-400.
Lafay, J.-D. (1991), « L’analyse économique de la révolution: synthèse des développements récents », Économie et Sociétés, Série Economia, PE n°14 (janvier, 27-15, Soviet Studies, 33(3), 386-400.
Lafay, J.-D. (1992), « La théorie probabiliste du vote », Revue d’économie politique, Vol 102, n°4, pp. 487-518
Lafay, J.-D. (1993), « Les apports de la théorie des choix publics à l’analyse des problèmes de développement », Revue d’économie du développement, pp.103-123.
Lafay, J.-D. (2005), « L’État sous la lunette de l’économiste » Sociétal, n°47, 1er Trimestre
Lafay, J.-D., Pommerehne, W. & Schneider, F. (1981), « Les interactions entre économie et politique : synthèse des analyses théoriques et empiriques », Revue Economique, n°1, Janvier 1981.
Lafay, J-D. & Lecaillon J. (1990), « Économie et popularité en France », Association française de science politique, miméo, octobre.
Lafay, J-D., Facchini, F. & Auberger, A. (2007). « Modèles politico-économétriques et Prévisions Électorales pour Mai 2007,» Revue Française d’Economie, 21 (4):145-64.
Lecaillon, J. (1981), « Cycle électoral et répartition du revenu national », Revue économique, n°2, mars 1981, 213-236
Lecaillon, J. (1988), « L’inexorable croissance du secteur public : un point de vue international », SEDEIS, N°65, pp.207-211.
Lewis-Beck, M. S. & Stegmaier, M. (2013), “The VP-function revisited: a survey of the literature on vote and popularity functions after over 40 years,” Public Choice, Vol. 157, No. 3/4, Special Issue: Essays in Honor of Martin Paldam (December 2013), pp. 367-385.
Lewis-Beck, M.S. (1985), « Un modèle de prévision des élections législatives (avec application pour 1986) », Revue Française de Science Politique, 35 (6) : 1080-1091.
Lewis-Beck, M.S. & Bellucci, P. (1982), “Economic influences on legislative elections in multiparty systems: France and Italy,” Political Behavior, Vol. 4, N°1, pp.97-107.
Migué, J.L. & Bélanger, G. (1974), “Towards a General Theory of Managerial Discretion,” Public Choice, 17, 27-51.
Morrisson C., Lafay J. D. & Dessus S. (1993), « La faisabilité politique de l’ajustement en Afrique (1980-1990) », Technical Paper, Paris, OCDE, Centre de développement.
Nadeau, R., Foucault, M., Jérôme, B. & Jérôme-Speziari.V. (2018), Villes de gauche, villes de droite, Presses de Sciences-Po, Paris
Mueller, D.C. (2003), Public Choice III, Cambridge University Press
Nadeau, R., Jérôme, B. & Lewis-Beck, M.S. (2022), “Forecasting the French Presidential Election,” Symposium, PS: Political Science & Politics, Vol. 55, (4), October.
Nannestad P. & Paldam, M. (1994), “The VP-Function: a Survey of the Literature on Vote and Popularity Functions after 25 Years,” Public Choice, 79, (3-4) : 213-245.
Niskanen, W. (1971), Bureaucracy and Representative Government, Chicago, New York, Aldine-Atherton.
Niskanen, W. (1975), “Economics and Fiscal Effects on the Popular Vote for President.”, Working paper n°25, Graduate School of Policy, University of California, Berkeley.
Niskanen, W. (1998), Policy Analysis and Public Choice: Selected Papers, The Locke Institute.
Nordhaus, W. (1975), « The Political Business Cycle », Review of Economic Studies, 42: 169-90.
Nordhaus, W. (1989). “Alternatives Approaches to the Political Business Cycle,” Brookings Papers on Economic Activity, (2): 1-68.
Norpoth, H., Lewis-Beck, M.S. & Lafay, J.D. (1991), Economics and Politics: The Calculus of Support, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (2de édition, 1971).
Rosa, J.J. & Amson, D. (1976), « Conditions économiques et élections : une analyse politico-économique (1920-1973) », Revue Française de Science Politique, 26 :1101-1124.
Salmon, P. & Wolfelsperger, A. (2001), « De l’équilibre au chaos et retour : bilan méthodologique des recherches sur la règle de majorité », Revue Française de Science Politique, (3), Vol. 51, pp.331-369.
Samuelson, P.A. (1954), “The Pure Theory of Public Expenditures,” Review of Economics and Statistics, 36.
Stigler, G.L. (1973), “General Economic Conditions and National Elections in Political Economy,” Political studies, 316-320.
Stiglitz, J.E., Lafay, J.D. & Walsh, C.E. (2014), Principes d’économie moderne, De Boeck supérieur.
Stiglitz, J.E., Lafay, J.D. & Rosengard, J.K. (2018), Économie du secteur public, De Boeck supérieur.
Tufte, E. (1975). “Determinants of the outcomes of midterm congressional elections,” American Political Science Review, 69: 812-826.
Tufte, E.R. (1978), Political Control of the Economy, Princeton University Press.
Tullock, G. (1976), The Vote Motive, Institute of Economic Affairs, traduction française in Le marché politique: analyse économique des processus politiques, Economica, 1978.
Turgeon, M., Bélanger, E. & Nadeau, R. (2015), “French Popularity Functions: Different Measures, Different Determinants,” French Politics, 3.
[1] Voir Mueller (2003) traduit par Facchini, Foucault, François, Magni-Berton et Melki (2010).
[2] Etienne Farvaque organisera à Lille en 2021 la cinquième conférence de l’EPCS sur le territoire français.
[3] Fredrik Carlsen, Linda Gonçalves Veiga, Jan Firdmuc, Véronique Speziari (Jérôme), Lars Feld, Toke Aidt, Guy Whitten , Christine Aymar (Fauvelle) et l’auteur de cet article.
[4] Voir aussi Alesina, Cohen et Roubini (1992).
[5] Le modèle est construit à partir des tableaux économiques d’ensemble (TEE) de la comptabilité nationale trimestrielle. Les secteurs institutionnels sont réorganisés afin de faire apparaitre explicitement une décomposition entre secteur privé et secteur public.
[6] En 2015 les fonctions de popularité françaises font à nouveau l’objet d’études avec les travaux de Turgeon, Bélanger et Nadeau sur les séries longues Ifop et Sofres-Kantar.
[7] Dans le cas américain, Tufte (1975) testera l’effet de la popularité sur le vote lors des élections au Congrès.
[8] Pour un panorama complet les travaux sur les déterminants du vote local, voir Nadeau, Foucault, Jérôme et Jérôme (2017).
[9] En dépit de son caractère plus conforme à la théorie des choix rationnels.
[10] Si l’on sépare la droite classique du centre à côté de la gauche et de la droite extrême.
[11] Jean-Dominique Lafay est devenu directeur du nouveau LAboratoire d’Économie Publique de Paris 1 en 1992 en succédant à Jean Bénard jusqu’alors directeur du Centre d’Économie Publique et de Planification. Le sigle LAEP a été initié par un premier noyau refondateur de doctorants, Patricia Vornetti, Samuel Adeleye, Bruno Jérôme et Véronique Speziari (Jérôme) qui seront rejoints peu après par Christine Aymar (Fauvelle). Le LAEP a été absorbé par le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) en 2009.