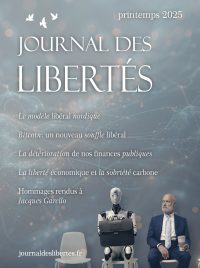une analyse de Vincent Tournier à propos de l’ouvrage :
La droitisation française : mythes et réalité
de Vincent Tiberj (PUF, 2024)
Avec son livre La droitisation française : mythes et réalités, le politologue Vincent Tiberj entend réfuter l’idée selon laquelle la France se serait droitisée. Pour cela, il avance un raisonnement en trois temps :
- Il n’y a pas de glissement des Français vers la droite (donc de droitisation « par le bas ») car les valeurs « de gauche » (ouverture, tolérance, individualisme moral, redistribution des richesses) n’ont cessé de progresser dans l’opinion publique ;
- il existe cependant une droitisation « par le haut », autrement dit dans les discours des médias et des partis, ce qui bénéficie aux partis de droite et d’extrême-droite ;
- Cette contradiction entre le haut et le bas s’explique par deux raisons : d’une part le matraquage des médias et des intellectuels « de droite » (c’est ce que Vincent Tiberj appelle la « droitisation d’atmosphère ») ; d’autre part l’abstention croissante des électeurs (ou la « grande démission ») car ces derniers ne se reconnaissent plus dans la classe politique et préfèrent s’investir dans la politique autrement que par le vote.
Malgré le recours à de nombreuses données, la démonstration peine à convaincre. Aux critiques formulées par Monique Dagnaud et Gérard Grunberg[1], nous ajouterons que la démarche suivie par l’auteur, trop soucieuse de venir en aide à la gauche, souffre de plusieurs défauts et s’avère finalement bien en peine d’expliquer les évolutions actuelles.
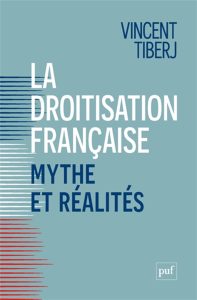
Un travail scientifique ?
Si l’auteur affirme suivre une démarche objective (« ce livre est de nature scientifique »), deux manques surprennent d’emblée : d’une part l’absence de toute analyse comparée, alors qu’il est évident que la situation française connaît des résonances au niveau européen ; d’autre part l’absence d’analyse des résultats électoraux.
Ce second point est particulièrement troublant. Vincent Tiberj présente le glissement vers la droite du vote des Français comme s’il s’agissait d’une évidence. Or, bien que le RN ait progressé, le total des voix obtenus par les partis de droite reste relativement stable. Il en va de même à gauche : l’effondrement du PS n’a pas débouché sur la disparition de la gauche dans les urnes. En réalité, on assiste moins à une droitisation de la vie politique qu’à une tripartition de l’espace électoral[2]. Au bloc central s’opposent désormais un bloc de la gauche radicale et un bloc de la droite radicale. On a donc plutôt affaire à une fragmentation qu’à un déplacement : si droitisation il y a, elle va de pair avec une « gauchisation » et une « centrisation ».
Sélection des données
Un autre étonnement concerne le tri qui est effectué entre les données. Vincent Tiberj insiste fortement sur les limites que rencontrent les sondages. Il a certainement raison, mais le malaise vient du fait que sa critique porte essentiellement sur les sondages qui ne vont pas dans son sens. En gros, tous les sondages qui font état de l’exaspération des Français sur l’immigration et l’insécurité ne lui semblent pas fiables. Par exemple, les études qui montrent que les Français croient au « Grand remplacement » ne présentent à ses yeux aucun intérêt : elles ne servent qu’à cautionner le discours alarmiste d’acteurs politiques mal intentionnés.
La prudence commande pourtant de ne pas refuser un résultat tant que celui-ci n’a pas été invalidé par des données plus robustes. Or, ce n’est pas ce que fait Vincent Tiberj. Ainsi, pour réfuter un sondage qui montre qu’une large majorité de Français approuvent les dispositions de la loi immigration (décembre 2023), il oppose d’autres sondages qui indiquent que l’immigration n’est pas la préoccupation prioritaire des Français, ce qui n’est pas le même sujet. De même, il explique que les réponses aux sondages sont souvent biaisées car les répondants sont victimes d’un biais d’acquiescement. Problème : il utilise un sondage qui démontre justement le contraire (figure 1.1).
Plus généralement, Vincent Tiberj relativise, voire rejette, les statistiques qui vont à l’encontre de sa démonstration. C’est ainsi que l’antisémitisme ou l’homophobie d’origine musulmane lui paraissent superficiels, bien qu’il fournisse des chiffres alarmants. Fidèle à la ligne tracée jadis par Nonna Mayer, il soutient qu’en matière de haine des juifs ou des homosexuels, la principale menace continue d’émaner de la droite radicale. Pour lui, le simple fait de parler d’un « vote musulman » le dérange car la religion musulmane ne peut pas être utilisée comme une variable explicative, le critère de l’islam n’ayant pas le même « statut scientifique » (sic) que la classe sociale. Pourquoi ? On ne le saura pas.
Valeurs de gauche, valeurs de droite ?
Autre surprise, plus importante celle-ci : le livre ne comporte aucune définition – même rudimentaire – de son objet, à savoir la droitisation des valeurs dont il entend contester la réalité. L’auteur est conscient de ce manque puisqu’il concède que « la droitisation est un concept flou » mais il n’en tire aucune conséquence.
Or, la question de savoir quelles sont les valeurs de droite et les valeurs de gauche n’est pas anodine. A-t-on affaire à des valeurs immuables et atemporelles ? Existe-t-il une « essence » de la gauche et de la droite ? De toute évidence, la réponse est négative : le nationalisme, le régionalisme, l’écologisme, le colonialisme, la planification, les nationalisations, et bien d’autres encore ont pu passer de la gauche à la droite, et inversement.
Une illustration récente concerne la laïcité. Alors que la laïcité a longtemps constitué un puissant marqueur de la gauche, la situation a radicalement évolué ces dernières années. La gauche est désormais mal à l’aise avec cette question (comme le montre le livre récent d’Aurélien Bellanger), alors que la droite s’en revendique sans difficulté. Afficher aujourd’hui son attachement à la laïcité n’a donc plus du tout le même sens qu’à l’époque de la loi Debré (1959) ou du projet Savary (1984) lorsque les débats concernaient les catholiques.
Un autre exemple de ce chassé-croisé se trouve dans le domaine des mœurs, thème qui occupe une place centrale dans le livre de Vincent Tiberj. Or, le PCF a longtemps critiqué la liberté sexuelle dans laquelle il voyait l’expression de l’immoralité de la bourgeoisie décadente, et c’est la droite qui a légalisé la pilule abortive (1967), le divorce (1975) ou l’avortement (1975). De surcroît, si une gauche libertaire a émergé dans la période post-1968, rejetant les interdits et prônant même la liberté sexuelle entre adultes et mineurs, la situation a bien changé aujourd’hui où le néo-féminisme est devenu très puritain. Bref, il paraît bien difficile de dire que la tolérance en matière de mœurs est une caractéristique immuable de la gauche. Il en va de même pour la liberté : la gauche défend volontiers la liberté lorsqu’il s’agit de choquer le bourgeois, par exemple pour la drogue, mais son attachement à la liberté n’ira pas jusqu’à défendre la liberté de licencier.
La tolérance, une valeur de gauche ?
L’absence de réflexion sur le concept de droitisation cache mal le prérequis de Vincent Tiberj, à savoir que seule la gauche est du côté de la vertu.
Vincent Tiberj laisse ainsi entendre que la tolérance appartient par essence à la gauche. Pourtant, la gauche a aussi ses détestations et ses intolérances. Jadis, elle désignait les bourgeois, les capitalistes ou les curés comme des ennemis du peuple. Aujourd’hui, sous l’influence du wokisme et de l’intersectionnalité, elle a renouvelé et élargi la palette de ses ennemis dans laquelle elle englobe les hommes, les Blancs, les hétérosexuels, les chrétiens, les nationalistes, voire tous les groupes désignés comme « phobiques » : les transphobes, les homophobes et autres islamophobes.
Plus grave : la résurgence d’un antisémitisme de gauche invite à rester prudent en matière de tolérance. La nazification des Israéliens, commencée dès avant les massacres du 7 octobre 2023, s’accompagne d’une indulgence, sinon d’un soutien à peine voilé, pour des mouvements comme le Hamas ou le Hezbollah, qualifiés par Judith Butler de « mouvements sociaux progressistes de gauche »[3].
Pour Vincent Tiberj, ce type de dérive reste négligeable. Il écrit :
« Je montrerai comment l’accusation d’antisémitisme est devenue un moyen de disqualifier les partis de gauche et les musulmans alors même que la » nouvelle judéophobie » ou » l’antisémitisme des banlieues « , bien réels, restent des formes minoritaires de préjugés contre les juifs. »
Notre auteur refuse donc de prendre au sérieux les déclarations de responsables politiques de gauche qui, pour s’attirer les bonnes grâces de l’électorat musulman, se livrent à une surenchère inquiétante, tout comme il refuse de prendre acte de l’existence d’un antisémitisme des banlieues pourtant bien documenté. Il ne veut pas voir, comme le relevait le regretté Jacques Julliard, que la défense des musulmans est devenue un marqueur de la gauche, tandis que la défense des juifs se présente comme un marqueur de la droite[4].
Bref, si la gauche et la droite se différencient, ce n’est pas parce que l’une serait tolérante et l’autre intolérante : c’est parce que chaque camp à ses préférences et instaurent des hiérarchies sans que celles-ci soient d’ailleurs équivalentes du point de vue de leur justification.
La faute aux médias de droite ?
En posant comme axiome que la gauche est naturellement tolérante et généreuse, l’auteur en déduit que celle-ci devrait mécaniquement bénéficier de l’évolution des mœurs. Comme ce n’est pas le cas, il en conclut qu’il existe un facteur perturbateur, et ce facteur n’est autre que l’action néfaste des médias et des intellectuels conservateurs.
Une hypothèse aussi forte aurait mérité d’être étayée. Or, le chapitre sur les médias et les intellectuels est certainement le plus faible de l’ouvrage. On y cherche désespérément des données. Vincent Tiberj se contente de dénoncer des médias ou des personnalités qu’il n’apprécie guère, auxquels il attribue un pouvoir de nuisance considérable.
La détestation ne constitue toutefois pas une preuve. Aucune analyse chiffrée n’est fournie sur l’audience des chaînes « réactionnaires » ou, pire, sur celle d’un journal comme Minute, auquel l’auteur attribue curieusement la poussée de la xénophobie enregistrée par les sondages dans les années 2013-2014.
Des questions essentielles sont ignorées ou tranchées sans preuve : les électeurs changent-ils d’avis parce qu’ils ont été exposés à un média ? Les médias de gauche sont-ils plus objectifs et pluralistes que les médias de droite ? Pourquoi, dans un système concurrentiel, les électeurs se tournent-ils vers tel média plutôt que vers tel autre ? Le succès (relatif) de CNews ne découle-t-il pas d’une insatisfaction vis-à-vis des médias traditionnels, voire des excès idéologiques de certains d’entre eux, comme Fox News a pu prospérer sur le rejet de CNN ?
Une autre affirmation discutable, et non étayée, est que les médias opèreraient un cadrage systématiquement favorable à la droite. Pourtant, l’interprétation inverse est tout aussi recevable tant certains médias, et non des moindres, se font un devoir d’être du côté progressiste et d’éviter toute stigmatisation des minorités. Par exemple, Vincent Tiberj déplore que les émeutes urbaines de 2005 aient été présentées comme des « émeutes musulmanes » au détriment d’une explication sociale ; or, à l’époque, la dimension religieuse a été très peu évoquée. De même, il regrette que la mort du jeune Thomas à Crépol (Drôme) ait été décrite comme un « francocide » sur CNews, mais d’autres médias ont présenté cet événement comme une banale rixe de village, ce qui a d’ailleurs valu une réprimande de l’ARCOM à l’éditorialiste Patrick Cohen sur la chaîne publique France 5.
Des intellectuels réactionnaires tout puissants ?
La faiblesse des preuves se retrouve lorsqu’il s’agit d’étudier l’influence des intellectuels. L’auteur dresse une liste nominative à la manière dont ont procédé jadis Daniel Lindenberg (Le rappel à l’ordre) ou Serge Halimi (Les nouveaux chiens de garde) sans dire quels sont ses critères de regroupement (qu’est-ce qu’un « intellectuel conservateur »?) et, surtout, sans expliquer pourquoi il considère que ces intellectuels ont plus de poids que les intellectuels progressistes, alors que ces derniers disposent de bataillons bien fournis dans les cercles savants et universitaires.
Le malaise grandit lorsque Vincent Tiberj ironise sur le manque de diplômes de certains contributeurs classés à droite. Ce dédain est d’autant plus troublant qu’il n’est pas symétrique : les intellectuels de gauche ne sont jamais critiqués, ni même mentionnés, alors qu’il y aurait beaucoup à dire sur le manque de clairvoyance des intellectuels progressistes, même lorsqu’ils sont bardés de diplômes.
Le plus surprenant est que les statistiques fournies par l’auteur peuvent se prêter à une conclusion nettement moins favorable à sa thèse d’une hégémonie de la droite. L’auteur observe en effet que les attentats djihadistes n’ont pas déclenché une vague antimusulmane dans l’opinion. Il attribue cette situation à la dynamique des valeurs : ce serait grâce à la hausse du niveau d’études et au renouvellement des générations que la tolérance a prévalu. Mais n’est-ce pas plutôt la preuve que la droite pèse bien peu dans le cadrage intellectuel et médiatique, comme elle pèse d’ailleurs pour presque rien dans la production artistique et culturelle – domaine auquel l’auteur ne s’intéresse pas ?
Demandes sécuritaires
Vincent Tiberj part du principe que la droite devrait normalement perdre les prochaines élections puisqu’elle a perdu la bataille des valeurs. Un tel raccourci étonne. Le passage des valeurs au vote n’a rien d’automatique : ce n’est pas parce que les électeurs sont acquis aux préoccupations environnementales qu’ils vont voter pour les partis écologistes.
Les valeurs ne forment pas un socle de prédispositions homogène et unilatéral ; elles sont susceptibles d’être interprétées ou agencées différemment, et peuvent même déboucher sur des choix contradictoires. A partir des valeurs féministes, il est par exemple possible d’avoir des opinions très opposées sur la prostitution ou sur le port du voile islamique.
Plus encore, Vincent Tiberj n’envisage pas que les valeurs de tolérance et de liberté puissent être compatibles avec une demande d’autorité et de sécurité. C’est pourtant ce qui a été relevé depuis le début des années 2000 où les sociologues ont vu émerger un « nouveau cocktail de valeurs » qui combine « liberté privée et ordre public »[5]. Autrement dit, si les Français sont attachés aux libertés individuelles (notamment en matière de mœurs et de vie familiale), ils veulent aussi de l’ordre et de la sécurité.
Maintes fois vérifié[6], ce constat a été résumé par une formule de Pierre Bréchon : « Fais ce que tu veux dans ta vie privée, mais respecte l’ordre public »[7]. La question de la sécurité n’étant pas le moindre des enjeux en France comme en Europe, on regrette que Vincent Tiberj ne fasse pas mention des analyses percutantes de Thomas Franck qui décryptent certaines évolutions contemporaines (Pourquoi les pauvres votent à droite, 2008 ; Pourquoi les riches votent à gauche, 2018).
Le libéralisme culturel empêche-t-il de voter à droite ?
Allons plus loin. Les valeurs post-modernes sont-elles nécessairement incompatibles avec un vote pour la droite, voire pour la droite radicale ? Ce n’est pas exclu car ces partis ont bien changé. La droite a globalement avalisé les réformes de société et ne met pas frontalement en cause l’État-providence. Le RN lui-même est souvent ambigu ou tempéré sur certains enjeux sociétaux et ne prône nullement le démantèlement des politiques sociales. Depuis l’arrivée de Marine Le Pen à sa tête en 2011, ce dernier a même opéré un spectaculaire revirement sur les trois marqueurs traditionnels de l’extrême-droite : les juifs, les femmes et les homosexuels. Désormais, le logiciel de l’extrême-droite est relativement compatible avec les valeurs post-modernes. En France comme dans plusieurs pays européens, il n’est pas rare de voir des femmes ou des homosexuels animer la fronde anti-immigration ou anti-islam.
Les données présentées par Vincent Tiberj, pour peu qu’on les regarde attentivement, confirment ces recompositions. Certes, le vote Le Pen apparaît maximal parmi les électeurs les moins libéraux sur le plan culturel (figures 6.7 et 6.8 du livre), ce qui est conforme à la thèse du cultural backlash exposée par Inglehart et Norris[8], mais le vote frontiste progresse aussi parmi les électeurs qui sont moyennement libéraux. Il progresse même, et c’est une grande surprise, parmi ceux qui sont les plus libéraux. Cela peut s’expliquer : les Français ne sont ni racistes, ni hostiles à toute immigration, mais beaucoup sont inquiets car ils ont le sentiment que l’immigration met en péril la tranquillité publique et les libertés individuelles. C’est un paradoxe bien connu : la tolérance peut amener à être intolérant envers les intolérants. Il se pourrait même que, plus les Français valorisent les libertés individuelles, plus l’opinion porte un regard critique sur des populations qui sont accusées de manquer de tolérance et d’ouverture.
Comprendre la crise démocratique
Pour Vincent Tiberj, un autre facteur favorise les partis de droite : la baisse de la participation électorale, laquelle touche prioritairement les nouvelles générations, qui sont les plus axées sur les valeurs progressistes. Autrement dit, si les jeunes allaient voter en masse, la gauche triompherait.
L’auteur n’explique pas cette baisse de la participation , sinon pour dire que les électeurs ne se reconnaissent pas dans la classe politique. Curieusement, il ne fait pas le lien avec la mutation des valeurs. Pourtant, la valorisation des libertés individuelles dans le domaine des mœurs n’a-t-elle pas pour effet de fragiliser le sens du devoir et le sentiment d’appartenance nationale, deux composantes importantes de la participation électorale ?
De même, Vincent Tiberj n’envisage pas l’hypothèse selon laquelle l’abstention pourrait trouver une partie de sa source dans le sentiment que les élites ont fait sécession, notamment sur le plan des valeurs et des modes de vie, tout en restant sourdes aux demandes de protection qui leur sont adressées dans un contexte de transformation brutale de la société à cause de la mondialisation et de l’européanisation.
On pourrait aller plus loin et objecter à Vincent Tiberj que les valeurs qu’il attribue à la gauche (l’hédonisme individuel, l’ouverture des frontières, l’acceptation de l’immigration et de la diversité culturelle) sont justement celles des nouvelles classes dominantes, à savoir les catégories diplômées des grandes métropoles qui aspirent à maximiser leurs libertés et leur bien-être. Les données fournies par Vincent Tiberj sont compatibles avec cette interprétation puisqu’elles montrent que les milieux populaires adhèrent beaucoup moins au valeurs individualistes que les catégories aisées (figure 5.5 et figure 6.1).
Sauver la gauche… ou l’amener dans le mur ?
La démonstration de Vincent Tiberj est sous-tendue par la volonté d’aider la gauche. Pour lui, la gauche trouvera son salut dans un programme radical axé sur la défense de l’État-providence et la promotion des valeurs dites « de gauche », en l’occurrence la tolérance et l’ouverture des frontières. En somme, la gauche ne doit pas être trop molle ; seule une gauche vraiment de gauche peut l’emporter.
Chacun a évidemment le droit d’avoir ses préférences mais, en voulant faire passer un message politique, le risque est de se tromper de diagnostic. Le postulat de l’auteur, on l’aura compris, est que les valeurs post-modernes devraient naturellement profiter à la gauche. En particulier, il est persuadé que les valeurs individualistes vont nécessairement contribuer à l’acceptation de l’immigration et à l’édification d’une société multiculturelle heureuse et prospère.
Ce postulat reste cependant à démontrer. Par exemple, la sensibilité accrue envers la cause animale peut très bien déboucher sur la condamnation de pratiques communautaires telles que l’abattage rituel. De même, l’attachement à la liberté d’expression peut amener à rejeter des minorités rigoristes qui rejettent toute critique de leur foi. On peut même se demander si, dans une société gagnée par les valeurs individualistes, les cultures minoritaires ne suscitent pas davantage de méfiance, justement parce qu’elles apparaissent antinomiques avec les libertés individuelles. On regrette alors que, par manque de distance avec ses propres convictions, Vincent Tiberj laisse dans l’ombre des questions dérangeantes. Il ne veut pas voir, manifestement, que les valeurs individualistes peuvent non seulement déboucher sur des choix contestables (la GPA et l’euthanasie sont-elles réellement des progrès ?), voire produire de nouvelles idéologies dogmatiques et intolérantes (l’antiracisme ne devient-il pas un nouveau racisme ?) mais aussi créer de redoutables fragmentations sociétales, sources d’insécurité pour les populations. Il serait peut-être bon que les chercheurs en sciences sociales cherchent moins à aider leur camp qu’à décrire et à expliquer la réalité.
[1] « Mythe contre mythe: la droitisation selon Tiberj », la bibliothèque de Telos, 12 Octobre 2024. Consultable à https://rebrand.ly/091ec5.
[2] Voir Pierre Martin, « Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 », Commentaire, n°187. Accessible à https://rebrand.ly/vfz7pd2.
[3] Voir « Conflit au Proche-Orient : La philosophe Judith Butler qualifie l’attaque u Hamas le 7 octobre d’acte de résistance et crée la polémique », Libération, 7 mars 2024. Accessible à : https://rebrand.ly/07iesd6.
[4] Voir Jacques Julliard, « La droite, la gauche et l’antisémitisme, » Figaro Vox, 2 mai 2018. Accessible à : https://rebrand.ly/b7zz5zf.
[5] Voir Etienne Schweisguth, « Un nouveau cocktail de valeurs ; liberté privée et ordre public », in Olivier Galland et Bernard Roudet, Les valeurs des jeunes–Tendances en France depuis 20 ans, Collection Débats Jeunesses, L’Harmattan, 2001/8/99-117. Accessible à : https://rebrand.ly/ldi857a.
[6] Voir : Etienne Schweisguth « Une demande croissante d’ordre public mais un désir accru de liberté privée », Le Monde, 24 avril 2009. Accessible à : https://rebrand.ly/e62dc9.
[7] Voir : Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia, La France à travers ses valeurs, Armand Colin, 2009. Accessible à: https://rebrand.ly/pdusgts.
[8] Voir Ronald Inglehart et Pippa Norris, Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism, Cambridge University Press, 2019. https://rebrand.ly/hlgc1hb.