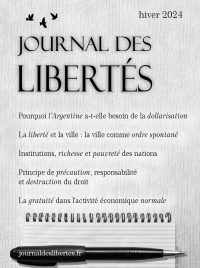Le principe de gratuité dans Caritas in Veritate
En 2009, le pape Benoît XVI publie l’encyclique Caritas in Veritate. Dans ce document, le Saint-Père met l’accent sur le « principe de gratuité » qui, selon lui, n’était pas pleinement développé dans la vie économique d’aujourd’hui. Ce principe se manifesterait dans les dons divins de l’amour et de la vérité, sans lesquels la vie humaine et la véritable fraternité ne sont pas possibles. Benoît XVI souligne que le principe de gratuité caractérise également la vie économique et qu’il la façonnerait bien plus qu’elle ne le fait aujourd’hui, si seulement on lui donnait la possibilité de se développer sans entraves.
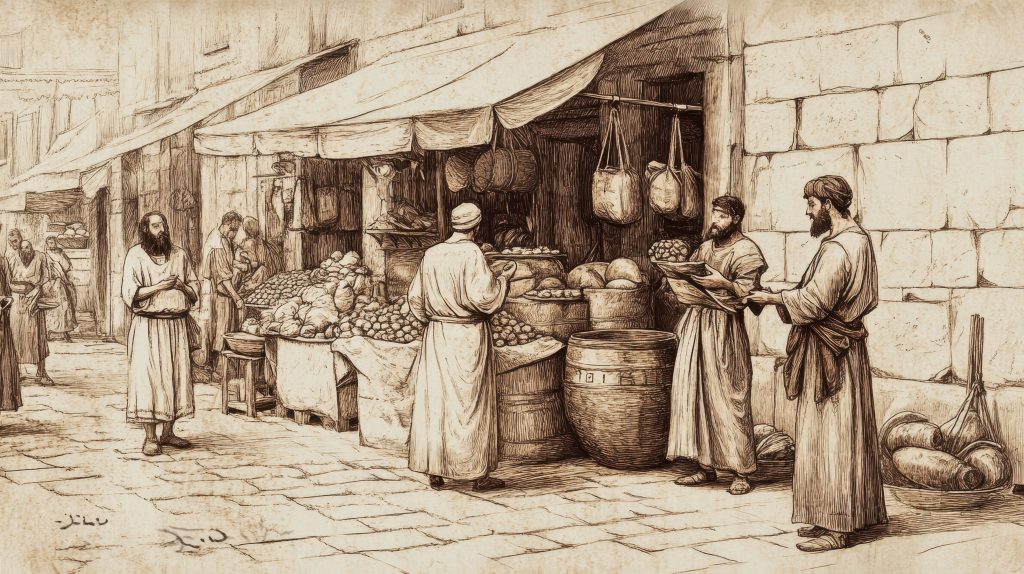
Le message de Caritas in Veritate est fort et clair en ce qui concerne la dimension spirituelle du principe de gratuité. Il est moins convaincant dès que le Saint-Père aborde son application dans le monde économique. Il argumente alors comme suit :
Il faut […] un marché sur lequel des entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents puissent agir librement, dans des conditions équitables. À côté de l’entreprise privée tournée vers le profit, et des divers types d’entreprises publiques, il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s’implanter et se développer. C’est de leur confrontation réciproque sur le marché que l’on peut espérer une sorte d’hybridation des comportements d’entreprise et donc une attention vigilante à la civilisation de l’économie. La charité dans la vérité, dans ce cas, signifie qu’il faut donner forme et organisation aux activités économiques qui, sans nier le profit, entendent aller au-delà de la logique de l’échange des équivalents et du profit comme but en soi. (CV, 38)
Toute focalisation de l’activité économique sur le profit est ici remise en cause, alors que les coopératives et les entreprises sociales sont présentées comme modèles prometteurs pour « civiliser » l’économie. Pour le Pape, l’entrepreneuriat à but lucratif n’en est apparemment pas capable, étant pris dans la « logique de l’échange des équivalents ».
Mais comment civiliser l’économie ? Que faut-il faire concrètement ? Benoît ne fournit aucune explication, mais appelle les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à résoudre ce problème. Il écrit :
Le grand défi qui se présente à nous […] est celui de montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité, ne peuvent être négligés ou sous-évalués, mais aussi que dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité. (CV, 36)
La présente contribution traite de cette question. Le manque d’espace ne me permet pas de donner une réponse exhaustive, mais j’utiliserai d’abord quelques exemples pour expliquer comment et pourquoi, dans les relations commerciales, le principe de gratuité trouve une place éminente dans l’activité économique normale. J’expliquerai ensuite pourquoi ce fait fondamental n’est pas dûment pris en compte dans la théorie économique standard de notre temps, la théorie néoclassique, et je conclurai par quelques réflexions sur l’impact de l’interventionnisme sur la gratuité. On trouvera beaucoup plus de détails dans mon livre Abundance, Generosity, and the State (2024)[1].
Le principe de gratuité dans l’activité économique : illustrations
Il existe de nombreux biens gratuits dans la vie humaine normale que les économistes appellent traditionnellement les dons gratuits de Dieu ou les dons gratuits de la nature : l’oxygène, l’eau, les minéraux dans le sol, la fertilité du sol, etc. Il y a aussi les dons de temps et d’argent que les êtres humains se font les uns aux autres, et les dons de temps à des causes louables. Tout cela est bien connu et largement incontesté.
Mais il existe aussi une grande catégorie de biens gratuits dont certains sont appelés des « biens d’aubaine » ou des « externalités positives » et pour lesquels je propose le nom général de « biens à effets secondaires ». Ces biens ne sont pas souvent mentionnés lorsque l’on discute des avantages et des inconvénients du capitalisme. Pourtant leur existence me semble être l’un des plus grands avantages des sociétés libres.
En effet, jour après jour, chacun d’entre nous fournit à de nombreuses autres personnes divers avantages, y compris des avantages matériels, sans être payé pour cela ni même souhaiter l’être. C’est toujours le cas, par exemple, lorsque nous disons la vérité ou que nous respectons la loi. Bien sûr, nous le faisons pour diverses raisons, dont certaines sont très égoïstes. Nous voulons être des dames et des messieurs honorables, nous voulons rester socialement acceptables, nous voulons conserver le respect de nos enfants et de nos amis. Mais cela ne change rien à trois faits fondamentaux, à savoir que (1) nous créons des avantages tangibles pour d’autres personnes par nos actions, que (2) nous leur fournissons généralement ces avantages de manière totalement gratuite et que (3) dans la plupart des cas, nous ne considérons pas du tout ces avantages pour les autres, car nous ne nous intéressons qu’aux avantages et aux inconvénients par rapport à nous-mêmes (ou à notre famille etc.).
Ces avantages gratuits pour les autres découlent de nos actions, comme des effets secondaires pour ainsi dire, même s’ils ne sont pas nécessairement planifiés ou souhaités. Friedrich August von Hayek, se référant aux Lumières écossaises, a souligné à plusieurs reprises la grande importance des effets secondaires de l’action humaine. Selon lui, le progrès économique et social est en grande partie le résultat de l’action humaine, mais non de leurs desseins (voir Hayek 1966).
Les biens à effets secondaires sont particulièrement évidents dans le cas des exemples. Alors que l’apprentissage n’est pas gratuit mais implique des sacrifices de temps et d’argent, les exemples fournis par la nature et d’autres personnes sont plus que souvent gratuits. Très souvent, ils sont fournis contre la volonté de ceux dont ils découlent. Tous les entrepreneurs fournissent gratuitement au monde extérieur de bons et de mauvais exemples, à condition que leurs activités soient visibles d’une manière ou d’une autre pour le monde extérieur. Observer ce que font les concurrents – imiter ceux qui réussissent et fuir les échecs des autres – est le pain et le beurre de la concurrence dans tous les domaines de la vie.
Un autre effet secondaire important se manifeste dans ce qui est communément appelé la « rente du consommateur ». Si Pierre échange sa pomme contre la poire de Paul, cela signifie que Pierre préfère la poire à la pomme, tandis que Paul préfère la pomme à la poire. Ils bénéficient tous les deux de cette transaction, et ils ne peuvent pas ne pas en bénéficier car, dans la logique même de leur interaction, les biens échangés ne peuvent pas avoir la même valeur. La pomme ne peut pas avoir la même valeur que la poire, et la poire ne peut pas avoir la même valeur que la pomme. C’est plutôt une différence de valeur personnelle qui entre en jeu dans l’échange pomme-poire. Le prix payé par l’acheteur vaut toujours moins que le bien qu’il acquiert, et les deux biens ont une valeur personnelle différente pour chacun des deux partenaires de l’échange.
La « rente du consommateur » est bien connue des économistes. Mais la plupart des non-économistes pensent que les biens échangés sont de valeur égale, ou devraient idéalement être de valeur égale. Nous trouvons ce point de vue notamment dans Caritas in Veritate. Le pape Benoît XVI y laisse entendre qu’un échange juste est (ou devrait être) un échange de valeurs égales. Ce postulat n’est pas exposé en détail. Il est implicite et transparaît dans diverses déclarations, notamment dans un passage que nous avons cité au début, où le Pape réduit la logique interne d’un échange de marché à une « logique de l’échange des équivalents » (CV, 38).
Enfin, une autre illustration : les effets secondaires de l’épargne et de l’investissement. Si davantage d’épargne est investie, le capital devient moins rare qu’il ne l’aurait été autrement. Par conséquent, la rémunération du capital sur le marché – sous la forme d’intérêts et de profits – aura tendance à diminuer. Comme toutes les unités d’un même bien tendent à être rémunérées au même prix sur le marché (loi du prix unique), toutes les unités de capital, anciennes et nouvelles, tendent à être moins rémunérées qu’auparavant.
Alors que les épargnants renoncent à leur propre consommation courante et supportent l’incertitude de l’investissement, les bénéfices reviennent donc en partie à d’autres agents. Lorsque l’épargne augmente, le capital continue généralement à générer un rendement, mais généralement moindre qu’auparavant. Les épargnants sont toujours récompensés, mais ils ne récoltent pas l’ensemble des fruits qu’ils ont semés. Une partie des bénéfices va à ceux qui n’ont rien fait pour augmenter la productivité de leur propre travail. C’est le processus d’accumulation de capital induit par l’épargne qui leur fournit gratuitement des biens économiques.
Dans de nombreux cas, ces avantages gratuits induits par l’épargne constituent un héritage durable pour les générations futures. Le drainage des marécages, la construction de bâtiments et de routes et toutes les réalisations intellectuelles des générations précédentes apportent des bénéfices gratuits aux vivants pour les générations à venir. Nous sommes, pour ainsi dire, des resquilleurs ou, pour reprendre la formule de Ludwig von Mises (1985 [1949], pp. 508, 517), « les heureux héritiers de nos pères et ancêtres ».
Pourquoi a-t-on tendance à négliger ces effets secondaires
Nous venons d’examiner quelques exemples qui montrent comment et pourquoi le « principe de gratuité » joue un rôle important dans l’activité économique ordinaire. Ce fait est de la plus haute importance pratique. C’est un avantage essentiel de tout ordre économique et social libéral fondé sur les droits de propriété privée. On pourrait donc penser qu’il joue également un rôle correspondant dans la théorie économique. Or, ce n’est précisément pas le cas.
Au contraire, les nombreux biens à effets secondaires dont les participants à une économie de marché jouissent gratuitement au quotidien sont pratiquement ignorés dans l’enseignement de la microéconomie et de la macroéconomie. Les manuels de microéconomie ne traitent généralement que d’un seul type de biens à effets secondaires, les externalités positives, et ces externalités sont considérées comme des défaillances du marché qui doivent être corrigées par des interventions publiques appropriées.
Pourquoi en est-il ainsi ? Faute de temps, je n’évoquerai que les deux raisons les plus importantes de ce triste état de fait. La première raison est la théorie aristotélicienne de la justice, qui a sous-tendu la pensée occidentale et, surtout, l’économie jusqu’à ce jour.
Selon Aristote (Éthique à Nicomaque, Livre V), un échange équitable est un échange de valeur égale. Si j’achète un pain de manière équitable pour le prix de trois euros, les deux biens échangés ont la même valeur. La valeur du pain est égale à la valeur des trois euros.
C’est la « logique de l’échange des équivalents » dont il est question dans Caritas in Veritate. Selon Benoît XVI, tout échange équitable sur le marché est, par nature, toujours et partout un échange de valeurs égales. Par conséquent, par définition, aucun bien ne peut être transmis gratuitement dans le cadre d’une transaction sur un marché équitable. Tous les biens reçus dans le cadre d’un échange équitable sont (ou du moins devraient être) également rémunérés par des prix équivalents.
C’est la raison fondamentale pour laquelle les externalités positives sont considérées comme des défaillances du marché. Elles ne respectent pas le postulat d’équivalence susmentionné. Dans la théorie néoclassique de l’économie du bien-être, ce postulat est connu sous le nom de postulat des marchés complets. Il affirme que, dans une économie idéale, tous les biens et services fournis aux autres, et qui ne sont pas délibérément offerts en cadeau, devraient être compensés par des paiements équivalents.
Il est clair que des marchés complets seraient stériles en termes de gratuité. Dans le modèle néoclassique standard de concurrence pure et parfaite, le prix d’équilibre concurrentiel (c’est-à-dire, le prix du produit) est exactement égal au prix cumulé de tous les facteurs de production. Le modèle présuppose que tous les facteurs de production sont rémunérés. Il n’existe aucune externalité positive. À l’équilibre, chacun paie l’équivalent exact de ce qu’il reçoit, sauf s’il le reçoit en cadeau. Dans le jargon économique d’aujourd’hui, cet idéal est appelé le « premier théorème fondamental de l’économie du bien-être ».
La deuxième raison pour laquelle l’économie traditionnelle considère les externalités positives comme des défaillances du marché est qu’elles tendraient à réduire la production, ce qui aurait des conséquences négatives sur le bien-être des consommateurs. Si un apiculteur ne reçoit pas une rémunération adéquate de la part du propriétaire d’un verger de pommiers pour les services de pollinisation fournis par les abeilles, moins d’abeilles seront élevées, moins de miel sera produit et moins de pommiers seront pollinisés. Le résultat global est une baisse de la production, avec une diminution correspondante de la consommation.
Mais cette ligne d’argumentation est défectueuse en ce qu’elle tombe dans le piège de l’erreur de composition. Il est vrai que les externalités positives de l’apiculture peuvent plafonner la production de miel et, par voie de conséquence, la production de produits connexes tels que les pommes. Mais il s’agit là d’un problème sectoriel et non d’un problème global. Les ressources qui auraient pu être absorbées, en l’absence d’externalités positives, dans l’exploitation de ruches et de vergers sont désormais disponibles dans d’autres secteurs d’activité.
En outre, cette argumentation ne peut être généralisée. Il est absurde de soutenir que toutes les externalités positives devraient toujours et partout être compensées. En effet, les externalités positives peuvent entre autres résulter d’un comportement vertueux, et les vertus ne peuvent pas être compensées par définition.
En résumé, la théorie néoclassique des biens à effets secondaires est à l’état embryonnaire parce qu’elle ne prend en compte qu’un seul type de ces biens, les externalités positives, et qu’elle se méprend complètement sur leur signification économique, sociale et politique. Plus que tout autre élément de la théorie économique prédominante aujourd’hui, cette erreur a aveuglé les économistes sur l’un des plus grands avantages du processus de marché. Au lieu d’apprécier le fait que l’échange sur le marché apporte de nombreux et importants avantages non rémunérés à la fois aux partenaires de l’échange et aux tiers, les économistes ont dénigré cette caractéristique et ont même tenté de la « corriger » par la coercition gouvernementale.
Conséquences de la production de biens gratuits par l’État
Avant de conclure j’aimerais aborder brièvement les conséquences de l’intervention de l’État sur l’économie des biens gratuits.
Il est bien connu que l’État-providence est en mesure de fournir des biens gratuits à ses bénéficiaires. Mais ces biens sont financés par des « prélèvements obligatoires », ce qui a des conséquences négatives sur les revenus réels de tous les agents. On peut donc se demander si, somme toute, l’État-providence favorise le bien-être matériel de ses protégés.
Ce qui est clair, en revanche, c’est que l’interventionnisme a un impact négatif sur les dons du secteur privé. L’intervention de l’État affaiblit non seulement la capacité à donner (par son influence négative sur la production économique globale), mais aussi la volonté de donner. La politique monétaire joue un rôle largement méconnu mais particulièrement important à cet égard.
En effet, sans intervention monétaire, le rendement du capital aurait tendance à baisser si de plus en plus de capital est investi à mesure que les actifs augmentent. Bien que cette baisse puisse être entièrement ou partiellement compensée par un effet de levier financier plus important à des taux d’intérêt faibles, la plupart des investisseurs éviteraient l’effet de levier car il augmente également les risques de liquidité et d’insolvabilité. Par conséquent, dans des circonstances normales, l’accumulation de capital conduit à des rendements du capital de plus en plus faibles. L’utilisation de l’épargne en tant que capital est de plus en plus découragée, et de plus en plus d’épargne finit en dons et autres utilisations non marchandes.
Mais ces tendances naturelles sont partiellement compensées, et parfois inversées, lorsque les politiques monétaires expansionnistes subventionnent des stratégies de levier financier. Lorsque les banques centrales accordent des prêts à faible taux d’intérêt et sauvent les investisseurs au bord de l’insolvabilité, les limites naturelles des investissements à effet de levier sont détruites et l’effet de saturation de l’accumulation de capital disparaît. Les autorités créent ainsi un piège de la rationalité. Les épargnants et les investisseurs sont désormais matériellement incités à convertir toute leur épargne personnelle en capital. Bien qu’ils épargnent de moins en moins, ils sont récompensés pour avoir investi une part de plus en plus importante de cette épargne réduite dans des projets à but lucratif plutôt que non lucratif.
En outre, les interventions monétaires annulent les effets secondaires du processus de marché et, dans certains cas, les transforment en leur contraire. J’ai souligné précédemment que les épargnants ne récoltent pas l’ensemble des fruits qu’ils ont semés lorsque le marché est libre. Une partie plus ou moins grande de leur effort d’épargne profite à des travailleurs qui n’ont rien fait pour augmenter la productivité de leur propre travail.
Il en va autrement lorsque, grâce aux interventions monétaires de l’État, la masse monétaire est gonflée au point de provoquer une inflation des prix. Lorsque l’inflation-prix devient permanente (ce qui a été le cas depuis la Seconde Guerre mondiale), les épargnants ne peuvent plus thésauriser leur épargne. Cette dernière est donc investie dans des biens durables tels que le foncier ou les actions, et cette fuite vers les valeurs tangibles va de pair avec une modification de la valeur relative du travail. Dans un contexte d’inflation des prix, le travail tend à perdre de l’importance par rapport aux biens matériels durables. Sa valeur subjective diminue aux yeux de tous les agents. La raison en est que le travail, justement, n’est pas un bien durable. Il ne peut être stocké et ne peut donc pas bénéficier de la fuite vers les valeurs tangibles. À l’inverse, les prix de l’immobilier et des actions des sociétés cotées en bourse augmentent par rapport au prix qu’ils auraient eu sans inflation des prix, mais aussi par rapport aux prix de tous les biens moins durables, comme le travail.
On peut donc dire que la politique monétaire de l’après-guerre a détruit une partie des effets de richesse gratuite, au détriment de toutes les personnes qui vivent principalement de leur travail.
Conclusion
Une économie libre est imprégnée de diverses formes de biens gratuits qui apparaissent comme des effets secondaires d’actions humaines qui ne visent pas directement (ou même pas du tout) à fournir gratuitement des biens à d’autres personnes.
Alors que ces biens à effets secondaires représentent un grand avantage des économies de marché, la microéconomie standard les néglige largement et considère même certains d’entre eux (les externalités positives) comme des défaillances du marché qui doivent être corrigées par des interventions publiques appropriées.
Les interventions publiques ne peuvent pas fournir des biens véritablement gratuits. Elles entravent l’économie du don privé, encouragent l’abus de dons et facilitent la privatisation artificielle et forcée des biens à effets secondaires.
Références
Aristote (2004), Éthique à Nicomaque, trad. Bodéüs, Paris : Flammarion.
Benoît XVI (2009), Caritas in Veritate, Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Hayek, F. A. (1966), « Résultats de l’action des hommes, mais non de leurs desseins » dans Claassen, E. M. (édit.), Les fondements philosophiques des systèmes économiques, textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur, Paris : Fayot, pp. 98-106.
Hülsmann, J. G. (2024), Abundance, Generosity, and the State, Auburn, Ala., Mises Institute.
Mises, L. v. (1985 [1949]), L’action humaine, Paris : Presses universitaires de France.
[1] NDR : On trouvera un compte rendu de l’ouvrage dans le numéro 25 de ce journal : https://journaldeslibertes.fr/article/abundance-generosity-and-the-state-an-inquiry-into-economic-principles/.