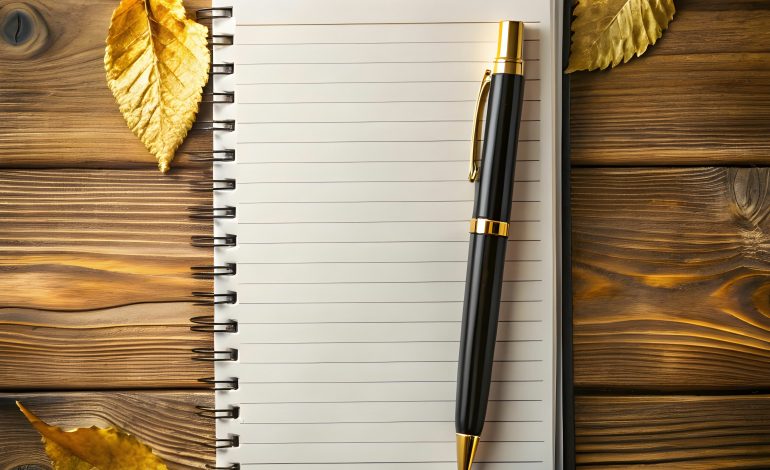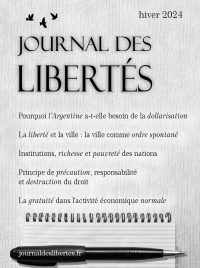Introduction
Javier Milei – le président de l’Argentine – libertarien excentrique, brandissant une tronçonneuse et se revendiquant anarcho-capitaliste – fait la Une depuis son élection en décembre 2023. Il a hérité d’une situation économique désastreuse et a promis une réduction des dépenses publiques ainsi qu’une série de déréglementations pour revitaliser l’économie. Il a déjà tenu ses promesses. Il a également promis la fermeture de la banque centrale et la dollarisation mais ces points restent à concrétiser.
Pour comprendre Milei, il faut remonter cinq siècles d’histoire Argentine. Au-delà de l’histoire des faits, c’est l’histoire des institutions qui compte.

Dans la tradition de l’économie autrichienne de Ludwig von Mises et F. A. Hayek, de la nouvelle économie institutionnelle de Douglass North, et de l’opérationnalisation plus moderne de ces théories à travers l’Indice de la liberté économique dans le Monde[1], l’histoire de l’Argentine, faite de splendeur et de décadence, est avant tout une histoire institutionnelle.
Cette note reprend l’essentiel des propos formulés lors de la session consacrée à l’Argentine dans le cadre de l’édition 2024 de l’Université d’Été d’Aix-en-Provence. Ces propos tenaient lieu d’introduction, historique et institutionnelle, à l’exposé d’Emilio Ocampo sur la dollarisation et la réforme politique en Argentine qui suivit nos interventions.
Prélude : 1500-1853
L’Argentine était une région pauvre de l’empire colonial espagnol. On n’y trouvait ni or, ni population indigène abondante à exploiter comme main-d’œuvre. En 1816, par suite de la chute de la couronne espagnole provoquée par les guerres napoléoniennes, la province de Buenos Aires proclama son indépendance. Cette décision ne s’appuyait cependant sur aucune vision quant aux institutions dont il fallait doter la nouvelle entité indépendante. S’en sont suivies quarante années marquées d’une alternance d’anarchie et de Léviathan. Les caudillos régionaux (chefs militaires) se battaient pour le pouvoir et envahissaient régulièrement les provinces voisines. La province de Buenos Aires tenta bien d’imposer des constitutions aux autres provinces, mais celles-ci furent rejetées ou ignorées par les caudillos locaux. De ce chaos émergea toutefois un caudillo plus fort que les autres, Juan Manuel de Rosas, qui parvint à s’imposer à la tête de la province de Buenos Aires. Il utilisa cette position pour régner autoritairement sur tout le pays de 1829 à 1852. Brutal, il rétablit néanmoins l’ordre.
Comme l’enseigne l’économie institutionnelle, ni l’anarchie ni le Léviathan ne favorisent le développement économique. L’Argentine manquait de stabilité, d’état de droit, de prévisibilité et de défense des droits fondamentaux. C’est pourquoi elle était restée pauvre.
Splendeur : 1853-1930
Le père fondateur et rédacteur de la constitution argentine, Juan Bautista Alberdi, a analysé les problèmes du pays et proposé des solutions dans son ouvrage de 1852, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Selon Alberdi, le problème était assez simple: la tyrannie et le manque de développement économique. Une présidence forte et un système de freins et contrepoids inspiré de celui des États-Unis devaient mettre fin à la tyrannie et ouvrir la voie à la croissance. Alberdi insistait sur le fait que nombre des difficultés de l’Argentine étaient liées à ses choix constitutionnels.
Il expliquait que l’Amérique latine avait traversé deux phases constitutionnelles. La première, immédiatement après l’indépendance, était tournée vers le passé et cherchait à corriger les défauts des anciens systèmes, sans s’attaquer aux problèmes fondamentaux. De plus, l’objectif principal à cette époque était l’indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole, plutôt que le développement économique ou la mise en œuvre d’un projet national commun. Dans la deuxième phase constitutionnelle, l’objectif n’était plus l’indépendance, mais le développement économique grâce à des institutions solides. La mission centrale de la constitution, selon Alberdi, était donc de promouvoir la croissance économique en Argentine.
Rosas a été renversé, et l’Argentine a adopté la constitution libérale classique d’Alberdi. La constitution argentine de 1853 est presqu’un copié-collé de celle des États-Unis de 1787. Elle établit un système fédéral encadré par une constitution rigoureuse, avec des provinces unies et un gouvernement fédéral pour concilier les intérêts provinciaux tout en empêchant la tyrannie locale et le chaos national. Le gouvernement fédéral fonctionne dans un cadre de pouvoirs énumérés, divisés entre un exécutif, un législatif et un judiciaire. Contrairement à son modèle américain, la constitution argentine confère au président des pouvoirs plus forts devant lui permettre d’assumer des pouvoirs d’urgence pour réprimer les dissidences locales. De même, elle attribue un rôle économique explicitement interventionniste au gouvernement fédéral. Grâce à cette réussite institutionnelle remarquable, l’Argentine passa rapidement d’une région coloniale marginale et chaotique à une nation prospère. En 1910, elle était devenue la huitième nation la plus riche au monde
Misère : 1930-2023
Malgré ce succès constitutionnel, l’Argentine souffrait encore de pathologies profondes. Les transferts de pouvoir étaient certes pacifiques, mais basés sur des élections frauduleuses et une oligarchie auto-perpétuée. Les caudillos régionaux étaient contrôlés par le gouvernement national mais au prix d’une présidence forte et de contrepoids institutionnels faibles. L’opposition, renforcée par la loi sur le suffrage universel de 1912, a finalement brisé ce monopole oligarchique en 1916. Les quatorze années qui suivirent virent la domination de gouvernements populistes qui semèrent les graines de la redistribution et annoncèrent l’érosion de l’ordre constitutionnel.
En 1930, survint le premier des onze coups d’État militaires que connut le XXème siècle. L’Argentine ne s’en est jamais remise.
1943 marqua l’avènement du prochain moment décisif : le coup d’État militaire auquel le colonel Juan Domingo Perón prit part. Trois années plus tard, en 1946, il fut élu président. Perón a marqué l’histoire de l’Argentine des 80 dernières années. Initialement ministre du Travail, il créa une version argentine du fascisme mussolinien, combinant populisme, clientélisme, redistribution des fonds publics pour acheter les votes, et corporatisme entre les divers groupes économiques et politiques du pays, le tout orchestré par un État puissant.
Les plans économiques quinquennaux, la réglementation lourde du travail et de l’économie, et un État redistributeur contribuèrent à un déclin lent et régulier de l’Argentine. Tout au long du XXème siècle et au début du XXIème siècle, l’économie argentine s’étouffa progressivement. Après six dictatures militaires entre 1930 et 1976, le retour au régime démocratique eut lieu en 1983. Pour autant le péronisme et l’interventionnisme continuèrent. L’Argentine – autrefois la huitième nation la plus riche du monde – connut l’hyperinflation dans les années 1980 et de nouveau à la fin des années 2010, tout en étant à plusieurs reprises sauvée par le Fonds monétaire international dont elle demeure le plus grand débiteur avec $44 milliards (loin devant la Turquie avec $16 milliards).
Si depuis 1983 le pays n’a pas toujours été aux mains des péronistes, l’interventionnisme n’en est pas moins demeuré une constante – à l’exception du mandat de Carlos Menem avec Domingo Cavallo à la tête du ministère des Finances. Tous deux ont tenté de dompter l’inflation avec l’épisode prometteur du currency board en 1991 ; épisode qui s’est mal terminé en raison de l’abandon de la règle stricte du 1 pour 1. La stagnation économique s’en est suivie ; nouvelle page troublée de l’histoire institutionnelle du pays.
Au cours de la dernière décennie 2013-2023, l’Argentine a connu une renaissance du péronisme, avec des conséquences économiques prévisibles. Le taux de pauvreté est passé de 10 % à 45 % de la population. Les contrepoids institutionnels furent une fois encore détruits : la Cour suprême s’est peuplée d’alliés présidentiels, et la banque centrale – indépendante sur le papier – devint un instrument pour le financement d’une redistribution massive. Sans surprise, l’hyperinflation un temps domptée par le gouvernement Menem et son currency board au début des années 1990, ne tarda pas à refaire surface avec des taux atteignant 300%.
C’est ce chaos dont Javier Milei hérite en décembre 2023, lorsqu’il est investi à la présidence de l’Argentine.
Conclusion : Un espoir pour l’Argentine ?
Javier Milei a été élu avec un programme de réformes typiquement libéral. Face à lui se dressent de nombreux et délicats défis : macroéconomiques, structurels, monétaires et réglementaires. Il doit aussi prendre en compte les intérêts politiques profondément enracinés et le clientélisme d’État qui freinent la croissance.
L’histoire nous enseigne que la croissance et la stabilité sont le résultat de la mise en place de solides institutions – comme l’état de droit, le respect des droits de propriété et des contrats, la liberté d’innover et d’échanger, la stabilité, la confiance et la prévisibilité. Le défi le plus fondamental de Milei est donc d’engager une réforme crédible des institutions. Durant sa campagne, il n’a eu de cesse de répéter qu’il fermerait la banque centrale et officialiserait la dollarisation dès son arrivée au pouvoir. Pourtant, ce sont les premiers éléments de son projet sur lesquels il est revenu, pour se concentrer sur d’autres réformes fiscales et réglementaires qui portent déjà leurs fruits. A-t-il fait les bons choix ? Nous laissons au Dr. Emilio Ocampo, professeur à l’Universidad del CEMA (Buenos Aires) le soin de nous aider à mieux saisir les enjeux des mois à venir.
[1] Publié par le Fraser Institute, l’indice peut être consulté ici : https://efotw.org