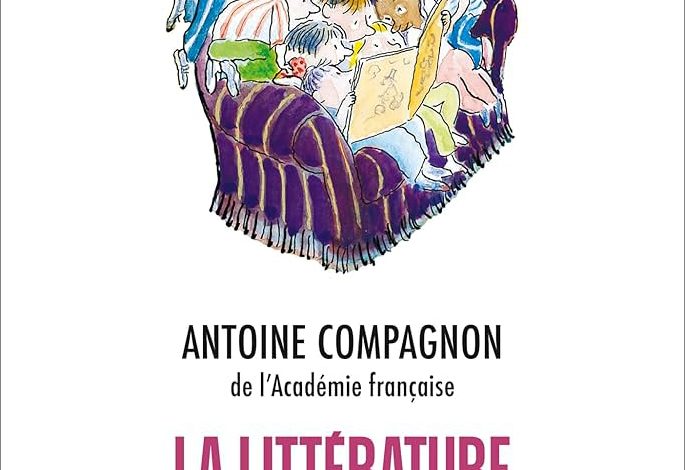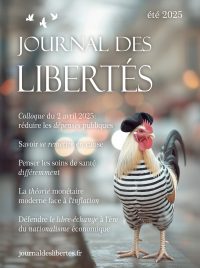La Fondation pour l’innovation politique vient de faire paraître deux intéressantes notes rédigées par Jérôme Perrier sur le même thème : Le détournement populiste du courant libertarien. Même si la première note porte en couverture une photographie du penseur anarcho-capitaliste américain Murray Rothbard, décédé en 1995, et la seconde celle d’une rencontre entre Javier Milei et Donald Trump, l’historien se concentre avant tout sur la tactique politique dessinée par Rothbard et sa mise en application par le Président argentin.
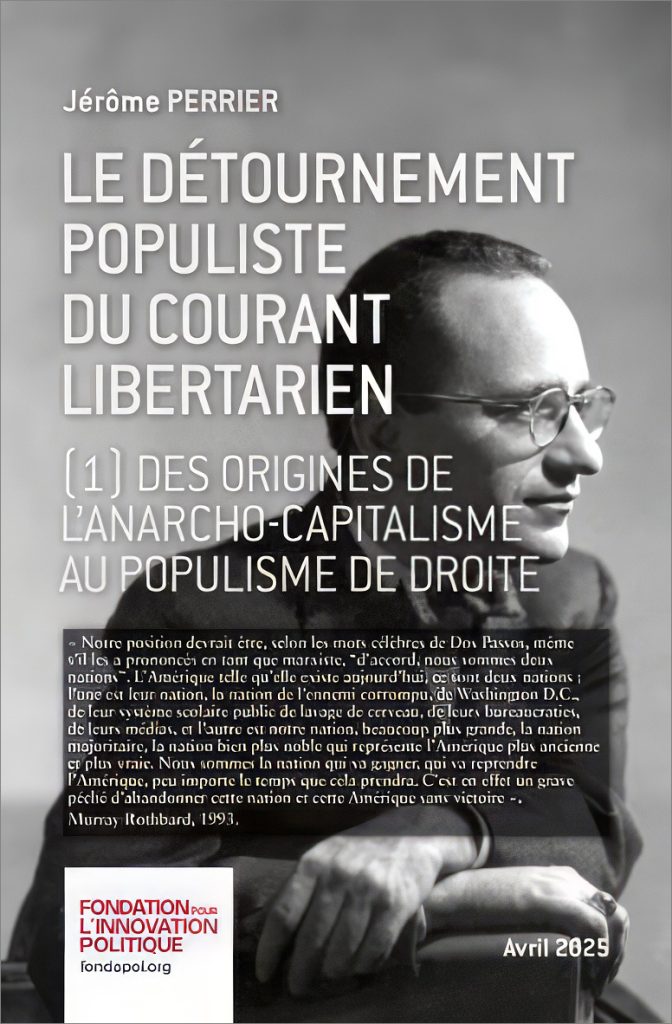
Des origines de l’anarcho-capitalisme au populisme de droite
Dans la première note, Jérôme Perrier traite Des origines de l’anarcho-capitalisme au populisme de droite. Il entend à juste titre opérer une clarification conceptuelle. Le courant libertarien, un terme apparu dans les années 1940 aux États-Unis, « rassemble des individus qui radicalisent les thèses du libéralisme classique, jusqu’à l’anarchisme pour les plus fondamentalistes » (1, p. 12). Jérôme Perrier veut montrer comment ce courant va opérer un changement d’alliance à partir des années 1970, de la gauche contestataire, avec l’opposition à la guerre du Vietnam, à la droite conservatrice et populiste. Une nouvelle alliance pour le moins surprenante voulue par le principal penseur de l’anarcho-capitalisme, Rothbard. Et justement Javier Milei, explicitement converti à l’anarcho-capitalisme après avoir eu une révélation à la lecture des œuvres de Rothbard, « est en quelque sorte l’héritier » de cette « doctrine/stratégie d’union » (p. 22).
Ce programme est explicitement présenté par Rothbard dans un manifeste de janvier 1992 intitulé « Populisme de droite : une stratégie pour le mouvement paléo », dont la traduction partielle se trouve à la fin de la seconde note (2, pp. 49 et suivantes). Le « paléo-libertarianisme est conçu comme « une alliance entre l’aile droitière du courant libertarien et l’aile conservatrice et populiste de la droite républicaine » (1, p. 12, n. 8). Il s’agit en sept points d’appliquer certains des principes fondamentaux de la pensée anarcho-capitaliste, telle la suppression de la banque centrale, mais aussi de faire un clin d’œil aux conservateurs américains avec l’idée d’une America First ou la défense des valeurs de la famille.
L’objectif n’est plus seulement, à la Friedrich Hayek, de convertir les intellectuels au libéralisme, mais aussi et surtout de convertir les masses. « Le populisme paléo-libertarien va fondamentalement consister à dresser le peuple contre ses élites, c’est-à-dire, les hommes de l’État, en se faisant l’avant-garde du premier » (p. 43). De manière manichéenne et simpliste, il y a d’un côté les « bons », les individus opprimés par le pouvoir, et de l’autre les « méchants », les hommes de l’État et leurs affidés. L’influence paradoxale du marxisme via Franz Oppenheimer, dont nous reparlerons un peu plus bas, apparaît en pleine lumière, même si Rothbard estimait que les marxistes n’avaient pas « une théorie claire et nette des bons contre les méchants ». Mais on peut faire aussi un parallèle avec la célèbre analyse de Carl Schmitt sur le principe ami-ennemi. Rothbard ne le cite pas explicitement, mais il juge que les nazis, eux « avaient une théorie claire et nette des bons contre les méchants ». La politique, selon le publiciste nazi Schmitt, c’est ce qui partage les amis des ennemis. Même si le héraut de l’anarcho-capitalisme s’intéresse ici à l’aspect tactique et non au fond, on ne peut qu’être surpris qu’il reprenne des idées expressément contraires à la « catallaxie » des penseurs autrichiens. Le terme « catallaxie » n’a-t-il pas été un néologisme construit pour signifier entre autres que, par le truchement du commerce et de la liberté, on transformait les ennemis en amis ?
La dernière partie de la première note, dont le plan n’est pas d’une grande rigueur, pas plus que celui de la seconde, s’attache aux sources de l’anarcho-capitalisme et du populisme libertarien, qu’il s’agisse des origines américaines à partir de Thomas Jefferson, avec une analyse synthétique et pertinente de l’Atlas Shrugged d’Ayn Rand notamment, des origines autrichiennes, mentionnées pour mémoire, et des origines françaises avec l’École de Paris.
Le « populisme paléo-libertarien » de Javier Milei
La seconde note, consacrée au populisme paléo-libertarien de Javier Milei est autrement plus polémique. Elle débute, là encore, avec un plan surprenant, par une louable tentative de conceptualisation du libéralisme qui aurait dû se trouver au début de la première note. Jérôme Perrier analyse le libéralisme comme indissociablement culturel, économique et politique. Il rejette la notion de « libéralisme conservateur », ce qui ne fera pas l’unanimité (sur ce sujet, voir l’ouvrage de Jean-Philippe Delsol, Libéral ou conservateur ? Pourquoi pas les deux ?, Manitoba, 2024). En contrepoint, il estime que le « populisme paléo-libertarien constitue une mutilation de l’idéal libéral qui conduit à le dénaturer complétement ». Il ajoute : « D’une philosophie fondée sur la modération (une idée répétée, mais qui aurait mérité des développements) et la défense de l’individu contre toutes les formes de domination ne reste plus qu’une caricature de la liberté : celle du renard dans le poulailler » (2, p. 12). De même, il allègue abruptement que « l’idée de souveraineté ‘absolue’ de l’individu ne peut que conduire à l’anarchisme puisqu’elle dénie à toute autorité politique la moindre légitimité », ce qui aurait exigé des explications plus nourries que cette déclaration à l’emporte-pièce.
Jerôme Perrier en conclut, de manière tout aussi polémique : « Certains libertariens radicaux alliés au conservatisme religieux, en Argentine avec Milei ou aux États-Unis avec Trump, trahissent à n’en pas douter des valeurs pourtant au cœur de toute philosophie authentiquement libérale » (p. 15). La phrase retient l’attention car elle mêle les hommes politiques et leurs soutiens, sans que l’auteur n’en donne d’ailleurs les noms, et que Javier Milei se trouve indistinctement confondu avec Donald Trump, dont on entend d’ailleurs peu parler et ce n’est pas un hasard. Il y a là plus qu’un glissement dangereux : comment établir une comparaison tangible entre un intellectuel à la pensée anarcho-capitaliste largement conséquente, et un homme politique populiste, sans corps de doctrine, insaisissable et opportuniste ?
Une critique inconséquente des libertariens
En réalité, ce que Jérôme Perrier ne supporte pas, c’est que, selon lui, les « libertariens radicaux » :
- ne s’opposent pas aux monopoles de certaines grandes entreprises privées, sans citer d’ailleurs l’évolution doctrinale de Hayek sur ce point et, quoi qu’en dise l’auteur, avec conséquence pour la simple et bonne raison que l’immixtion de l’État dans la sphère de la concurrence, de manière ordo-libérale en fait, constitue un grave danger pour la liberté économique ;
- ne soient pas favorables à la libre-circulation sans limites des individus, sans évoquer le fait de l’immigration de confort qui permet de bénéficier des largesses de l’État-providence, un point que n’avaient pas anticipé pour l’essentiel les libéraux classiques ;
- délaissent le « libéralisme culturel », selon une expression discutable ;
- s’opposent à l’avortement, même si le fait que l’Argentine reste un pays catholique au sein duquel la pratique religieuse est loin d’être anodine, n’est pas souligné ;
- enfin soient « obsédés » par le wokisme et la question des discriminations, le terme d’obsession étant bien contestable s’agissant d’une idéologie aussi pernicieuse que dangereuse.
Jérôme Perrier en veut pour preuve le discours prononcé par le Président Milei à Davos le 25 janvier 2025, qu’il reproduit in extenso (pp. 36 et suivantes). Ce qui est gênant, c’est qu’il ne commente pas vraiment ce discours, et qu’il passe surtout par pertes et profits ses éléments remarquables, au-delà de certains points qui peuvent effectivement paraître fort discutables. Il est aussi gênant qu’il mêle sans nuance ce discours au programme de Murray Rothbard rappelé précédemment, alors même que l’allocution de Javier Milei s’attache aux grands principes, tandis que le texte de Rothbard est explicitement une réflexion sur la bonne tactique à adopter pour faire progresser les idées anarcho-capitalistes. Quoi qu’il en dise, la congruence entre les deux textes est loin d’être totale et ceux-ci auraient mérité une analyse plus nuancée.
Une conception extensive des penseurs libéraux
Si Jérôme Perrier fait, on l’a dit, un effort de conceptualisation du libéralisme dans la première note, succinctement, et dans la seconde, de manière plus nourrie, il a la fâcheuse tendance, très française à vrai dire, à voir des penseurs libéraux un peu partout avec une conception extensive que nous n’hésiterons pas à qualifier de coupable. Successivement :
- Franz Oppenheimer (1, pp. 17 et 56), qui cependant n’a jamais été libéral, mais très marqué par le marxisme ;
- Isaiah Berlin (p. 18), qui n’était pas plus libéral et qui défendait l’interventionnisme ;
- John Stuart Mill, que Jérôme Perrier qualifie de « libéral modéré » (p. 47), avant de reconnaître qu’il « sera considéré à la fin de sa vie comme un socialiste libéral et jugé par nombre de libertariens comme un traître à la cause » (2, pp. 13-14), mais après avoir cru bon de considérer sa définition du libéralisme comme « pour ainsi dire canonique » (p. 11), malgré tout dangereuse sur plusieurs points ;
- Adolphe Blanqui (1, p. 54), le pourfendeur des grandes entreprises ;
- Michel Chevalier (ibid.), certes progressivement libre-échangiste, mais rallié de la première heure et avec enthousiasme à la dictature napoléonienne, et thuriféraire du pouvoir fort ;
- puis Germaine de Staël (2, p. 10, n. 3), certes d’un grand intérêt quant à l’aspect strictement politique du libéralisme, mais qui a délaissé l’aspect économique, à l’encontre de son compagnon Benjamin Constant ;
- Karl Popper (p. 14), qui défendait un interventionnisme non négligeable dans le domaine de l’économie ;
- ou encore le Colloque Lippmann de 1938 (pp. 15-16), si important dans le rejet du libéralisme classique et la construction du « néolibéralisme », poussé par la conjonction des ordo-libéraux allemands et des auteurs français au grand dam des libéraux autrichiens. Pourtant, Jérôme Perrier avait précisé avec à propos à deux reprises combien le terme « néolibéral » devait être manié avec précaution (1, pp. 13 et 19).
La seconde note s’arrête abruptement sans conclusion, comme la première d’ailleurs, mais, pour comprendre nos fortes réserves sur ces différents auteurs ou courants que nous estimons non libéraux, nous inviterons les personnes intéressées à prendre connaissance de notre ouvrage Exception française. Histoire d’une société bloquée de l’Ancien Régime à Emmanuel Macron (Odile Jacob, 2020).