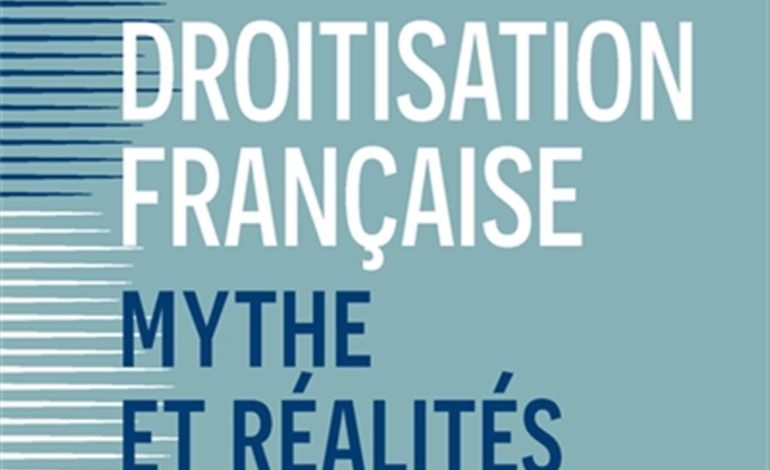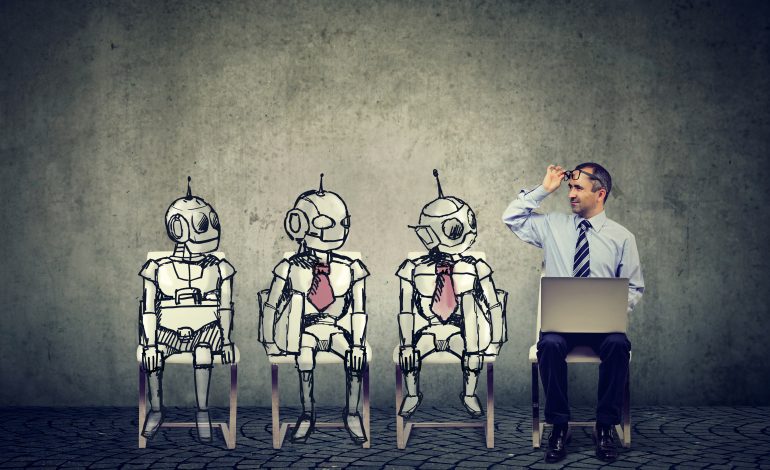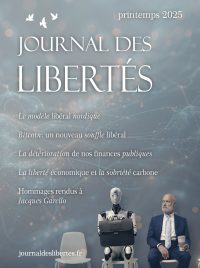1. Introduction
Il est communément admis (Samuelson 1973 : 885 ; Sachs 2006 : 42) que les cinq pays nordiques sont des exemples d’économies mixtes efficaces qui ont su néanmoins préserver la liberté individuelle. Dans cet article, nous suggérons qu’au contraire, le succès relatif des pays nordiques s’est fait en dépit de l’interventionnisme économique et non à cause de celui-ci. Les pays nordiques s’étaient engagés sur la voie de la liberté et de la prospérité bien avant que les sociaux-démocrates ne prennent le pouvoir dans les années 1930 dans les trois pays scandinaves, la Suède, le Danemark et la Norvège, alors que dans les deux autres pays nordiques, l’Islande et la Finlande, ils n’ont jamais atteint la même hégémonie politique qu’en Scandinavie. Le succès des pays nordiques repose, comme nous le soutenons ici, sur trois piliers solides que les sociaux-démocrates du XXe siècle n’ont, pas plus que les rois absolutistes du passé, pu supprimer : une tradition juridique conduisant à des libertés relativement sûres ; le libre-échange ; et la cohésion sociale, avec un niveau élevé de confiance et de coopération volontaire. Nous identifions ici trois penseurs nordiques influents qui ont articulé ces pratiques : le chroniqueur islandais du XIIIe siècle Snorri Sturluson, le pasteur et homme politique fenno-suédois du XVIIIe siècle Anders Chydenius et le pasteur, homme politique et poète danois du XIXe siècle Nikolaj F. S. Grundtvig. À la fin de l’article, nous examinons brièvement certaines implications pratiques de ce « modèle nordique libéral » pour les pays européens et les pays en développement.

2. La tradition juridique : Snorri Sturluson
Une tradition nordique libérale a été identifiée par certains juristes du XXe siècle (Herlitz 1939 : 7 ; Castberg 1949 : 72–73 ; Vinding Kruse 1963 : xiii–xiv ; Lindal 1981 : 38). Bien avant, Montesquieu avait suggéré que l’idée d’un gouvernement limité par des assemblées populaires était d’origine nordique :
« Il suffit de lire l’excellent ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains pour voir que les Anglais ont emprunté à eux l’idée de leur gouvernement politique. Cet élégant système a été découvert dans les bois » (2018 : XI, 6).
Montesquieu ajoutait que les nations scandinaves « ont été la ressource de la liberté en Europe, c’est-à-dire de presque tout ce qu’il y a de liberté aujourd’hui parmi les hommes » (2018 : XVII, 5). Dans son histoire des rois norvégiens, Heimskringla, le chroniqueur islandais Snorri Sturluson (1179-1241) décrit cette tradition politique et juridique. Il écrit sur les conflits répétés entre les assemblées populaires et les rois qui cherchent à remplacer « la bonne vieille loi » par leurs stipulations. Snorri (en islandais, le nom de famille n’est pas donné, Sturluson signifiant simplement qu’il était le fils de Sturla, et les Islandais portent donc leur prénom) a été élevé dans l’idée que les rois étaient avant tout des guerriers qui prélèvent des impôts élevés. Après tout, l’Islande avait été colonisée en grande partie par des Norvégiens fuyant au IXe siècle l’oppresseur Harold Fairhair, premier roi d’une Norvège unifiée. En 930, ils avaient établi une République sans roi ni autre organe exécutif, où une assemblée générale, l’Althingi, se réunissait une fois par an pour trancher les différends et interpréter la loi. Le seul fonctionnaire de la République était le porte-parole de la loi, dont la tâche était de se prononcer sur la loi, tandis que son application était privée (Friedman 1979 ; Lindal 1993 ; Birgir 1993). La tradition islandaise antiroyaliste a été exprimée de manière concise par un chroniqueur antérieur, Ari le Savant, qui écrivait sur la christianisation de son pays en l’an 1000. Le porte-parole de la loi fut chargé de servir de médiateur dans le conflit entre païens et chrétiens. Il prononça un discours dans lequel il « raconta comment les rois de Norvège et du Danemark avaient maintenu la guerre et les batailles les uns contre les autres pendant longtemps, jusqu’à ce que les peuples de ces pays aient fait la paix entre eux, même s’ils ne le souhaitaient pas » (Ari 2006 : Ch. VII, 9).
Dans le Heimskringla de Snorri, on trouve deux principes politiques (Lindal 2007) qui furent plus tard systématiquement élaborés par John Locke (1764) dans sa défense de la révolution whig de 1688 : le gouvernement par consentement et le droit de rébellion. Snorri fait une distinction entre, d’un côté, les bons rois qui respectent la « bonne et ancienne loi », maintiennent la paix et font respecter la loi fiscale, et de l’autre, les mauvais rois qui enfreignent la loi, déclarent la guerre à d’autres pays et imposent des impôts élevés au peuple. Par exemple, le roi Harold à la Belle Chevelure, que de nombreux colons islandais avaient fui, était mauvais, alors que son fils Haakon était bon. « Harold avait asservi et opprimé tous les habitants du pays, tandis que Haakon souhaitait le bien à tout le monde et proposait de restituer aux agriculteurs leurs patrimoines », rapporte Snorri (2014 : I, 88). En effet, le roi Haakon a été surnommé « le Bon ». Un siècle plus tard, lorsque les agriculteurs norvégiens apprirent que le roi Olof Tryggvason voyageait avec une grande armée, imposant des coûts énormes aux agriculteurs « et enfreignant les anciennes lois du peuple, tandis que tous ceux qui s’y opposaient devaient faire face à des punitions et à des peines sévères », ils se rassemblèrent pour rencontrer le roi et lui dire qu’ils ne se soumettraient pas à une loi injuste « Même s’ils sont introduits par le roi » (2014 : I, 189). Snorri écrit encore avec approbation à propos de deux comtes qui ont gouverné la Norvège pendant un certain temps, car « ils respectaient scrupuleusement l’ancienne loi et toutes les coutumes du pays et étaient de bons dirigeants populaires » (2014 : I, 233).
L’exemple le plus révélateur des idées politiques de Snorri est peut-être son récit d’un conflit en 1018 entre le roi suédois Olof Ericsson et une assemblée populaire à Uppsala. Le roi voulait déclarer la guerre à son homonyme, le roi Olof le Gros de Norvège. Dans un discours à l’assemblée, le porte-parole Torgny se plaignit que
« ce roi que nous avons maintenant ne laisse personne oser lui dire autre chose que ce qu’il veut qu’on fasse, et consacre tout son enthousiasme à cela, mais laisse ses terres tributaires lui échapper par manque d’énergie et de détermination. »
Torgny s’opposa à une guerre avec la Norvège et lança un avertissement sans détour au roi : « Si vous ne voulez pas accepter ce que nous exigeons, alors nous monterons une attaque contre vous et vous tuerons, et nous ne tolérerons pas votre hostilité et votre iniquité. C’est ce qu’ont fait nos ancêtres avant nous » (2015 : II, 74–75). Le message de Torgny fut renforcé par le porte-parole Emund et un vieux sage, Arnvid l’Aveugle (2015 : II, 95–102). Le roi dut céder et accepter les conditions des agriculteurs.
Ce qui est également remarquable dans l’incident de 1018 à Uppsala, c’est que Snorri y expose brièvement le cas du libre-échange. Un orateur de l’assemblée, le comte Rognvald,
« a raconté à quel point c’était un problème pour les Goths occidentaux de ne pas avoir toutes les choses de Norvège qui auraient pu compléter leur propre production, et d’être en même temps exposés à leurs attaques et à leurs raids chaque fois que le roi de Norvège rassemblait une armée et les envahissait » (2015 : II, 73).
Le commentaire du comte selon lequel les agriculteurs suédois des régions frontalières devaient commercer avec les Norvégiens pour « compléter leur propre production » est une observation précoce de la nécessité de la division du travail.
Le Heimskringla, avec ses nombreuses histoires sur l’avarice, l’insensibilité et la cruauté des rois, peut être lu comme un avertissement général contre les rois (Fjalldal 2013 ; Sawyer 2015). Snorri lui-même oppose le règne des rois à la tradition anti-royaliste islandaise dans son récit d’une réunion à l’assemblée générale islandaise, l’Althingi, en 1024. Un émissaire du roi norvégien Olof le Gros avait demandé aux Islandais un morceau de terre en cadeau, en échange duquel le roi avait promis son amitié. Un fermier islandais, Einar de Thvera, a répondu : « Ainsi, bien que ce roi soit un homme bon, comme j’en suis fermement convaincu, il arrivera désormais comme par le passé, lorsqu’il y aura un changement de dirigeant, qu’ils se comportent différemment, certains bien, d’autres mal. » Mais si le peuple de ce pays souhaite conserver sa liberté, dont il jouit depuis que ce pays a été colonisé, il serait alors préférable de ne pas accorder au roi de prise sur ce territoire » (2015 : II, 143-144). Einar a convaincu l’assemblée de rejeter la demande du roi. Ce fermier islandais présentait le même dilemme que Karl Popper (1945 : I, chap. 7, II) au XXe siècle : nous devons nous préparer à de mauvais dirigeants, tout comme les navires sont construits pour les mers agitées. Les rois « finissent différemment, certains bons, d’autres mauvais ». La solution islandaise au dilemme était de ne pas avoir de roi, tandis que la solution norvégienne, selon Snorri, était d’exiger du roi le respect de la « bonne vieille loi » ainsi que la paix et des impôts bas, et de le destituer s’il n’acceptait pas cela.
Snorri Sturluson était un homme de tous les temps. Poète accompli, il n’était pas seulement l’auteur de Heimskringla, mais aussi de l’Edda, un manuel pour jeunes poètes, notre principale source de mythologie nordique et germanique. Il est probablement (Olsen 1904) l’auteur de La Saga d’Egil, l’une des meilleures sagas islandaises, récit d’une querelle entre la famille royale norvégienne et une famille islandaise à laquelle appartenait le poète-guerrier coloré Egil. De plus, Snorri était un homme du monde. À son apogée, il était le plus riche fermier d’Islande, ayant des enfants de sa femme – dont il a fini par divorcer – et plusieurs maîtresses. Il a été porte-parole de la loi islandaise de 1215 à 1218, puis de 1222 à 1232, poursuivant la politique étrangère exprimée dans le discours d’Einar de Thvera (qui a bien sûr été écrit par Snorri lui-même) selon lequel les Islandais devaient être les amis mais pas les sujets du roi de Norvège. Le roi Haakon le Vieux de Norvège n’était pas d’accord et fit assassiner Snorri. En 1262, les Islandais cédèrent aux pressions de la Norvège (dont le pays dépendait pour tout son commerce) et prêtèrent serment d’allégeance au roi norvégien contre une promesse royale selon laquelle le commerce avec l’Islande serait assuré, qu’ils pourraient avoir leur propre loi et que tous les fonctionnaires seraient islandais. Mais comme Snorri exprimait de manière vivante les deux idées libérales fondamentales élaborées plus tard par Locke – le gouvernement par consentement et le droit de rébellion – il mériterait peut-être plus que saint Thomas d’Aquin l’épithète de Lord Acton (1985 : 33) en tant que « premier Whig ». Mais il serait ahistorique de qualifier Snorri de libéral. Il était un proto-libéral, tout comme le pasteur, homme politique et écrivain fenno-suédois Anders Chydenius (1729-1803) qui fut élu de Finlande centrale au rang du clergé à la Diète suédoise en 1765, devenant immédiatement un porte-parole important et influent de la liberté économique et intellectuelle.
3. Le libre-échange : Anders Chydenius
Bien que les rois suédois aient tenté d’imposer l’absolutisme au XVIIe siècle, ils n’ont jamais aboli la Diète de leur pays qui se composait de quatre états : la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et, chose inhabituelle en Europe, les paysans. La défaite de la Suède face à la Russie et à ses alliés lors de la Grande Guerre du Nord de 1700-1721 avait fait pencher la balance du pouvoir en faveur de la Diète, et la période de 1718 à 1772 a été appelée « l’ère de la liberté » dans l’histoire suédoise. Deux partis politiques vaguement organisés avaient émergé, les Chapeaux qui cherchaient à restaurer la Suède dans son ancienne gloire militaire, et les Caps qui insistaient pour la recherche de la paix. Chydenius appartenait aux Caps et, dès son arrivée à Stockholm, il commença à publier des pamphlets en faveur de la liberté. Dans sa paroisse du centre de la Finlande, il avait observé les effets néfastes des monopoles commerciaux. Les biens produits là-bas devaient être acheminés vers Stockholm et ne pouvaient pas être vendus directement à des clients potentiels. Chydenius affirmait (2012a : §31) que la liberté économique
« garantirait au Suédois la jouissance de son droit naturel le plus précieux et le plus important, qui lui a été accordé en tant qu’être humain par le Tout-Puissant, à savoir celui de gagner sa vie à la sueur de son front du mieux qu’il peut ».
Il tenait pour acquis l’intérêt personnel :
« Chaque individu poursuit son propre avantage. Cette inclination est si naturelle et nécessaire que toute société du monde est fondée sur elle : sinon, les lois, les sanctions et les récompenses n’existeraient même pas et l’espèce humaine entière périrait complètement en peu de temps. Le travail le mieux récompensé est toujours celui qui a la plus grande valeur et le plus recherché est celui qui est le mieux récompensé » (2012a : §5).
Cependant, Chydenius a souligné que l’intérêt personnel « nuisible » « qui essaie toujours de se cacher derrière une réglementation ou une autre » pourrait « être contrôlé le plus efficacement par la concurrence mutuelle » (2012a : §31).
Chydenius a enseigné, comme Adam Smith (1776) onze ans plus tard, que c’était la division du travail et le libre-échange qui ont apporté la prospérité. Il a utilisé une analogie pour illustrer la coordination sans commandements : la gravitation du travail vers son utilisation la plus précieuse est comme le mouvement descendant de l’eau. Les réglementations superflues sont analogues à
« des barrages qui concentrent les gens dans certains endroits, les déplaçant d’un endroit à un autre, sans qu’il soit possible de dire dans quel endroit ils seront le plus utiles et augmenteront ou réduiront le profit national » (2012a : §15).
Chydenius a fermement rejeté tous les privilèges et toutes les positions protégées par la force. Bien que la société n’ait aucun droit sur la propriété légalement acquise des individus, il a reconnu qu’elle « contribue à la ruine du pays si elle n’ouvre pas rapidement ces barrages qui ont accumulé la richesse dans quelques endroits et appauvri le reste » (2012b). Dans une économie libre et concurrentielle, le profit privé et le profit national fusionnent en un seul intérêt, selon Chydenius.
« Lorsqu’il n’y a pas d’obstacles sur la voie, chaque travailleur rivalise pour sa subsistance et augmente ainsi le profit de la nation » (2012a : §15).
L’économiste suédois Eli F. Heckscher a commenté (1936 : 121) que Chydenius a fourni « une exposition presque classique, claire et simple des principes fondamentaux du libéralisme économique ». Ce n’est cependant qu’au XIXe siècle que les Suédois ont mis en œuvre une libéralisation économique complète. Entre 1870 et 1970, la Suède avait l’une des économies les plus libres et les plus prospères du monde (Norberg 2023).
À la Diète, Chydenius défendait également la liberté d’expression et la liberté de religion. Il affirmait qu’il fallait encourager « l’usage libre de la plume » (2012c : 228). Les idées devaient être mises à l’épreuve.
« Si la déclaration est absurde, il y aura bientôt des gens pour la réfuter. Si elle est fondée sur la vérité, elle restera invincible, et aucune forteresse ne peut être plus louée que celle qui a résisté aux sièges les plus sévères. Si l’affaire est équivoque, la vérité doit être établie par des échanges publiés »,
a-t-il déclaré dans un mémoire adressé à un comité de la Diète. En effet, il était utile de dénoncer l’erreur :
« Le mensonge fait honte à son auteur mais profite à la nation, dans la mesure où la vérité est établie et peut prendre racine plus fermement » (2012d : 224).
Ainsi, Chydenius a anticipé deux vénérables idées libérales, la conception de la science de Popper comme libre concurrence des idées (1963) et l’argument de John Stuart Mill (1859) selon lequel même les idées erronées devraient être autorisées car leur réfutation pourrait renforcer des idées utiles et correctes. C’est en grande partie grâce aux efforts de Chydenius que la Diète a accepté en 1766 d’abolir la censure et d’introduire une loi sur la liberté de la presse, la première du genre au monde. En outre, la loi garantissait également la liberté d’information, c’est-à-dire que les documents officiels devaient être accessibles au grand public. Cela a peut-être contribué à la réduction de la corruption en Suède. Les autorités sont devenues transparentes et responsables. Alors que le roi Gustave III s’est emparé du pouvoir en 1772 et a mis fin à « l’ère de la liberté », la pleine liberté de la presse a été réintroduite dans la Constitution de 1809 après la destitution du roi Gustave IV à la suite de ses aventures militaires et de la perte de la Finlande au profit de la Russie.
Chydenius fut réélu à la Diète en 1769, mais son élection fut invalidée en raison d’une formalité. Il fut élu une troisième fois en 1778 et mena ensuite une campagne pour que la liberté religieuse, y compris pour les catholiques et les juifs, soit garantie. Les Suédois devraient, écrit-il, ouvrir les bras
« à tous ces malheureux qui sont déjà ou pourraient être privés d’un sanctuaire dans leur pays d’origine et qui aspirent donc à se déplacer ailleurs pour chercher une certaine protection contre la violence et l’oppression » (2012e : 317).
Malgré l’opposition farouche de son propre État du clergé, Chydenius réussit à convaincre les trois autres États de sa proposition, ainsi que le roi Gustave III qui fit remarquer : « Je suis assez audacieux aussi, mais je n’aurais jamais osé faire ce que Chydenius a fait » (2012f : 343). C’est notamment sous l’influence de Chydenius que la Suède a adopté une loi de tolérance en 1781. En 1792, Chydenius fut élu pour la quatrième fois à la Diète, qui ne siégea cependant que pendant un mois. Marié mais sans enfant, il était un homme aux intérêts et aux capacités variés, actif dans sa paroisse natale dans l’assèchement des marais, l’expérimentation de nouvelles races d’animaux et de plantes, l’adoption de nouvelles méthodes de culture, la réalisation d’opérations mineures, la préparation de médicaments, la vaccination de ses paroissiens contre la variole et même la direction d’un orchestre qui donnait des concerts au presbytère. Bien qu’il puisse être considéré comme un homme des Lumières, il désapprouvait la Révolution française, décrivant comment il avait
« observé des flots de sang couler sous la bannière des Lumières et de la liberté et sous le nom sacré des Lumières une frénésie d’autoritarisme se répandant rapidement dans toute l’Europe, menaçant les dirigeants, les sujets et les citoyens de la plus terrible anarchie » (Schauman 1908 : 412–413).
4. Cohésion sociale : Nikolaj F. S. Grundtvig
L’absolutisme n’a réussi qu’en partie dans les pays nordiques. « La royauté s’affirma mais fut, d’une manière ou d’une autre, forcée de reconnaître et de faire des compromis avec l’ancien système germanique », observa le juriste islandais Sigurdur Lindal (1981 : 38). L’absolutisme était cependant plus fort au Danemark qu’en Suède. Le roi danois abolit la Diète lorsqu’il prit le pouvoir en 1660. Il était cependant lié par la tradition juridique nordique, comme le reconnut l’écrivain anglo-irlandais Robert Molesworth. Fervent partisan de la révolution whig de 1688, lors de la destitution du roi Jacques II, Molesworth servit comme envoyé britannique au Danemark de 1689 à 1692. Il écrivit ensuite un livre pour mettre en garde ses compatriotes contre le danger des rois absolutistes. Les Whigs craignaient le retour du roi déchu. Molesworth énuméra de nombreux défauts de la société danoise, mais fit une exception.
« Jusqu’ici, nous y avons rencontré bien des choses à éviter et peu de choses qui méritent d’être imitées : mais comme il s’agit maintenant de parler des lois danoises, je dois commencer par ce qu’elles ont de bon en général, à savoir qu’en termes de justice, de concision et de clarté, elles dépassent tout ce que je connais au monde » (Molesworth 2011 : Ch. XV, 143).
À la fin du XVIIIe siècle, cet élément libéral de la société danoise s’est renforcé lorsque les hauts fonctionnaires de Copenhague ont inclus des amis personnels et des admirateurs d’Adam Smith, et ils ont veillé à ce que la première traduction autorisée de La Richesse des Nations paraisse en danois en 1779-1780 (Kurrild-Klitgaard 1998). Des réformateurs prudents ont pris le pouvoir en 1784. Ils ont aboli le monopole du commerce avec l’Islande et le Finnmark et ont mis fin au villeinage au Danemark. Les réformateurs ont également encouragé les innovations agricoles, les enclos et les ventes de terres : deux tiers des agriculteurs danois sont devenus propriétaires-occupants, contre seulement 10 % au milieu du XVIIIe siècle (Henriksen 2006). La censure existait toujours, mais elle était relativement modérée et, en 1797, les droits de douane sur les importations ont été considérablement abaissés. Le Danemark était ce que l’on a appelé une « monarchie guidée par l’opinion ». Le roi était censé faire respecter la loi, résoudre les conflits et écouter le peuple. Dans des images saisissantes présentées par Bertrand de Jouvenel (1997 : 38), il devait être un rex comme Saint Louis, assis sous un chêne à Vincennes, rendant la justice à ses sujets, plutôt qu’un dux comme le général Bonaparte sur un cheval à Arcole, encourageant ses soldats. Il devait être un arbitre plutôt qu’un chef.
Mais que se passerait-il si et quand le pouvoir serait transféré du roi au peuple ? Comment éviter le règne despotique des foules et des démagogues ? C’est le problème auquel s’est attaqué Nikolaj F. S. Grundtvig (1783-1872), le libéral danois le plus influent du XIXe siècle. Il soutenait avant tout que l’opinion devait se former librement. La « monarchie guidée par l’opinion » devait être remplacée par une « démocratie guidée par l’opinion ». Admirateur de l’héritage nordique et traducteur du Heimskringla de Snorri Sturluson en danois, Grundtvig composa en 1832 un long poème sur la « mythologie nordique », dans lequel on trouve un célèbre couplet (2011a : 49) :
La liberté doit être notre mot d’ordre dans le Nord !
La liberté pour Loki comme pour Thor.
Loki et Thor faisaient tous deux partie des anciens dieux païens, les Ases ; Loki était un voyou et Thor un héros. Grundtvig mettait l’accent sur la nécessité de la liberté d’expression, également pour ceux qui ont des opinions impopulaires ou qui appartiennent à des minorités méprisées. Mais le message principal de son poème était que les Danois devaient réaffirmer leur identité en tant que nation nordique éprise de liberté. Grundtvig croyait également que pour un transfert réussi du pouvoir du roi au peuple, l’éducation était cruciale. Il fallait éduquer le peuple, non pas dans « l’école de la mort » – par laquelle Grundtvig entendait un lycée classique qui enseignait principalement des langues mortes, le latin et le grec – mais dans « l’école de la vie » qui enseignait la langue et l’histoire danoises aux gens ordinaires. Les étudiants y allaient pendant quelques mois, un an ou deux, sans examen final. Ils y apprendraient, comme le dit Grundtvig (2011b : 178-179), « la nature et la condition du peuple, du pays et de la langue maternelle, leur situation actuelle, leur amélioration et leur progrès naturels ».
La première école populaire grundtvigienne fut fondée en 1844. De telles écoles proliférèrent au Danemark après la défaite ignominieuse de ce pays en 1864 face à la Confédération germanique dans une guerre au sujet du Schleswig. Les Danois voulaient tourner la page sur une question qui avait jusque-là dominé leur politique. Pour un libéral, la question du Schleswig était néanmoins intrigante. Depuis le Moyen Âge, le roi danois était également duc de Schleswig et de Holstein. Contrairement au Schleswig, le Holstein faisait partie de la Confédération germanique et ses habitants parlaient presque tous l’allemand. C’était une région allemande incontestée. Au Schleswig, cependant, on parlait danois dans la partie nord et allemand dans la partie sud. Les nationalistes danois voulaient annexer l’ensemble du Schleswig au Danemark, ce qui signifierait que la moitié germanophone de la population serait forcée de devenir sujette au Danemark. Inversement, les nationalistes allemands voulaient s’emparer de l’ensemble du Schleswig, ce qui signifierait que la moitié danophone de la population serait forcée de devenir sujette à un État allemand. Ainsi, dans les deux cas, une minorité serait créée. Grundtvig voulait cependant diviser le Schleswig selon les souhaits de ses habitants.
« Le territoire du Danemark ne s’étend que dans la mesure où la langue est parlée, et certainement pas plus loin que les gens souhaitent parler danois, en d’autres termes, quelque part que personne ne connaît au milieu du duché de Schleswig » (2019a : 111).
Il a exprimé la même idée dans un poème (2019b : 230) :
Tous les membres d’un « peuple »
Ceux qui se considèrent comme tels,
Ceux dont la langue maternelle sonne le plus doux,
Et qui aiment beaucoup leur patrie.
La réponse de Grundtvig à la question de savoir ce qu’est un peuple (ou une nation) était simple : tous ceux qui veulent être membres du peuple. C’est la théorie libérale de la nationalité, réaffirmée plus tard au XIXe siècle par l’historien français Ernest Renan qui a observé que l’histoire, la langue et la localisation d’un groupe pouvaient toutes être importantes pour façonner son identité, mais qu’en fin de compte aucun de ces attributs ne déterminait pleinement ce qu’était une nation. Ce qui était crucial était la volonté du groupe de vivre ensemble sous la même loi, dans le même État. La nation était un plébiscite quotidien :
« Si des doutes surgissent au sujet des frontières nationales, il faut consulter la population de la zone en litige. Elle a le droit d’exprimer son opinion sur la question » (Renan 2004 : 19).
On fait parfois une distinction entre le nationalisme culturel, essentiellement une conscience nationale, et le nationalisme politique, la revendication d’un État-nation (Gellner 1983 ; Tamir 1993). Grundtvig n’était pas seulement un nationaliste culturel, mais aussi un nationaliste politique. En effet, les cinq pays nordiques sont tous des États-nations. Lorsque les Norvégiens se séparèrent de la Suède en 1905, c’était parce qu’ils s’identifiaient comme Norvégiens et non comme Suédois. Lorsque les Finlandais se séparèrent de la Russie en 1917, c’était parce qu’ils s’identifiaient comme Finlandais et non comme Russes. Lorsque les Islandais se séparèrent du Danemark en 1918, c’était parce qu’ils s’identifiaient comme Islandais et non comme Danois. Le problème de la population suédophone des îles Åland qui voulait rejoindre la Suède fut résolu par un arbitrage international et par l’octroi par la Finlande de l’autonomie aux insulaires tout en conservant leur souveraineté. Mais le nationalisme politique de Grundtvig n’était pas agressif, comme le montre sa position dans la question du Schleswig. Son nationalisme politique découlait de son nationalisme culturel, de l’appréciation de l’héritage culturel danois et, dans un sens plus large, nordique, sans aucun dénigrement des autres nations et des autres cultures. La grande réussite de Grundtvig fut d’articuler l’idée qu’un nationalisme tolérant et libéral était possible. Dans un discours de 1843, il s’exclama (Lundgreen-Nielsen 1997 : 91) :
« En faisant des conquêtes, toute nation noble perd bien plus qu’elle ne gagne, et en conquérant le monde, elle se perdrait elle-même. Elle peut cependant, dans des limites étroites et ignorée du monde, être parfaitement heureuse lorsqu’elle est autorisée à posséder la terre de ses pères en paix, à s’exprimer librement et à converser dans sa langue maternelle avec les grands comme avec les petits, les érudits comme les laïcs, sans offenser personne, en suivant ses inclinations et les impulsions de son cœur dans les grandes comme dans les petites choses, chez elle comme à l’étranger. »
Bien sûr, l’État a souvent été une force oppressive. Mais il peut aussi être une force d’expression, la manifestation d’une identité commune, si elle repose sur la volonté (d’une majorité non négligeable) des citoyens de vivre ensemble, comme l’envisageaient Grundtvig (et Renan). Grundtvig voyait l’État-nation comme un lieu de coopération volontaire, non seulement pour des bénéfices mutuels sur le marché, mais aussi dans les écoles privées, les congrégations indépendantes et divers collectifs et associations spontanés où les individus acquéraient un sens de l’objectif et de l’appartenance. « Le cas danois est intéressant parce qu’une forte identité nationale a émergé à la suite d’un processus partant de la base dans un pays libéral et en voie de démocratisation », observe Francis Fukuyama. « Cela n’aurait pas été possible sans le travail d’un prêtre luthérien, N. F. S. Grundtvig » (2015 : 42-43).
Grundtvig n’était pas seulement un leader spirituel, mais aussi un citoyen énergique et engagé, passionné et intransigeant. Il a eu trois enfants de sa première femme décédée en 1851, un enfant de sa deuxième femme décédée en 1854, et un autre à l’âge de 76 ans de sa troisième femme. Il fut un poète d’une immense production : sur les 791 hymnes du recueil de cantiques danois (2003), 253 sont de sa main, soit près d’un tiers. Il traduisit non seulement Heimskringla de Snorri Sturluson de l’islandais, mais aussi l’histoire du Danemark de Saxo Grammaticus du latin et Beowulf de l’anglo-saxon. Il fut pasteur d’une église de Copenhague de 1839 à 1872, et à partir de 1861, il reçut le titre honorifique d’évêque. On comptait parmi ses fidèles la reine du Danemark. Grundtvig participa activement à la politique danoise. En 1848, il fut élu à l’Assemblée constituante dont la tâche était de rédiger une constitution pour le Danemark après que le roi eut volontairement renoncé à son pouvoir absolu. Il siégea de 1849 à 1852 et de 1854 à 1858 à la chambre basse du parlement danois, où il fut très actif, mais pas toujours efficace. Il fut élu en 1866 à la Chambre haute où il tenta en vain de résister aux restrictions au suffrage : aucun groupe ne devait être exclu du processus démocratique, croyait-il.
Après la débâcle de 1864, l’influence de Grundtvig grandit. Les Danois ressentirent le besoin de se réaffirmer à l’intérieur de leurs frontières. Aidés par leur éducation dans les lycées populaires de Grundtvig, les agriculteurs formèrent des coopératives, fondées sur le gain mutuel. Lorsque les céréales bon marché d’Amérique du Nord inondaient les marchés européens, la réponse danoise ne fut pas le protectionnisme mais plutôt l’adaptation aux nouvelles conditions, en remplaçant les céréales par du bétail, le Danemark devenant un fournisseur majeur de fromage, de beurre et de porc. En « maintenant le libre-échange, les Danois adhérèrent à une tradition nationale de libéralisme, reflet d’une petite économie sans aucune ressource minérale nationale » (Henriksen 1993 : 156). Grundtvig a également été une source d’inspiration pour les entrepreneurs danois, comme Carl Frederik Tietgen, qui a fait ériger une statue à son effigie devant une église de Copenhague.
En Norvège, le prédicateur et entrepreneur charismatique Hans Nielsen Hauge était un autre enfant de l’esprit nordique, du travail acharné et de l’autonomie. Sans surprise, Grundtvig et Hauge s’estimaient mutuellement beaucoup (Dreyer 2021). En 1920, la proposition de Grundtvig de diviser le Schleswig selon la volonté des habitants a été mise en œuvre. La région a été divisée en trois zones électorales. La zone la plus au nord a voté à une écrasante majorité pour rejoindre le Danemark. La zone du milieu a voté à une écrasante majorité pour appartenir à l’Allemagne, et par la suite, il a été jugé inutile d’organiser un référendum dans la zone la plus au sud. Si les idées principales de Snorri Sturluson et d’Anders Chydenius – le gouvernement par consentement, le droit de rébellion, le libre-échange et la liberté intellectuelle – sont assez connues, la contribution de Grundtvig au libéralisme classique fut originale et unique : elle articula et encouragea la cohésion sociale au sein de l’État-nation.
5. Pourquoi la tradition libérale nordique a-t-elle prévalu
Dans les pays nordiques, comme ailleurs, différentes traditions rivalisaient. La tradition de la sécurité juridique, du libre-échange et de la cohésion sociale rivalisait avec une tradition d’absolutisme royal, de centralisation et de conquêtes militaires. Mais il se trouve que les deux principaux pays nordiques, la Suède (qui contrôlait la Finlande jusqu’en 1809) et le Danemark (qui contrôlait la Norvège jusqu’en 1814 et l’Islande jusqu’en 1918), ont subi des défaites humiliantes à l’étranger qu’ils ont cependant réussi à transformer en victoires à l’intérieur de leurs frontières en se redéfinissant : la Suède a perdu ses possessions baltes et la Finlande et le Danemark ont perdu la Norvège et le Schleswig. Les deux pays se sont tournés vers l’intérieur. Le commerce a pris le pas sur la conquête. C’est ce qu’a exprimé avec éloquence le poète suédois Esaias Tegnér en 1812, trois ans après la perte de la Finlande :
Led flodens böljor kring som tamda undersåter
[Guidez les vagues du fleuve comme des sujets complaisants]
och inom Sveriges gräns erövra Finland åter !
[et regagnez la Finlande à l’intérieur des frontières de la Suède!]
La première ligne faisait référence à la construction du grand canal de Göta dans le sud de la Suède alors en construction. Tegnér disait à ses compatriotes qu’ils devraient renoncer à tenter de conquérir des pays étrangers et plutôt soumettre la nature à l’intérieur des frontières de la Suède. Le poète danois Hans Peter Holst a exprimé une pensée similaire en 1872, huit ans après la perte du Schleswig :
For hvert et tab igen erstatning findes ;
[Chaque perte entraîne une compensation]
hvad udad tabes, det må indad vindes.
[ce qui est perdu à l’extérieur doit être regagné à l’intérieur.]
Sous des rois ambitieux, la Suède et le Danemark avaient tous deux cherché à devenir des puissances européennes importantes ; et les deux pays ont dû abandonner leurs rêves de gloire militaire qui se sont avérés être, pour leurs habitants, une bénédiction, et non une malédiction.
De nombreux spécialistes nordiques contemporains se sont concentrés sur les idées politiques anglo-saxonnes, négligeant leur propre tradition libérale, qui pourtant réaffirme parfois ses droits. Par exemple, lorsque les Suédois déposèrent le roi Gustave IV en 1809, ils agissaient conformément aux principes énoncés par le porte-parole de la loi Torgny dans son discours de 1018. Lorsqu’une assemblée constituante fut convoquée en Norvège en 1814, le principal auteur de la constitution, Christian Magnus Falsen, mentionna le récit de Snorri Sturluson sur le roi Haakon le Bon. Falsen pensait que les Norvégiens revenaient à leurs racines. Comme à l’époque du roi Haakon, la nouvelle Constitution conférait le pouvoir législatif au peuple (Castberg 1949 : 71). Au printemps 1848, une réunion publique à Copenhague exigea l’abolition de l’absolutisme. La résolution comprenait une menace à peine voilée : « Nous implorons Votre Majesté de ne pas pousser la nation à prendre des mesures désespérées » (Grundtvig 2019c : 19). Le roi s’empressa d’exaucer ses vœux. À l’automne 1863, les principaux ministres du gouvernement suédois rencontrèrent le roi Charles XV au palais d’Ulriksdal pour discuter du conflit du Schleswig. Le roi voulait soutenir les Danois si et quand les Allemands attaqueraient. La réunion se transforma en un échange houleux entre lui et le ministre des Finances Johan August Gripenstedt, un libéral convaincu, qui était contre toute aventure étrangère. Gripenstedt « alla jusqu’à mettre en garde le roi, en référence à la déposition de Gustave IV Adolphe, contre une initiative aussi mal conçue » (De Geer 1892 : 250). Tant à Copenhague en 1848 qu’au palais d’Ulriksdal en 1863, on pouvait entendre un écho pas si faible du discours du porte-parole de la loi Torgny.
On peut aussi affirmer que le passage relativement sans heurts à la démocratie dans les pays nordiques peut être attribué, au moins en partie, à la reconnaissance du principe de la destitution. La démocratie est, comme le soutient Popper (1945 : chap. 7, II), essentiellement un moyen pacifique de destituer ceux qui sont au pouvoir s’ils perdent le soutien du peuple, et constitue donc une continuation logique de la tradition nordique de destituer les rois (ou de menacer de le faire) s’ils ne respectent pas la « bonne vieille loi ». Mais la force et la résilience de la tradition libérale nordique sont peut-être mieux illustrées par le fait qu’elle a non seulement été capable de résister aux nombreuses tentatives des rois du passé d’accroître leur pouvoir en invoquant la grâce de Dieu, mais aussi aux tentatives des sociaux-démocrates du XXe siècle d’accroître leur pouvoir en invoquant la grâce du peuple. Les rois et les sociaux-démocrates ont bien sûr affirmé qu’ils défendaient l’intérêt public de manière désintéressée.
Le modèle libéral nordique n’a cependant pas seulement une importance historique. Il a des implications pratiques dans la troisième décennie du XXIe siècle. Le principe de modification des frontières par plébiscite ne pourrait-il pas être appliqué en Ukraine, comme il l’a été au Schleswig ? La communauté internationale ne devrait-elle pas faire pression sur la Chine pour qu’elle accepte la décision de 2013 d’un tribunal des Nations Unies sur la mer de Chine méridionale, comme la Suède et la Finlande ont accepté l’arbitrage international il y a un siècle dans un différend sur les îles Åland ? De même, la communauté internationale ne devrait-elle pas reconnaître le droit du Tibet et de Taiwan à se séparer de la Chine, comme la Norvège, la Finlande et l’Islande ont fait sécession de la Suède, de la Russie et du Danemark respectivement ? L’autonomie des îles Åland sous souveraineté finlandaise ne pourrait-elle pas servir de modèle aux territoires palestiniens sous souveraineté israélienne ? La coopération au sein du Conseil nordique, avec un abandon minimal de souveraineté des cinq pays nordiques, ne pourrait-elle pas servir de modèle à l’Union européenne, au lieu de tenter de construire une nouvelle superpuissance, les États-Unis d’Europe ? L’accent mis par Grundtvig sur l’éducation des citoyens pour qu’ils deviennent de bons citoyens pourrait peut-être aussi inspirer les pays en développement qui ne peuvent pas compter sur une longue tradition de sécurité juridique et de cohésion sociale. Snorri Sturluson, Anders Chydenius et Nikolaj F. S. Grundtvig, avec leurs idées sur le gouvernement par consentement, le libre-échange et l’intégration sociale au sein de l’État-nation, sont peut-être encore pertinents.
Références
Acton, Lord John E. E. (1985). “The History of Freedom in Christianity.” In: J. Rufus Fears (ed.), Selected Writings of Lord Acton, I. Indianapolis IN: Liberty Fund, 29–53. (Originally a lecture in 1877).
Ari Thorgilsson (2006). The Book of the Icelanders. London: the Viking Society for Northern Research. (Written ca. 1122–1133).
Birgir Th. Runolfsson [B. Solvason] (1993). “Institutional Evolution in the Icelandic Commonwealth,” Constitutional Political Economy, 4 (1): 97–125.
Castberg, Frede (1949). Norsk livssyn og samfunnsliv. Oslo: H. Aschehoug.
Chydenius, Anders (2012a). “The National Gain (1765).” In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 142–165.
Chydenius, Anders (2012b). “The Source of Our Country’s Weakness (1765)”. In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 124–138.
Anders Chydenius (2102c). “Report on the Freedom of Writing and Printing, 18 December 1765.” In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 228–233.
Chydenius, Anders (2012d). “Memorial on the Freedom of Printing (1765)”. In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 219–225.
Chydenius, Anders (2012e). “Memorial regarding Freedom of Religion (1779)”. In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 317–322.
Chydenius, Anders (2012f), “Autobiography submitted to the Society of Arts and Sciences in Gothenburg (1780).” In: Marin Jonasson and Pertti Hyttinen (eds.), Anticipating the Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803. London: Routledge, 331–350.
De Geer, Louis Gerard (1892). Minnen [Memoirs], I. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner.
Dreyer, Rasmus H.C. (2021). “Norges Grundtvig fylder 250 år” [Norway’s Grundtvig Celebrates his 250th Anniversary], Kristeligt Dagblad 29 August.
Fjalldal, Magnus (2013). “Beware of Kings: Heimskringla as Propaganda.” Scandinavian Studies, 85 (4): 455–68.
Friedman, David (1979). “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case,” Journal of Legal Studies, 8 (2): 399–415.
Fukuyama, Francis (2015). “Nation Building and State Building.” In: John A. Hall et al. (eds.), Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity. Montreal: McGill-Queens University Press, 29–50.
Gellner, Ernest (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.
Grundtvig, Nikolaj F. S. (2011a). “Nordic Mythology (1832).” In: Edward Broadbridge (ed.), The School for Life: N. F. S. Grundtvig on Education for the People. Aarhus: Aarhus University Press.
Grundtvig, Nikolaj F. S. (2011b). “To the Norwegians Concerning a Norwegian High School (1837).” In: Edward Broadbridge (ed.), The School for Life: N. F. S. Grundtvig on Education for the People. Aarhus: Aarhus University Press.
Grundtvig, Nikolaj F. S. (2019a). “Speech to the Schleswig Aid Society on 14 March 1848.” In: Edward Broadbridge (ed.), The Common Good: N. F. S. Grundtvig as Politician and Contemporary Historian. Aarhus: Aarhus University Press.
Grundtvig, Nikolaj F. S. (2019b). ‘“Of the people” is our watchword’ (Folkeligt skal alt nu være). In: Edward Broadbridge (ed.), The Common Good: N. F. S. Grundtvig as Politician and Contemporary Historian. Aarhus: Aarhus University Press.
Heckscher, Eli F. (1936). Ekonomisk-historiska studier. Stockholm: A. Bonnier.
Henriksen, Ingrid (1993). “The Transformation of Danish Agriculture 1870–1914.” In: Pedro Lains and Vicente Pinilla (eds.), The Economic Development of Denmark and Norway since 1870. Aldershot: Routledge.
Henriksen, Ingrid (2006). “An Economic History of Denmark,” EH.Net Encyclopedia, ed. Robert Whaples. http://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-denmark/
Herlitz, Nils (1939). Sweden: A Modern Democracy on Ancient Foundations. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
Hymnal (2003). Den danske salmebog. Copenhagen: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.
Jouvenel, Bertrand de (1997). Sovereignty. An Inquiry into the Political Good. Indianapolis IN: Liberty Fund. (Originally published in 1957).
Kurrild-Klitgaard, Peter (1998). “Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur “[Adam Smith and the Group Behind the Wealth of Nations], Libertas, 25, 5–14.
Lindal, Sigurdur (1981). “Early Democratic Traditions in the Nordic Countries”. In: E. Allardt et al. (eds.), Nordic Democracy. Copenhagen: Det danske Selskab, 15–43.
Lindal, Sigurdur (1993). “Law and Legislation in the Icelandic Commonwealth”, Scandinavian Studies in Law, 37: 53–92.
Lindal, Sigurdur (2007). “Stjornspeki Snorra Sturlusonar eins og hun birtist i Heimskringlu” [Snorri Sturluson’s Political Thought, as Expressed in Heimskringla], Ulfljotur, 60 (3): 651–732.
Locke, John (1764). Two Treatises of Government, ed. Thomas Hollis. London: A Millar et al. (Originally published in 1689).
Lundgreen-Nielsen, Flemming (1997). “Grundtvig as a Danish Contribution to World Culture,” Grundtvig Studier, 48 (1), 72–101. (Quoting a speech by Grundtvig on 14 April 1843).
Mill, John Stuart (1859). On Liberty. London: John W. Parker & Son.
Molesworth, Thomas (2011). An Account of Denmark, ed. Justin Champion. Indianapolis: Liberty Fund. (Originally published in 1694).
Montesquieu, Charles Louis de Secondat (2018). The Spirit of the Law. Indianapolis IN: Liberty Fund. (Originally published in 1648).
Norberg, Johan (2023). The Mirage of Swedish Socialism: The Economic History of a Welfare State. Vancouver BC: Fraser Institute.
Olsen, Bjorn M. (1904). “Landnama og Egils saga”, Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 2nd series, 19, 167-247.
Popper, Karl R. (1945). The Open Society and Its Enemies, I. London: George Routledge.
Popper, Karl R. (1963). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul.
Renan, Ernest (2004). “What is a Nation?” In: Homi K. Bhabha (ed.), Nation and Narration. New York: Routledge. (Originally a lecture in 1882).
Sachs, Jeffrey (2006). “Welfare States Beyond Ideology,” Scientific American, 295 (4), 42.
Samuelson, Paul (1973). Economics, 9th ed. New York: McGraw-Hill.
Sawyer, Birgit (2015). Heimskringla: An Interpretation. Tempe AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.
Schauman, Georg (1908). “Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.” Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
Snorri Sturluson (2014–2016). Heimskringla, vols. I–III. London: Viking Society for Northern Research. (Written ca. 1220–30).
Tamir, Yael (1993). Liberal Nationalism. Princeton NJ: Princeton University Press. Vinding Kruse, Frederik (1963). A Nordic Draft Code: A Draft Code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Copenhagen: Munksgaard.