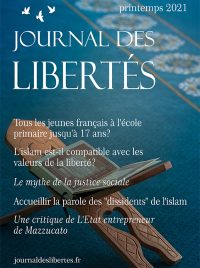Comme on le sait, Friedrich Hayek a écrit un livre remarquable, Droit, législation et liberté, et le titre du deuxième volume est Le mirage de la justice sociale. Friedrich Hayek explique de manière convaincante que l’expression « justice sociale » n’a pas de sens. Ainsi, il écrit dans la préface de ce volume :
« Démontrer qu’une expression universellement employée, et incorporant pour bien des gens une croyance quasi-religieuse, n’a absolument aucun contenu et ne sert qu’à insinuer qu’il nous faut consentir à ce que réclame un certain groupe, voilà qui est beaucoup plus difficile que de prouver qu’une conception est fausse. »
Friedrich Hayek réussit brillamment à démontrer de manière très rigoureuse l’inanité du concept de « justice sociale » et on peut penser que tout a été écrit par Friedrich Hayek et qu’il ne faut pas essayer de débattre de la justice sociale.
Nous ne critiquerons certainement pas ce qui a été écrit par lui, ni n’essaierons de résumer son livre. Mais nous pensons que ce sujet est si complexe et si important qu’il est peut-être possible d’ajouter quelques remarques à ce qui a été définitivement écrit par Friedrich Hayek.

Justice sociale, éthique universelle et éthique personnelle
Il est évident qu’il n’y a pas une seule définition de la « justice sociale ». Ce terme est très utilisé — en particulier en ce qui concerne les politiques publiques — mais souvent avec des significations implicites divergentes. Cependant, une chose est certaine : lorsqu’on parle de « justice sociale », tout le monde l’interprète à juste titre comme un concept éthique. Par conséquent, afin de mieux comprendre sa signification, il peut être utile de commencer par une approche plus générale, à savoir examiner ce que l’on entend exactement par « éthique ». De ce point de vue, il semble tout à fait justifié de faire une distinction fondamentale entre deux types d’éthique qu’il nous semble utile de qualifier d’ « éthique universelle » et d’ « éthique personnelle ».
L’éthique universelle n’est malheureusement pas universellement reconnue à notre époque et peut-être devrions-nous l’appeler « éthique universalisable ». Elle peut être définie comme un ensemble de principes moraux qui sont potentiellement acceptables pour tous les individus du monde sans qu’il puisse y avoir de contradictions et de conflits entre les actions des uns et des autres. Il semble donc qu’une seule définition de l’éthique universelle soit possible, à savoir le respect des droits légitimes des individus, c’est-à-dire leurs droits sur leur propre personne et les droits de propriété qu’ils ont légitimement obtenus.
En ce qui concerne l’éthique personnelle, elle consiste pour chacun, par exemple, à choisir avec qui on veut être altruiste et comment on veut se comporter envers les autres. Dans la mesure où il n’est évidemment pas possible d’être altruiste avec tous les gens du monde, chacun doit choisir avec qui il veut être altruiste et sous quelles formes. Par conséquent chacun choisit simultanément d’exclure d’autres personnes de ses activités altruistes (ou « égalitaires »). Ainsi, si un individu préfère aider ses enfants plutôt que d’aider une personne qui vit misérablement parce qu’elle ne veut pas travailler et/ou parce qu’elle préfère vivre aux dépens des autres, pourquoi une politique visant à réduire les « inégalités » exigerait-elle que cet individu fasse les choix qu’il ne souhaite pas ? Cette politique crée de nouvelles inégalités entre ceux qui considèrent que cette politique est respectueuse de leur moralité personnelle et ceux qui n’en sont pas d’accord.
Cette distinction entre éthique universelle et éthique personnelle permet de comprendre ce que l’on entend par « justice sociale ». En fait, il existe deux définitions très différentes de la « justice sociale ». La première concerne l’éthique universelle, à savoir le respect des droits individuels. D’autre part, l’éthique personnelle inspire la seconde définition de la « justice sociale » : elle consiste à comparer la situation réelle des individus et à décider subjectivement que les différences sont justes ou non. Cette deuxième définition est la plus largement acceptée et, généralement, lorsqu’on parle de « justice sociale », les gens se soucient principalement des revenus monétaires des individus et éventuellement de la valeur monétaire de leurs patrimoines. Selon un jugement personnel — plus ou moins partagé par un grand nombre de personnes — on considère que les différences entre les revenus ou patrimoines individuels doivent être plus ou moins diminuées. Maintenant, certaines caractéristiques des deux définitions doivent être clarifiées afin d’avoir une analyse rigoureuse de ce problème.
Considérons d’abord la première définition de la justice sociale qui est en fait une simple application de l’éthique universelle. Nous venons de mentionner qu’elle signifie que les droits individuels sont respectés par tous. Mais il ne suffit pas de se soucier du respect des droits, car les droits individuels doivent être fondés sur l’éthique pour qu’une situation respectueuse des droits soit justifiée sur le plan éthique. En fait, supposons qu’il existe une société dans laquelle la plupart des biens ont été obtenus au moyen de vols ; il est évident que, dans un tel cas, il n’y a aucune justification au respect des droits de propriété ! Cela signifie qu’il est important de déterminer dans quels cas les droits de propriété sont légitimes.
Le principe de base de l’éthique consiste à affirmer que les individus sont libres, ce qui signifie qu’ils ne sont pas soumis à la contrainte d’autres personnes, c’est-à-dire qu’ils sont propriétaires d’eux-mêmes. Mais on n’est pas son propre propriétaire si jamais on n’est pas propriétaire des biens et des services qu’on crée en utilisant son esprit et ses activités physiques. Il faut donc considérer que les droits de propriété légitimes sont ceux qui sont obtenus par des actes de création (et, évidemment, par l’échange de biens et de services qui ont été créés par les partenaires dans l’échange).
Ainsi, la première définition de la justice sociale peut potentiellement être acceptée par tous les individus dans le monde entier (du moins si les gens s’accordent sur la légitimité des droits de propriété).
De l’immoralité des politiques de redistribution
Mais, en ce qui concerne la deuxième définition de la justice sociale — à savoir une comparaison du niveau de vie des individus dans une société — chaque individu a une définition différente de ce qu’il considère comme socialement juste. Il y a donc un problème très important, à savoir la cohérence entre ces différentes opinions. Comme, très probablement, tous les individus ont des opinions différentes sur la « solidarité », il ne peut y avoir de critère « universel » de ce qui est considéré comme « justice sociale », c’est-à-dire la répartition équitable des ressources. On suppose alors que la justice sociale dans la répartition des revenus ou des patrimoines peut être définie par une majorité de voix dans un système démocratique. De nos jours, lorsqu’on parle de justice sociale, on entend implicitement par là la solidarité ou plutôt les activités de redistribution (politique sociale), ce qui renvoie au deuxième sens de la justice sociale. On suppose implicitement que la justice sociale implique une réduction des inégalités. Dans le terme « égalité » ou « inégalité », il y a un jugement de valeur implicite. C’est pourquoi on considère la réduction des inégalités comme une politique moralement justifiée.
Les libéraux sont souvent critiques à l’égard des politiques égalitaires, de sorte qu’on prétend souvent qu’ils favorisent l’égoïsme et que le libéralisme doit être remis en question pour des raisons éthiques. Mais les êtres humains se caractérisent par leur diversité et c’est pourquoi il faut, d’une part, parler de diversité plutôt que d’inégalité et, d’autre part, être respectueux de cette diversité inhérente à la nature humaine. Le terme d’inégalité serait justifié si le sort de tous les individus — et en particulier leur niveau de vie — était déterminé par une autorité centrale possédant toutes les ressources et capable de les « distribuer » plus ou moins « également ». Mais ce n’est pas le cas — heureusement — dans une société libre et c’est pourquoi l’expression « redistribution des revenus » est totalement trompeuse.
Cependant, contrairement à ce que l’on prétend souvent, le libéralisme ne soutient pas la liberté de chacun de faire quoi que ce soit, mais la liberté d’agir dans le respect des droits légitimes d’autrui. Cette liberté d’agir implique la liberté de mettre en œuvre sa propre éthique personnelle, mais seulement si elle est légitime et si elle est respectueuse de l’éthique universelle. C’est le cas si une personne qui détient des droits de propriété légitimes sur certaines ressources utilise une partie de ces ressources pour aider une autre personne ; ses actes sont alors conformes à sa morale personnelle sans porter atteinte à la morale universelle. Ce comportement est totalement moral et respectable. Mais quelqu’un qui vole des biens à une personne pour donner son butin à une autre personne — parce que sa morale personnelle l’incite à aider cette dernière — viole les droits de propriété de la première personne et donc la morale universelle.
Or, c’est exactement la même chose qui existe avec les « politiques d’inégalités » : les hommes d’État (politiciens et bureaucrates) prélèvent, grâce à la contrainte, des ressources auprès de certaines personnes (appelées citoyens) pour les donner à d’autres. Ce faisant, ils portent atteinte à l’éthique universelle et nous devons donc accepter l’idée qu’une politique visant à réduire les « inégalités » est en principe immorale. Si les hommes d’État utilisent leur monopole de la contrainte légale de telle sorte que cette contrainte soit légale, elle est cependant immorale puisqu’elle constitue une atteinte aux droits de propriété légitimes (et c’est pourquoi il faut considérer comme un devoir moral de réduire les impôts autant que possible). Il se peut qu’en agissant ainsi certains hommes d’État tentent de mettre en œuvre leur propre moralité personnelle, mais de toute façon ils portent atteinte à la morale universelle. D’autre part, il est bien connu que, ce faisant, ils poursuivent souvent des objectifs personnels : ainsi, pour être élus ou réélus, ils transfèrent des ressources à un grand nombre d’électeurs aux dépens d’une minorité. C’est pour cette raison que l’impôt progressif – immoral et inégal par nature – existe. Et le fait que les hommes d’État soient élus par une majorité d’électeurs ne leur donne pas de légitimité puisqu’on peut toujours trouver une majorité pour violer les droits légitimes d’une minorité dans la mesure où l’exercice de la contrainte légale est possible.
De plus, l’égalité est définie arbitrairement à partir d’un seul critère, à savoir le revenu à un moment donné. Or les objectifs des individus sont variés (ils ne concernent pas seulement les revenus monétaires), leur âge est différent et donc leur expérience et leur capital (qui sont des sources de leurs revenus). Imaginons que tous les individus soient identiques, il y aurait cependant une inégalité des revenus en fonction de l’âge de chacun.
Bien sûr, certains sont victimes de handicaps physiques ou mentaux et l’histoire de l’humanité montre que la charité a toujours existé dans de tels cas. Cette charité, décidée personnellement par chaque individu, correspond à une morale personnelle et elle est extrêmement respectable, contrairement à la charité dite publique (qui est d’ailleurs entachée de perspectives électorales et qui conduit donc à de nouvelles inégalités entre ceux qui arrivent ainsi au pouvoir – prétendant prendre en charge la pauvreté – et ceux qui doivent subir des choix publics).
Pourquoi le libéralisme est humaniste et crée une dynamique vertueuse
Soulignons encore une fois qu’il est totalement faux de prétendre que les libéraux prônent l’égoïsme puisqu’ils ne sont pas d’accord avec les politiques égalitaires. Ils sont respectueux de tous les êtres humains — riches ou pauvres, jeunes ou vieux, etc. — et ils respectent une morale profondément universelle mais aussi toutes les morales personnelles tant qu’elles restent compatibles avec la morale universelle. Et c’est pourquoi il n’est pas faux de dire non seulement que le libéralisme est humaniste, mais même que seul le libéralisme est un humanisme. Au fond, les libéraux ont confiance dans les capacités des individus au lieu d’essayer de les manipuler comme on le ferait avec une machine. Ils savent que les individus sont capables de générosité et aussi qu’ils sont capables, si nécessaire, d’inventer des processus pour apporter du secours aux autres. C’est le cas, par exemple, des activités d’assurance qui aident les victimes de certains événements malheureux à bénéficier d’une indemnisation. On pourrait, dans cette perspective, imaginer que, dans une société où il n’y aurait pas de politique égalitariste, les parents obtiennent une assurance avant même la naissance de leurs enfants pour leur permettre de vivre décemment même s’ils souffrent d’un handicap physique ou mental qui les empêcherait d’obtenir ce qui est nécessaire pour leurs besoins.
C’est donc pour des raisons morales qu’il faut se montrer critique à l’égard des politiques égalitaristes. Mais il y a aussi des raisons utilitaires. Ainsi, si un salaire minimum est rendu obligatoire par la loi dans un pays, il est censé permettre à tous les employés de recevoir au moins le même salaire. Mais la conséquence est qu’il exclut certains individus — surtout les plus jeunes — du marché du travail et les empêche d’améliorer leur vie grâce à leurs propres efforts et aux connaissances qu’ils pourraient sinon accumuler. C’est aussi une soi-disant préoccupation d’égalitarisme qui est donnée pour justifier un fort impôt progressif sur le revenu. Mais cette politique « inégale » a pour conséquence de punir et de décourager ceux qui sont les plus innovants, les plus travailleurs, les plus aptes à prendre des risques. Il en résulte l’existence d’obstacles au progrès économique, ce qui est préjudiciable pour tous. Et cette politique pousse également à l’exil certains individus qui en sont particulièrement victimes, ce qui est aussi la création d’une inégalité entre les individus.
Prenons aussi le cas des droits de succession. On suppose assez souvent qu’il n’est pas « juste » que certaines personnes obtiennent plus de ressources que d’autres grâce à l’héritage et qu’il est juste de redistribuer ce qu’elles ont ainsi obtenu. Supposons que deux individus, Jacques et Martin, aient gagné exactement le même montant de revenus tout au long de leur vie, qu’ils meurent au même âge et qu’ils aient exactement le même nombre d’enfants qui reçoivent un héritage de leur part. Mais supposons par ailleurs que Jacques ait constamment accepté le sacrifice de consommer moins que ses revenus pour accumuler un capital et le transmettre à ses enfants après sa mort, alors que Martin a préféré obtenir plus de satisfactions en consommant toutes les ressources correspondant à ses revenus. Tous deux auront payé le même montant d’impôts de leur vivant, au moins en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, bien qu’il puisse y avoir une sur-taxation du capital (ce qui est en particulier le cas en France). Il n’est certainement pas juste que les droits de succession impliquent que tout au long de leur vie et après, les ressources gagnées par Jacques soient plus taxées que celles gagnées par Martin. Une fois de plus, une politique de « justice sociale » crée une injustice très importante.
Prendre en compte la source des inégalités
L’idée qu’il existe des inégalités insupportables — par exemple dans la répartition des revenus ou de l’héritage — provient d’une formidable confusion entre un concept purement statistique et un concept moral. La notion même de répartition des revenus ou des richesses est vide de sens dans la mesure où quelqu’un ne peut redistribuer que ce qui lui appartient. Les revenus et les richesses existent dans la mesure où ils sont créés, et ils ne sont créés que dans la mesure où ils sont possédés. Les disparités statistiques ne sont donc que le reflet de la disparité des capacités et des préférences des individus. En d’autres termes, la dispersion statistique (en termes de revenus ou de richesses) n’est rien d’autre que le résultat de l’activité humaine.
Certes, les individus sont égaux en droits (droit à la liberté et donc droit de posséder les fruits de ses activités), mais ils ne sont pas identiques et c’est cette diversité qui crée la solidarité entre eux. Un individu est fondamentalement un être social, car il nourrit sa diversité avec celle des autres. L’individualisme, souvent critiqué comme préconisant le repli sur soi, repose au contraire sur la reconnaissance des liens sociaux entre les individus, car il met l’accent sur le caractère unique de chaque individu, ainsi que sur son égale dignité. Et cela n’exclut pas, bien sûr, les actes de générosité volontaire : la persistance des liens familiaux à travers l’histoire et les civilisations en est le témoignage le plus frappant.
Cependant, dès que l’on accepte de modifier les résultats des activités individuelles, on porte atteinte à ce qui est la source de ces activités, c’est-à-dire les droits individuels. Une politique de transferts obligatoires, sous prétexte d’égaliser les résultats de l’activité humaine, consiste à prendre de force les ressources de ceux qui les ont créées pour les donner à ceux qui ne les ont pas créées. Contrairement à ce qui se passe dans le cas du don volontaire ou de l’échange, où les deux partenaires sont gagnants, dans le transfert forcé il y a un gagnant et un perdant et aucun test ne permettra de dire s’il y a un « gain social » : l’évaluation de ce transfert est purement subjective et personne ne peut démontrer que la lutte contre les inégalités (statistiques) est une amélioration. Ainsi, une politique de réduction des inégalités signifie nécessairement l’introduction de l’arbitraire dans les relations entre les personnes.
Les sociétés modernes, celles qui ont permis au plus grand nombre de personnes d’accéder aux ressources matérielles, à la culture ou à la santé, sont des sociétés complexes où chacun joue un rôle spécifique et bénéficie, par l’échange, des activités des autres. Le miracle de l’échange est qu’il est créateur de valeur pour les deux partenaires : il n’y a pas un simple transfert de valeur, il n’y a pas un jeu à somme nulle, il y a création de richesse. Dans un échange libre, il y a égalité entre la valeur marchande de ce qui est vendu et de ce qui est acheté (je vends 10 euros de tomates contre 10 euros de blé). Et pourtant, ce que j’achète a plus de valeur pour moi que ce que je vends. Ce que chacun de nous cherche, dans ses rapports avec les autres, c’est une inégalité de valeurs subjectives. Et on ne peut atteindre ses propres objectifs, incommunicables aux autres, que parce que les individus ne sont pas les mêmes, parce qu’ils n’ont pas les mêmes échelles de valeur, ils sont inégaux du point de vue de leurs capacités, de leurs préférences, de leurs informations. L’être humain tire sa spécificité et même sa dignité de ses différences.
Justice de résultat et justice procédurale
Selon la conception classique du Droit, et comme l’a remarquablement expliqué Friedrich Hayek, l’égalité en droit entre les individus implique qu’une règle soit générale — c’est-à-dire qu’elle n’impose pas un résultat spécifique — soit universelle — c’est-à-dire que tous les citoyens soient égaux devant le Droit — et soit certaine. Avec le Droit ainsi défini — souvent invoqué, mais aussi souvent mal compris — personne ne peut savoir à l’avance quel sera le résultat précis de l’application des règles générales (par exemple, la règle selon laquelle « le contrat est la loi des participants »). Or, la revendication habituelle d’égalité est une revendication de résultat (concernant par exemple les revenus des citoyens) et elle est incompatible avec cette conception de la justice. Si le jeu spontané des activités humaines selon des règles générales et universelles ne conduit pas au résultat souhaité par ceux qui monopolisent le pouvoir de contrainte, leur intervention détruit le caractère général, universel et certain du Droit qui est le fondement d’une société libre.
Pour prendre un exemple simple, qui pourrait oser prétendre qu’il est moralement justifié de prendre de l’argent à un individu qui a courageusement travaillé pour le donner à un individu paresseux ? Et ne faut-il pas reconnaître honnêtement que la progressivité d’un impôt est injuste parce qu’elle échappe à l’universalité qui devrait caractériser une règle de justice ? Loin de créer une « égalité » entre les personnes, la progressivité introduit des discriminations entre elles et elle est injuste. Elle empêche les citoyens d’être « égaux devant la loi ». Les gouvernements de nombreux pays — développés ou moins développés, socialistes ou conservateurs — ont assez récemment réduit la progressivité de l’impôt sur le revenu pour des raisons d’efficacité, qui sont évidentes. Mais il faut aller plus loin et reconnaître son caractère profondément immoral (l’inefficacité de la progressivité n’est qu’une conséquence logique de son immoralité). Il est également clair qu’un impôt progressif n’existe que parce que, dans un système basé sur l’absolutisme démocratique, c’est-à-dire en fait sur la tyrannie de la majorité, il est toujours possible de trouver une majorité pour opprimer une minorité et de réaliser des transferts par la force sous prétexte de « réduire les inégalités ».
Les conséquences indésirables de la poursuite de l’égalité des revenus
Dans une société basée sur le libre-échange, celui qui « possède » le plus est celui qui a créé le plus de valeur pour les autres. Ce n’est plus le cas dans une société basée sur la contrainte et les inégalités de ressources sont en partie le produit de processus arbitraires. Un cercle vicieux peut alors se développer : les inégalités étant moins fondées sur l’exercice des droits individuels, elles apparaissent plus arbitraires et plus susceptibles d’être modifiées par la contrainte.
La notion d’égalité des résultats est réductrice : elle est évaluée, par exemple, par les revenus monétaires. Cependant, si un individu préfère vivre modestement à la campagne en admirant la nature, au lieu de travailler continuellement pour obtenir le revenu que ses capacités lui permettraient d’obtenir, il sera considéré comme « défavorisé » du point de vue du critère statistique de la répartition des revenus monétaires et d’autres individus seront éventuellement contraints de lui transférer des ressources. Mais pourquoi n’est-il pas obligé de transférer à d’autres personnes une partie des « privilèges » dont il bénéficie du fait de sa vie agréable ? Parce que c’est plus difficile, ce qui signifie qu’une politique d’égalité est très réductrice par rapport à la subtilité des choix faits dans chaque vie humaine. Et si jamais l’égalité des niveaux de vie était obtenue — ce qui est le rêve des utopistes égalitaires — elle conduirait évidemment au totalitarisme. Il n’y a en fait aucune différence logique entre la revendication d’une plus grande égalité (des résultats) et la revendication éventuelle d’une société plus totalitaire.
Les inégalités de revenu : de précieux signaux
Dans les sociétés complexes que nous connaissons, comment orienter les gens vers les emplois où ils sont le plus utiles aux autres ? Par le système de rémunération et, plus généralement, par toutes les caractéristiques d’un emploi : prestige, attractivité, sécurité, etc. En essayant d’égaliser certaines de ces caractéristiques — par exemple les revenus ou les patrimoines —on ne prend en compte qu’une partie d’un ensemble très complexe de choix et de relations. Et si tous les membres d’une société étaient exactement dans les mêmes conditions, quels que soient leurs efforts, leurs mérites, leurs capacités, non seulement ils ne seraient plus incités à faire des choix qui profiteraient le plus à eux-mêmes et aux autres, mais même le plus généreux d’entre eux n’aurait pas les moyens de savoir lesquelles de ses actions sont les plus profitables aux autres. L’inégalité ne signifie donc pas que certains font des profits au détriment des autres, mais au contraire qu’ils fournissent des services aux autres. En ce sens, les inégalités sont « demandées », elles sont même la condition de la coopération sociale entre les personnes.
La justice de résultat conduit à l’arbitraire et au totalitarisme
Mais, on peut dire qu’il n’est pas nécessaire, lorsqu’on parle d’inégalité, de monter de force vers des conditions de vie totalement égales pour tous. Mais quelle est la définition de ce qui est tolérable dans la voie du totalitarisme ? Chaque personne a sa propre définition, de sorte que le degré d’inégalité tolérable est nécessairement déterminé par l’équilibre des pouvoirs. Alors que le libre-échange et le don gratuit sont de nature pacifique, la péréquation des ressources est nécessairement « violente ». Elle implique que certaines personnes peuvent imposer à d’autres leur conception du niveau tolérable de totalitarisme. Et la violence n’est pas moins violente parce qu’elle est légale.
Un individu a suffisamment conscience des exigences de sa propre nature pour condamner spontanément les vols, car il s’agit d’une atteinte à la liberté d’action des individus. Comment un vol pourrait-il devenir légitime parce qu’il est légalisé par des procédures arbitraires — par exemple la règle de la décision majoritaire — au nom d’une certaine conception de l’égalité ? Même le thème de l’inégalité n’est en fait rien d’autre que l’expression de la tyrannie démocratique. Il s’agit de prétendre que certaines personnes ont des droits sur le travail des autres au-delà de ce qu’elles souhaitent donner ou échanger. Quel est le fondement éthique de cette incroyable revendication ? Il n’y en a aucun.
L’obsession de l’égalité devient destructrice de la civilisation et il n’est pas surprenant que les révolutions en faveur de l’égalité aient conduit aux pires inégalités, celles issues de l’inégalité de pouvoir : l’enrichissement par l’exploitation des autres remplace l’enrichissement par le service des autres. Il y a deux façons de se différencier des autres, mais l’une est nuisible, l’autre non. Cela signifie qu’il est absurde de regarder le résultat du jeu social, au lieu de regarder le processus et de se demander si certains ont la possibilité d’en voler d’autres légalement.
L’effondrement du socialisme partout dans le monde n’est pas surprenant. Alors que sa légitimité provenait essentiellement de ses exigences d’égalité, il ne pouvait exister que grâce à l’arbitraire et à la tyrannie, c’est-à-dire en créant des inégalités en ce qui concerne les règles de droit. Et quand on apprend que tel ou tel pays se convertit au libéralisme, cela signifie qu’il y avait une incohérence dans le système existant qui était si profonde qu’elle est devenue forcément intolérable.
La seule véritable inégalité est celle qui existe entre ceux qui vivent grâce à leurs propres efforts et ceux qui vivent grâce à la contrainte, qu’elle soit légalisée ou non. C’est le drame essentiel de notre époque. A travers la violence d’État, nous revenons à une situation de lutte de tous contre tous. La soi-disant lutte contre l’inégalité a créé un monde arbitraire, sans règles, sans respect de l’autre, une énorme machine à détruire les gens, même, et peut-être surtout, les plus courageux, les plus honnêtes, les plus généreux. La véritable inégalité qui existe c’est le droit inégal à la liberté.