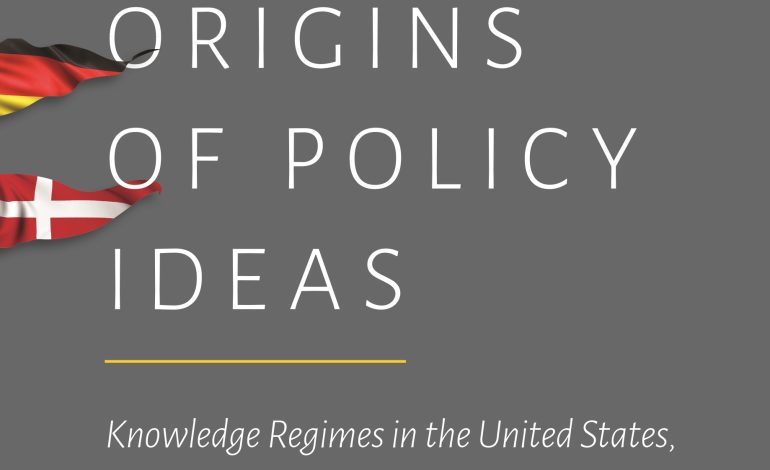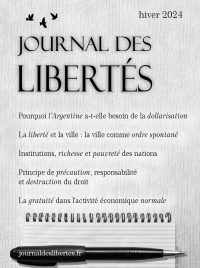Note de l’auteur : En dépit de nos mises en garde, très isolées dans le monde des juristes, la Charte de l’environnement a été consacrée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 et elle appartient depuis lors au « bloc de constitutionnalité » au même titre, entre autres, que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Nous avons choisi de reproduire sans modification le texte qui suit qui date de 2004 –Recueil Dalloz, n° 14, 1er avril 2004, pp. 970-972 – qui conserve malheureusement toute son actualité.

L’essentiel
Le gouvernement a adopté le 25 juin 2003 en conseil des ministres le projet de loi constitutionnelle sur la Charte de l’environnement. Ce projet s’appuie sur le rapport de la Commission Coppens, mise en place par le ministre de l’Écologie. Il modifie le Préambule de la Constitution de la Ve République en ajoutant aux droits de l’homme de 1789 et aux principes économiques et sociaux de 1946 les droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement. Il est permis de se demander si cette charte, loin de faire progresser le droit de l’environnement, ne mine pas le Droit.
A la suite de son discours d’Orléans du 3 mai 2001, Jacques Chirac a proposé le 18 mars 2002 dans son discours d’Avranches d’inscrire le droit de l’environnement dans une charte adossée à la Constitution de la Ve République « aux côtés des droits de l’homme et des droits économiques et sociaux ». Le 2 septembre, il n’a pas hésité à déclarer lors du sommet de Johannesburg : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il a accepté la désignation par le Premier ministre d’un ministre de l’Écologie et du « Développement durable ». Ce dernier a demandé au professeur Coppens du Collège de France d’animer la réflexion et la consultation qui devaient aboutir à une Charte de l’environnement.
La Commission Coppens était composée de dix-huit membres, dont seulement deux juristes. Il est vrai qu’elle était notamment assistée d’un comité juridique, qui semble avoir joué un rôle non négligeable. A la suite d’une gestation de neuf mois, la Commission a adopté un texte, de manière consensuelle pour une bonne part. C’est en réalité le « principe » de précaution qui a concentré les débats. Les assises territoriales de la Charte de l’environnement, au nombre de dix au début de l’année 2003, ont entendu être un lieu de dialogue « démocratique », mais elles ont pesé d’un poids tout relatif sur les membres de la Commission et ont essentiellement rempli un objectif publicitaire. Les juristes associés à la réflexion de la Commission ont eu pour leur part la volonté de ne pas mettre le constituant en porte-à-faux par rapport aux textes internationaux existants. Ils ont souhaité inscrire des objectifs à valeur constitutionnelle plutôt que des droits, afin d’éviter de donner trop de pouvoir au Conseil constitutionnel et de dessaisir en conséquence le Parlement. Ils ont pesé pour redéfinir le principe de précaution et pour en faire un principe procédural, tout en le distinguant de celui de prévention.
Le 15 avril 2003, le ministre de l’Environnement a présenté le projet de Charte au Conseil des ministres. Le gouvernement a adopté le 25 juin le projet de loi constitutionnelle sur la Charte de l’environnement. Le texte de la Commission a été intégré et modifié sur plusieurs points notables. Plus nerveux, le projet n’en est pas pour autant moins dangereux. Il modifie le Préambule de la Constitution (I) et promeut une Charte de l’environnement (II).
I – La modification du Préambule de la Constitution
Conformément aux vœux du rapport Coppens, l’article 1er du projet de loi constitutionnelle modifie le Préambule de la Constitution in limine en indiquant que le peuple français proclame solennellement son attachement « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2003 ». Il porte en son sein la thématique dangereuse des faux droits (A) et des faux devoirs (B).
A – Les faux droits
Le projet adosse aux droits de l’homme de 1789 et à ceux de 1946 de nouveaux droits définis en 2003 et relatifs à l’environnement. Il s’agirait de la première modification des droits fondamentaux depuis la fin de la dernière guerre mondiale, alors que traditionnellement ce type de réforme suit un changement de régime. Il prolonge ainsi les atteintes continues à la Constitution depuis plusieurs années. Il ne s’agit pas de signifier que cette dernière serait intouchable mais que, au lieu de la modifier point par point, il serait préférable de poser clairement la question de son devenir et d’éviter des réformes impressionnistes ou hypocrites. Il est fort révélateur que d’aucuns fassent si peu de cas de la loi fondamentale laquelle, à l’image des lois ordinaires, se trouve partiellement bouleversée de manière périodique. Il est piquant de relever qu’un président considéré comme gaulliste fasse subir tous les outrages au texte fondateur fortement inspiré par de Gaulle.
La Charte promeut de nouveaux droits. Qui pourrait critiquer de prime abord le droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé, comme le proclame l’article 1er de la Charte ? Contrairement au rapport de la Commission, le projet a entendu reprendre la forme même de la Déclaration de 1789. Toutefois, bien que l’expression de « droit à » ne soit pas employée, le projet ne proclame pas, mais invente un « droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé ». Il s’agit bien et explicitement d’un droit de créance. Or,
« parler de droits là où ce dont il s’agit n’est fait que d’aspirations qui ne peuvent être satisfaites en dehors d’un système motivant les volontés, c’est non seulement détourner l’attention des seules sources effectives de la richesse souhaitée à tous, mais encore dévaloriser le mot de “droit”, alors que maintenir le terme dans son sens strict est de la plus haute importance, si nous voulons sauvegarder l’avenir d’une société libre. »[1]
En ce sens, parler de « droit à » est tout à la fois absurde, car seul le prétendu titulaire de ce droit est connu et jamais celui sur qui pèserait l’obligation corrélative, et dangereux, parce que les prétendus droits-créances aboutissent à diluer les droits-libertés[2].
Le projet crée explicitement une troisième génération de droits de l’homme, après la consécration des droits individuels du XVIIIe et celle des droits économiques et sociaux du XXe. Cette troisième génération ne serait que le développement, au moins partiel, de la seconde. Comme la précédente, elle vise à limiter les droits de la première. Or, la consécration des faux droits mine le Droit et, comme la monnaie, chasse les vrais droits. Ces droits, inventés et non pas proclamés, marquent un recul des droits de l’homme au profit des droits de l’État. Le projet ne se contente malheureusement pas d’inventer des faux droits, il entend consacrer également des faux devoirs.
B – Les faux devoirs
Le projet prévoit que le Préambule de la Constitution fasse explicitement référence aux devoirs définis dans la Charte de l’environnement. L’article 2 de cette dernière dispose effectivement que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Le rapport Coppens prétendait d’ailleurs que les devoirs venaient immédiatement après les droits dans une symétrie aussi forte que possible, car ils ne se concevaient pas les uns sans les autres. Or, ce qui est symétrique aux droits, ce sont les obligations, et certainement pas les devoirs. Lorsqu’une personne détient un droit – un vrai droit… –, les autres individus ont l’obligation de le respecter. La sphère du Droit et la sphère de la morale restent distinctes. Il est révélateur que le rapport, qui se veut « progressiste », use du vocabulaire des contre-révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Après avoir promu de faux droits, le projet entend imposer des faux devoirs. Or, si l’individu a des devoirs, il lui appartient de les définir, quitte à en supporter la responsabilité ; il n’appartient pas à l’État de les lui imposer, sauf à faire régner un ordre moral.
Si l’article 1er du projet modifie cursivement le Préambule de la Constitution, son article 2 contient des dispositions sans commune mesure plus longues, à savoir la Charte de l’environnement.
II – La Charte de l’environnement
La Commission Coppens s’est divisée sur la question du « principe » de précaution. Aussi a-t-elle choisi de proposer deux variantes de son texte à cet égard : l’une qui ne faisait pas référence à quelque principe que ce soit, l’autre qui consacrait d’une part le principe de précaution, distingué de celui de prévention, et d’autre part le principe pollueur-payeur. Même si le président de la République a pesé de tout son poids pour que des principes soient établis, le projet ne consacre que le principe de précaution dans son article 5, tandis que son article 3 se contente de faire référence à une prévention et que son article 4 se borne à viser la réparation des dommages causés à l’environnement. Or, la Charte méconnaît les mécanismes de l’action humaine et bouleverse les fondements du Droit en portant atteinte aux caractères nécessaires tant du risque (A) que de la responsabilité (B).
A – Le risque nécessaire
Le principe de précaution revient à admettre que les générations futures disposent de droits sur les générations actuelles et que conséquemment celles-ci ont une responsabilité collective à leur égard. Responsabilité qui, bien entendu, ne peut être organisée et exercée que par l’intervention de l’État. Or, à la base du principe de précaution, se trouve une démarche malthusienne, guidée par une conception animiste de la nature[3]. Malthus entendait déjà démontrer au début du XIXe siècle que la catastrophe se préparait : à la progression géométrique de la population ne pouvait répondre qu’une progression arithmétique des ressources. Un courant s’est formé aux Etats-Unis dans les années 1960 pour prôner la croissance zéro. Il estimait qu’une croissance trop rapide et mal orientée, une industrialisation forcenée et un emballement technologique provoquaient l’aliénation de l’homme, l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles. Si bien que seul l’arrêt de la croissance permettait de préserver la planète d’une irrémédiable pollution. Commandé par le Club de Rome, le rapport du MIT de 1972 sur les limites de la croissance était sous-intitulé de manière révélatrice : « Halte à la croissance ». Il mettait en lumière l’épuisement des ressources naturelles, la pénurie de nourriture, l’effondrement de la production industrielle privée d’énergie et de matières premières, et ce à partir du milieu des années 1980 pour culminer au début des années 2020. Or, imaginer qu’il suffise de s’abstenir d’agir pour éviter toute prise de risque est d’autant plus naïf que le fait même de ne pas agir conduit à prendre d’autres risques[4].
La civilisation passe par des prises de risque raisonnées, encadrées par le droit de la responsabilité dont le rôle est d’inciter les individus à faire preuve de prudence. Le principe de précaution va malheureusement au-delà de la prudence : là où il existe le moindre doute, il entend empêcher les individus d’agir. Un exemple souvent utilisé par certains écologistes américains démontre par l’absurde l’inanité de ce principe : si l’homme avait dû réfléchir aux risques qu’il prenait en dominant le feu, il n’aurait pas quitté la préhistoire. Le même exemple est applicable pour toutes les inventions. Si l’individu avait dû réfléchir aux risques qu’il prenait en inventant et en développant les avions ou les véhicules automobiles, le fabuleux progrès connu au XXe siècle n’aurait jamais existé. Avec le principe de précaution, loin d’être spontanément ouvert à l’exploration de l’avenir, l’individu se trouve enfermé dans l’immobilisme. En effet, le principe de précaution n’admet l’expérimentation qu’à la condition que soit garantie l’absence d’échec possible. Or, imaginer que l’expérimentation garantisse l’absence d’échec est là encore naïf. Tout essai implique nécessairement un risque d’échec, alors que le principe de précaution présuppose qu’il serait possible d’apprendre et de découvrir sans encourir ce risque[5].
Une telle conception est empreinte de primitivisme épistémologique. La découverte scientifique, comme toute découverte intellectuelle, est un processus d’essais et d’erreurs, de conjectures et de réfutations. Le principe de précaution conduit à la négation du libre arbitre dans la mesure où ce n’est plus la conscience qui préside à la prise de risque, mais l’application de critères et de règles imposés en fonction de l’idée que l’État se fera du savoir scientifique. Une telle idéologie pernicieuse est sous-jacente dans le point 5 du Préambule de la Charte qui prétend que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles. Elle se retrouve dans l’article 6 de la Charte qui dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » et que, à cet effet, elles prennent en compte et concilient, d’une part, la protection et la mise en valeur de l’environnement, d’autre part, le développement économique et social. En conséquence, dispose l’article 9, « la recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement ». Au nom d’un risque non prouvé, l’État va interdire ; paradoxalement, ce sera à la liberté d’apporter la preuve qu’elle n’est pas coupable. Les conséquences d’une telle conception sont aisées à concevoir. A l’inflation d’interdictions succédera une inflation d’impôts et une instabilité juridique arbitrée par un État tutélaire au nom d’une prétendue vision à long terme. Or, le risque est nécessaire ; mais il appelle corrélativement la responsabilité.
B – La responsabilité nécessaire
La Commission Coppens avait consacré dans l’une des variantes de son texte le principe pollueur-payeur. Une telle consécration laissait circonspect. S’il s’agissait du principe selon lequel chaque individu était responsable des dommages qu’il occasionnait, il ne pouvait qu’être approuvé. Mais il était permis de se demander quel était l’intérêt de consacrer un principe qui était inscrit dans le marbre de la loi depuis au moins 1804, et plus précisément dans le célèbre article 1382 du code civil [devenu l’article 1240 du code civil en 2016]. En revanche, s’il s’agissait de consacrer un principe de responsabilité collective, il ne pouvait qu’être rejeté fermement. La Charte évince finalement ce principe pour préciser dans son article 4 :
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. »
Il est là encore difficile de comprendre l’intérêt d’une telle disposition qui fait redondance avec les principes ancestraux du droit civil, si ce n’est que dorénavant, au lieu d’être définie de manière prétorienne, la réparation des dommages sera l’office du législateur !
Quant au principe de précaution, il tue le droit de la responsabilité. Pour savoir qui est responsable d’un dommage, le droit interrompt à un moment donné la chaîne des responsabilités. A cette fin, il dispose d’un critère, qui est celui de la faute. Or, le principe de précaution remplace l’ancestrale responsabilité individuelle par une responsabilité collective et fait retour à une conception primitive de la responsabilité. Pour prendre un exemple, le droit français considère, comme tous les droits civilisés, que celui qui a intentionnellement tué à l’aide d’un pistolet un individu est coupable. L’individu qui lui a légalement vendu cette arme ne l’est pas, pas plus que ne l’est l’inventeur du pistolet ou celui de la poudre à canon. Pour prendre un autre exemple, l’automobiliste ivre qui cause un grave accident est responsable. Pas celui qui lui a légalement vendu la boisson qu’il a ingurgitée, pas plus que le fabricant de la boisson, encore moins son inventeur ! Avec le principe de précaution, le droit perd sa fonction fondamentale de cohésion pour devenir un instrument de politisation généralisée de la société. En l’absence du critère moral de la faute, c’est aux politiques qu’il appartiendra de désigner à la vindicte publique le coupable. En présence d’une victime, l’homme politique débonnaire désignera le bouc-émissaire et prévoira le mécanisme qui aboutira à sa punition au nom des générations futures.
Le projet va contribuer à pervertir le terme de responsabilité dans la logique d’un processus de pollution intellectuelle et de pervertissement des principes fondamentaux de la civilisation. En effet, les conséquences de l’adoption de la Charte de l’environnement seront loin d’être anodines. Il s’agit explicitement de permettre au Conseil constitutionnel, dans les cas de conflits de droits, de rééquilibrer ces derniers en fonction des textes, autrement dit de brimer les droits de 1789 par une nouvelle génération de droits. Il s’agit explicitement de consacrer le caractère liberticide du droit de l’environnement tel qu’il est prôné par quelques intégristes et d’accepter à cet égard l’aspect antagoniste des politiques environnementales, ce qui explique la promotion des prétendus devoirs. Bref, il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher entre des droits contradictoires, en réalité de les concilier puisqu’ils seront de même valeur, au même titre que les droits de 1789 ne sont ni supérieurs ni inférieurs à ceux proclamés en 1946 selon la jurisprudence de la rue de Montpensier. Le dossier d’information pour la préparation de la Charte indiquait d’ailleurs très clairement qu’il s’agissait de promouvoir le droit de l’homme à un environnement sain et de le placer au même niveau que les droits précédemment proclamés, et notamment le droit de propriété. Les droits et les principes, explicitement à portée universelle, proclamés par la Charte de l’environnement entendent faire de la France un exemple tant au niveau communautaire qu’au niveau mondial. Dans cette surenchère de droits et de devoirs établis par les différents textes internationaux et onusiens, les autorités françaises entendent une nouvelle fois se placer au premier rang, conformément aux termes de l’article 10 du texte.
La Charte de l’environnement n’est rien moins qu’une pollution juridique et scientifique. Mais elle sera également une pollution culturelle. La Commission Coppens entendait en effet promouvoir une « éco-citoyenneté » et inciter l’État à intégrer dans les programmes scolaires et universitaires, de même que dans la formation initiale et continue des enseignants, la prise de conscience et les initiatives nécessaires à une meilleure gestion de l’environnement. L’article 8 de la Charte dispose en continuité que « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs » définis par le texte. Il s’agit en bref, avec la vision centralisatrice propre à l’Éducation nationale française, de faire de la propagande pour former de bons et honnêtes citoyens. De tout le texte, cette disposition est peut-être la plus inquiétante.
[1] F. A. Hayek, Droit, législation et liberté. Une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie politique. Vol. 2 : Le mirage de la justice sociale, trad. Raoul Audouin, PUF, 2e éd., 1986, appendice au chapitre 9, p.127.
[2] J.-P. Feldman, « Bastiat, précurseur de Hayek ? Essai sur la proclamation des principes libéraux et leur dévoiement par le processus de socialisation », Journal des économistes et des études humaines, vol. 6, n° 4, déc. 1995, p. 621-654 ; « Hayek’s Critique of the Universal Declaration of Human Rights », loc. cit., vol. 9, n° 4, déc. 1999, p. 529-539.
[3] H. Lepage, « Vache folle et principe de précaution : la fin du règne du droit, » Liberté économique et progrès social, n° 93, avr. 2001, p. 3.
[4] Loc. cit., p. 7.
[5] Loc. cit., p. 9.