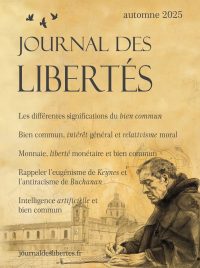Le droit est une ordination de la raison au bien commun…
Thomas d’Aquin
Pour expliquer les multiples sens de l’expression « bien commun » au sein d’une communauté politique, la distinction établie par le politologue Michael Oakeshott entre associations d’entreprise et associations civiles est utile[1].
- Les membres d’une association d’entreprise partageant un but, une tâche ou un objectif commun.
- Une association civile, en revanche, désigne des relations régies par des règles entre des personnes libres et égales, ces règles précisant des responsabilités communes plutôt que des tâches, des fins ou des objectifs communs.
Ces deux types d’association n’ont pas la même vision du bien commun.
- Une association d’entreprise est un groupe, et un groupe est une entité noétique et morale. Son unité et sa réalité résident dans la connaissance et le choix par ses membres de la fin, du but ou de la tâche du groupe. Les équipes, les clubs, les organisations fraternelles et les corporations sont des exemples d’associations d’entreprise. Les membres d’une association d’entreprise coordonnent leurs actions afin d’atteindre une fin déterminée. Une fin déterminée est l’objet d’une finalité humaine dont les caractéristiques identifiables peuvent être utilisées pour définir les actions appropriées et inappropriées pour la réalisation de cette fin. En tant que membre d’une association d’entreprise, chacun subordonne sa conduite à la fin déterminée de celle-là. Cette fin, ce but, cette finalité ou cette tâche constitue son bien commun.
- Une association civile n’est pas un groupe. Son unité ou sa réalité ne viennent pas d’un choix délibéré de ses membres. La finalité d’une telle association est procédurale. La fonction d’une fin procédurale est de définir les conditions dans lesquelles la poursuite de fins déterminées se fera, mais elle ne précise pas quelles seront ces fins, ni quand ni comment elles seront réalisées. Les membres d’une association civile subordonnent donc leurs actes aux conditions définies par la fin procédurale de l’association. L’établissement et le maintien de ces conditions constituent leur bien commun.

Deux traditions bien différentes
Dans la tradition aristotélicienne-thomiste, le droit positif établit et maintient le bien commun au sein d’une communauté politique. Or, comme cette tradition conçoit généralement la communauté politique comme une association d’entreprise, le bien commun y est souvent considéré comme une finalité. Aujourd’hui, les communautaristes, les conservateurs et les libéraux contemporains (au sens américain du terme) adoptent une approche similaire dans leur conception du bien commun d’une communauté politique. Les noms d’Alasdair MacIntyre, John Finnis, Charles Taylor, Martha Nussbaum et Amartya Sen nous viennent à l’esprit. Leur commune acception du bien commun, qui relève d’une association d’entreprise, est largement partagée.
En revanche, selon Oakeshott, toute communauté politique étant une association civile, sa notion du bien commun serait surtout procédurale. Le bien commun établit les conditions dans lesquelles les formes spécifiques d’activité humaine peuvent se dérouler[2]. Ces conditions doivent être aussi ouvertes que possible pour permettre justement à chacun de poursuivre les fins qu’il se sera données. Cette conception procédurale du bien commun est souvent associée à la tradition libérale classique.
Cependant, puisque, au-delà de l’intérêt commun, nous parlons ici du bien commun, la dimension éthique est essentielle. Que la fin d’une association soit opérationnelle ou procédurale, quel est le fondement éthique de la fin qu’un ordre politico-juridique cherche à établir et à maintenir ? Il y a différentes façons d’aborder cette question, et nous n’avons pas le temps ici de toutes les examiner. Concentrons-nous donc, et encore très brièvement, sur la comparaison entre l’approche de la tradition aristotélicienne-thomiste (telle qu’elle est généralement enseignée) et l’approche néo-aristotélicienne développée dans nos travaux précédents.
Ces deux approches partagent le principe que le bien humain sert de référence à tout jugement éthique, compris en termes de telos humain, lui-même assimilé à l’épanouissement personnel (human flourishing) ou au perfectionnement personnel (self-perfection). Fondement éthique ultime, ce bien humain détermine le bien commun de la communauté politique. Pour autant, l’interprétation du bien commun varie considérablement d’une approche à l’autre :
- La tradition aristotélicienne-thomiste assimile généralement la communauté politique à une association d’entreprise. Lié à sa finalité, le bien commun favorise l’épanouissement humain ou le perfectionnement personnel. Sans nier ni les problèmes pratiques ni les limites de ce que peut accomplir le droit positif, une telle association doit chercher à favoriser l’épanouissement humain ou, du moins, créer les conditions qui lui sont favorables. Ces conditions impliquent tous les biens génériques qui favorisent l’épanouissement de chacun : la santé, le savoir, la richesse, l’amitié, la vertu… Fournir effectivement de tels biens déterminerait la capacité d’une communauté politique à servir le bien commun. Certes ces biens ne sont pas l’objectif explicite de l’ordre politique ou juridique, mais cet ordre peut se confondre avec leur réalisation concrète. Ainsi, le bien commun consiste-t-il à créer les conditions nécessaires à l’épanouissement des êtres humains. Et le droit positif, toujours suivant cette tradition, doit aider l’individu à se comporter en être moral, c’est-à-dire, à s’ épanouir et à se perfectionner. Gouverner s’identifie alors à l’art de façonner les âmes : Statecraft is soulcraft !
- Notre approche néo-aristotélicienne conçoit, au contraire, la communauté politique comme une association civile. Nous accordons au bien commun une fin procédurale. Gouverner n’est pas l’art de façonner les âmes, et le droit positif ne doit pas dicter à chacun ni son comportement moral ni comment s’épanouir. Il en est ainsi pour quatre raisons fondamentales :
- Le lien entre ce que la morale exige et ce qui est requis par le droit positif n’est ni direct ni isomorphe. Non pour une simple raison pratique, mais parce qu’il existe une différence de principe entre les exigences de justice moralement contraignantes et celles qui sont et moralement et légalement contraignantes. Contrairement à la règle morale, le droit positif recourt in fine à la contrainte physique, ou la menace de celle-ci. On ne peut donc pas simplement présumer que ce que l’éthique exige ou interdit soit aussi exigé ou interdit par la loi. Sémantiquement, le premier n’équivaut pas au second, ni ne l’entraîne.
- L’épanouissement personnel n’est jamais abstrait ni impersonnel ; mais plutôt individualisée et personnelle. Bien que l’on puisse énumérer de manière abstraite les biens génériques qui permettent l’épanouissement, ceux-ci ne deviennent réels, déterminés et précieux que par l’exercice de la sagesse pratique de chacun. Aucune recette universelle ne convient à tous ; c’est plutôt la sagesse pratique de chacun qui lui permet de trouver le chemin de son épanouissement personnel. L’épanouissement personnel et le perfectionnement personnel échappent donc au bien commun que pourrait imposer une loi[3].
- La sagesse pratique consiste en l’exercice soigné de la raison pratique ; or la raison pratique n’est pas automatique ; elle mobilise la volonté de l’individu. Sans cette autonomie[4], il ne peut y avoir aucune sagesse pratique, et sans sagesse pratique, aucun des biens génériques évoqués ci-dessus ne peut caractériser l’épanouissement personnel. L’épanouissement personnel ne devient opérationnel et efficace que s’il résulte d’un engagement personnel. Ainsi, comme le note l’aristotélicien John Cooper : « Pour Aristote, l’épanouissement humain est nécessairement le fruit d’efforts personnels ; le succès, quel qu’il soit, n’est un épanouissement que s’il résulte d’un effort.[5]» L’épanouissement personnel ne peut être ce qu’il est sans engagement de l’intéressé. Conditionner son épanouissement paralyse l’individu et sape sa capacité à choisir et donc à être moralement bon[6].
- L’épanouissement humain est enfin profondément social. Il requiert un potentiel d’altruisme. La philia (amitié), souligne Aristote, est l’une des composantes de l’épanouissement humain[7]. Nous ne sommes ni des individus abstraits ni des atomes isolés ; et c’est donc une profonde erreur d’imaginer que des individus atteindraient leur maturité et s’épanouiraient dans leur coin sans rejoindre la société ni s’intéresser à ce qui s’y passe. De plus, la socialité ne se limite pas au groupe restreint de ses proches ; elle doit s’ouvrir à l’universel, à n’importe quel autre être humain. Les gens s’ouvrent aux autres, même à ceux dont ils ne partagent pas initialement les valeurs. La socialité est plus vaste et plus variée que ne le pensent les critiques conservateurs ou communautaristes du libéralisme classique. On ne peut nier que les sociétés les plus vastes, ouvertes et diversifiées sont le fruit de l’ingéniosité et de l’habileté ce ceux qui ont su s’ouvrir à autrui. De fait, comme l’observait Aristote, l’humain est le plus social des animaux car il possède le logos[8]. La socialité humaine ne se limite donc pas à la polis ; elle est souvent cosmopolite. Enfin, n’est-il pas artificiel d’opposer l’éthique individuelle à l’éthique sociale ? Le véritable défi est de s’épanouir avec et parmi les autres – même, et souvent parmi des inconnus.
Vers une nouvelle synthèse aristotélicienne ?
Utiliser le droit positif pour favoriser l’épanouissement humain revient non seulement à méconnaître le caractère individuel, autonome et social de cet épanouissement, mais à en méconnaître le fondement légitime. Il s’agit d’une faille fondamentale de la tradition politique aristotélicienne-thomiste, du moins telle qu’elle est généralement conçue[9].
Ces quatre raisons fondamentales suggèrent que l’ordre politico-juridique fondé sur des principes éthiques, peut résoudre ce que l’on pourrait appeler « le problème de la compossibilité »[10]. Puisque nous sommes des êtres sociaux et que l’épanouissement humain est individualisé, nous avons besoin d’un principe qui nous laisse une liberté dans le choix des personnes avec lesquelles nous désirons nous associer. Il en est ainsi parce que nous avons besoin d’espace pour trouver des partenaires adaptés à nos formes d’épanouissement respectives, mais aussi parce que, dans cette même logique, nous devons admettre que l’épanouissement de chaque individu lui est propre. Chacun est moralement responsable et, à ce titre, le liberté d’action doit être protégée afin que chacun puisse utiliser sa raison pratique pour façonner son propre épanouissement. En résumé, l’épanouissement humain est individuel mais il ne s’accomplit qu’avec et parmi les autres : l’individualité comme la socialité doivent être reconnues dans leur dimension morale.
Quelques mots pour conclure
Une communauté politique pourrait-elle combiner différentes formes, individuelles mais sociales, d’épanouissement humain ? Comment la compossibilité sera-t-elle réalisée ? Sur quelle éthique l’ordre politico-juridique pourrait-il s’appuyer sans exiger dans ses principes qu’une forme d’épanouissement humain soit sacrifiée à d’autres ?
Résoudre le problème de la compossibilité est une nécessité éthique, mais avant de s’y atteler il faut noter que la préoccupation éthique s’est à présent déplacée car on s’interroge sur ce qui, au sein du bien commun d’une communauté politique diverse, rendrait plusieurs formes d’épanouissement compatibles entre elles. C’est une nouvelle perspective que permet notre approche néo-aristotélicienne, en dépassant la tradition thomiste. Car, pour une communauté politique, le bien commun ne se résume plus à une fin déterminée ; il doit résulter d’un processus encadré par des règles. Comme indiqué précédemment, ces règles procédurales définissent les conditions dans lesquelles la poursuite de fins déterminées se fera, sans préciser ce que seront ces fins, ni quand ni comment elles seront réalisées. Nous sommes à la recherche d’une norme éthique qui n’indique pas comment bien « jouer le jeu moral », mais qui établit les règles à respecter si l’on désire participer à ce jeu moral. Nous avons baptisé cette norme procédurale une « méta-norme », et nous avons expliqué pourquoi les droits fondamentaux, négatifs et naturels des individus à la vie, à la liberté et à la propriété établissent la méta-norme qui permet précisément de résoudre notre problème.
Ainsi, les droits individuels protègent la liberté pour chacun de conduire sa vie comme il l’entend, interdisant tout usage ou menace d’user d’une quelconque forme de contrainte physique. Ces droits protègent ainsi cette caractéristique de l’épanouissement humain sans laquelle il ne saurait être épanouissement humain : l’autonomie. Caractéristique commune à tout épanouissement personnel, cette autonomie contribue aussi à permettre cette compossibilité. C’est pourquoi les droits individuels sont la solution au problème de compossibilité. Respecter ces droits c’est opter pour un régime politique de liberté.
Ayant décrit et défendu ces droits dans nos différents ouvrages, il n’est pas nécessaire d’approfondir ici. Ces droits fonctionnent permettent de comprendre et d’instaurer le droit positif d’une communauté politique débouchant, par exemple, sur une constitution qui puisse intégrer par la suite des questions non prévues par ses fondateurs[11].
Pour conclure nous reprendrons quelques mots d’un auteur crédité et critiqué pour sa défense des fondements de la liberté ; auteur qui décrit précisément ce que signifie le bien commun d’une communauté politique dans la tradition libérale classique :
Un système social ne peut légitimement se préoccuper que de principes abstraits. Un système social ne peut imposer aucun bien particulier à un homme ni le contraindre à le rechercher : il ne peut que maintenir des conditions d’existence qui laissent chacun libre de le rechercher. Un gouvernement ne peut pas vivre la vie d’un homme ; il ne peut que protéger sa liberté. Il ne peut pas prescrire de choses concrètes, il ne peut pas dire à l’homme comment travailler, que produire, qu’acheter, que dire, qu’écrire, quelles valeurs rechercher, quelle forme de bonheur poursuivre – il ne peut qu’inscrire de tels choix dans son droit. . . C’est en ce sens que « le bien commun » . . . ne réside pas dans ce que font les hommes lorsqu’ils sont libres, mais dans le fait qu’ils sont libres[12][13].
[1] NDT : 1/ les intertitres sont de la rédaction ; 2/ nous choisissons de traduire « enterprise association » par « association d’entreprise ». « Association en vue d’entreprendre », « organisation » ou tout simplement « entreprise » étaient également des choix possibles. Ce que les auteurs entendent par « enterprise association » est en tous les cas sans ambiguïté.
[2] S’agissant d’activités menées par des individus ou par des entreprises ; il s’agit donc là de la « société civile ».
[3] Dans « Ethics, Flourishing and Liberty présenté à la Société du Mont-Pèlerin le 23 septembre 2024 à New Delhi, nous soutenions que toute tentative visant à fournir des biens génériques – l’approche dite des capabilités de Nussbaum et Sen – semble incapable de penser sinon en termes de biens génériques ; et que ces biens existeraient indépendamment de tout choix et de toute réflexion. En bref, ces biens seraient « à consommer directement » plutôt que choisis par l’exercice de la sagesse pratique. Pour approfondir ce point de vue, voir: « Liberalism in Retreat », The Review of Metaphysics 62.4 (juin 2009) : 875-908 ; « Retreat from Liberalism : Human Capabilities and Public Reasoning », Journal des économistes et des études humaines 15.1 (2009) : 1-25, co-écrit. Disponible sur : http://www.bepress.com/jeeh/vol15/iss1/art1 ; et « Rights and Capabilities », Law, Liberty, Morality and Rights, dir. Tomasz Gizbert-Studnicki (Cracovie: Wolters Kluwer Polska, 2010), in Actes du 23ème Congrès mondial IVR de philosophie du droit et de philosophie sociale (1er – 6 août 2007, Cracovie, Pologne), 312-327.
[4] NDT: nous traduisons par « autonomie » le mot « self-direction » qui est central à leur théorie. Les auteurs précisent dans l’un de leurs ouvrages que la “self-direction” est simplement « l’acte d’appliquer son jugement et sa raison sur son environnement, avec l’intention d’agir en conformité avec eux. Cela peut déboucher sur une conduite appropriée ou qui ne l’est pas. » (Norms of Liberty, p. 89).
[5] John Cooper, Reason and Human Good in Aristotle (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1975), p. 124.
[6] Au surplus, une telle contrainte est incompatible avec l’unité et la réalité des groupes humains.
[7] Voir notre discussion sur les familles, les clans, les tribus et les nations dans « The Polis and Rights », Reason Papers : 218-221 ainsi que notre discussion sur l’amitié dans Liberty and Nature, pp. 173-219.
[8] Aristote, Politics in The Basic Works of Aristotle, ed. R. McKeon and trans. Benjamin Jowett (New York: Random House, 1968),1253 a7-10.
[9] Il n’est pas évident qu’une fois distingués les différents contextes d’utilisation du « bien commun » – c’est-à-dire les contextes éthique, social, politique, métaphysique et théologique – la vision thomiste s’oppose vraiment à notre vision néo-aristotélicienne. Il en est pour la pensée aristotélicienne. Fred D. Miller, Jr. relève chez Aristote l’ambiguïté de sa « polis » : « La polis – en tant que société – prépare une vie vertueuse et heureuse, s’ensuit-il pour autant que la polis – en tant qu’État – doive forcer les citoyens à être vertueux et heureux ? » Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 360. Voir aussi pp. 27-66 et 357-366.
[10] Ce problème n’est pas un corollaire du choix libéral ; il tient au caractère hautement individualisé et profondément social de l’épanouissement humain. Nous l’avons appelé « le problème de la diversité politique intégrée » ; et parce que le libéralisme a été la seule tradition politique à en saisir l’importance, nous l’avons également appelé « le problème du libéralisme » montrant ainsi que les libéraux le connaissent, l’assument et tentent de le résoudre.
[11] Approche développée dans Tibor R. Machan : « Dissolving the Public Goods Problem: Financing Government Without Coercive Measures » The Libertarian Reader, Totowa, NJ.: Rowman & Allanheld, 1982, pp. 201-208.
[12] Ayn Rand, « From My ‘Future File’, » The Ayn Rand Letter 3.26 (September 23, 1974): 4–5 (nous avons ajouté les premiers italliques).
[13] [NDT : notre traduction.]
[*] Cet essai est basé sur une conférence donnée à l’Université d’été d’Aix-en-Provence, en France, le 11 juillet 2025, parrainée par l’Institute for Economic Studies – Europe. Il utilise, avec de légères modifications, des éléments tirés des ouvrages suivants : Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order (La Salle, IL : Open Court, 1991) ; Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics (University Park : Pennsylvania State University Press, 2005) ; The Perfectionist Turn: From Metanorms to Metaethics (Édimbourg : Edinburgh University Press, 2016) ; The Realist Turn: Repositioning Liberalism (Palgrave Macmillan, 2020) ; « The Myth of Atomism », The Review of Metaphysics 59.4 (juin 2006) : 843–70 ; et « The Polis and Rights », Reason Papers 43.1 (printemps 2023) : 215-231.