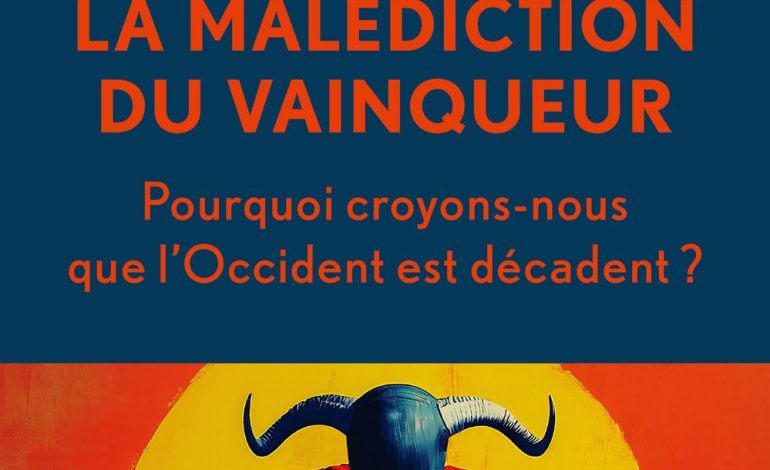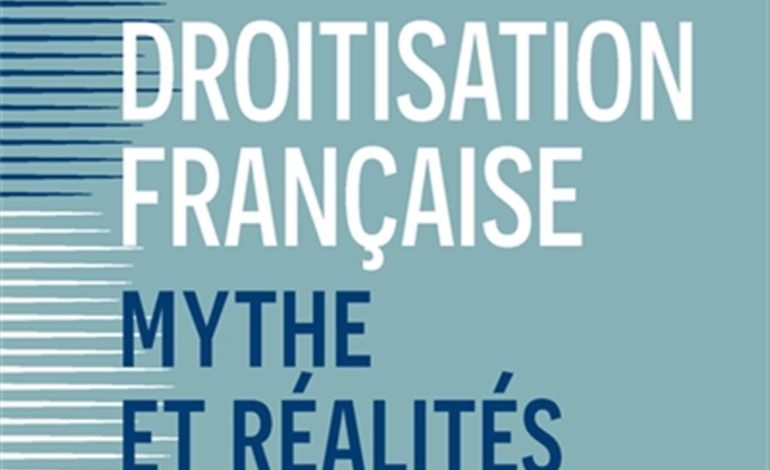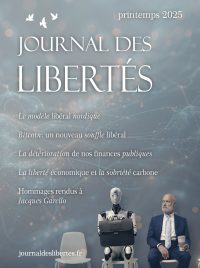Classiques Garnier, Paris, 2024, 1312 p. Édition variorum
Jean-Baptiste Say (1767-1832) est sans conteste l’un des principaux auteurs de l’économie politique. Il était déjà très célèbre de son vivant, tant en France qu’à l’étranger, probablement en raison de l’importante « loi des débouchés » que l’on appelle aussi : loi de Say dans la littérature.
Pour autant, ni l’histoire personnelle, ni les engagements, ni l’importante production littéraire, théâtrale, morale ou philosophique de ce grand auteur n’avaient, jusqu’à présent, autant retenu l’attention que ses travaux économiques.
Ce fut en l’an 2000 que le Centre Auguste & Léon Walras de Lyon décida d’entreprendre la première édition complète des œuvres de Jean-Baptiste Say et de rassembler la quasi-totalité du corpus laissé par cet auteur : textes publiés, correspondances, pièces inédites ou inachevées etc.[1]

Le projet éditorial des Œuvres complètes de J.-B. Say[2]
Le Traité d’économie politique de J.-B. Say est sans doute son ouvrage le plus largement diffusé. Il couvrait un vaste champ disciplinaire (valeur, monnaie, production, répartition, consommation, fiscalité, institutions financières etc.). Édité cinq fois du vivant de l’auteur (entre 1803 et 1826), ce texte fut souvent modifié par l’auteur de son vivant. Il fut refondu et complété « sur les manuscrits qu’il a laissés » et augmenté des notes de son fils Horace Say dans une sixième édition post mortem parue à Paris chez l’éditeur Guillaumin en 1841. Publié chez Economica en 2006, le premier volume de cette édition des Œuvres complètes établit les variantes de ce grand classique, avec moult références et un appareil critique.
Le Cours complet d’économie politique pratique, version rédigée des leçons de J-B. Say au Conservatoire des Arts et Métiers, données de 1820 jusqu’à sa mort en 1832[3], parut en six tomes chez l’éditeur parisien Rapilly, entre 1828 et 1829. De nombreuses versions-pirates de cet ouvrage furent contrefaites à l’étranger, notamment à Bruxelles à partir de 1832. Une seconde édition de ce Cours, complété par « les manuscrits laissés par l’auteur à son fils Horace Say », fut publiée chez Guillaumin en 1841. Horace Say y ajouta des compléments posthumes et ses propres notes. Le volume II des Œuvres complètes de J.-B. Say, deux tomes publiés chez Economica en 2009, établit les variantes de ce long texte, suivant la même méthode que l’édition du Traité.
Imprimé en 2020 par les Éditions Garnier, le Catéchisme d’économie politique (initialement paru à Paris en 1815), ainsi que des Lettres à M. Malthus & Divers Opuscules constituent le volume III de cette édition. Édité chez Economica en 2002, le volume IV des Œuvres complètes de J.B. Say collationnait des Leçons d’économie politique données à l’Athénée de Paris, au Conservatoire des Arts & Métiers et au Collège de France, cours presque inédits jusqu’à présent.
Le volume V des Œuvres complètes comprend divers imprimés réunis par les éditeurs sous le titre : Œuvres morales & politiques, ainsi qu’un manuscrit inachevé sur la « Politique pratique ». Ce volume est paru en 2003 chez Economica. En préparation, le volume VI devrait reproduire de nombreux comptes-rendus et critiques artistiques, politiques ou philosophiques donnés par J.-B. Say à La Décade jusqu’en 1807 ainsi qu’à La Revue encyclopédique.
Paru en mai 2024 chez Garnier, quelques mois avant la parution du volume VIII qui justifie cette chronique, le volume VII : Notes & pièces diverses, rassemble un corpus d’écrits et d’annotations économiques, organisé en deux tomes : des inédits économiques et financiers (tome premier) ; ainsi que de multiples annotations portées en marge des livres issus de la bibliothèque personnelle de J.-B. Say, que l’équipe éditoriale a pu retrouver (tome 2).
Face cachée de cette œuvre
Au-delà de ses travaux d’économie et de sciences politiques, Jean-Baptiste Say eut d’autres talents : il fut employé de banque, agent d’affaires, entrepreneur et l’éditeur de La Décade qu’il fonda en 1794 avec une dizaine d’amis réunis autour de Chamfort (p. 18). Servies par sa curiosité et par une réelle facilité d’écriture, ses Œuvres littéraires débordent largement l’économie politique qui fit sa célébrité. On découvre cette riche production intellectuelle, très variée, dans les deux tomes du volume VIII des Œuvres complètes (1.300 p.), parus tout récemment, qui comportent :
- un essai moral d’une centaine de pages, déjà publié du vivant de l’auteur en 1817 et 1818, réédité post mortem en 1839, titré « Le Petit Volume », qui suivait « le genre de La Bruyère et de La Rochefoucauld » (et, sans aucun doute, l’esprit des Maximes de Chamfort)[4]. Suivent six pièces de théâtre en prose, écrits de jeunesse tout à fait conformes à l’atmosphère des scènes parisiennes de l’époque révolutionnaire : au moins l’une de ces pièces fut représentée ; d’autres furent publiées en revues. Des projets ou des ébauches d’ouvrages, des embryons de mémoires, des fables ainsi que des nombreuses Notes, soigneusement rédigées mais inédites, touchent à l’art d’écrire, au style, à la rhétorique, à la langue et à la grammaire française. Ce tome publie enfin un recueil d’aphorismes et de citations dont la variété témoigne de l’esprit critique de l’auteur et de sa fidélité à la tradition des Lumières. Un peu hétéroclite, cet ensemble est assorti de notes des éditeurs qui soulignent surtout les variantes ou les repentirs de l’auteur. Le tout constitue ce premier tome de 700 p.
- le second tome du volume VIII (612 p.) regroupe des critiques littéraires et théâtrales parues dans La Décade philosophique, littéraire & politique entre juin 1794 et juin 1804, période pendant laquelle J.-B. Say tint la rubrique « spectacles » de cette publication décadaire. Au fil de ces chroniques, on découvre l’intérêt tout particulier que J.-B. Say portait au théâtre, un genre littéraire auquel il s’essaya dès son adolescence puisque sa première pièce : Le Tabac narcotique (1780) fut écrite à 14 ans ! On doit rappeler, à ce propos, l’importance politique de l’institution théâtrale au cours d’une période troublée mais créative ; ainsi que la variété des auteurs, des troupes et des comédiens, tous confrontés à la « police des salles » et à la censure de leurs textes, de leurs mises en scène et de leurs publications, une censure qui n’a jamais cessé pendant cette période au cours de laquelle les « tombeurs » de la monarchie ont prouvé qu’ils étaient plus intolérants encore que les censeurs précédents, ce que prouve cet extrait des décrets d’août 1793 : « tout théâtre … tendant à dépraver l’esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, sera fermé, ses directeurs arrêtés et punis selon la rigueur des lois » (cité tome 2, p. 722) : affichée comme une conquête révolutionnaire de 1789 à 1791, la liberté d’écrire et de s’exprimer passa un bien mauvais moment dans les années qui suivirent…
Comme le souligne l’introduction (non-signée) de ce tome II (p. 707) les autres articles livrés par J.-B. Say à La Décade et à la Revue philosophique, politiques, philosophiques, historiques, voire encyclopédiques, seront publiés au volume VI des Œuvres complètes à paraître prochainement ; ses Correspondances, sa Biographie et les Index de cette édition (noms et sujets) constitueront respectivement les volumes IX et X de cette imposante publication.
Quelques réflexions sur cette édition de J.-B. Say
En concluant cette chronique, je ne peux éviter de soulever des questions qui viennent à l’esprit en découvrant cette volumineuse édition de J.-B. Say dont la rédaction et l’édition (plus de 7.000 pages au bas mot) auront duré plus d’un quart de siècle.
Première interrogation : la brièveté du propos liminaire qui introduit chacune des parties du volume VIII (quelques pages, essentiellement descriptives) suggère qu’il s’agit vraisemblablement d’une simple démarche bibliographique. Si c’est bien le cas, cette longue série de livres imprimés, destinés à des lecteurs francophones, est-elle la bonne manière de diffuser pareille somme ? De nos jours, des services électroniques, aussi accessibles en France qu’à l’étranger – ubiquitaires, faciles à compléter ou à amender – sont accessibles à très bon compte par les rares spécialistes, dispersés dans le monde, qui pourraient s’intéresser aux écrits originaux de Jean-Baptiste Say [5]!
Seconde réflexion : si l’équipe qui a produit cette édition variorum avait collationné et présenté les variantes et les inédits dans un thesaurus électronique sur Internet, l’œuvre aurait été terminée plus rapidement, les coûts de mise en forme et de présentation auraient été sans doute réduits etc. L’édition aurait donc, très probablement, rendu aux quelques experts susceptibles d’exploiter ces éditions savantes autant – et peut-être plus – de services concrets que ne le feront des ouvrages subventionnés, petits tirages rédigés en français, ne serait-ce qu’en bénéficiant d’un moteur de recherches ou d’une puissante intelligence artificielle comme Chat GPT ou Claude ! Enfin, depuis que cette édition de J.-B. Say est partagée entre deux éditeurs (Economica pour les premiers volumes parus, Garnier pour la suite) la série complète sera un peu difficile à réunir par ceux qui en auront besoin.
Dernière réflexion : nous le savons d’expérience, rééditer les grands textes du passé est une tâche ingrate, peu reconnue, qui impose de l’abnégation, du soin et une bonne dose d’optimisme : minutieuse, la démarche philologique peut consumer une vie entière ! Pareille dévotion incombait autrefois aux bénédictins. Or, à notre époque et dans un pays comme la France, les monastères n’ont plus guère de moines ni de moniales pour conduire de tels travaux. Sachant qu’aucun éditeur ne finance une telle opération sur fonds propres, biberonnés comme ils le sont à la manne publique, nos chercheurs proposent à l’État et aux collectivités de supporter leurs aventures éditoriales[6].
L’édition qui servit de modèle pour la présente édition de J.-B. Say, celle des Œuvres économiques de Walras père et fils, illustra bien cet état de choses : les initiateurs réunirent collègues, thésards etc. pour préparer l’édition complète des Walras (cf. supra n. 1). Cette tâche se termina après une vingtaine d’années, soit la moitié d’une carrière universitaire, environ ! Elle affichait deux objectifs : répondre au vœu posthume de Léon Walras qui souhaitait associer son père à sa propre œuvre économique dont Auguste Walras posa les prémisses ; et, second objectif, implicite : inscrire ce Centre Walras dans la continuité de la doctrine walrassienne, touchant notamment à ce que l’on nomme aujourd’hui « l’économie sociale & solidaire », thème majeur du centre lyonnais [7].
Ce modèle, les animateurs du Triangle l’ont reproduit pour éditer J. B. Say. Ce fut sans doute utile pour entretenir les compétences éditoriales de ce centre sur la longue durée; et une nouvelle moitié de carrière pour les éditeurs de Walras. Au-delà de la révélation des variantes et des importants inédits publiés dans les volumes V, VII & VIII, l’édition complète de J.-B. Say eut-elle un tel propos implicite ?
Je l’ai souligné plus haut, commentaires et introductions des volumes parus ont peu de dimension critique ; l’impulsion d’André Tiran, qui consacra à J.-B. Say ses recherches doctorales et postdoctorales, fut probablement significative, cela se comprend[8]. Mais le lien intellectuel entre l’œuvre et la personnalité de Say, d’une part ; et l’équipe du Triangle actuel, d’autre part, parait ténu. Éditer tout l’œuvre de Say fut-il, pour des éditeurs dont les centres d’intérêt sont éloignés de l’héritage de Jean-Baptiste Say, aussi un projet ad hoc pour eux et pour leur centre de recherche ?
recensé par
Jean-Pierre Chamoux
Annexe : Œuvres complètes de J.-B. Say parus à ce jour
2002 : volume IV : Leçons d’économie politique, inédits, Economica, Paris.
2003 : volume V : Œuvres morales & politiques, imprimés & inachevés, Economica, Paris.
2006 : volume I : Traité d’économie politique, édition variorum, Economica, Paris.
2009 : volume II : Cours d’économie politique, édition variorum, Economica, Paris.
2020 : volume III : Catéchisme d’économie politique & alii, Garnier, Paris.
2024 : volume VII : Notes & pièces diverses, Garnier, Paris.
2024 : volume VIII : Œuvres littéraires, Garnier, Paris.
NB : Les volumes VI (articles philosophiques & politiques parus à La Décade & La Revue encyclopédique), volume IX (Correspondances) et volume X (Biographie et Index) sont à paraître.
[1] Le Centre Auguste & Léon Walras – renommé récemment « Le Triangle » – avait déjà établi l’œuvre économiques complète d’Auguste et de Léon Walras en quatorze volumes publiés chez Economica entre 1987 et 2005. A la suite de la redécouverte d’un fonds d’archives de Léon Walras qui trainait dans les caves de la bibliothèque universitaire de Lyon en 1983, et diverses autres péripéties, il apparut que Léon Walras avait souhaité que les écrits économiques de son père Auguste et les siens propres soient rassemblés dans une même publication posthume. Initié en 1987 et endossé par Jean Pavlevski, directeur des éditions Economica, cette édition qui comprend quatorze volumes s’étala sur 18 ans jusqu’en 2005. Ses initiateurs ont résumé leur projet in Pierre Dockès & Claude Mouchot : « Lire Walras : Des fonds d’archives à l’édition & la réinterprétation des œuvres économiques complètes d’Auguste & Léon Walras », Cahiers d’éco. po. 2010 – 2, n°57, p. 197-210. Accessible @ : https://doi.org/10.3917/cep.057.0197/ .
[2] Projet animé par André Tiran, désormais professeur-émérite à l’université de Lyon 2. Outre Emmanuel Blanc qui dirigea l’édition du volume VIII, six universitaires y ont contribué : P.-H. Goutte, G. Jacoud, C. Mouchot †, J-P. Potier, J.M. Servet & Ph. Steiner, ainsi que Carole Boulai. Ancien doyen de la faculté d’économie & gestion de Lyon II, A. Tiran administra et présida (2010-12) cette université lyonnaise.
[3] La chaire d’économie du CNAM inaugurée par J-B. Say fut notamment occupée au XX° siècle par Jean Fourastié et par Jacques Lesourne.
[4] Réédité par l’Institut Coppet en 2017, pour le bicentenaire de sa première édition en 1817 (cité p. 15, tome I).
[5] Faute de maîtriser les finesses de la langue française dont l’usage se perd parmi les lettrés contemporains, le nombre des spécialistes qui accordent une attention suivie à de tels travaux se rétrécit. Un exemple : une thèse, soutenue au Japon par une Japonaise, qui analysait l’interaction entre les jansénistes de Port Royal et les reformés français. Les logiciels linguistiques facilitent ces recherches transculturelles : la synthèse écrite est en français ; l’appareil analytique est sur le net !
[6] Villes, départements et régions contribuent parfois à des projets académiques dont les retombées sont aléatoires. Ils endossent, par effet de mode, des productions (livres, séries télévisées, longs métrages etc.) dont ni leur territoire ni les élus ne tirent de résultat concret, sinon leur plaisir hédoniste d’agir en mécène en prodiguant l’argent public.
[7] Léon Walras s’inscrit dans la tradition sociale et coopérative notait J. Schumpeter : continuateur de son père Auguste, il « manquait d’aptitude pratique, comme tout intellectuel » (sic). Avant de rejoindre Lausanne en 1870 (où il fit ses découvertes immortelles qu’admirait Schumpeter) il fut le rédacteur en chef du Travail (1866-68) organe du mouvement coopératif français. Cf : Histoire de l’analyse économique, vol. III, Tel-Gallimard (1983), p. 111 sq.
[8] La présentation de cet ouvrage plaide pour une édition variorum complète de J.-B. Say ; elle regrette les nombreux « reprint » bruts (souvent étrangers) des auteurs français d’économie politique comme Say ou Sismondi, mais n’affiche guère d’objectif « critique ». Cf. Jean-Pierre Potier & André Turan : « L’édition des œuvres complètes de Jean -Baptiste Say » , Cahiers d’économie politique n°57, L’Harmatan, 2009, pp. 151-173.