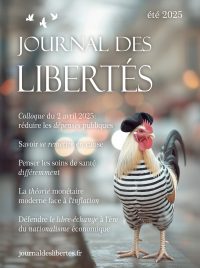1. Le vice de la répartition
La répartition a été instituée par Pétain et pérennisée à la Libération, en pillant au passage les caisses de retraite par capitalisation qui existaient. A l’époque le système était viable. On avait plus d’enfants, on travaillait plus et on mourait plus jeune. Selon la CNAV, en 1965 il y avait 4,29 actifs pour un retraité. Mais aujourd’hui, selon Statista, il y en a 1,7 et il y en aura 1,2 en 2070. Les réformes démagogiques d’abaissement de l’âge de départ à la retraite à 60 ans ont fragilisé le système des retraites. En même temps les jeunes commencent à travailler plus tard, la natalité baisse de manière structurelle, le nombre d’actifs se rétrécit, l’espérance de vie à 65 ans s’accroît régulièrement. Entre 1950 et 2022, elle a augmenté de 8,5 ans pour les femmes et de 7 ans pour les hommes.

Les perspectives démographiques remettent donc en cause gravement et sans doute durablement les perspectives des retraites par répartition dans lesquelles les pensions servies aux retraités proviennent chaque année des cotisations des actifs.
L’OCDE a développé un modèle d’analyse[1] qui anticipe, sur la base des règles et données actuelles dans chaque pays et en fonction des prévisions démographiques, les retraites qu’obtiendront dans 40 à 45 ans (voire parfois plus) les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle et commencent à cotiser à 22 ans. Selon l’étude de 2023 les taux de remplacement bruts seraient[2] à terme pour les retraités français commençant à travailler en 2022 de 58,4 % de leur revenu actif moyen au long de leur vie professionnelle en France[3].
Il faut éclairer le débat sur 3 points particulièrement importants :
- C’est le principe même de la répartition qui aujourd’hui ne peut plus fonctionner, quelles qu’en soient les modalités. En remettant en chantier la réforme des retraites, François Bayrou a rappelé, en forme de suggestion pour ce « conclave », avoir été un « militant » de la retraite à points que défend la CFDT. Mais un système de répartition à points n’améliorerait pas l’équilibre des retraites et resterait dépendant de notre démographie déclinante.
- Les cotisations sont très élevées en France, près de 28 % du salaire brut (contre 18,2 % en moyenne dans l’OCDE en 2022), Pourtant, elles n’ont financé en 2023 que moins de deux tiers des pensions. Le dernier tiers a été pris en charge par les contribuables à raison d’une contribution de l’État de 130 Mds € dont 20 Mds € au profit du Fonds de Solidarité des Retraites et le surplus, 110 Mds €, versé principalement d’une part en compensation de divers dispositifs d’exonération de cotisations des salariés privés et d’autre part à raison de l’insuffisance des cotisations des fonctionnaires et de divers régimes spéciaux publics ou parapublics. Mais malgré la réforme de 2023 et ces apports conséquents de l’État au système de retraite, celui-ci reste déficitaire et, selon Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites, ce déficit est appelé, en l’état, à s’accroitre significativement, jusqu’à 0,8 % par an du PIB au-delà de 2030.
- La répartition est aujourd’hui une épée de Damoclès considérable. Elle représente une créance des cotisants sur l’État qui de fait est garant des pensions à leur verser. Non enregistrée en dette publique dans les comptes de l’État, ne serait-ce qu’en « hors bilan », elle représentait pourtant 8 474 Mds € à fin 2023. C’est considérable. Un passage à la capitalisation effacera progressivement cette dette.
La France s’obstine à croire que seul un régime de répartition serait social et solidaire et elle a exclu jusqu’à présent la capitalisation, ce qui fait courir un risque majeur, une quasi-certitude, d’appauvrissement général des retraités à terme sauf à faire peser sur les actifs des cotisations excessives représentant pour eux une charge insupportable.
2. La transition vers la capitalisation est possible
La difficulté est de passer de la répartition à la capitalisation parce que les actifs qui ont cotisé à leur retraite par répartition ont une créance sur l’État en quelque sorte : ils ont un « droit à » une pension de retraite qui, selon le système de la répartition, devrait être versée par les actifs des générations suivantes. Si les actifs ne cotisent plus à un système de répartition mais à un système de capitalisation, la créance des actifs ayant cotisé à une retraite de répartition, dont les cotisations ont servi à payer les pensions des retraités année après année, ne pourra pas être honorée. Ce qui n’est pas possible.
La transition sera nécessairement progressive et ne pourra se faire que sur une période longue. Elle est possible parce que la capitalisation offre un rendement bien meilleur que la répartition. Albert Einstein, qui aurait dit que « Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l’univers », a théorisé la règle de 72 selon laquelle si un capital est placé avec un taux d’intérêt de t % par période (en général, années), il faut 72/t périodes pour le doubler. Sur la base des taux de rendement moyen des capitaux placés à long terme au cours des cent dernières années, il paraît possible de retenir l’hypothèse prudente d’un taux moyen de rendement de 3,5 % par an, après frais de gestion et inflation, des placements des cotisations versées par les assurés pendant leur vie active de 44 ans en moyenne.
Cette transition serait possible en prélevant chaque année et pendant une durée d’une cinquantaine d’années une partie des cotisations (13/28ème) et des dotations d’équilibre de l’État (130 Mds € en 2023, voir ci-dessus) à l’effet de financer la retraite de ceux qui auront cotisé pour des retraites par répartition avant la transformation du système de retraite en capitalisation, tout en accumulant une partie des cotisations dans des fonds de capitalisation pour payer à terme les retraites des cotisants du nouveau régime de capitalisation. Durant cette période de transition, l’État devrait emprunter pour compléter le besoin de financement des anciennes retraites cotisées en répartition. Mais année après année, la dette de l’État (estimée ci-dessus à environ 8 500 Mds en euros constants 2023) se réduirait sensiblement. Une partie des dettes de répartition étant payées par les cotisations surnuméraires (13/28èmes selon la proposition ci-dessus), chaque année l’État se désendetterait plus qu’il ne s’endetterait pour arriver en fin de période à être entièrement désendetté.
En contrepartie de l’effort contributif à la transition de tous les actifs cotisants, ceux-ci pourraient obtenir de l’État une garantie de retraite d’un montant au moins égal au taux prévu à terme par l’OCDE pour les retraités français cotisant en répartition (58,4 % du salaire moyen sur toute la carrière). Les actifs de tous les régimes actuels de répartition (fonctionnaires, régimes spéciaux, indépendants, régime général) verseraient donc une cotisation de 28 % (le taux commun actuel) de leur rémunération sur laquelle 13/28èmes seraient affectés au paiement des anciennes retraites par répartition et 15/28èmes contribueraient à la constitution des nouvelles retraites par capitalisation.
Ainsi, un salarié commençant à travailler à 21 ans avec un salaire brut de 2500 €/mois augmentant linéairement jusqu’à 3500€/mois lorsqu’il aura 65 ans et qu’il prendra sa retraite, pourra, en cotisant 15 % de son salaire, obtenir une pension mensuelle de 3 028 € correspondant à 86,5 % de son dernier salaire et 101 % de son salaire moyen sur toute sa carrière après avoir cotisé 15 % sur ses salaires au lieu des 28 % qui sont prélevés en France sur les salaires bruts au titre d’une retraite par répartition qui ne délivre qu’une retraite égale au plus à 75 % du dernier salaire et qui selon l’OCDE devrait à terme délivrer une retraite égale à 58,4 % du salaire moyen sur toute la carrière.
Les cotisants seraient obligés de cotiser au nouveau système de capitalisation à hauteur de 15 % de leur salaire, mais ils devraient pouvoir choisir le fonds de pension gestionnaire de leur retraite et pourraient en changer. Ils pourraient cotiser des montants supérieurs et déductibles de leurs revenus. Ils seraient libres de prendre leur retraite quand ils voudraient au-delà d’un certain âge (60 ans ?) et après une durée minimale de cotisation (40, 42 ans ?). Ils reprendraient ainsi la maîtrise de leur retraite. Bien entendu, les fonds de pension gestionnaires devraient satisfaire à divers critères de sécurité.
A terme, le coût global des retraites en France reviendrait en dessous de 10 % du PIB (au lieu d’environ 14 % aujourd’hui) et les retraités auraient droit à une meilleure retraite qu’aujourd’hui. Ces chiffres sont conformes à ceux de nombreux pays ayant adopté des régimes de retraite par capitalisation comme les Pays-Bas ou le Danemark.
Les dépense publiques et privées des systèmes de retraite représentent en France 3,5 % de plus qu’aux Pays-Bas ou au Danemark. Parce que ces deux pays ont adopté très largement la capitalisation. En taux de remplacement brut, avant impôts et charges sociales, les systèmes par capitalisation danois et néerlandais permettent d’offrir aux retraités des pensions de plus de 30% supérieures à celle des Français alors que l’effort financier demandé aux cotisants et aux contribuables français est 30 % supérieur à celui demandé aux leurs par les Pays-Bas et le Danemark.
3. Avantages de la capitalisation
Chacun, sauf cas très particulier, recevrait le fruit de ses économies. Ce qui est plus juste que cette immense caisse noire de la répartition dans laquelle chacun n’arrive à piocher plus que les autres qu’à la hauteur de la puissance des lobbies qui le défendent.
Dans certaines limites à définir, chacun pourrait moduler ses cotisations de capitalisation et chacun serait responsable de son épargne. Sous réserve d’une durée raisonnable de cotisation, la retraite de chacun serait significativement supérieure à ce que serait une retraite par répartition.
Un financement de l’économie : les fonds de pension gérant les retraites disposeraient d’une épargne importante susceptible d’être, pour une large partie, investie dans l’économie nationale de façon à en financer le développement. Les cotisants seraient ainsi indirectement impliqués dans l’économie de leur pays.
La charge publique en serait à terme réduite de près de moitié si toutes les retraites étaient en capitalisation. Mais bien entendu, la sagesse politique serait sans doute de conserver une partie (limitée) du système en répartition pour répartir les risques.
Annexe concernant l’étude de l’OCDE
Pour cette analyse, les droits à pension présentés par l’OCDE sont ceux ressortant des dispositifs en vigueur de chaque pays au cours de l’année de première cotisation. Les calculs correspondent aux prestations d’un salarié qui s’est affilié au système de retraite cette année-là à l’âge de 22 ans (20 ans dans les études antérieures) et prend sa retraite à l’issue d’une carrière complète. Les principaux résultats sont donnés pour une personne seule. La longueur de la carrière varie avec l’âge légal de la retraite : 40 ans pour la retraite à l’âge de 62 ans, 45 ans pour la retraite à 67 ans, etc. Les modèles de retraite présentés et modélisés incluent tous les régimes obligatoires, publics ou privés, pour les salariés du secteur privé. Les droits à retraite sont comparés pour des salariés percevant des niveaux de rémunération de 0.5 fois, 1 fois et 1,5 fois le salaire moyen. La hausse des prix est supposée s’établir à 2 % par an. Le taux de croissance des salaires réels est fixé à 1.25 % par an en moyenne (soit une hausse nominale des salaires de 3,275 % compte tenu de la hausse des prix retenue). Le salaire individuel est supposé croître comme la moyenne nationale, c’est-à-dire que l’individu est supposé rester au même niveau sur l’échelle de distribution des salaires et percevoir le même pourcentage du salaire moyen durant toute sa vie professionnelle.
Le taux de rendement réel pour les régimes de retraite par capitalisation à cotisations définies est supposé être de 2,5 % par an (3 % par an dans les précédentes études). Il est supposé que les frais administratifs, la structure des commissions et le coût d’achat d’une rente entraînent un coefficient de conversion (régime à cotisations définies) de 90 %. La modélisation de référence utilise les projections de taux de mortalité par pays issues de la base de données démographiques des Nations Unies pour chaque année entre 2016 et 2080. OCDE: https://doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en.
[1] NDLR : Pour plus de détails sur ce modèle on peut consulter la note placée en annexe de cet article.
[2] Le taux de remplacement brut futur compare le niveau des prestations de retraite qui seront versées aux retraités par les régimes de retraite obligatoires publics et privés l’année où ils prennent leur retraite aux revenus annuels moyens d’activité des dits retraités au cours de leur vie.
[3] OCDE, Panorama des pensions 2023. Dans cette dernière édition, l’âge auquel les individus sont censés commencer à travailler est reporté de 20 à 22 ans.