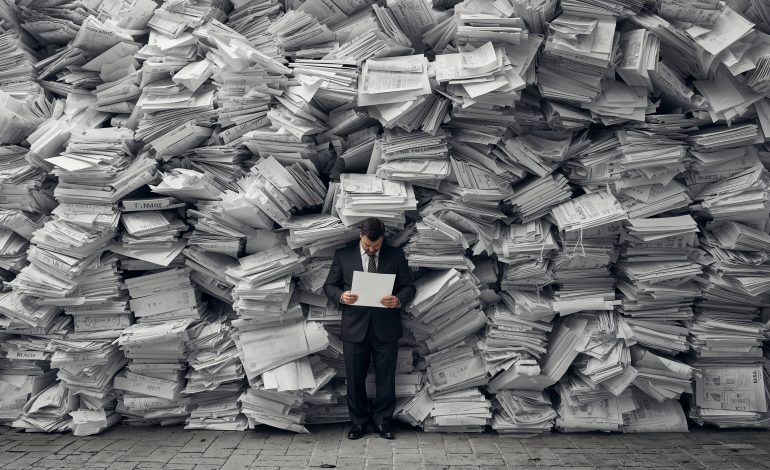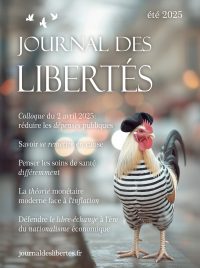1. Le principe du déséquilibre budgétaire
Les libéraux ont toujours été de chauds partisans de l’équilibre budgétaire. Mais force est de constater que celui-ci n’a jamais été un principe de nos finances publiques. Un auteur a pu calculer qu’en près de deux siècles, de Henri IV à la Révolution, la France n’a pas connu trente années d’excédents budgétaires ! Un autre auteur a pu calculer qu’entre 1814 et 2010, 75 budgets seulement sur 195 avaient été votés en excédant, et que seuls 37, soit moins de 19 %, avait été exécuté en excédant. De 1930 à 2025, seuls onze budgets ont été présentés sans déficit. Depuis 1978, toutes les lois de finances sont présentées et exécutées en déficit. Si bien que l’on pourrait parler de manière ironique d’un principe du déséquilibre budgétaire… Un principe qui explique que les gouvernements incompétents d’aujourd’hui ne sont que les héritiers plus ou moins lointains des gouvernants incompétents d’hier.

2. La chronologie du débat français sur les bonnes finances publiques
Le débat du milieu des années 2020 sur les remèdes à apporter à nos difficultés budgétaires n’a pas progressé par rapport à celui qui a débuté du mitan des années 2000 au tout début des années 2010, essentiellement sous la présidence Sarkozy. En voici la chronologie :
- 2001 : la loi organique sur les lois de finances prévoit la détermination par ces dernières de l’équilibre budgétaire et financier.
- 2005 : le ministre de l’Économie Thierry Breton confie à Michel Pébereau une mission compte-tenu de l’importance de la dette, qui dépasse les 65 % du PIB. Un rapport intitulé « rompre avec la facilité de la dette publique » est remis en décembre. Il prône la réduction des dépenses publiques en 5 ans avec le maintien du niveau des prélèvements obligatoires.
- 2008 : la Constitution est révisée avec l’introduction entre autres de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques à l’article 34.
- 2009 : Nicolas Sarkozy ouvre un débat sur une règle budgétaire à l’allemande.
- 2010 : Jacques Delpla fait paraître une note pour la Fondapol, intitulée « Réduire la dette grâce à la Constitution ». L’économiste prône l’inscription dans la Constitution et dans la loi organique d’une règle budgétaire contraignante de moyen terme inspirée de la réforme allemande de 2009. Il prévoit toutefois de multiples exceptions en cas de récession, de circonstances exceptionnelles, etc.
- 2010 : En mars, le Premier ministre, François Fillon, confie à Michel Camdessus, ancien membre de la Commission Pébereau, de rendre un rapport pour mieux assurer le respect de l’objectif d’équilibre des comptes publics inscrit dans la Constitution. Ce rapport est remis sous le titre « Réaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques ». Il recommande l’institution d’une loi-cadre de programmation pluriannuelle des finances publiques, avec des exceptions en cas de dégradation imprévue de la conjoncture.
- 2011 : Le gouvernement Fillon propose l’inscription dans la Constitution d’une loi-cadre de programmations pluriannuelles des finances publiques pour au moins trois années, avec contrôle du Conseil constitutionnel. En juillet, l’Assemblée nationale adopte le projet après le Sénat. Nicolas Sarkozy renonce à réunir le Congrès, la majorité des 3/5ème n’étant pas assurée.
- 2014 : Des députés UMP déposent le 12 décembre une proposition de loi constitutionnelle sur le principe d’équilibre des finances publiques, avec des exceptions.
- 2022 : Lors de l’élection présidentielle avec Valérie Pécresse, puis lors des élections législatives avec les Républicains, est proposée une double « règle d’or » : l’équilibre du budget grâce à des pactes renouvelés tous les cinq ans contrôlés par le Conseil constitutionnel, l’interdiction de tout changement de normes fiscales sur cinq ans.
- 2024 : Gabriel Attal, le Premier ministre, propose lors des élections législatives une « règle d’or », en fait une règle fiscale selon laquelle il n’y aurait pas de hausses d’impôts.
- 2025 : Dans un entretien, l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, propose en mars une « règle d’or » : revenir à un équilibre financier en 10 ans.
3. Les leçons du droit comparé
Le droit comparé permet tout d’abord de clarifier des concepts qui, par malignité ou par inconscience, sont trop fréquemment confondus. La règle d’or, au sens strict, n’est autre que l’équilibre budgétaire, à savoir l’interdiction du déficit, par conséquent l’absence de dettes. Comme son nom l’indique, l’objectif d’équilibre des finances publiques est un simple objectif, plus ou moins contraignant. Enfin, la notion germanique de « frein à l’endettement » représente une limite maximale à la dette ou au déficit public. Si les leçons à tirer de l’exemple allemand sont très contrastées, elles sont autrement probantes s’agissant de l’exemple suisse.
En Allemagne, la loi fondamentale de 1949 se trouve modifiée en 1969 : le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d’investissements inscrits au budget… sauf perturbation de l’équilibre économique global. Du fait du laxisme du contrôle de la Cour constitutionnelle, l’endettement public explose : de 17,5 % du PIB en 1970, il passe à 67,9 % en 2006. Entre temps, en 2002, l’Allemagne est sujet à une procédure pour déficit excessif menée par la Commission européenne. En 2006, la Constitution est révisée : la Fédération et les Länder tiennent compte des exigences de l’équilibre de l’ensemble de l’économie. La modification de la loi fondamentale n’ayant aucun effet, une nouvelle révision a lieu en 2009 pour introduire le « frein à l’endettement ». Le déficit structurel de l’État fédéral est limité à terme à 0,35 % du PIB, sauf exceptions : catastrophe naturelle, situation exceptionnelle d’urgence échappant au contrôle de l’État et compromettant considérablement les finances publiques. Par ailleurs, les budgets des Länder doivent être à terme équilibrés. En 2025, le frein à l’endettement est supprimé pour les dépenses de défense. Au troisième trimestre 2024, la dette publique s’élevait à 62,4 % du PIB, un chiffre inférieur à celui de 2006 et très largement inférieur à celui de l’État français.
En Suisse, à la suite d’une votation référendaire de 2001, 85 % des votants ayant voté « pour », l’article 126 de la Constitution dispose que « la Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes ». Une exception est cependant prévue en cas de besoins financiers exceptionnels, toutefois avec compensations les années suivantes. Des mécanismes similaires se retrouvent au niveau cantonal. Le taux d’endettement de la Confédération suisse, limité à 10 % en 1990, avait dépassé les 25 % en 1997, puis en 2002, ce qui avait conduit à la réforme de la Constitution. Entrée en vigueur en 2003, le frein à l’endettement a permis de réduire la dette publique à moins de 15 % en 2019 et la crise sanitaire mondiale a simplement entraîné une petite dégradation en portant le taux à 15 % en 2022.
4. Comment faire en France ?
En France, il existe une « règle d’or » des finances locales. En effet, l’article L 1612-4 du Code général des collectivités territoriales interdit de recourir à l’emprunt pour financer des dépenses de fonctionnement. Cette règle est très ancienne puisqu’elle remonte à 1802 et elle constitue une version large de la règle d’or. Au niveau national, l’article 34 de la Constitution prévoit simplement un objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les écueils sont nombreux et ils peuvent être classés en quatre catégories :
- L’inefficacité, donc la dévalorisation de la norme constitutionnelle à l’image de la norme législative, donc aussi l’atteinte à la majesté de la Constitution.
- La complexité et l’inélégance de la norme suprême, donc une nouvelle atteinte à la majesté de la Constitution.
- L’atteinte à la « séparation des pouvoirs » avec l’intervention des juges, et spécialement des juges constitutionnels.
- Tomber de Charybde en Sylla : du rigorisme inefficace au laxisme inutile. Soit on prévoit ce qu’il ne peut pas être raisonnablement respecté, soit on prévoit des exceptions qui minent le principe.
Quatre propositions alternatives seraient envisageables :
- À l’image de la proposition Delpla de 2010, on pourrait prévoir dans la Constitution une phrase du type : « Une loi organique détermine le montant maximal du déficit des administrations publiques, corrigé des incidences de la conjoncture économique ». Cette rédaction renvoie à l’exemple allemand et au frein à l’endettement, et non pas à une règle d’or au sens stricte. Par surcroît, son élégance ne saute pas aux yeux…
- Le projet de loi constitutionnelle de 2011 : on prévoirait une loi-cadre d’équilibre des finances publiques votée pour au moins trois années afin d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques, avec un renvoi pour le surplus à la loi organique. Là encore, il ne s’agit pas d’une règle d’or au sens stricte.
- La Constitution suisse : « L’État équilibre à terme ses recettes et ses dépenses ». Le problème vient évidemment des mots « à terme », qui renvoie là encore à la notion de frein à l’endettement.
- La Constitution italienne : « l’État respecte l’équilibre entre recettes et dépenses ». Bien que la réforme italienne du début des années 2010 ait été largement copiée de l’exemple suisse, cette phrase renvoie à la règle d’or.
Une proposition de révision de la Constitution française pourrait ainsi être formulée : « l’État équilibre à terme ses recettes et ses dépenses. Une loi organique en définit les modalités ».
* * *
* *
Dans un monde idéal, l’équilibre budgétaire serait une évidence. On pourrait donc le graver dans le marbre, tel un principe immarcessible. Mais le réalisme oblige à reconnaître que, dans le monde très imparfait de l’État-providence le plus étendu qu’il soit, seul un frein à l’endettement serait réaliste à court et moyen termes. Or, un frein à l’endettement n’est pas une idée libérale au sens stricte. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est un pays au sein duquel l’ordo-libéralisme est si important qui en représente le paradigme. En effet, l’idée est celle d’une « cybernétique » constitutionnelle où la règle juridique alliée à la technique dresserait un rempart face aux dérives des finances publiques voulue par des hommes politiques irresponsables ou tenté par un assouplissement prétendument provisoire de la rigueur budgétaire.
Par ailleurs, inscrire un frein à l’endettement dans la Constitution n’est pas un gage de succès, le droit comparé le prouve. Et le constitutionnaliste doit être humble car il sait que la Constitution n’est jamais qu’une barrière de papier. Enfin, un frein à l’endettement paraît directement contraire à la critique hayékienne du constructivisme selon laquelle on ne pourrait pas décider à l’avance d’un taux maximal d’endettement, à l’image du rejet du monétarisme et de l’idée chimérique selon laquelle il faudrait décider à l’avance du taux de croissance maximale de la masse monétaire.
On peut donc nourrir un scepticisme plus ou moins fort sur l’efficacité d’un frein à l’endettement en général et sur son application en France tout particulièrement.
Un dernier remord nous taraude : à lire les récriminations des socialistes et des néokeynésiens virulemment opposés de manière générale au frein à l’endettement, sans parler de l’équilibre budgétaire, on se dit, en définitive, que ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée… Jacques Delors ne qualifiait-il pas en 2011 le simple « objectif » d’équilibre des finances publiques de « piège à c… » ? Le constitutionaliste de gauche Dominique Rousseau ne s’inquiétait-il pas en 2012 : « Obliger le Parlement a toujours voter le budget en équilibre, n’est-ce pas dire aux électeurs que leur vote ne peut avoir aucun effet sur la politique budgétaire ? S’ouvre alors la terrible question du rapport entre droit et démocratie, entre l’expression du suffrage universel qui pourrait envoyer au Parlement une majorité keynésienne et la règle constitutionnalisée de l’équilibre qui interdirait au peuple de vouloir ce qu’il veut ! » ? L’économiste néo-keynésien Mathieu Plane, chercheur à l’OFCE, ne se lamentait-il pas : « Ce n’est pas une bonne idée car elle empêcherait de faire des choix politiques pour financer des politiques de long terme. La transition écologique, par exemple. En s’imposant des règles plus strictes que les règles européennes, la France s’interdirait d’innover en matière fiscale » ?