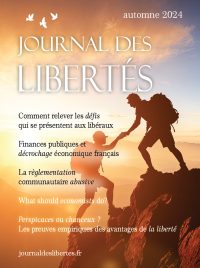Après avoir servi l’administration américaine à la tête du Conseil d’analyse économique du président Clinton (Council of economic advisors, 1995 à 1997), l’économiste Joseph Stiglitz poursuivit sa carrière d’économiste-conseil auprès d’institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Ces fonctions lui ont permis de parcourir le monde pendant de nombreuses années ; et de cultiver sa notoriété un peu partout, comme conférencier ou comme professeur-invité ; ainsi que de conseiller des gouvernements. Distingué par le Nobel d’économie en 2001, le président Sarkozy lui déroula le tapis rouge en 2008 à Paris, pour animer une commission dédiée au climat. à plus de 80 ans, il enseigne encore à l’université new-yorkaise de Columbia.
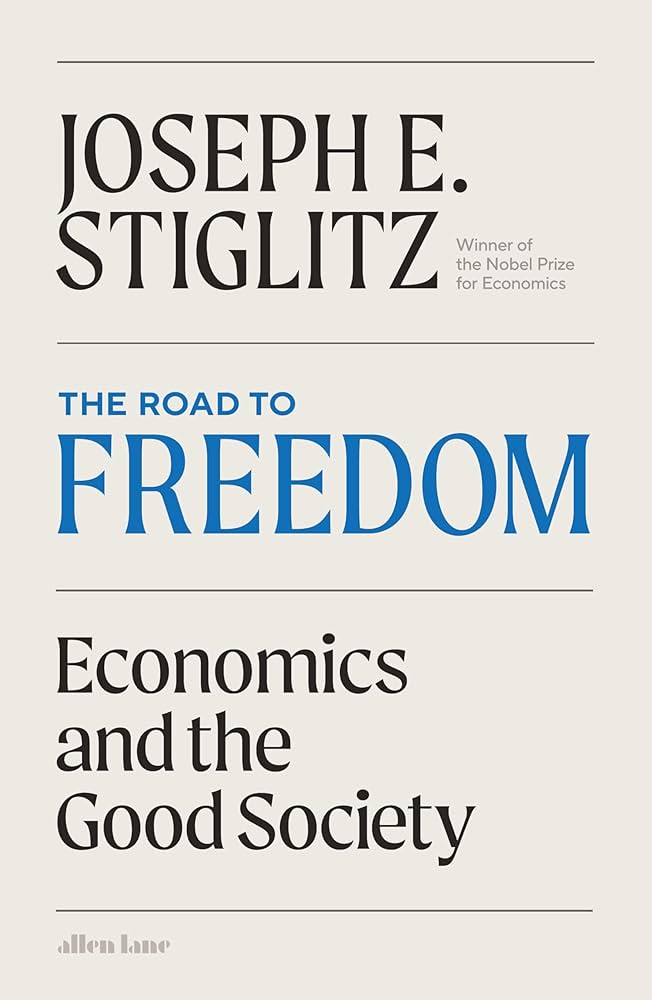
Joseph Stiglitz fut manifestement irrité par la notoriété durable du livre Road to Serfdom[1] dont il critique souvent et vivement l’auteur, Friedrich Hayek. Faussement malin, le titre du présent livre, son quinzième essai à ma connaissance, n’est pas donc pas un hommage à Hayek ; il est simplement ironique!
Organisation du livre[2]
Dès ses premières pages, Stiglitz souligne que, selon des lanceurs d’alerte, en seize ans (2006 à 2022), l’indice des libertés aurait baissé dans le monde : 80% de la population mondiale souffrirait d’un régime autoritaire ; et en Amérique, vrai sujet du livre, le penchant autoritaire de Trump est patent ; alors qu’au sein de l’Union européenne, par principe attachée à la liberté, la république hongroise s’affirme illibérale, un qualificatif vague, brandi comme un chiffon rouge ! Friedrich Hayek et Milton Friedman ont, selon l’auteur, gravement péché ; et si d’autres libéraux, comme le Président Ronald Reagan, ont favorisé des marchés libres, ce n’était ni pour la liberté ni pour leurs peuples ; mais pour préparer – peut-être sans le savoir ni le vouloir – un avatar du fascisme qui pourrait marquer le XXI° siècle (sic, p. 290) !
Rédigée par l’auteur lui-même, l’assez longue préface (14 pages numérotées en chiffres romains) s’ouvre sur une citation du philosophe britannique Isaiah Berlin à qui Stiglitz emprunte une formule, sortie de son contexte, qui n’est qu’une caricature du libéralisme[3] : « la liberté des loups entraîne souvent la mort des moutons » ! Ces mots empruntés donnent le ton du livre qui décline de nombreux lieux communs d’inspiration keynésienne, sur près de 300 pages.
Les deux chapitres introductifs (Chap. 1 & 2) enfoncent déjà le clou : dans ses campagnes présidentielles, F-D. Roosevelt avait fixé deux objectifs politiques aux États-Unis : freedom from want (sortez du besoin) et freedom from fear (n’ayez plus peur)[4] ; ces deux règles impliquaient des actes politiques ; elles imposèrent à l’État-providence de répondre aux besoins qu’expriment les bénéficiaires des « droits à » que leur avait promis la puissance publique, sous la forme de prestations ou de services, gratuits ou presque, profitant à tous ceux qui sont censés être dans le besoin (logement, école, soins médicaux, etc.). Définis et garantis par l’État fédéral, ces droits sociaux consomment d’importants budgets sociaux.
L’essai comprend ensuite trois parties.
- Cinq chapitres (Chap. 3 à 7) exposent ce que l’auteur entend par « liberté » ; il jongle avec deux mots qui sont difficiles à distinguer par un esprit français : Liberty (dérivé du mot français) et Freedom (de racine saxonne). Au-delà des méandres de cette réflexion, un seul point est limpide : cette « liberté » (qu’il estime menacée) n’a de sens que dans un cadre social et redistributif. Car Stiglitz considère la liberté comme une ressource limitée, résultant d’un jeu à somme nulle qui la répartit au sein de la société. Sous plusieurs formes, il répète : « la liberté des uns n’existe qu’au détriment de celle des autres », thème central du chapitre 3 qu’il reprend souvent (pp. 87, 106, 129, 194, 203 etc.) ; et c’est pourquoi, dans son esprit, les inégalités qui minent la société américaine, qu’il juge insupportables, doivent être compensées par l’État (pp. 67-68) ! Sans surprise, c’est un moyen keynésien qu’il suggère : l’État-Providence doit redistribuer la liberté, de la même manière qu’il redresse les différences de revenu en attribuant des avantages sociaux. Mieux : puisqu’il considère que la plupart des inégalités de revenu et de situation résultent d’externalités, une réglementation correctrice et une fiscalité ad hoc (que Stiglitz adore, semble-t-il) l’aideraient à parvenir à ses fins (résumé pp. 120-121) !
- Trois chapitres posent ensuite les bases d’une bonne société (sic) pour l’Amérique, projet que résume le sous-titre de l’ouvrage. Afin de formater les individus et de leur faire adopter les valeurs nécessaires à la réussite d’un tel projet (Chap. 8 & 9), Stiglitz n’hésite pas à rappeler que cela imposerait une dose de contrainte : au passage, son analyse du « crédit social » chinois qu’il semble tolérer bien mieux que la publicité des multinationales, est très ambigüe (p. 159) ! Un autre passage confus, relatif aux rapports entre solidarité et liberté (Chap. 10) définit la tolérance non pas comme une vertu que chacun pratiquerait, mais comme une valeur sociale, complémentaire de la solidarité qui devrait primer sur tous les autres impératifs sociaux, dit-il. Il cite aussi la « laïcité à la française » (p. 204) et notre devise républicaine (liberté, égalité, fraternité) qu’il associe à cette qualité suprême : la solidarité !
- La troisième et dernière partie de ce livre, confirme la quête de ce que Stiglitz appelle « une société libre, juste et bonne», dont il aurait conçu le projet dès le début de sa carrière, dans les années 1960. Cette société diffèrerait du « néo-libéralisme » dont il attribue la paternité à Milton Friedman & consorts, responsables, selon lui, de l’échec constant, patent et continu du capitalisme américain, ce que tentent de prouver les multiples tableaux qui constituent l’essentiel du chapitre 11 (constat d’échec du capitalisme: pp. 218 – 225). L’auteur décline ensuite les composantes de l’action volontariste et généreuse qu’il reprend des chapitres précédents : réviser profondément les droits de propriété intellectuelle et industrielle, la gestion et l’affectation de la dette publique, la production mondialisée et le commerce international. Tout cela préparant un new deal mondial afin de redistribuer tâches (et revenus) entre pays du nord et pays du sud, d’éradiquer le « néo-colonialisme » qui entrave le Tiers-monde, de partager les richesse minières et agricoles… et de contrecarrer le dérèglement climatique qu’il dénonce depuis des années (chap. 12).
Ainsi se dessinent les axes d’une social-démocratie mondialisée que Stiglitz appelle de ses vœux (chap. 13); et un « capitalisme progressiste »[5] qui réaffecterait la richesse, tant au sein des États-Unis qu’entre les membres de la communauté mondiale. De « justes obligations » s’imposeraient alors à l’Amérique (puis à l’occident, par la suite), grâce à la justice sociale qu’exige une société bonne [6]. Chacun modérerait ses besoins afin de permettre aux autres d’assouvir les leurs (Chap. 14, p. 278 sq.). Si la droite et les médias dominants (d’Amérique) n’admettent pas spontanément cette vision du monde futur, les contraindre s’avérerait nécessaire. Aucun doute n’est donc permis: c’est bien cela qu’implique le titre de ce livre : « En route vers la liberté »![7]
Stiglitz : un augure, pas un scientifique !
La lecture de Road to Freedom prouve que Stiglitz ne joue pas dans la même cour que son ainé Hayek : au terme du dernier confit mondial, Hayek montrait, lucidement, que Staline et Hitler poursuivirent, l’un comme l’autre, un projet socialiste ; et que leur conquête s’exerça au détriment de leurs peuples et des autres nations. En démontant ce piège qui fit peser une grave menace sur notre monde, Hayek agissait en moraliste politique ;il réfléchissait au long terme, bien au-delà de sa discipline académique, l’économie !
Tout au contraire, dans son dernier livre comme dans les précédents, Stiglitz dénonce seulement des politiques économiques qu’il rejette ; il les dénigre en les affublant du terme « néo-libéral », péjoratif dans sa bouche car instaurées lors de la présidence de Reagan. Il leur attribue les maux actuels de la société américaine. Point de souffle, mais des affirmations, plaisantes pour la gauche du parti démocrate car elles suscitent chez ses électeurs du dépit, de l’envie ou de la jalousie. L’auteur offre à la vindicte populaire ceux qu’il définit comme des manipulateurs intéressés et cyniques de l’économie et de la monnaie américaines. Il s’exprime comme un augure, non comme un savant ni comme un « spectateur impartial », lui qui prétend prolonger la tradition d’Adam Smith (pp. 22 sq., 101 sq. etc.)!
Ce donneur de leçons a fréquenté – parfois bousculé – les institutions auxquelles il participait. Cependant, malgré son brio académique, Joseph Stiglitz s’est souvent trompé (d’analyse, de combat ou d’adversaire) au cours des trente dernières années. Ainsi :
- En 2002, un rapport commandé à son équipe, encourageait vivement à généraliser des prêts immobiliers garantis par l’État fédéral, par l’intermédiaire d’établissements publics (Freddie Mac et Fannie Mae) en faveur de ménages déshérités, presque insolvables ; l’expérience prouva que ces financements, titrisés grâce à cette garantie publique, contribuèrent au crack de 2008, alors que Stiglitz affirmait qu’un défaut des « subprimes » était « inimaginable »[8] !
- En 2007, il encouragea le Venezuela de Chavez à financer une redistribution clientéliste par sa rente pétrolière ; la quasi-faillite qui frappa ce pays dissuade la prospection pétrolière et laisse tomber en désuétude l’équipement des puits producteurs ; résultat : l’exploitation est aujourd’hui minime, polluante et délaissée ; un beau succès[9] !
- En 2016, en critiquant l’euro, Stiglitz se trompait aussi : certes, beaucoup de pays de l’Union européenne achètent à l’Allemagne plus qu’ils ne lui vendent ; mais, au sein de l’actuel marché intérieur européen, ces indicateurs n’ont plus le sens qui leur était accordé avant l’effacement des frontières intérieures de l’Europe, avant la libre-circulation et avant l’unité monétaire de la zone euro ! Croyez-vous qu’au sein du marché intérieur américain, unifié depuis plus d’un siècle comme sa monnaie, Stiglitz prêterait autant d’importance à la balance des échanges entre Texas et Californie qu’il le fit entre la RFA, la France ou l’Italie ? Son regard sur l’Europe communautaire est hors cadre ! D’ailleurs, les membres de l’Union européenne (à l’exception de la Grande-Bretagne qui fut toujours à part jusqu’au Brexit, sur ce point comme sur le reste) n’envisagent pas d’abandonner cet acquis !
En pratique, Stiglitz néglige le monde réel lorsqu’il le gène. Ainsi, l’une des questions posées par l’équipe Sarkozy à cet augure, celle d’établir des indicateurs pour décrire l’économie européenne ouverte, n’a pas reçu de réponse, à ma connaissance [10]! Plus grave pour l’économiste qui écrit cet ouvrage, alors qu’il insiste très souvent sur l’importance de la concurrence économique, Stiglitz ne cite pas la très importante novation que les « marchés bifaces » ont introduite dans l’économie numérique : cette innovation procédurale explique l’effet d’échelle et la concentration inéluctable des plates-formes numériques. Elle va de pair avec une autre forme de concurrence, liée à l’innovation technique, qui déstabilise les positions dominantes ; innovation que l’on a vu à l’œuvre souvent en quarante ans : pour les produits informatiques, pour les téléphones portables et pour les moteurs de recherche, notamment. Comment un économiste aussi soucieux que Stiglitz de conforter les marchés concurrentiels, peut-il omettre qu’un changement de paradigme, technique ou commercial, bouleverse un marché aussi concentré que le numérique, bien plus profondément et plus vite que ne peut le faire une institution quasi-judiciaire comme l’autorité de la concurrence (aux États-Unis: la FTC – Federal Trade Commission) ? En occultant, tout simplement, que le marché numérique se transforme en permanence et que des opérateurs et des plates-formes naissent et meurent constamment! Ce que d’autres ont observé, décrit et théorisé depuis plus de vingt ans, Stiglitz l’oublie. Surprenant, vraiment[11] !
Quelques éléments de synthèse.
Comme ses nombreuses publications antérieures, ce nouvel essai n’est tendre ni pour l’Amérique, au sein de laquelle Joseph Stiglitz fut élevé et qui lui offrit beaucoup d’honneurs ; ni pour les entreprises américaines qu’il accable, notamment celles qui ont tenu, au fil des décennies, des positions à peu près inexpugnables dans le monde. Il donne du monde contemporain une vision qui n’est pas libérale ; il fustige ceux qu’il estime être « de droite » ; il voue Trump aux gémonies. Mais révère, en revanche, le président F. D. Roosevelt[12] et son «New deal [13]» qu’il encense, ainsi que le dirigisme qui s’imposa pendant la très longue présidence de FDR dont la durée excessive dérogeait à la tradition. Le 22ème amendement constitutionnel, voté au lendemain du décès de FDR, interdit de répéter cette anomalie : pas plus de deux mandats de quatre ans !
Stiglitz se situe nettement à la gauche de l’échiquier politique américain. Il n’hésite jamais à prendre le parti de l’Amérique latine, de l’Asie ou de l’Afrique ; ni à stigmatiser l’action et les pratiques des banques d’affaires, des multinationales et des prêteurs (liés aux États-Unis, dans son esprit) dont il souligne la « voracité » et « l’égoïsme », particulièrement face aux débiteurs chroniques qui furent incapables d’honorer leurs engagements financiers (comme l’Argentine, qu’il cite souvent ; ou la Tanzanie qu’il évoque aussi), tous pays dont la déroute financière (faut-il le rappeler?) est souvent liée au caractère prédateur de leurs dirigeants.
Bien que de tradition juive[14], Joseph Stiglitz pourrait facilement endosser la sentence du dominicain Lacordaire, fort peu libérale mais toujours vivante dans la vie politique française : « entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit »[15]. Cela explique-t-il la faveur, parfois l’estime que lui accorde une partie de la société politique française, je l’ai signalé à propos du président Sarkozy, plus haut.
La route de la servitude de F. Hayek accusait l’État tyrannique de mépriser le peuple et de saper ses libertés ; de nos jours, Stiglitz prétend qu’à l’ombre de l’étroit nationalisme de Trump, ses partisans et leurs émules préparent le « nouveau fascisme du XXI° siècle » dominé par de gigantesques firmes multinationales (les GAFAM?). Et qu’une social-démocratie féministe, écologiste et pro-active pourrait sortir les États-Unis de l’ornière néo-libérale dans laquelle ils seraient embourbés depuis un demi-siècle. Cette « révolution des esprits » devrait reformater la pensée et l’éducation des jeunes américains (p. 291). Seule une « action collective » pourrait redresser la barre, comme FDR le fit en son temps, en imposant une nouvelle donne « arc-en-ciel » ! Cette proposition converge avec ces universitaires qui labourent les campus depuis des années, interdisant l’accès aux classes et aux amphithéâtres à ceux qui ne pensent pas comme eux, et qui veulent éduquer les masses (à la mode soviétique ou à la chinoise ). Ce progressisme végan, écologique et décroissant, serait assorti d’une discrimination positive (à l’école, à l’université et dans toute la société) ; en faut-il « encore une couche » ?
Depuis plus de trente ans, Stiglitz accuse les grands patrons, les financiers, les initiés des marchés financiers etc. de n’avoir aucune intention altruiste ; il défend la franche politique redistributive que la gauche du parti démocrate aimerait imposer aux États-Unis afin d’y réduire ces « inégalités » qui asserviraient l’Amérique à « une « minorité agissante et cupide », celle des intermédiaires de Wall Street, du Mercantile de Chicago et des gourous de la Silicon Valley ! Inspiré, dit-il, par J. Stuart Mill (p. XVII, p. 195 etc.)[16] notre auteur prétend qu’au XXI° siècle, les seuls vrais défenseurs de la liberté sont ces progressistes qui luttent contre la pollution (industrielle), contre le changement climatique (anthropique), contre la vente libre des armes (aux États-Unis), pour l’avortement (libre et gratuit) et pour que quiconque qui se sent mal dans sa peau choisisse son genre ! En revanche, affirme-t-il, le monde n’est qu’affrontement frontal entre le bien et le mal, « entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur » pour citer à nouveau Lacordaire que Stiglitz n’a probablement pas lu, mais qui pensait comme lui. Esquissé depuis des décennies, ce projet n’est-il qu’un remake de la lutte des classes ? Verrait-il le jour si Kamala Harris devenait présidente des États-Unis ces prochains mois ? Qui vivra, verra !
[1] Un grand succès, littéraire et politique, en 1944-45. Adaptation française : F. A. Hayek : La route de la servitude, PUF, Quadrige, Paris 2013 [éd. originale anglaise : 1944].
[2] Joseph E. Stiglitz, The Road to Freedom: Economics and the Good Society, Norton, New York, 2024, 360 p. (30 US $).
[3] Vargas Llosa remercia Berlin – comme l’on fait Aron, Popper et Revel – de lui avoir ouvert le « chemin de la liberté » (aurait pu dire J.-P. Sartre !): « j’avoue (leur) devoir ma revalorisation de la culture démocratique et des sociétés ouvertes » in : Conférence Nobel, 7 décembre 2010, Stockholm.
[4] Cf. son message sur « l’état de l’Union » le 6 janvier 1941, proche du terme de son second mandat présidentiel : personne ne serait vraiment libre sans s’affranchir de ces deux frayeurs (p. XIV de la préface !).
[5] Véritable oxymore que Stiglitz aligne, sans aucun humour (p. 277)!
[6] Ce livre (p. ex. p. 86-87) évoque souvent John Rawls (1921-2002) : « les économistes esquivent tout débat sur la justice sociale » (p. 210) ; « Rawls peut nous aider à repérer les règles favorables à une société bonne » (p. 283). Sans index, difficile de repérer toutes les mentions de cette icône de l’intelligentzia depuis un demi-siècle. cf. : A Theory of Justice, Oxford Paperbacks, 2005 [ed. originale 1971].
[7] D’innombrables notes sont rassemblées à la fin de l’ouvrage, citant de multiples travaux dirigés par l’auteur, en petits caractères (pp. 299-356), difficilement exploitables sans bibliographie ni index. Des appendices que l’auteur disait déjà inutiles dans un essai précédent (Globalization and its Discontents,WW Norton, 2002 – trad. : La grande désillusion, Fayard, 2002 (pp. 13 & 24). Surprenant, pour un universitaire !
[8] Joseph E. Stiglitz, Jonathan M. Orszag et Peter R. Orszag, “Implications of the New Fannie Mae and Freddie Mac Risk-based Capital Standard,” Fannie Mae Papers, vol. 1- 2, mars 2002.
[9] Rory Carroll, “Nobel economist endorses Chávez regional bank plan,” The Guardian, 11 octobre 2007; Megan McArdle, “Does Hugo Chavez help the poor?,” The Atlantic, 7 mars 2008 ; ainsi que : Peter Foster: “Chavez’s rule was marked by using state oil company as his populist piggy bank,” National Post, 5 mars 2013.
[10] The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W. W. Norton & Company, 2016.
[11] Rochet & Tirole : « Platform competition in two-sided markets », J. Europ. Eco. Ass., vol 1, n°4, p. 990 sq. (2003).
[12] Élu pour quatre mandats ; le dernier ne dura que quelques semaines.
[13] Au sens littéral : une « nouvelle donne » politique, comme la donne d’un jeu de cartes.
[14] Ses biographes le disent rarement ; mais le blog des étudiants de la Columbia Business School, incisif et bien informé, rapporta ce propos : « I had a very strong religious upbringing. In high school I had a personality test done and they said based on my personality: I should be a Rabbi … I have a very strong Jewish background »! in : 2003 UNCOVERED: the most interesting people at Columbia Business School. https://business.columbia.edu/press-releases/cbs-press-release/interview-professor-joseph-stiglitz.
[15] En France, la liberté échappe progressivement au droit naturel : de plus en plus définie par la loi et par les vues du Conseil d’État à qui l’injonction du R. P. Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) convient très bien ! Cf. Œuvres, IV., T. III, p. 494 (52ème conférence à Notre-Dame du 16 avril 1848, intitulée : Du double travail de l’homme).
[16] On Liberty (1859) traduit et édité en France en 1860 chez Guillaumin ; édition moderne chez Folio.