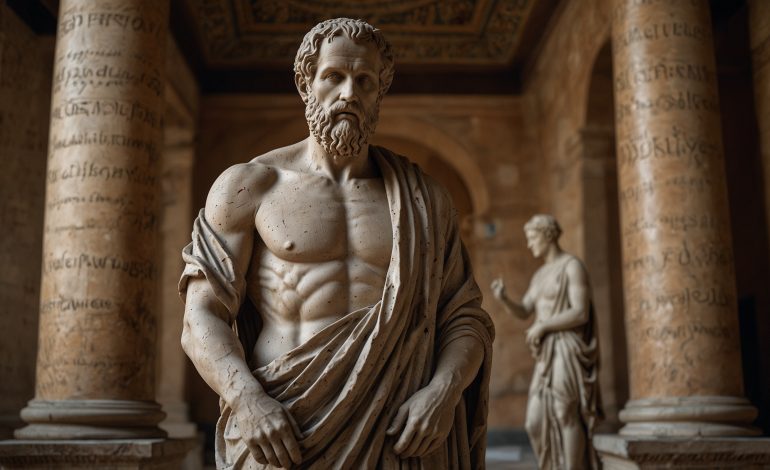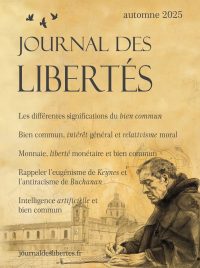Le Dictionnaire de la langue philosophique définit le bien commun comme « l’ensemble des conditions matérielles et spirituelles procurant à une communauté humaine un bien-être favorable au développement harmonieux des individus qui la composent »[1]. Décliné dans sa dimension politique et juridique, il signifie que le pouvoir n’est légitime que s’il s’accorde avec son but[2]. Aux yeux de certains, la notion de bien commun paraît incompatible avec la tradition libérale par sa dimension holistique. Plus encore, les auteurs libertariens rejettent le plus souvent avec horreur la notion de « bien commun ». Ainsi, sous la plume de Ayn Rand, Howard Roark s’exclame :
« Le “ bien commun ” de la collectivité en tant que race, que classe ou qu’État fut le but avoué et la justification de toutes les tyrannies qui furent imposées à l’homme. Les pires horreurs furent accomplies au nom de l’altruisme. La civilisation n’est rien d’autre que le développement de la vie privée. (…) La civilisation n’a d’autre but que de libérer l’homme de l’homme.[3] »

Pascal Salin considère que :
« l’État n’étant que l’expression formelle des rapports de force, il est erroné d’imaginer qu’il puisse définir un quelconque “ bien commun” » ou se constituer en arbitre des intérêts individuels. L’État n’est rien d’autre qu’une abstraction. Il n’est pas doté de volonté et de pensée. Le “ bien commun ” n’est qu’un mythe inaccessible dans la mesure où les buts de tous les membres d’une société sont différents et a priori incompatibles. Ce n’est qu’un formidable alibi, continuellement utilisé par tous ceux qui ont un intérêt personnel à introduire des rapports de force dans le fonctionnement d’une société et d’en tirer profit[4]. »
Et il est évident que lorsque l’on lit les déclarations de Joseph Stiglitz selon lesquelles un « capitalisme progressiste » doit « créer une démocratie vivante où les gens coopèrent pour le bien commun », cela ne risque pas d’accroître la popularité de cette expression…[5]
Pourtant, les pré-libéraux n’étaient pas forcément rétifs à utiliser l’expression. Ainsi, dans son Second traité du gouvernement civil, John Locke fait des gouvernants non plus des autocrates de droit divin, mais des fonctionnaires au service du bien commun qui permettent aux citoyens de s’épanouir pleinement dans le respect de la loi de nature. De même, il présuppose que ceux qui ont le droit d’être consultés sur la résistance à l’oppression, le breach of trust, s’accordent sur une définition du bien commun.
L’« intérêt général »
Il est bien connu que, dans les domaines juridique et politique, la notion de bien commun a été progressivement supplantée par celle d’intérêt général. En effet, le « bien commun » est apparu pour beaucoup comme une notion surannée, coupablement chargée de connotations morales et religieuses. Apparue au XVIIIe siècle, la notion d’intérêt général devient courante à partir de la Révolution française[6]. Là encore, les libéraux sont très rétifs à l’utilisation de l’expression, la substitution de l’intérêt général au bien commun ne changeant rien à l’affaire. Ainsi Pascal Salin peut-il écrire que :
« la prétention à définir un quelconque “ intérêt général ”, différent de l’intérêt de chacun des membres d’une société n’est rien d’autre qu’une escroquerie intellectuelle. La contrainte n’est pas moins contraignante parce qu’elle est légale. (…) L’intérêt général n’existe pas et il ne constitue rien d’autre qu’un alibi pour satisfaire les uns aux dépends des autres[7]. »
Lorsque la Secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, allègue que les grands patrons « n’en ont plus rien à faire de la France, de l’intérêt général » et que leur seul objectif, « c’est l’appât du gain », là encore l’expression a peu de chance d’être attractive aux yeux des libéraux…[8]
Pour nous guider dans les méandres de la notion, il est utile de prendre connaissance d’une étude souvent citée du Conseil d’État consacrée à l’intérêt général en 1999. L’étude distingue de manière contestable deux grandes conceptions de l’intérêt général : l’une d’inspiration utilitariste, l’autre d’inspiration volontariste. La première « ne voit dans l’intérêt commun que la somme arithmétique des intérêts particuliers, laquelle se déduit spontanément de la recherche de leur utilité par les agents économiques ». La seconde, « qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers »[9]. L’étude confond coupablement utilitarisme et libéralisme, mais voici comment elle conçoit plus précisément les deux conceptions qu’elle sépare :
« Dans sa version utilitariste et libérale, la notion d’intérêt général permet de penser l’organisation de la vie sociale sur le modèle de l’activité économique, sans qu’il soit besoin de faire intervenir un pouvoir politique régulateur des relations entre les individus. Dans sa version volontariste et rousseauiste, l’intérêt général ne saurait être obtenu, ni les liens sociaux subsister, sans que l’intérêt personnel ne s’efface devant la loi, expression de la volonté générale, et sans que l’État ne régule la société civile pour garantir la réalisation des fins sur lesquelles cette volonté s’est prononcée. Dans la première approche, l’intérêt général résulte de la conjonction des intérêts particuliers dont il n’est que la somme algébrique. Dans la seconde, l’intérêt général ne saurait subsister sans que les individus n’acceptent, par un contrat social, de faire abstraction de leurs intérêts particuliers[10]. »
Pour le dire d’une autre manière, la première conception « conçoit l’intérêt général comme la synthèse des intérêts particuliers dont il émane », tandis que la seconde le présente « comme un dépassement des intérêts particuliers, qu’il transcende et auxquelles il s’oppose ».[11]
Les libéraux, les intérêts particuliers et l’intérêt général
I – Le XVIIIe siècle
La thématique de l’intérêt général renvoie à plusieurs concepts largement développés par la pensée libérale classique française avec les notions d’intérêt et d’harmonie des intérêts qui renvoient à la célèbre « main invisible ».
Dès le milieu du XVIIIe siècle, Turgot traite des rapports entre le « bien général » et les intérêts particuliers.
« Dans la perspective de Turgot, il n’y aucune place pour un quelconque “ bien commun ” surplombant les individus et s’imposant d’en haut à eux pour juguler et « dépasser » leurs intérêts particuliers comme un tout soumettant les parties à ses exigences propres prétendument supérieures[12]. »
Dès 1759, Turgot anticipe la thèse de la « main invisible » lorsqu’il allègue : « Il est impossible que, dans le commerce abandonné à lui-même, l’intérêt particulier ne concoure pas avec l’intérêt général », ou encore : « l’intérêt particulier abandonné à lui-même produira toujours plus sûrement le bien général que les opérations du gouvernement ». Deux ans plus tôt, il avait déjà écrit : « là où l’intérêt des particuliers est précisément le même que l’intérêt général, ce qu’on peut faire de mieux est de laisser chaque homme libre de faire ce qu’il veut ». Une déclinaison magistrale du « laissez-faire ! ».
Le même thème se trouve sous la plume d’Edmund Burke dont les Réflexions et détails sur la rareté de 1795 contiennent cette phrase toute smithienne : « La Providence oblige les hommes, qu’ils le veuillent ou non, lorsqu’ils poursuivent leur propre intérêt égoïste, à relier le bien commun à leur réussite individuelle ». Un passage qui ne laissera pas indifférent Friedrich Hayek puisqu’il est cité dans le second volume de Droit, législation et liberté en 1976.
Les libéraux, les intérêts particuliers et l’intérêt général
II- Le XIXe siècle
C’est bien la question de l’intérêt général qui retient l’attention de Benjamin Constant lorsqu’il écrit que ce dernier n’est rien d’autre que « la transaction qui s’opère entre tous les intérêts particuliers ». Il ajoute :
« L’intérêt général est distinct sans doute des intérêts particuliers ; mais il ne leur est point contraire. On parle toujours comme s’il gagnait à ce qu’ils perdent. Il n’est que le résultat de ses intérêts combinés, il ne diffère d’eux que comme un corps diffère de ses éléments. Cet intérêt public n’est autre chose que les intérêts individuels, mais réciproquement hors d’état de se nuire[13]. »
Comme toujours, Benjamin Constant développe des principes, mais il a bien en tête des polémiques d’une brûlante actualité. Il vise le dualisme exprimé dans le rapport de Le Chapelier en juin 1791 sur les coalitions ouvrières qui supprime les corporations au motif qu’« il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général ». Constant s’oppose à l’idée jacobine selon laquelle
« la vertu était le moyen supposé par lequel le citoyen, faisant taire en lui toute donnée particulière, pouvait s’élever jusqu’à la volonté générale, à la communion avec le peuple, en théorie, avec le gouvernement révolutionnaire, en fait[14]. »
Constant décline la même idée en s’opposant à la centralisation administrative héritée de la Révolution et de Napoléon : les intérêts locaux sont légitimes dès lors qu’ils ne portent pas atteinte aux intérêts de l’ensemble national, un prélude de la subsidiarité qui ne dit pas son mot[15]. Chantre de l’individualisme méthodologique, Constant traite de la question de l’intérêt général en sa qualité de parlementaire au début de la Restauration. Il définit l’intérêt général comme « la réunion, la conciliation de tous les intérêts privés qui existent simultanément » et il confie qu’il s’est toujours défié de l’expression : « lorsqu’on invoque cet intérêt général, je suis toujours prêt à parier qu’on veut froisser quelque intérêt privé ». Or, les intérêts privés sont les seuls véritables, « puisque la société n’est que l’agrégation des individus privés qui en sont membres »[16].
Au milieu de XIXe siècle, Frédéric Bastiat oppose, d’une part, les socialistes, qui croient à l’antagonisme des intérêts et à leur résolution par l’intérêt général grâce à l’intervention de l’État, et, d’autre part, les économistes, qui s’en remettent à l’harmonie de la nature des hommes et des choses. Par la suite, les libéraux français naviguent entre le rejet de l’expression d’intérêt général et une conception particulière de l’expression, seule acceptable à leurs yeux. En 1863, Edouard Laboulaye marque une défiance absolue envers la notion :
« C’est dans l’intérêt général, dira-t-on, que l’État interdit ou favorise certaines industries. De la hauteur où il est placé, il voit ce qu’il échappe à l’individu. (…) La sagesse de l’État est une chimère. (…) Les hommes qui forment l’administration, si habiles et si clairvoyants qu’on les suppose, en savent toujours moins que l’intérêt particulier. (…) Cet intérêt élastique n’est que le synonyme de l’arbitraire, il ne peut prévaloir contre le droit[17]. »
Même s’il utilise l’expression en plusieurs occurrences, Jules Simon, pour combattre le communisme, se défie de la notion : « C’est une folie de prétendre qu’en substituant l’intérêt général à l’intérêt particulier comme stimulant du travail et la prescription d’un magistrat à la libre vocation du citoyen, vous allez augmenter la masse des produits de la fabrication humaine »[18]. En 1892, le juriste Ernest Martineau consacre un article à « l’intérêt général d’une nation » et aux « intérêts particuliers ». Ce disciple de Bastiat estime que « l’intérêt général se confond avec l’intérêt des hommes au point de vue du consommateur » et ce, pour s’opposer au tarif Méline. « L’intérêt général, conclut-il, c’est l’ensemble, la masse des intérêts particuliers des citoyens envisagés au point de vue du grand public consommateur ». Une conception que Murray Rothbard n’aurait pas validée en considérant que ce qui importe, ce n’est pas la souveraineté du consommateur, mais la souveraineté de l’individu[19].
Quoi qu’il en soit, Martineau reste un authentique libéral alors que Paul Leroy-Beaulieu démontre sur le thème de l’intérêt général comme sur beaucoup d’autres que le libéralisme dérive vers le conservatisme à la fin du XIXe siècle :
« L’État moderne ne conçoit presque jamais les intérêts sociaux sous leur forme synthétique ; il ne les aperçoit que morcelés, dans la situation d’antagonisme les uns avec les autres. Il n’a, pour ainsi dire, jamais en vue que des intérêts particuliers, l’intérêt absolument collectif lui échappe. Il se figure, comme le vulgaire, que l’intérêt général n’est que la somme des divers intérêts particulier, ce qui est une proposition d’ordinaire vraie, mais qui ne peut pas être toujours admise sans réserve[20]. »
Le libéralisme, un relativisme moral ?
Le libéralisme est fréquemment caractérisé comme une volonté de puissance sans borne de la part d’un individu libre de s’affranchir de Dieu, de s’auto-détruire, de flatter les plus vils instincts, de commercer de tout jusqu’aux êtres et aux choses les plus immondes. Il ne serait pas seulement l’amoralisme du marché, mais un immoralisme complet avec une autonomie de la volonté poussée à son acmé et dont l’illustration extrême serait le droit de consentir à son propre esclavage. Le libéralisme serait donc une déclinaison du relativisme, cette doctrine qui affirme la relativité de la connaissance et par conséquent des normes d’action[21].
Deux auteurs, qui ne sont d’ailleurs pas des libéraux, ont fait litière de l’appariement entre libéralisme et relativisme. Dans son remarquable ouvrage consacré à Benjamin Constant, le juriste américain Stephen Holmes écrit : « On accuse souvent le libéralisme d’avoir abandonné la quête antique de la vie conforme au Bien pour se contenter de la poursuite matérialiste du confort et de la simple survie. Mais cette accusation n’est qu’un travestissement de la pensée libérale. Les libéraux ont en fait simplement décentralisé cette quête »[22]. Quant à Raymond Aron, il avait distingué en 1969 la liberté libérale de la liberté libertaire, prônée par la « nouvelle gauche » dans le contexte de l’après-mai 1968. Or, ce n’est pas parce que les libéraux ont attaché leur nom à la liberté de l’individu qu’ils acceptent un quelconque relativisme moral. Ils refusent simplement, au grand dam des conservateurs, toute morale qui serait imposée par une autorité, fût-elle démocratiquement élue. Selon Aron, le libéralisme souffre de « la peur des responsabilités que l’ordre libéral impose à tous. Car l’ordre libéral laisse à chacun la charge de trouver, dans la liberté, le sens de sa vie »[23].
L’individu est apte à se forger un destin qu’il s’est choisi et à rechercher son bonheur, ainsi que le proclamaient les révolutionnaires américains en 1776. Il faut, remarque Hayek en 1960, un certain degré d’humilité pour laisser les autres effectuer cette recherche à leur guise. Le libéralisme attache son nom à la tolérance et il ne saurait empêcher que certains soient relativistes. Il sépare soigneusement la sphère du droit de celle de la morale, limitée aux seules consciences individuelles, afin d’éviter tout contrôle social sur l’individu, et tout moralisme, afin de décharger l’individu du poids des autorités morales, politiques et religieuses.
[1] Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, P.U.F., 6ème éd., 1992, p. 72.
[2] François Rangeon, v° « Bien commun » in Pascal Mbongo et.al. (dir), Dictionnaire encyclopédique de l’État, Berger-Levrault, 2014, p. 88.
[3] Ayn Rand, La source vive, trad. Jane Fillion, Plon, 1997, p. 677.
[4] Pascal Salin, Libéralisme, Odile Jacob, 2000, p. 122.
[5] Joseph Stiglitz, entretien, Libération, 22 janvier 2025.
[6] François Rangeon, v° « Intérêt général » in Pascal Mbongo et. al., Dictionnaire encyclopédique de l’État, op. cit., p. 553.
[7] Pascal Salin, op. cit., pp. 86 & 259.
[8] Sophie Binet, Entretien, RTL, 31 janvier 2025.
[9] Conseil d’Etat, Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998. L’intérêt général, La Documentation française, Études & Documents, n° 50, 1999, p. 245.
[10] Ibid., pp. 248-249.
[11] François Rangeon, v° « Intérêt général » in Pascal Mbongo et. al., op. cit., p. 553.
[12] Alain Laurent, « Turgot : le vrai sens de “ laissez-faire ! ” » in Alain Madelin (dir.), Aux sources du modèle libéral français, Perrin, 1997, pp. 65-78.
[13] Benjamin Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, Henri Grange (éd.), Aubier, 1991, VI, 9, p. 309. Le passage se retrouve de manière identique dans ses Principes de politique in Id., Écrits politiques, Marcel Gauchet (éd.), Gallimard, 1997, p. 355.
[14] Lucien Jaume, « Le problème de l’intérêt général dans la pensée de Benjamin Constant » in Françoise Tilkin (dir.), Le Groupe de Coppet et le monde moderne, Liège, Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, 1998, pp. 159-176.
[15] Ibid., p. 6.
[16] Benjamin Constant, Session des chambres de 1810 à 1819, VI, « Discussion sur le projet relatif aux pétitions » in Id., Cours de politique constitutionnelle, 3ème éd. par J.P. Pagès, Bruxelles, Société belge de librairie, 1837, pp. 369-370.
[17] Edouard Laboulaye, Le Parti libéral, son programme et son avenir, Michel Leter (éd.), Les Belles Lettres, 2007, pp. 76-77 & 131.
[18] Jules Simon, La Liberté civile, Hachette, 3ème éd., 1867, p. 107.
[19] Ernest Martineau, « L’intérêt général d’une nation et les intérêts particuliers », La Nouvelle Revue, 1892, t. 77.
[20] Paul Leroy-Beaulieu, L’Etat moderne et ses fonctions, Guillaumin, 3ème éd., 1900, p. 70.
[21] Paul Foulquié, op. cit., p. 629.
[22] Stephen Holmes, Benjamin Constant et le libéralisme moderne, trad. Olivier Champeau, P.U.F., 1994, p. 182 (nous soulignons). V. Jean-Philippe Feldman, « Le constitutionnalisme selon Benjamin Constant », Revue française de droit constitutionnel, n° 76, octobre 2008, pp. 680-681.
[23] Raymond Aron, « Liberté, libérale ou libertaire ? » in Id., Études politiques, Gallimard, 1972, p. 273 (nous soulignons).