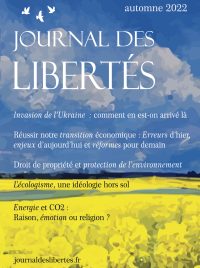L’épuisement des ressources en pétrole, la peur de manquer d’énergie, la surpêche, la disparition des grands mammifères, les menaces sur la biodiversité (faune et flore), la destruction des paysages naturels, la pollution de l’air, des océans et des sols, et l’accumulation de déchets non dégradables à court terme ainsi que l’effet de l’émission de gaz à effet de serre à l’origine du dérèglement climatique et de ses perspectives funestes d’une disparition de la vie sur terre sont autant de sujets qui occupent l’actualité, et hypothèquent la qualité de vie des générations présentes et futures. Cette hypothèque est autant subjective et mentale qu’objective. Elle limite l’insouciance et favorise la violence.

Jusqu’à présent, les gouvernements de gauche comme de droite ont suivi des politiques très similaires pour faire face à ces problèmes. Ils cherchent, disent-ils, à profiter des bienfaits du capitalisme sans en subir ses maux environnementaux. Pour cela ils renforcent la régulation des marchés. Dans cette perspective, la réglementation et la fiscalité sont les deux principaux instruments utilisés pour traiter des questions environnementales. L’outil fiscal reste, cependant, très marginal en France par rapport à l’outil réglementaire qui est de fait le principal instrument d’intervention de la puissance publique en matière environnementale. De tels politiques sont fondés sur la croyance que les défaillances des marchés constituent l’unique source des risques environnementaux et que l’État est la seule organisation capable de résoudre les problèmes environnementaux. Elles partent donc du principe que les seules solutions envisageables passent par la coercition.
Ce que souhaite rappeler cet article c’est qu’il existe de nombreuses raisons de ne pas avoir confiance dans les solutions publiques pour traiter des problèmes environnementaux. Il est l’occasion de faire connaître ou de rappeler les conclusions de la nouvelle économie des ressources et en particulier le fait que l’État est trop souvent un pompier pyromane qui évince les solutions privées qui auraient émergé s’il n’était pas intervenu. Au lieu de faire, les hommes politiques devraient faire faire. Ils devraient avoir l’humilité de déléguer la gestion des problèmes environnementaux à une société civile qui aurait repris confiance dans l’institution pivot des ordres décentralisés : la propriété. L’article s’organise de la manière suivante. Il présente succinctement l’histoire et les principales contributions de la nouvelle économie des ressources (1) puis montre par quelques exemples pourquoi il est juste de traiter l’État de pompier pyromane en matière d’environnement mais aussi pourquoi le recours à la réglementation s’avère inefficace pour traiter l’ensemble des problèmes environnementaux (2). Il propose pour cette raison une liste de mesures de politique publique alternatives qui font confiance aux institutions du marché et à ses entrepreneurs (3).
1. La Nouvelle économie des ressources : 30 ans de recherche à l’ICREI
La nouvelle économie des ressources (« new natural resource economics ») apparaît aux Etats-Unis dans la deuxième moitié des années 1970 (Stroup, 1990[1]) dans les Universités du Montana, et de Californie (UCLA). Elle se dressait contre la théorie du développement durable, qui inspire la plupart des politiques publiques des pays développés et de la France en particulier, et contre l’écologie politique qui affirme que pour résoudre les problèmes environnementaux il faut sortir du capitalisme. Cette nouvelle économie des ressources a aussi pris le nom d’écologie de marché (« free market environmentalism »).
Les Professeurs John Baden (Montana State University), Richard Stroup (Montana State University puis North Carolina State Univ.), Terrey L. Anderson (Montana State Univ.), Donald R. Leal (California State Univ., Hayward), et Randy Simmons (Utah State Univ.) en sont les initiateurs[2]. Ils avaient l’ambition de montrer que le marché et la libre entreprise sont les solutions aux maux environnementaux des sociétés contemporaines.
Cette innovation intellectuelle s’est diffusée en Europe et en France en particulier via l’initiative du Liberty Fund qui en septembre 1985 a organisé un séminaire aux Université d’été de la Faculté de droit de l’université d’Aix-Marseille qui donnait la parole aux défenseurs de cette nouvelle manière de penser les problèmes d’épuisement des ressources naturelles et de qualité de l’environnement. De ce premier contact est né en 1992 le Centre International de Recherche sur les Problèmes Environnementaux (ICREI[3]) à l’initiative de l’ancien ministre Alain Madelin et d’un groupe d’économistes et de juristes français qui se proposait d’utiliser la nouvelle économie des ressources naturelles pour renouveler les débats autour de la protection de l’environnement en France. Trois auteurs ont porté ce message. Henri Lepage dans son livre Pourquoi la Propriété y consacre tout un chapitre « Capitalisme et écologie : privatisons l’environnement » (Lepage (1985[4]), Max Falque dans un article de la revue Futurible (Falque 1986[5]) et le Professeur Gérard Bramoullé (1991) dans son pamphlet La Peste verte qui évoquait les limites et les effets pervers de la violation des droits de propriété (Falque 2018[6], p.28).
Sans pouvoir dans les limites de cet article résumer 30 années de recherche sur ces thématiques on peut cependant en rappeler les principaux résultats.
La première leçon de ces travaux est qu’historiquement les systèmes économiques qui ne reconnaissent ni la propriété privée, ni la liberté d’entreprendre, ni l’économie de marché, ont engendré des désastres écologiques, comme le montre notamment l’exemple soviétique[7]. Il est important de le rappeler à tous ceux qui souhaiteraient verdir la planification pour en faire une alternative au capitalisme et aux politiques de développement durable.
La seconde leçon est que le développement économique n’est pas incompatible avec la qualité de l’environnement. Il est au contraire une condition des bonnes performances environnementales d’un pays[8]. Outre les fameux débats autour de la courbe de Kuznets environnementale, une recherche récente menée sur soixante-sept pays met au jour une corrélation positive entre entrepreneuriat d’opportunité (fondé sur la liberté d’entreprendre) et performance environnementale[9]; un autre travail, mené sur soixante-dix pays et trois continents (Amérique latine, Asie, Afrique), montre que le niveau de déboisement est plus élevé, en moyenne, dans les pays où les libertés civiles et politiques sont les plus faibles[10].
La troisième leçon est que la propriété privée est favorable à la protection de l’environnement[11], car elle encourage l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat vert en particulier. L’entrepreneuriat est le génie du développement économique, et rend ainsi socialement soutenable les contraintes qu’imposent la protection de la nature sur les choix individuels. A ce premier dividende de la propriété s’ajoute le fait qu’un bon régime de propriété crée des mécanismes de sanction et de récompense qui limitent la surexploitation des ressources naturelles (eau, air, faune, flore, paysage, etc.). Une ressource qui n’appartient à personne est en effet condamnée à être surexploitée et rapidement épuisée. A ce second dividende s’en ajoute un troisième. Un bon régime de propriété rend le pollueur responsable des dommages qu’il provoque.
La quatrième leçon est que l’État est souvent un « pompier pyromane ». L’État peut-être la solution, mais il peut aussi être le problème. Penser qu’il suffit de traduire l’impératif écologique dans la loi et les règlements pour aligner le comportement des hommes et des entreprises est une erreur funeste, car, ainsi qu’il le fait face à la contrainte fiscale, l’homme cherchera toujours à éviter les coûts que représentent une interdiction ou une contrainte réglementaire. Il ne suffit pas de produire des lois pour changer les comportements.
La cinquième leçon est que, face aux problèmes environnementaux, il est urgent de faire confiance aux mécanismes de coordination des ordres décentralisés. L’inefficacité des politiques publiques en matière d’environnement ne doit pas conduire, en effet, à conclure qu’il ne faut rien faire pour l’environnement[12]. Il faut au contraire que tous les citoyens qui pensent que la protection de l’espèce humaine et la bonne exploitation des ressources naturelles sont des objectifs justes s’engagent dans le verdissement de leur consommation, et de la production et acceptent la privatisation de la nature. Ils doivent être favorables au développement économique et à un régime de propriété qui privilégie la propriété privée ou la propriété commune avec accès fermé ou réglementé.
Comme nous ne pouvons pas traiter chacune de ces propositions nous allons focaliser notre attention sur les défaillances de l’État (2) et dessiner les contours de solutions concrètes qui peuvent avantageusement remplacer les solutions réglementaires et coercitives qui dominent les débats et les choix de politiques publiques depuis les années soixante-dix (3).
2. L’Etat et l’aggravation des problèmes environnementaux
Contrairement à une croyance très populaire, l’Etat n’est pas toujours le garant de l’environnement. Il a en fait souvent été à l’origine de sa destruction[13]. La réglementation n’est pas la solution et l’Etat cherche souvent à corriger des maux qu’il a lui-même aggravés ou suscités.
A l’origine de ces défaillances de l’Etat se trouve l’intérêt des responsables politiques et administratifs qui est plus dans l’accroissement de leur pouvoir que dans le bonheur des citoyens. Ceci est particulièrement vrai en matière d’environnement où l’on doit considérer le long terme et non les prochaines élections. C’est pourquoi le principe de précaution devrait s’appliquer en priorité à l’action de la puissance publique qui est par nature irresponsable en ce sens que, à la différence des entreprises et des individus, les États fonctionnent de telle manière que ce n’est jamais celui qui a pris une décision qui en subit les conséquences, bonnes ou mauvaises. Le risque est en effet réel d’une instrumentalisation des problèmes environnementaux par les élus, et par certains groupes d’intérêt. Lorsqu’ils parviennent à leur fin il en résulte une incohérence inter-temporelle dans les décisions et, in fine, une aggravation des problèmes. A l’origine de ces défaillances de l’Etat il y a la myopie (volontaire) des hommes politiques qui servent l’intérêt des électeurs et non celui des générations futures et l’alliance entre les « pro-environnement » et des groupes industriels qui voient dans l’environnement un moyen d’augmenter leurs parts de marché[14]. Les normes environnementales pour certains patrons sont des moyens de lever des barrières à l’entrée sur leurs marchés.
La réglementation n’est pas la solution
L’inefficience de la réglementation, ici du droit de l’environnement est un constat commun aux libéraux et aux interventionniste[15]. Contrairement aux interventionnistes, cependant, les libéraux soutiennent que l’inefficience du droit de l’environnement est la conséquence du non-respect de règles fondamentales. (Ce que récusent les interventionnistes et l’ancienne ministre de l’environnement, Corinne Lepage (2008), en particulier.) Pour les libéraux, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme qui sont des extensions du droit public sont en grande partie inapplicables car trop complexes. Ce droit est aussi à l’origine d’un phénomène d’expropriation réglementaire qui crée les conditions de la dépravation de la vie publique. Le problème – contrairement à ce que suggèrent les dernières annonces du Ministre de l’intérieur qui s’engage à investir massivement dans une gendarmerie verte[16] – n’est pas une mauvaise application de la règle de droit, mais bien l’imposition de règles défaillantes. Cela justifie un rétablissement des droits des propriétaires.
Comme toute réglementation publique, le droit de l’environnement induit des coûts de définition et de mise en œuvre. Logiquement, plus il y a de règles plus ces coûts sont élevés et plus les risques de non-application sont grands. Ce risque n’est pas le seul. S’y ajoute l’action des propriétaires qui cherchent à éviter, comme on évite l’impôt, les coûts que l’Etat leur fait supporter. Ces mêmes propriétaires cherchent aussi dans certains cas à tirer profit du droit de l’environnement pour valoriser leur capital, souvent au détriment des autres propriétaires. L’échange dans la sphère du politique n’est en effet pas gagnant – gagnant : ce que gagne les uns est perdu par les autres. De tels comportements de la part des propriétaires s’expliquent par le fait que le droit de l’environnement, comme toutes les politiques réglementaires, ouvre la voie i) à une inégalité de traitement entre les propriétaires fonciers, ii) à la corruption et iii) en fin de compte à l’inefficacité de la protection de l’environnement (Falque 2008, p.50).
Le zonage par exemple est plus écologique qu’urbain. Il confère une plus-value au terrain constructible. Il provoque une moins-value pour les espaces protégés. Il crée une situation d’expropriation réglementaire. Un zonage a de plus une durée de vie limitée. Les changements de majorité dans une municipalité mais aussi les efforts déployés par les propriétaires pour influencer les politiques expliquent cet état de fait. L’inefficacité finit par prévaloir car personne ne croît à la pérennité des documents d’urbanisme (ce que traduit le marché foncier par une non-conformité des prix aux contraintes de zonage). L’influence politique des propriétaires peut se faire directement par l’engagement dans la vie politique locale. Elle peut aussi prendre des formes illégales. La corruption des élus ou des agents publics est une conséquence attendue des politiques réglementaires[17]. En 2006 selon le classement de l’ONG Transparency International la France était placée au 18e rang en 2021 et 22e rang aujourd’hui. L’Italie et la Grèce restent les pays les plus corrompus d’Europe derrière la France, mais alors que l’Italie était au 55e rang en 2012, elle est désormais placée au 42e rang. De la même manière, la Grèce qui était au 80e rang est passée en 2021 au 49e rang[18]. La multiplication des réglementations environnementales participe à la corruption générale.
La théorie économique a depuis longtemps expliqué l’origine de ce lien entre corruption et bureaucratisation de l’économie[19]. La réglementation crée les conditions de profits inattendus. Ces profits n’existent que parce que les individus peuvent devenir des « faiseurs de règles ». Ils peuvent grâce à leur action politique modifier les prix, la qualité et/ou les quantités de marché. Les nouvelles règles du jeu qu’ils imposent aux autres joueurs induisent alors pour tout le monde de nouvelles occasions de pur profit, mais aussi la disparition d’autres occasions de profit qui, en l’absence de changement dans les règles du jeu, auraient existé[20]. Parmi les opportunités de profit résultants de l’intervention réglementaire de l’Etat il y a bien sur celles qui passent par la corruption des hommes politiques et des administrations publiques. La corruption accroît les coûts de la protection légale des droits de propriété[21]. Les coûts réglementaires sont alors concentrés sur les propriétaires et les citoyens qui n’ont pas cherché à corrompre les pouvoirs publics et/ou à influencer les choix réglementaires des élus.
L’Etat est souvent un pompier pyromane
L’action des pouvoirs publics n’est pas seulement fondée sur un mauvais instrument, la réglementation. Elle est aussi défaillante parce qu’elle varie dans le temps au gré des modes et des préférences politiques des élus. L’action de l’Etat n’a aucun cohérence intertemporelle. L’Etat prend alors la figure du pompier pyromane. La figure de l’Etat pompier pyromane peut être illustrée par de nombreux exemples. Les effets ambigüs et controversés des politiques publiques en sont les conséquences[22].
Il est important avant toute chose de rappeler que la production publique n’est pas moins polluante que la production privée. Les camps d’entrainement militaires sont à l’origine d’importantes détérioration de la qualité des sols. Le traitement des déchets nucléaires est une source éternelle de pollution, malgré toutes les précautions prises, et cela sur des millions d’années.
Avant d’être pro-environnement, l’Etat a longtemps été pro-développement, pro-industrie. Les conséquences réelles de ces choix sur le développement ne peuvent pas être traitées ici, mais ce qu’il faut comprendre pour notre sujet c’est que ce goût pour l’industrialisation a justifié de nombreuses décisions qui allaient à l’encontre du caractère absolu de la propriété privée[23]. L’Etat a ainsi favorisé, probablement sans le savoir, la dégradation de l’environnement. Un exemple emblématique de ce lien entre action publique et dégradation de l’environnement peut être donné : Le décret de 1810 sur les établissements insalubres. Celui-ci est souvent présenté comme la première décision politique censée lutter contre la pollution. Il est en fait un moyen pour les grandes industries polluantes de se soustraire à la règle de responsabilité qui impose à chaque riverain de payer les dommages qu’il inflige à autrui. C’est parce que l’Etat a progressivement assoupli la règle de responsabilité que les industriels ont pu déplacer une partie des coûts de leur décision sur les autres. Cela signifie que l’industrialisation, sous un autre régime de responsabilité, aurait revêtu un autre aspect. L’Etat en limitant les droits de propriétaires a favorisé les activités polluantes. Lorsque l’Etat met en place une règle pollueur-payeur il ne fait en ce sens que corriger une partie de son erreur. Il est bien un pompier pyromane.
De manière assez similaire, avant d’être agri-environnementale, la politique agricole a été productiviste. Le volume de la production par hectare était l’objectif ultime[24]. La conséquence fût la destruction des haies, et des zones humides et le financement public de l’irrigation afin d’augmenter la surface agricole utile. Toutes ces mesures ont participé à la baisse de la biodiversité en détruisant en partie l’habitat de nombreuses espèces. Lorsque l’Etat subventionne la reconstitution des haies, et des zones humides il ne fait que corriger l’effet de ses propres choix. Il se comporte bien en pompier pyromane.
La destruction des haies (bosquets, boqueteaux, arbres épars, bandes enherbées des chemins) a été subventionnée par les autorités politiques alors que la haie est désormais présentée par les écologues comme un lieu de biodiversité. Une haie est une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes et arbrisseaux, sous-arbrisseaux et autres plantes. Les politiques de remembrement des années 1960 en France ont réduit considérablement le nombre de kilomètres de haies en France. Ces politiques étaient justifiées par la modernisation des pratiques agricoles. Il s’agissait alors d’augmenter les rendements et la SAU. La conséquence fût entre autres la suppression des haies, des talus, des fossés et tout ce qui pouvait limiter la mécanisation. L’Institut Français de l’Environnement (IFN) estime que le linéaire de haies en France est passé de 1 244 110 km à 707 605 km entre les deux premiers cycles de l’inventaire IFN séparés de 12 ans (1975-1987), soit une perte annuelle d’environ 45 000 km de haies sur cette période. Il est estimé qu’entre 1960 et 1990 536 000 kilomètres de haies boisées ont disparu. Sans le savoir l’Etat a subventionné la destruction de l’habitat de nombreuses espèces et in fine accru les dangers d’une baisse de la biodiversité. Aujourd’hui des aides publiques à la reconstitution des haies sont proposées aux agriculteurs[25]. Là encore l’Etat est un pompier pyromane. Il aide à détruire les haies puis à les reconstituer.
L’Etat a aussi aidé les agriculteurs à assécher les zones humides afin d’accroître la surface agricole utile et réaliser ainsi l’objectif d’autosuffisance alimentaire. Longtemps, les zones humides ont été associées à des aires maléfiques, des lieux dangereux[26]. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe siècle, les représentations sociales négatives de ces zones persistent. Les scientifiques, médecins, géographes, etc. associent zone humide et maladie[27]. Il était souhaitable dans ces conditions d’assécher les zones humides et de leur donner un usage agricole. C’est ce que l’Etat et les propriétaires fonciers ont fait à partir du XVIIIe siècle et durant quasiment tout le XXe siècle avec un droit rural très favorable à l’assèchement, à l’assainissement et à la conquête agricole. Depuis bientôt 40 ans cependant, à travers notamment la signature de la convention internationale de RAMSAR, les États ont changé d’objectif. Ils se proposent de protéger les zones humides. Ils cherchent donc à corriger ce qu’ils ont autrefois encouragé[28]. Il y a incohérence intertemporelle.
On peut étendre notre histoire à l’industrie. Les subventions versées durant des années aux charbons, à la sidérurgie, ont été à l’origine d’importantes pollutions et de dégradation de l’environnement. On pourrait penser qu’il s’agit d’une histoire ancienne, mais si on en croît un rapport récent du Fonds Monétaire International[29] les États dans le monde subventionnaient la production et la combustion de charbon, de pétrole et de gaz à hauteur de 5 900 milliards de dollars (5 100 milliards d’euros) en 2020. Ces aides publiques jettent, selon les mots de ces experts, de l’huile sur le feu de la crise climatique. Aujourd’hui encore, lorsque les municipalités des communes côtières financent par l’impôt des travaux visant à limiter les effets de l’érosion maritime pour protéger le bâti, lorsque l’Etat subventionne les assurances afin de traiter des catastrophes naturelles et de restaurer les plages, les pouvoirs publics réduisent les coûts que devront supporter ceux qui construisent dans les zones humides, les plaines inondables et sur les zones côtières fragilisées par la montée des eaux. Elles engagent des ressources qui favorisent des comportements non écologiques.
De manière très similaire, la politique fiscale peut, elle aussi, induire des comportements destructeurs de l’environnement alors que de nombreux experts cherchent à nous convaincre que l’écotaxe est la solution à de nombreux problèmes environnementaux. L’impôt sur l’héritage favorise par exemple le morcellement des terres. Les familles qui héritent d’un important patrimoine foncier et qui ont de faibles revenus sont généralement dans l’obligation de vendre leur propriété, ce qui provoque son morcellement et parfois son abandon, car de petites parcelles de forêt ou de prairie n’ont pas un rendement suffisant. Une baisse du taux d’imposition pourrait éviter ce type d’enchainement.
Tous ces exemples montrent qu’avant d’obliger les consommateurs et les producteurs à ne pas polluer, à ne pas dégrader l’environnement, à être sobre, l’Etat devrait s’assurer qu’il est lui-même exemplaire (non pollueur, non destructeur et sobre). Le premier message de l’écologie de marché est donc qu’avant de contraindre les agents de la société civile, l’Etat doit faire en sorte de ne pas polluer et de ne pas inciter les entreprises à avoir de mauvaises pratiques. Le second message de l’écologie de marché est que l’intervention réglementaire en matière d’environnement crée les conditions d’une dépravation de la vie publique sans pour autant protéger l’environnement puisque les règles sont sous influence. Les puissants peuvent les éviter, seuls les citoyens moins intrigants ou ayant un capital social faible supportent ces coûts. Une telle dépravation favorise le populisme et entretient la crise de la démocratie. Il serait souhaitable dans ces conditions de s’engager dans un large mouvement de dérèglementation. Le troisième message de l’écologie politique est qu’il faut rendre de la cohérence aux choix de politique publique. L’Etat ne doit plus soutenir financièrement des pratiques pour en suite les interdire ou les limiter par des lois et des règlements. Il faut simplifier (réduire le nombre des lois et des règlements), mais aussi chercher plus de cohérence.
4. Replacer l’initiative individuelle au cœur de la gestion des problèmes environnementaux
L’écologie de marché n’a pas qu’un message critique. Elle est aussi très optimiste. Elle estime que, face à tous les problèmes environnementaux cités en introduction, les solutions les plus durables reposent sur le système des prix (propriété privée) et/ou la coopération volontaire autour de régimes de communs dont l’accès est limité par des règles propres à chaque communauté de propriétaire de nature privée et volontaire.
Là encore il est difficile de traiter de chaque solution de manière détaillée mais on peut ici proposer un tour d’horizon qui devrait suffire à convaincre de la pertinence des prescriptions de la nouvelle économie des ressources.
Pour faire face à l’épuisement des ressources en énergie fossile il faut accepter dans une première phase la hausse des prix afin d’intéresser, d’une part, tous les entrepreneurs à l’innovation et de rendre, d’autre part, les solutions alternatives économiquement viables[30]. Un entrepreneur vert ou environnemental est une personne qui trouve des moyens pertinents et novateurs afin de transformer les problèmes environnementaux en atouts, en recourant aux droits de propriété et au marché[31]. Sous cette définition on comprend que l’entrepreneur verdit sa production dès lors qu’il perçoit une opportunité de gain dans le verdissement de la consommation et/ou de la production. Si verdir le processus de production devient un argument de vente, les innovateurs se positionnent pour proposer des procédures de production plus vertes. Ce qui, mécaniquement, verdit la consommation. Lorsque les ressources viennent à manquer, il devient rationnel de réduire leur usage pour faire face à l’augmentation des prix. Là encore tout ce qui permet d’économiser l’usage des ressources naturelles intéressera l’entrepreneur. Tout ce que doit faire l’Etat c’est de ne pas bloquer ces évolutions par des interdictions réglementaires ou de manière plus insidieuse par des subventions publiques à des pratiques obsolètes.
Face au réchauffement climatique les agents économiques doivent avoir les moyens de s’adapter. Le signal prix est une aide essentielle pour bien accomplir cette tâche. Ils doivent aussi pouvoir prévenir ses maux par i) la mise en place d’institutions favorables au travail de l’intelligence collective, et au progrès technique, ii) par le démantèlement de toutes les politiques publiques qui subventionnent les activités émettrices de gaz à effet de serre, iv) par l’entrepreneuriat et v) par les recherches sur la judiciarisation des émissions de CO2 [32].
Face à l’accumulation de déchets l’objectif ne doit pas être le zéro déchet, mais de gérer de la manière la plus économe possible les déchets produits. Dans cette optique, la meilleure solution est de se rapprocher lau plus près des mécanismes de marché afin que chacun soit responsable de ses déchets et ne soit pas incité à produire des déchets qui sont des désutilités pour tout le monde. Le bon déchet est celui qui peut être transformé. Il sera alors approprié par ceux qui en tirent le plus grand bénéfice, en parvenant à le transformer à moindre coût. Ce principe conduit à soutenir i) le démantèlement du monopole municipal sur la collecte des déchets industriels et commerciaux afin de promouvoir un strict principe de responsabilité des propriétaires (ménages et entreprises), ii) la tarification au volume (« pays as you throw ») et l’abandon de la TEOM, et iii) la privatisation des décharges et/ou iv) la mise en place de permis négociables de décharge ou de certificats de valorisation des emballages échangeables afin de se rapprocher des mécanismes marchands[33].
Face aux menaces sur la biodiversité (faune et flore) – le combat du siècle ? – les solutions ne devraient pas être plus d’impôts et plus de règlements (interdiction), mais plus de développement économique autrement dit plus de propriété afin i) de faire passer les biens environnementaux d’un statut de bien de luxe à la catégorie des biens normaux; ii) d’accroître le prix d’accès à la nature et d’en rationner son usage et iii) de rendre responsable toute personne qui détruit une ressource naturelle sans le consentement de son propriétaire. C’est parce que la nature n’appartient à personne qu’elle est détruite[34].
Le cas des ressources halieutiques
Face à la surpêche la France devrait imiter les politiques mises en œuvre en Islande, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande et donner le droit aux producteurs d’échanger leurs quotas[35]. Les quotas individuels transférables (QIT) ont fait leur preuve en Islande et dans plusieurs pays du Pacifique. En 1990 l’Islande a en effet instauré une politique de gestion des ressources marines par Quotas individuels transférables Individual fishing quotas (IFQ) ou catch shares. La Nouvelle-Zélande et l’Islande ont été les deux premiers pays à avoir instauré une politique de gestion des ressources marines par QTI. Ils s’inspirent des thèses de la nouvelle économie des ressources (market-based fisheries management). La Nouvelle-Zélande a instauré ce régime en 1986 et l’Islande en 1990. Cette politique repose sur la distribution de quotas. Le quota consiste à fixer un montant de prise maximum, à diviser ensuite ce montant par le nombre de pêcheurs et à les attribuer. Elle est critiquable à ce titre, car personne ne peut vraiment connaître le bon niveau de quota et leur distribution peut être à l’origine d’importantes inégalités. Ces réserves admises, les quotas permettent par principe de réduire le montant des prises. Ils rationnent par un permis de pêche. Les QTI rapprochent encore un peu la pêche en mer du marché, car chaque pêcheur, détenteur d’un quota, peut l’utiliser (pêcher), le louer ou le vendre selon les législations. Le pêcheur n’est plus incité à pêcher le maximum de poisson de peur que les autres vident la mer avant lui. Le caractère transférable du quota accroît son efficacité, car les pêcheurs les moins performants ou qui ne réussissent pas à atteindre leur quota de pêche peuvent céder leurs droits. Les QTI incitent ainsi les pêcheurs à ménager la ressource halieutique. Ils gèrent leur quota comme un fonds de commerce. Il cherche à en accroître la valeur afin de les revendre au mieux. Les premières évaluations sont plutôt favorables au QTI. Sur la période 1950-2003 et des données portant sur 11.135 pêcheries il a été constaté que l’instauration des QTI a permis de limiter l’effondrement des stocks de poisson concernés par les QTI[36].
Ce résultat ne doit pas cependant conduire à penser que les QTI sont la solution miracle[37]. Les quotas ont, tout d’abord, tendance à faire baisser les profits des entreprises. Le nombre des individus qui peuvent vivre de la pêche diminue et le secteur de la pêche a mécaniquement tendance à se concentrer. Le nombre de bateaux baisse ce qui mécontente tous ceux qui craignent ne plus pouvoir vivre de la pêche. La politique des quotas, indépendamment de leur transférabilité, protège de plus seulement les espèces pour lesquelles il y a des quotas. Elle néglige les espèces non commerciales et sans rationnement. Les pêcheurs respectent les quotas, mais lors de leur chalutage remontent des poissons accessoires ou non commercialisables. Cela peut mettre en danger ces espèces qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l’écosystème marin. La disparition de ces espèces accessoires non protégées déséquilibre l’écosystème et menace la pêche des espèces pour lequel a été mis en place une politique de quotas car elles sont pêchées et rejetées mortes[38]. La solution est une extension des quotas aux espèces accessoires. C’est ce qui a été fait sur la Côté Ouest des Etats-Unis. L’impossibilité de contrôler à quai le nombre des poissons pêchés puisqu’ils ne sont pas commercialisables a cependant rendu nécessaire une surveillance sur les chalutiers. Les pêcheurs savent ainsi que s’ils vont au-delà des quotas qui leur ont été attribués ils devront en racheter – ce qui a un coût et limite leur marge – ou rester cloués à quai. Ils ont donc intérêt à limiter la surpêche de toutes les espèces listées et/ou de limiter le nombre de sorties afin d’étaler sur l’année leur activité et de se donner les moyens d’ajuster leur pêche à l’état du marché des droits de pêche et du poisson.. Les droits de propriété sous forme de droit de pêche incitent donc les pêcheurs à utiliser leur connaissance du milieu et à modifier leur pratique pour minimiser leur coût, maximiser leur profit et réduire la surpêche. Tout ce qui augmente le coût d’accès à la ressource limite sa surexploitation. Ces réserves légitimes – à propos de la définition des quotas, de leur distribution et des effets pervers qu’ils peuvent avoir sur les espèces non commercialisables – expliquent pourquoi une réflexion doit être menée en parallèle sur la privatisation des mers et des océans, autrement dit, sur la mise en œuvre de cadastres maritimes.
Privatiser la mer aurait les mêmes effets que la privatisation progressive de la terre en Occident. Cela créerait les conditions d’un capitalisme maritime qui aujourd’hui a peine à exister. Les Etats pourraient vendre les espaces maritimes internationaux en reversant une part des recettes à tous les Etats de la planète et sans perdre le contrôle de leurs zones maritimes et côtières. Ils pourraient aussi créer un cadastre maritime pour leurs ressortissants qui leur permettrait de privatiser leur ressource et de créer ainsi de nouvelles recettes fiscales. Chaque pêcheur ou pêcherie deviendrait propriétaire d’une partie des mers nationales. Comme les Etats font respecter leur zone maritime, les propriétaires paieraient des sociétés pour protéger les ressources dont ils ont acquis l’exclusivité par un achat de droit. Toutes les ressources du fonds des mers (crustacés) sont facilement localisables et peuvent faire l’objet d’un tel système. Pour les bancs de poisson, la question est sans doute plus délicate et devra imposer probablement la vente de parcelles de très grande taille. Pour les zones maritimes internationales, qui sont plutôt des eaux profondes, la mise aux enchères peut être envisagée avec des corridors maritimes pour éviter l’impact sur le commerce mondial. Une telle politique permettrait de réduire les coûts d’exclusion et les coûts de mise en œuvre des politiques de quotas[39] .
Des réserves naturelles privées
Face à la dégradation des paysages et des espaces naturels l’une des solutions les plus évidentes est la mise en œuvre de réserves naturelles. La loi de 1960 instituant les parcs nationaux et la loi de 1976 sur les réserves naturelles, reprises et complétées par l’importante loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (« loi biodiversité ») du 9 août 2016 sont la preuve du rôle déterminant de la maitrise foncière en matière de protection. Ce que l’on sait moins, cependant, c’est que les premières réserves naturelles comme les premières aires marines ont été constituées à l’instigation d’associations privées dont la cause et les idéaux ont progressivement obtenu reconnaissance légale puis administrative[40]. Les propriétaires s’associaient pour protéger leur patrimoine naturel et cherchaient par la loi à imposer leurs choix aux générations futures. On aurait pu alors voir se développer des contrats semblables aux « Conservation easements » que l’on trouve aux Etats-Unis et au Canada. Ces contrats permettent au conservatoire privé (land trust) de payer les services écologiques produits par les propriétaires fonciers.
Le développement des parcs nationaux et régionaux a probablement empêché de telles solutions de se généraliser en France. Ces parcs publics, contrairement aux espaces gérés par les associations, font supporter à tous les propriétaires fonciers privés les coûts de la conservation. Ils limitent leur liberté d’usage de leur capital foncier donnant lieu à ce que les économistes appellent « une expropriation réglementaire » (regulatory taking).
La première conséquence de cette politique publique est de détourner les épargnants du marché foncier. La protection des espaces naturels devient une charge alors qu’elle pourrait être à l’origine de bénéfices si les gérants privés pouvaient vendre la nature sous toutes ses formes aux visiteurs : péage sur les chemins de randonnée, droit à l’image (photographie), vente des points de vue, parcours de découverte, etc. Le parc naturel pourrait être exploité comme un parc d’attraction. En d’autres termes, si l’on veut donner aux propriétaires fonciers la possibilité de faire de leur terre une réserve naturelle il faut que le non-usage soit financièrement rentable. Le non-usage productif n’est possible que si les propriétaires peuvent exploiter les aménités rurales de leur capital foncier (privilégier l’usage récréatif) ou tout simplement le laisser à l’abandon sans frais, autrement dit sans impôt. Actuellement une telle possibilité est découragée par le droit rural. Le préfet de département et le président du conseil départemental peuvent engager, tout d’abord, une procédure pour sommer les propriétaires de remédier à l’état inculte (le non-usage) de leur propriété sous peine de voir leurs droits confisqués. La majoration de la taxe foncière sur les terres agricoles incultes ou manifestement sous exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure est aussi une disposition inscrite au code général des impôts[41]. Il serait utile, dans ces conditions, de refaire un inventaire de toutes les mesures fiscales qui sont défavorables à la protection de l’environnement. On pourrait ainsi alléger l’impôt et protéger l’environnement[42].
La seconde conséquence de la mise en place de parcs nationaux et régionaux est qu’ils font injustement supporter les coûts aux protecteurs de l’environnement. C’est un peu le contraire de la subvention optimale. Le producteur de bénéfices externes paie la société pour cette production. Il serait juste, dans ces conditions d’indemniser les propriétaires pour les servitudes environnementales qu’ils subissent dans le cadre des politiques publiques de protection de l’environnement[43]. Il faudrait à cette fin revenir sur l’ordonnance de juin 1943 qui interdit l’indemnisation des services d’urbanisme ; ordonnance qui a été étendue par commodité aux servitudes environnementales. Il en résulte une situation d’iniquité où le protecteur devient le payeur mais aussi un désintérêt des propriétaires pour la protection de leurs espaces naturels.
5. Conclusion
Ce n’est donc pas un vain mot que de dire qu’il existe une alternative propriétariste à l’écologie coercitive qui domine les choix de politiques publiques depuis les années soixante-dix et qui, progressivement, tend à dresser une partie de l’opinion contre de justes causes. Si on devait résumer notre propos on pourrait proposer aux futures majorités de promettre à leurs électeurs :
- de lever tous les obstacles aux innovations de l’entrepreneuriat vert, autrement dit de déréglementer afin de limiter le niveau de l’expropriation réglementaire qui touche tous les acteurs de la vie économique et les propriétaires fonciers en particulier,
- de faire en sorte que les producteurs de déchet paient en fonction des quantités qu’ils rejettent,
- de rétablir un prix de marché pour le capital foncier afin de favoriser l’adaptation aux changements climatiques et de mettre en œuvre des conditions favorables à la protection in situ de la biodiversité,
- de généraliser la pratique des quotas de pêche transférables,
- d’indemniser les propriétaires pour les servitudes environnementales, et
de ne pas s’opposer à la mise en place d’expérimentation en matière de cadastre maritime.
[1] Stroup, R. (1990). “Natural resource scarcity and the economics of hope,” in Blocks, W. (ed.), Economics and environment: a reconciliation, The Fraser Institute, Canada.
[2] Voir Simmons, R., and Mitchell, W.C. (1984). “Politics and the New Resource Economics,” Contemporary Economic Policy, 2 (5), 1-13 et Simmons, R., and Baden, T. (1984). “The theory of the new resource economics,” Journal of Contemporary Studies, III (2), 45-.
[3] On peut retrouver l’intégralité de travaux de ce centre sur son site web. Centre International de Recherche sur les problèmes environnementaux https://www.icrei.fr/ (consulté le 24/08/2022).
[4] Lepage, Henri (1985). Pourquoi la propriété, collection Pluriel, Paris, Hachette.
[5] Falque, Max (1986). « Libéralisme et environnement », Futuribles, 97 (mars), repris dans Max Falque (2015), Propos écologiquement incorrects, volume 1, Nice, Libre échange.
[6] Falque, Max (2018), « Les droits de propriété dans la problématique environnementale Approprier pour sauvegarder », Revue Foncière, Mars-Avril, n°22, 26-30.
[7] Bernstam, M. (1991), The Wealth of Nations and the Environment, Occasional Paper n°85, Institute of Economic Affairs (IEA), Londres. Rey, M-P. (1997), « L’environnement en Union soviétique : perspective historique et problèmes actuels », Histoire, économie et société, vol. 16(3), p. 523-531.
[8] Facchini, François et Max Falque (2021), Droits de propriété environnementaux/ Environmental property rights for the environment Max Falque Editor/ sous la direction de Préface de Laurent Fonbaustier/Préface de Richard Epstein, Bruxelles, Bruylant-Larcier.
[9] He, J., M., Nazari, M., and N., Cai (2020), “Opportunity-based entrepreneurship and environmental quality of sustainable development: a resource and institutional perspective”, Journal of Cleaner Production, vol. 256: 120390.
[10] Bhattarai, M. (2000), The Environmental Kuznets Curve for Deforestation in Latin America, Africa, and Asia: Macroeconomic and Institutional Perspectives. Dissertation, Clemson University, Clemson SC, décembre.
[11] Facchini, François et Max Falque (2021), Droits de propriété environnementaux/ Environmental property rights for the environment Max Falque Editor/ sous la direction de Préface de Laurent Fonbaustier Préface de Richard Epstein, Bruxelles, Bruylant-Larcier.
[12] Benson, B. (2010) (ed.). Property rights. Eminent Domain and regulatory takings re-examined, Palgrave-McMillan for the Independant Institute.
[13] Falque, M., 2021. « La puissance publique : garante ou destructrice de l’environnement », Journal des économistes et des études humaines, 2 (1), 103-122.
[14] Falque M. (2020), « Ecolos, grand capital … même combat ? », Revue des Deux Mondes, Février, 144-150.
[15] Pour les interventionnistes, voir Lepage, C. (2008), « Les véritables lacunes du droit de l’environnement », Pouvoirs, 127, 123-133.
[16] On fait référence ici à l’annonce par le Ministre de l’intérieur de la création de 3000 postes de gendarme affectés à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement (Oclaesp). Structure interministérielle créée par le décret n°2004-612 du 24 juin 2004, l’office est un service de police judiciaire à compétence nationale dont la mission est de lutter contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Sur le site de l’Oclaesp il est écrit que pour remplir ces missions, l’office dispose de soixante-quatre gendarmes et policiers, appuyés par quatre conseillers techniques issus des ministères des sports, de la santé, de l’environnement et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
[17] Falque, M. (2015). « Les pratiques de la corruption liées aux règles environnementales », Études Foncières, 3 (janvier).
[18] Transparency International. Lien : https://bit.ly/ (consulté le 30/08/2022).
[19] Kirzner I. (1985), “Government regulation and the market discovery process,” in Discovery and the Capitalist Process, Chicago and London, University of Chicago Press (p.145).
[20] Kirzner, supra, p. 144.
[21] Facchini, F. (2004), « Critiques de trois arguments justifiant les lois sur le financement de la vie politique », Politiques et Management public, 22 (4), 27-46.
[22] Falque, M. (2008), « Entreprises et nouvelles politiques environnementales », Sociétal, 59 (1), 48-
[23] Mises, Ludwig (1966/1985), L’action humaine. Traité d’économie, collection libre échange, Paris, PUF : « Dans de nombreux pays, jadis, les propriétaires d’usines et de chemins de fer n’ont pas été tenus responsables des dommages que leur façon de conduire leurs entreprises infligeaient aux biens et à la santé des voisins, des clients, des employés et autres gens, par les fumées, la suie, le bruit, la pollution de l’eau, et par les accidents dus à des équipements défectueux ou mal conçus ; c’est qu’alors l’idée était qu’il ne fallait pas entraver le progrès de l’industrialisation et le développement des moyens de transport » (Mises 1985, p.690). Voir aussi : Bouckaert B. 1991. « La responsabilité civile comme base institutionnelle d’une protection spontanée de l’environnement », Journal des Économistes et des Études Humaines, 2 (2/3), 315-335.
[24] Facchini, François (1995), « La qualité de l’environnement, nouvel enjeu de la réforme de la politique agricole commune », Politiques et Management Public, 13, 1 : 29-54.
[25] Lien : https://bit.ly/3SDleTs (consulté le 25/08/2022).
[26] Goeldner-Gianella, Lydie (2017). « Les représentations sociales des zones humides : quel lien avec l’action ? Analyse historique et cas de la dépoldérisation », Sciences Eaux & Territoires 3 (24), 10-15, page 10.
[27] supra p.11.
[28] Voir : évolution des superficies irriguées en France. 1970, 539 000 hectares, 1995 1,62 millions d’hectares. Entre 2000 et 2010 la quantité de surfaces irriguées se stabilise autour de 1,4 millions d’hectares. Entre 2010 et 2020 l’augmentation des surfaces irriguées est de 14,6% selon les données compilées par France Nature Environnement (FNE).
[29] Fossil Fuel Subsidies à : https://bit.ly/3fCbYQO (consulté le 25/08/2022).
[30] Chamoux, J.P. et M., Falque (2018), « Environnement : le temps de l’entrepreneur », Journal des Libertés, 1 (3), 135-149. Max Falque (dir.), Jean-Pierre Chamoux (dir.), Erwan Queinnec (dir.) (2021), Écologie, La nature a besoin d’entrepreneurs – Nature requires entrepreneurship, éditions Libertés numériques.
[31] Chamoux et Falque, supra, page 136.
[32] Facchini, F. (2022), « Climat et liberté », Journal des Libertés, 17 (été), 51-68.
[33] Facchini, F. (2021), « Gérer les déchets », Journal des Libertés, 13 (été), 81-100.
[34] Facchini, F. (2020), « Protéger la biodiversité », Journal des Libertés, 11 (hiver), 147-163.
[35] Falque, M., « Assouplir les quotas de pêche, oui… mais dans quel sens ? », ICREI, Lien : https://bit.ly/3ei5VR7 (consulté le 25/08/2022).
[36] Costello, C., S., D., Gaines and J., Lynham (2008), “Can catch shares prevent fisheries collapse?” Science, 321 (5896), 1678-1681.
[37] Birkenbach, A.M., D.J., Kaczan and M.D., Smith (2017), “Catch shares slow the race to fish,” Nature, 544, 223-226.
[38] Miller, S.J. and R.T., Deacon (2017), “Protecting marin ecosystems: regulation versus market incentives,” Marin Resource Economics, 32 (1), 83-107.
[39] Hannesson, R. (2004), The Privatization of the Oceans, Cambridge Mass, MIT Press. Block, Walter et Nelson Peter Lothian (2015), Water capitalism: the Case of privatizing oceans, rivers, lakes and aquifers, Lanham: Lexington books.
[40] Therville, C., R., Mathevet, et F., Bioret (2012), « Des clichés protectionnistes aux clichés intégrateurs : l’institutionnalisation des réserves naturelles en France », Vertigo, 12, 3.
[41] Zignani, G. (2016), « Une majoration de la taxe foncière des friches agricoles pour le seul bénéfice des agriculteurs est-elle envisageable ? » La Gazette des communes, Lien : https://bit.ly/3Mdo4w7 (consulté le 25/08/2022)
[42] Falque, M., et P., Beltrame (1992). « Incidence de la fiscalité française sur l’environnement. Inventaire et analyse », Ministère de l’environnement, SOMI Consultant.
[43] Falque, M., « De la servitude d’urbanisme à la servitude environnementale. Plaidoyer pour une indemnisation », ICREI, consultable à : https://bit.ly/3T7AYhr.