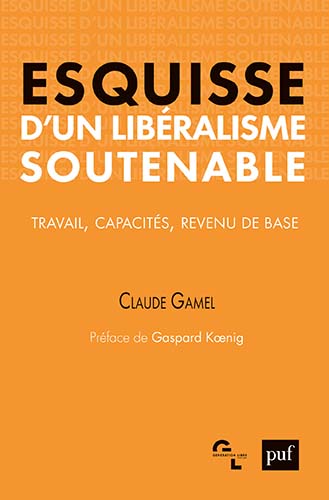
Voilà une production qui devrait être — a priori — pleine de promesses intellectuelles. L’auteur est un universitaire, qui a grandi à la Faculté d’Économie Appliquée d’Aix-Marseille, réputée pour sa connaissance des idées libérales. Claude Gamel avait eu le courage de faire sa thèse de Doctorat d’État sur « L’analyse économique de la justice », à une époque (1986) où l’académisme des sciences économiques considérait qu’un tel sujet semblait hors de ce champ disciplinaire. Le pari s’est avéré payant, le thème de la justice (sociale) devenant un thème central dans les débats internationaux sur le libéralisme, et ce travail académique, et ses qualités, furent reconnus par une réussite à l’agrégation des Universités — sciences économiques — (1988)[1]. Malheureusement, sa dernière livraison laisse un goût amer, provoqué par le soupçon d’une tromperie sur la marchandise. « Esquisse d’un égalitarisme durable » est un titre qui parait mieux correspondre à son contenu, tant ses liens avec le libéralisme sont distendus. (Celui d’ « égalitarisme libéral » est d’ailleurs revendiqué par l’auteur).
Le graphisme de la couverture de l’ouvrage met déjà le lecteur sur la voie : ESQUISSE et SOUTENABLE sont en majuscules, quand le « libéralisme » est d’une police amoindrie, comme si le mot n’était pas important. Mais peut-être n’est ce que la responsabilité d’un éditeur cherchant un titre accrocheur, avec pas trop de libéralisme et beaucoup de soutenable, ce qui est plus tendance aujourd’hui dans le monde de l’édition…
La préface de Gaspard Koenig n’arrange pas les choses lorsqu’il écrit : « pourquoi les intellectuels adorent l’État ? … parce que les libéraux eux-mêmes se sont discrédités, sur le plan intellectuel en proposant une vision du marché figée dans les années 1970… » ; on a connu le philosophe médiatique mieux inspiré que cette attaque bien loin des analyses de Raymond Boudon, lequel est néanmoins pris, pro forma, en référence. Il est vrai que le défenseur du « jacobinisme libéral » n’a pas peur de l’oxymore, ni d’envoyer l’ultra libéralisme au diable ce qu’il fait dans son roman « L’enfer » (2021, L’observatoire). Koenig est moins contestable quand il évoque un Gamel plaidant « pour une dispersion maximale du pouvoir », ce qui doit se comprendre du seul pouvoir économique, car le pouvoir politique serait lui plutôt maximisé à la différence des travaux de Monique Canto Sperber[2]. S’il y a beaucoup de points communs entre ces deux auteurs, celle-ci cherche au moins à renouer avec les libertés politiques, quand celui-là recherche la plus grande dispersion du pouvoir économique, c’est-à-dire de l’égalitarisme maximal des résultats. Un égalitarisme qui est bien la valeur dominante de notre auteur et le fondement de ses propositions d’action politique.
En fait, ce livre est, sinon un programme d’action politique, du moins une théorie pour un tel programme. Il s’agit à partir de sélections de quelques éléments abstraits de théories de la justice (Rawls, Sen, Van Parijs), de montrer que l’abstraction peut avoir une image concrète dans le champ des politiques publiques contemporaines (toutes celles qui ne sont pas régaliennes…). En changeant de catégories le jeune universitaire théoricien de la justice se transforme sur le tard en un conseiller du Prince et il faut reconnaitre que cette mue se fait avec une recherche de cohérence interne, une grande (trop) subtilité, malgré des erreurs conceptuelles sur lesquelles nous reviendrons. Mais on sait depuis Jean-François Revel que plus ils sont intelligents, plus les intellectuels élaborent subtilement leurs erreurs…
L’introduction de Claude Gamel fixe le cadre de ses réflexions et constitue véritablement l’esquisse de l’ouvrage qui se décline ensuite en trois parties programmatiques : le travail, les capacités et le revenu de base (trois éléments qui donnent son sous-titre à l’ouvrage). Cette esquisse introductive est essentielle pour le lecteur parce qu’elle pose, comme si elle coulait de source, les conceptions particulières et discutables de l’auteur sur la liberté, le libéralisme et la justice.
Liberté ?
C’est bien « la question essentielle (qui) porte sur le contenu à donner à l’idée de liberté » (CG p. 12). L’auteur ne répond pas brutalement à cette question, mais on sent bien qu’il n’accepte pas la définition classique d’absence de coercition, pour préférer rappeler le séculaire clivage entre « libertés formelles et libertés réelles ». Au-delà de Marx, l’influence d’un Philippe Van Parijs est assumée ; en particulier la teneur de « Real Freedom for All – What (if anything) can justify capitalism ? » (Oxford University Press, 1995), véritable manifeste de réhabilitation des « libertés réelles »[3]. Van Parijs, présenté parfois comme un « libertarien de gauche » (sic), alors qu’il n’est sans doute ni l’un ni l’autre, présente l’avantage de revendiquer haut et fort, sans masque, le concept de « liberté réelle ». Or il ne s’agit pas d’un concept, mais, comme le dit Ayn Rand, d’un anti-concept, c’est-à-dire, une contradiction dans les termes[4] ; « le réel » ne peut être obtenu qu’en portant atteinte au « libre ». Le masque d’Isaiah Berlin, substituant au clivage marxiste celui de « liberté négative et liberté positive » ne change rien : il s’agit toujours, avec la « liberté positive », de confondre liberté et pouvoir, alors que ce n’est pas la même chose d’être libre ou d’avoir du pouvoir. Ce n’est pas parce que les expressions « liberté réelle ou liberté positive » sont employées qu’elles concernent réellement la liberté et qu’elles ne sont pas des abus de langage. Bruno Leoni suggère qu’une origine possible de la confusion peut provenir de l’aspect protéiforme de « free » qui peut dire aussi bien libre que gratuit (free lunch) ; et ce dernier, concernant ces clivages, souligne « qu’il n’est pas possible d’adopter l’une de ces définitions sans sacrifier dans une certaine mesure l’autre, et vice versa »[5] . Et d’enchainer sur sa critique des tenants de la liberté « positive » : « la liberté dont il s’agit est seulement la leur, tandis que la contrainte qu’ils veulent augmenter concerne exclusivement les autres ». En bon compatriote de Leoni, Angelo Petroni précise aussi que « l’incompatibilité entre liberté négative et liberté positive devient purement définitoire et immédiate dès que la seconde implique pour un certain individu d’agir sur d’autres individus, d’induire des actions que ceux-ci n’auraient pas accompli sur la base de transactions pleinement volontaires »[6]. Ajoutons que même un utilitariste (ce que n’est pas Gamel) ne pourrait compenser les gains des uns et les pertes des autres compte tenu de l’impossibilité des comparaisons interpersonnelles d’utilité. Enfin, si l’assimilation du pouvoir à la liberté est posée, que devient la dispersion maximale du pouvoir sinon une dispersion maximale de liberté ? Mario Vargas Llosa ne s’y trompe pas lorsqu’ au sujet du clivage « libertés formelles et libertés réelles » il dénonce les secondes « que mettent toujours en avant ceux qui veulent supprimer les premières » [7]! Difficile alors de se dire libéral et de défendre ces expressions.
Libéralisme ?
Bien qu’adepte de l’anti-concept marxo-berlinois, Claude Gamel tient à appartenir au libéralisme, et plus précisément à un libéralisme. Car pour lui, cette philosophie est une « auberge espagnole » (CG p.12), aux contenus divers et rivaux. Évidemment cette métaphore n’est pas neutre ; elle favorise l’expression de variantes éloignées du noyau dur de l’auberge qui, lui, n’est pas mis en exergue (contrairement à ce que fait par exemple Pascal Salin qui titre simplement « Libéralisme » — Odile Jacob, 2000 — son ouvrage de référence). Certes, il connait, et semble apprécier la richesse des débats qui ont permis l’approfondissement du libéralisme « classique » pouvant donner des variantes comme le « libertarisme ». Mais sous le prétexte, étonnant de la part d’un universitaire, que « les subtilités des approches libérales ou libertariennes restent peu connues et peu discutées en France » (CG p. 13), cette richesse n’est pas exploitée et délaissée au profit de développements sur la notion plus galvaudée de néolibéralisme. Il est difficile de comprendre à quoi servent ces développements, d’autant qu’ils occultent le colloque de Walter Lippmann qu’un Serge Audier considère à juste titre comme essentiel pour comprendre le terme[8]. Or, l’histoire de ce colloque permet de mieux comprendre les conceptions de Claude Gamel.
En 1938, année qui débute avec l’Anschluss, Walter Lippmann publie « La Cité Libre » (The Good Society), un titre en forme de défi à cette époque. Louis Rougier organise à Paris, du 26 au 30 Août, un colloque international autour de ce livre et de son auteur. Les participants sont ou vont devenir connus : W. Röpke, M. Rustow, L. Marlio, Hayek, Mises, Rueff, Marjolin, Baudin, Detoeuf… et le secrétariat est assuré par le jeune R. Aron ! La question débattue est : que faire du libéralisme face à la montée des périls totalitaires ? Pour Baudin, par exemple, « le mot usé est dangereux » ; pour certains, le sauvetage de la démocratie passe par la perte de libertés économiques car il faut « réaliser le maximum de justice sociale » (Marjolin) ; fleurissent pour eux les qualificatifs souvent contradictoires avec le libéralisme : rénové, social, révisé, assagi, de gauche, intervenant, positif, (pas encore avancé…). Le terme de « socialisme libéral » a même été évoqué, mais le chantre de ce courant, Carlo Rosselli, n’a pu être présent, assassiné en juin 1937. Bien sûr, on y trouve le terme de néolibéralisme (que Jean-Luc Gaffard qualifie de « libéralisme vulgaire »[9]. On est loin de la clarté conceptuelle d’un Pascal Salin (op. cit.). D’autres, comme Hayek, Mises ou Polanyi (Michael) préfèrent l’approfondissement du libéralisme à son dépassement social-démocrate générateur de coercition étatique. Même Michel Foucault s’interroge[10] :
« pour éviter ce moins de liberté qui serait entrainé par le passage au socialisme, au fascisme, au national-socialisme, on a mis en place des mécanismes d’intervention économique. Or ces mécanismes d’intervention économique est-ce que, précisément, ils n’introduisent pas subrepticement des types d’intervention, est-ce qu’ils n’introduisent pas des modes d’action qui sont eux-mêmes au moins aussi compromettants pour la liberté que ces formes politiques visibles et manifestes que l’on veut éviter ? »
Évidemment, ce passage qui met en doute le libéralisme des politiques keynésiennes, n’est pas commenté par Gamel, alors même qu’il s’attarde sur la théorie de la « gouvernementalité » de notre bio-politicien, montrant que le pouvoir l’intéresse plus que la liberté. Certes la tension entre le pouvoir et la liberté est bien réelle depuis longtemps, et elle existe même si la source du pouvoir est démocratique. L’analyse économique de la démocratie d’Anthony Downs (1957) montre ainsi que dans un système majoritaire à deux partis, les préférences de l’électeur médian sont déterminantes ; et si le revenu médian est inférieur au revenu moyen, la majorité peut conduire à des redistributions coercitives garanties par l’État détenteur du monopole légal de la violence. L’analyse de « La route de la servitude » n’était pas encore présente lors du colloque Lippmann, mais la dichotomie entre les vrais et les faux tenants du libéralisme existait déjà[11]. Le national-capitalisme de 2021 aurait-il les mêmes conséquences de dissolution du libéralisme que les nazis de 1938, et Claude Gamel ne serait-il que le pendant de Robert Marjolin ?
Justice ?
Reconnaissons à notre auteur la volonté de rechercher l’intégration des dimensions politique et économique d’une société. C’est bien un des marqueurs de la philosophie libérale, mais s’il est nécessaire il n’est pas suffisant pour caractériser le libéralisme. De plus, considérer que cette recherche d’intégration revient à résoudre le problème de la justice en société (CG p. 18) est trop réducteur tant la notion de société « juste » est controversée et dépassée par la notion de « bonne » ou « grande » société ou encore de société « ouverte ». Cela permet cependant à Gamel de retrouver sa spécialité de jeunesse dont il extrait arbitrairement les seules contributions de Hayek et de Rawls et accessoirement celle de A. Sen. Exit le constitutionnalisme de Buchanan, la philosophie libérale de Nozick ou celle de Rothbard. En réalité exit aussi Hayek malgré une présentation acceptable de ses idées ; Gamel considère en effet que le libéralisme hayékien, et en particulier les règles abstraites de juste conduite, ont une protection juridique (constitutionnelle) « très insuffisante » et que sa proposition d’un revenu minimum accordé pour éviter l’extrême pauvreté est « rudimentaire » et même « archaïque » (CG p. 24). Des appréciations manquant pour le moins d’humilité, confondant la pauvreté absolue avec la pauvreté relative, mais qui lui paraissent suffisantes pour écarter Hayek de la suite de ses analyses…
L’élimination du prix Nobel laisse le champ libre à « la piste (plus) supportable de l’égalitarisme libéral » de John Rawls, (CG p. 25), lequel est un « incontournable allié pour penser la gauche de notre temps » (dédicace de Philippe Van Paris pour son livre « Sauver la solidarité », ed. Du Cerf, 1995). Le parti pris en faveur de Rawls pourrait être qualifié de « rudimentaire » et d’ « archaïque » car aucune des critiques vraiment libérales (Nozick) ou même communautariennes (Sandel, « Le libéralisme et les limites de la justice », Seuil, 1999 ) ne sont évoquées. Pour Gamel, le seul inconvénient de Rawls est d’être trop philosophique, trop abstrait, et la logique du « voile d’ignorance » dans « la position originelle », malgré les coups de griffes de Sen, est acceptée. Cette logique conduit à un contrat social d’ignorants, averses au risque, où est justifiée une hiérarchie de principes s’achevant par le fameux principe illibéral de « différence ». Ce dernier consiste à maximiser la situation des plus pauvres (maximin) et hybride toute l’analyse qui n’est plus une théorie de la justice de procédure pure pour finir avec un objectif de résultat qui n’a rien de libéral. Rappelons que la conception procédurale des règles sociales résulte de la reconnaissance de l’importance des probabilités dans les sciences de l’homme[12]. Pourtant Gamel retient la hiérarchie des principes de « A theory of justice » (1971) qui vont lui servir de plan pour ses développements de politiques publiques : « égales libertés « (travail), « juste égalité des chances » (capacités) et « principe de différence » (revenu de base).
Ce triptyque structure les trois parties de l’ouvrage, mais le contenu, les interprétations, que fait Gamel de ces principes renforcent le coté illibéral de l’œuvre de 1971 en s’appuyant sur les prolongements de 2001[13], et en particulier sur « la démocratie de propriétaires », un concept perverti lorsqu’il vise « prioritairement la dispersion maximale du pouvoir économique » (CG p. 32). On passe ainsi du maximin des pauvres au maximin du pouvoir… confondant cette fois liberté et dispersion du pouvoir, c’est-à-dire liberté et égalité.
Plus encore, Gamel cherche à donner un contenu économique, qui se veut plus concret, plus compatible avec des politiques publiques, aux principes de Rawls jugés trop abstraits, trop formels. (Alors même qu’il défendait une analyse des fondements philosophiques de la justice, pour sortir de l’économisme étroit de certains défenseurs du marché). Le principe d’ « égales libertés » est ainsi interprété comme une « priorité au travail choisi » ; celui de « juste égalité des chances » doit assurer une égalité « réelle » des chances fondée sur la notion de « capacité » de Sen ; enfin le principe de différence s’élargit à un revenu de base universel proche de la conception de Van Parijs puisque versé même aux surfeurs de Malibu… Ces métamorphoses conceptuelles constituent l’originalité de l’ouvrage, mais elles sont quelque peu parachutées et pas toujours claires .
Par exemple, dans la transformation du premier principe, pourquoi priorité « au travail choisi », et pas à la consommation ou au loisir ? Quelle différence entre les expressions « l’égale liberté de travailler », « l’égale liberté d’accès à l’emploi » et « l’égale liberté de choisir de travailler » ? Et comment comprendre que ce principe « suppose d’abord que la personne qui veut travailler aux conditions courantes du marché puisse le faire et ne se heurte pas à une forme ou une autre de chômage involontaire » (CG p. 53) ? Cela signifie-t-il que ce chômage doit être déclaré illégal ?
Dans le deuxième principe d’ « égalité des chances » revisité en « égalité des capacités (enrichies ) », l’égalitarisme économique atteint un paroxysme ; les inégalités sociales mais aussi les inégalités naturelles sont considérées comme des « injustices réparables » par des mesures réparatrices égalisatrices : la logique voudrait même abolir la famille, trop diverse et trop influente sur les « capacités » inégales des enfants, lesquels devraient être reformatés dans des camps de « rééducation » (CG p. 93). Sans aller jusqu’à cette extrémité (avec regret ?), Gamel défend un équivalent plus politiquement correct, une « nouvelle école publique », nouvelle par « l’augmentation des flux financiers publics » qu’elle exige pour empêcher l’école privée de perpétuer les inégalités. (Évidemment, la privatisation de l’offre éducative que permettraient des vouchers est exclue au nom d’une « gratuité » que l’on sait illusoire). La tarte à la crème de l’autonomie des établissements, ou la référence polie à la décentralisation ne change pas l’ossature de « l’enrichissement des capacités », celle d’une politique d’égalitarisme extrême, toujours étatique et engendrant une imposition confiscatoire. Il est étonnant de voir encore recommandée une politique de moyens accrus pour une école publique à la dérive pour d’autres raisons que des budgets insuffisants.
Enfin, le principe de « différence » évolue lui, vers le traitement d’inégalités dites « irréductibles », comme celles dues à la malchance, et son outil opérationnel est une allocation universelle, fixée au niveau le plus élevé possible. D’un périmètre à la Van Parijs, donc distribué même aux surfeurs de Malibu, et d’une technique à la Friedman, donc d’un impôt négatif assurant un revenu minimum (crédit d’impôt), le revenu de base à la Gamel bute, au-delà de questions d’éthique, sur la question de son financement. Le prélèvement fiscal de type CSG qu’il suppose n’est pas précisé et l’on ne sait pas s’il est économiquement soutenable. Les surfeurs de Malibu ne sont pas les surfeurs d’El Zonte (Salvador) et ne peuvent, comme ces derniers, se prévaloir des dons de Bitcoins d’un riche donateur[14]… Et même si Claude Gamel était favorable aux cryptomonnaies privées, il lui faudrait encore résoudre sa contradiction entre l’inconditionnalité de son revenu de base et son affirmation que « le travail, c’est un fait, compte beaucoup dans la vie des hommes, d’abord comme source de revenu mais aussi comme facteur d’interaction sociale, voire d’épanouissement personnel » (CG p. 51). Justifié pour compenser la malchance, le revenu de base pourrait être rendu inutile par un système assurantiel, plus responsable, mais pour Gamel « il importe de favoriser la coopération sociale entre citoyens sur une base moins individualiste » (CG p. 117). Il est vrai que la crise du Covid-19 peut être appelée à la rescousse pour valider le revenu de base, comme le propose aujourd’hui l’ineffable Thomas Piketty, grand partisan du « libéralisme soutenable » de notre auteur.
Finalement, le lecteur, partant d’une théorie de la justice, est convié à une théorie d’un programme politique d’essence fortement social-démocrate. Politique redistributive, lutte contre toutes les inégalités, primat de l’école publique, allocation universelle, recours à l’État au-delà des compétences régaliennes, fiscalité galopante, les totems essentiels du socialisme à la française sont en place. Ce programme se veut le résultat d’assemblages de notions théoriques progressivement détournées de leur sens originel. Ce bricolage intellectuel ne fait que donner un visage humain à une barbarie illibérale, et il ne doit sa soutenabilité qu’à la croyance qu’il sera préféré par une majorité de citoyens. Rawls aussi avait été séduit un temps par la recherche d’un consensus politique à la Habermas ; après les critiques contre sa théorie de la justice fondée sur le rationnel, il préféra s’appuyer sur le raisonnable en 1993[15]; mais en 2001 il revient vers ses premières amours, ce que ne fait pas Gamel. En attendant le verdict des urnes, on retrouve dans la conclusion de l’ouvrage des thèmes politiques « tendance » comme ceux du changement climatique et des menaces du numérique, attracteurs étranges de l’étatisme coercitif, et constitutifs aussi du « libéralisme soutenable ».
On retrouve avec cette expression les confusions conceptuelles apparues lors du colloque Lippmann, comme celle de Rawls évoquant un « régime socialiste libéral » (même si Gamel critique cette dernière, cf. CG note 1 p.33, mais en s’en prenant au terme socialiste et non à celui de libéral). Confusion délibérée ? Ce n’est pas sûr, même si l’on sait depuis au moins Lénine que jeter le trouble dans le vocabulaire était le meilleur moyen de commencer à déstabiliser l’adversaire. Si l’on en croit Hayek, le cas de Gamel n’est pas exceptionnel ; dans un paragraphe intitulé « Confusion morale et délabrement du langage » Hayek signale :
« [O]n pourrait multiplier indéfiniment ces exemples, cueillis presque au hasard, de l’abus courant du vocabulaire politique où des gens habiles à se servir des mots, en faisant dévier le sens de concepts que peut-être ils n’ont jamais tout à fait compris, les ont progressivement vidés de tout contenu intelligible. …lorsqu’ils invoquent la démocratie, nous devrions montrer que ce qu’ils professent est de l’égalitarisme[16]. » Et de rappeler que « lorsque les mots perdent leur signification, les hommes perdent bientôt leur liberté » (Confucius, cité par Hayek, op. cit. p. 162).
[1] Un petit digest de la thèse intitulé « Économie de la justice sociale. Repères éthiques du capitalisme » est publié chez Cujas en 1992.
[2] Monique Canto Sperber, « La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme », Robert Laffont, 2019.
[3] En juin 1996, Claude Gamel organisait un débat autour de cet auteur et son livre, dont le chapitre 2 titre : « the highest sustainable basic income ». La logique de 2021 était déjà en place.
[4] cf. Ayn Rand, « Introduction to Objectivist Epistemology », 1966, réédition en 1990 par H. Binswanger et L. Peikoff.
[5] Bruno Leoni, « La Liberté et le Droit »,1961, réédité en 2006, Les Belles Lettres, p. 27.
[6] Angelo Petroni, « Une note sur l’état présent d’un concept inactuel : la liberté », Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Décembre 1993, p. 642, note 19.
[7] Mario Vargas Llosa, L’appel de la tribu, 2018, traduction française 2021, Gallimard, p. 262.
[8] cf. Serge Audier, Le colloque Walter Lippmann. Aux origines du néolibéralisme, Ed. Le bord de l’eau, 2008.
[9] Cité dans Le national-capitalisme autoritaire – Une menace pour la démocratie, de Pierre-Yves Hénin et Ahmet Insel, ed. bleu autour, 2021, p. 72, note 3.
[10] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978/ 79, Seuil, 2004, p. 71.
[11] Cf. F.A. Hayek, “Individualism: true and false”, dans Individualism and Economic Order, Chicago, 1996.
[12] Cf. Philippe Raynaud, Trois révolutions de la liberté, PUF, 2009, p. 234.
[13] John Rawls, La justice come équité. Une reformulation de la Théorie de la justice, La Découverte/Poche, 2008 [2001].
[14] Cf. le reportage d’Angelina Montoya, Le Monde, 4 et 5 juillet 2021.
[15] Cf. John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993.
[16] F.A. Hayek, Droit, législation et liberté, tome 3, chap. 18, p. 162 et suiv. Quadrige PUF, 1995 [1979].



