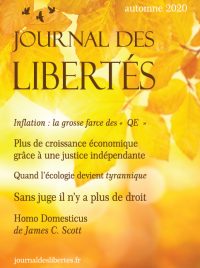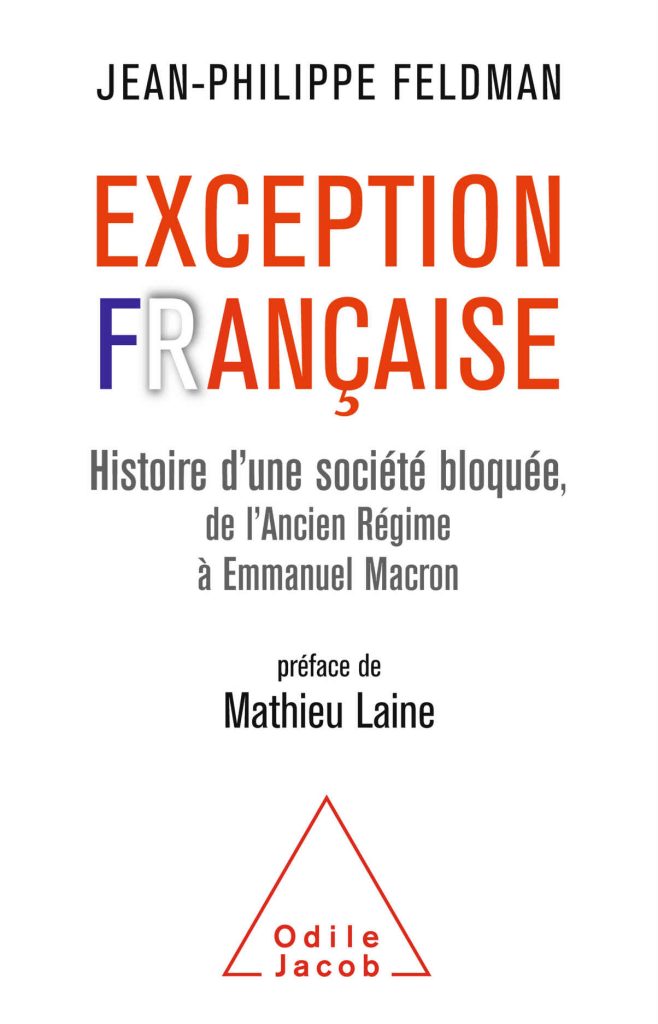
De Jean-Philippe Feldman
Odile Jacob, 2020
Historien de la pensée politique, universitaire juriste et libéral engagé, Jean Philippe Feldman nous inquiète, nous stimule et s’interroge.
Inquiétude : « Tous les Français sont étatistes et il n’y en a point qui soient libéraux » (Emile Faguet, p.14)
Stimulation : « Qu’on mette enfin la liberté à l’épreuve ! » (Bastiat, p. 480)
Interrogation : Macron peut-il réformer d’en haut ?
L’historien va tenir le lecteur en haleine tout au long de l’ouvrage : sa plume aérienne et moqueuse, son savoir encyclopédique, sa rigueur scientifique (811 notes tenant 28 pages) incitent à aller chaque fois plus loin.
La méthode choisie par Jean Philippe Feldman y est aussi pour beaucoup. Comme c’est la mode actuellement, il rompt avec la présentation chronologique de l’histoire pour proposer une présentation thématique. Les quatre thèmes qu’il choisit sont : l’étatisme, la monarchie, la centralisation, la religion. Mais bien évidemment pour chaque thème il respecte la chronologie, en remontant jusqu’à Rome (la France est un pays latin) et en terminant sur la Vème République.
L’étatisme
C’est à l’étatisme que Jean-Philippe Feldman consacre ses deux premiers chapitres, et les plus longs. Le Moyen Age se veut moral et religieux plus qu’économique, de sorte que l’argent, le commerce et la propriété n’y trouvent pas leur compte, et sont déjà entravés par de nombreuses lois, et surtout par un état de guerre permanent (p.28). La royauté réussit à centraliser le pouvoir, l’État absorbe la nation et, d’Henri IV à la Révolution, le chrysohédonisme et le mercantilisme inspirent la politique de Richelieu, et surtout de Colbert, le père des nationalisations, des règlementations des métiers, des nouveaux impôts et taxes, et finalement des déficits publics qui se gonfleront tout au long du 18ème siècle, jusqu’à la réunion des États Généraux. Contrairement aux idées reçues, Jean Philippe Feldman ne croit pas que la Révolution, même dans sa phase première (1789-1793) ait instauré le libéralisme, les « droits de l’homme » à la française donnent en fait au peuple souverain le pouvoir d’encadrer la liberté, « le harcèlement textuel s’impose » (p.53) : 2553 lois pour la Constituante, 2712 pour la Législative, 11210 pour la Convention (en 3 années). Napoléon, qui n’aimait ni le commerce (qui dessèche l’âme) ni les commerçants (p.53), porte l’interventionnisme à son maximum, et codifie toutes choses. La Restauration n’y changera rien et la deuxième République socialisante construira le droit du travail et multipliera les grands travaux, que Napoléon III, inspiré par les Saint Simoniens, portera à leur sommet. Le traité de commerce avec l’Angleterre en 1860, salué comme un grand moment libéral, ne produira aucun effet durable sur la croissance française, en net recul par rapport à celle des Anglais, jusqu’à l’effondrement de 1870. Courageusement la IIIème République, dans ses toutes premières années, va rembourser la dette publique, mais la tradition étatiste se retrouvera dans le cadre d’une politique ambiguë : « une économie théoriquement fondée sur le marché mais dont la concurrence se trouve anémiée ; un État théoriquement non interventionniste mais à la pratique protectionniste ; un Parlement attaché aux principes libéraux, mais sensible au lobbying et enclin à l’immobilisme » (Richard Kuisel (p.87).
Socialisme, troisième voie : non au libéralisme
L’ambiguïté disparaîtra avec la fin de la première guerre mondiale, en dépit du succès du « bloc national » aux élections de 1919. Elle disparaît pour ouvrir l’ère du socialisme désormais triomphant. La continuité sera assurée de Laval à Blum, puis à Pétain, puis au programme communiste du Conseil National de la Résistance, puis à De Gaulle et au gouvernement provisoire qui s’en inspirent, puis à la IVème et à la Vème Républiques. Avec la présidence du Général, et en dépit du rapport Rueff Armand, le plan devient une « ardente obligation », la participation ouvre l’ère de la « troisième voie », car :
« le capitalisme écrase les plus pauvres […] C’est bien joli l’économie de marché mais si l’on n’y prenait pas garde des pans entiers de notre économie s’effondreraient » (De Gaulle, cité p. 133).
Le « libéral » VGE ouvre l’histoire des déficits budgétaires, en dépit d’une hausse des prélèvement obligatoires qui approchent 40 % du PIB à la veille des élections de 1981. Avec deux septennats Mitterrand l’étatisme socialiste se renforce : nationalisations, planification, dévaluations, dette publique, fonction publique se multiplient.
Jean-Philippe Feldman n’aura pas lâché l’État pour ses méfaits durant des siècles, et il argumente à la perfection sa thèse : ce que nous vivons aujourd’hui est dans la stricte continuité historique, aussi loin que l’on remonte dans le temps. Pire encore : cette tradition résiste à l’alternance droite-gauche, ou royauté-république, ou conservatisme-socialisme. La seule alternance observée est entre « le tout par moi » et le « rien sans moi »(p.105).
C’est avec autant de précision et de pertinence que Jean-Philippe Feldman décrit et dénonce le monarchisme, la centralisation, et le poids de la religion.
Libéralisme et Catholicisme
Sur ce dernier point, je conseille de lire le chapitre 8 consacré à « la fille aînée de l’Église ». A juste titre il dénonce l’incohérence du gallicanisme : le catholicisme doit s’accommoder de la souveraineté nationale, la religion est sous contrôle de la politique. Mais la religion catholique, à travers les encycliques pontificales, condamne la liberté économique – ce qui ne peut cependant accréditer la thèse de Max Weber sur les liens entre protestantisme et capitalisme. Il faut attendre Léon XIII (Rerum Novarum, 1891) et la Doctrine Sociale de l’Église Catholique pour trouver une condamnation très claire du socialisme, et une apologie de la propriété privée. C’est avec Jean Paul II (Centesimus Annus, 1991) que « l’économie de liberté » est reconnue comme la base de la prospérité et de la convergence des intérêts particuliers. En sens inverse le Pape François verse dans la « théologie de la libération » et visiblement ignore les réalités économiques et sociales contemporaines. Cela conduit Jean-Philippe Feldman à poser la question insolente : peut-on être libéral et catholique ? Il répond en distinguant les « libéraux catholiques »,et les« catholiques libéraux » (p.321). Je suis, comme nombre de rédacteurs de ce Journal, un libéral catholique : j’associe la liberté à la dignité de la personne humaine, créée à l’image de Dieu. En revanche un catholique libéral (comme Lamennais) réduit la liberté à ce que prescrivent les autorités catholiques.
Et Macron ?
Peut-il faire appel à la liberté ? Il faut bien en discuter puisqu’il est en titre de l’ouvrage. Le jeune Président a l’ambition de créer une nouvelle société. Mais peut-on réformer une société historiquement bloquée, avec des Français « en avance d’une révolution parce que toujours en retard d’une réforme » (Edgar Faure, p.481) ? Jean-Philippe Feldman évoque la thèse (bien ancrée chez certains libéraux) suivant laquelle la réforme dans un pays étatiste centralisé ne peut venir que du haut. Comme Bastiat il n’y croit pas (p.480).
Comme en Angleterre, la réforme ne peut venir que du bas, de la pression de l’opinion publique. Mais là est le problème : « L’État, à force d’interventionnisme, émollient, a apprivoisé la société civile, jusqu’ à la pervertir » (p.480)
Pourtant, conclut l’auteur :
« le pessimisme n’est pas de mise […] S’il y a une exception française longuement forgée plusieurs siècles durant, il n’y a pas de déterminisme qui interdirait aux Français de se réformer et de le faire enfin de manière profonde » (p.482)
Jean-Philippe Feldman nous invite ainsi à libérer la société civile de l’exception française. Il s’y emploie d’ailleurs avec énergie et talent. Pour les lecteurs qui l’ignoreraient il est administrateur de l’ALEPS, membre du Comité de Rédaction du Journal des Libertés, et il est régulièrement intervenu dans les Universités d’Été d’Aix en Provence. Dans le civil il est Professeur agrégé de Droit, il enseigne à Sciences Po, et il est avocat à la Cour de Paris.
 Jacques Garello est professeur émérite de l’Université Aix-Marseille. Président de l’ALEPS de 1978 à 2015, il publie depuis 1981 La Nouvelle Lettre, hebdomadaire. Il a été l’un des créateurs du groupe des Nouveaux Économistes (1977) et a organisé 38 Universités d’Été de la Nouvelle Économie à Aix en Provence.
Jacques Garello est professeur émérite de l’Université Aix-Marseille. Président de l’ALEPS de 1978 à 2015, il publie depuis 1981 La Nouvelle Lettre, hebdomadaire. Il a été l’un des créateurs du groupe des Nouveaux Économistes (1977) et a organisé 38 Universités d’Été de la Nouvelle Économie à Aix en Provence.