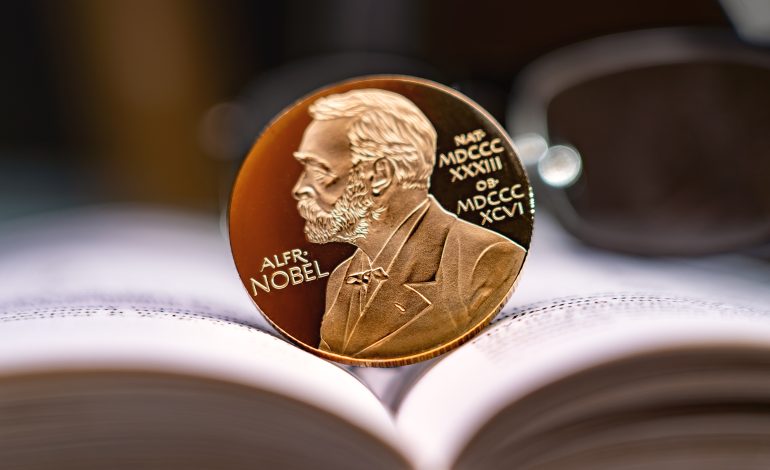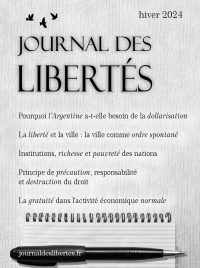« You can’t sell welfare reform in the same way you sell soap! Our challenge is to wrap up our policies which truly are fair, in an egalitarian wrapping paper! » [1]

L’homme, son œuvre et ses talents
Fred Smith vient de nous quitter. Sa vie professionnelle et ses engagements personnels furent profondément marqués par sa passion pour la liberté et par son prosélytisme en faveur du marché et de la responsabilité personnelle, tant dans la vie civile que dans l’action économique, sociale ou politique[2].
De ses années passées au sein de l’Agence américaine pour l’environnement (Environment Protection Agency, EPA) cet homme qui rayonnait d’énergie vitale et d’intelligence politique – sans oublier son brio et sa faconde – tira des leçons qui orientèrent la suite de son existence : soumis à la politique et aux travers d’une bureaucratie centralisée, un organisme comme l’EPA n’a pratiquement aucune chance, disait-il, d’atteindre les objectifs ambitieux annoncés lors de sa création et qui en justifient encore l’existence. L’enfer administratif, en cette matière comme en d’autres, est pavé d’intentions impossibles à concrétiser !
Frances, son épouse, fut aussi engagée dans l’action : sa carrière bien remplie est indissociable de celle de Fred. Elle travailla avec lui, avec le consumérisme pour cible, au sein de Consumer Alert, une ONG libérale qui ferma ses portes en 2005 (probablement en raison de conflits politiques internes à Washington). Consumer Alert s’est distinguée en étant notamment la seule organisation libérale à être officiellement conviée à l’une des grandes rencontres mondiales sur le climat ! Le Competitive Enterprise Institute (ci-après : CEI) a été fondé en 1988 par Fred Smith et son épouse. C’est un organisme indépendant que Fred inspira jusqu’à ses derniers jours, un « agent d’influence » du Policy Making libertarien. A ce titre, le CEI est presque à mettre au même plan que l’autre grande organisation libertarienne de Washington, le CATO Institute, mais avec un agenda différent et un tout autre style.
Les réglementations de toute nature furent la principale cible de Fred Smith et du CEI, celles qui contraignent, par exemple, le déplacement automobile car « la mobilité » était, aux yeux de Fred, l’une des grandes conquêtes de la civilisation libérale. Fred écrivit de grands articles sur ce sujet, sans doute l’un des premiers qu’approfondit son Institut. Non pour défendre l’automobile en tant que telle ; mais ce qu’elle représente en termes d’autonomie personnelle, de maîtrise du temps, de relation sociale ou de liberté personnelle. La réglementation des produits chimiques, au début des années 2000, fut un autre de ses grands dossiers, juste avant qu’il ne revienne, en profondeur, sur l’importance cruciale des droits de propriété pour traiter les grands dossiers écologiques (pollution, climat, gestion des ressources etc.).
L’écologie de marché : une approche typique de Fred Smith
La méthode de Fred Smith s’employa brillamment à faire comprendre ce qu’il aurait pu nommer : l’écologie libérale. Il développa souvent ses vues sur cette écologie positive, qu’il opposait à l’écologie punitive imposée par les « verts », tant en Amérique que dans d’autres régions du monde. En 1992, au moment-même où était fondé l’ICREI à l’initiative d’Alain Madelin et d’Henri Lepage, Max Falque résumait ainsi les travaux débutés en compagnie de Fred Smith, poursuivis ensuite pendant une trentaine d’années :
« Si l’environnement des pays capitalistes est sensiblement moins dégradé que celui des pays socialistes, on le doit moins (à leurs) multiples réglementations qu’à l’efficacité de l’économie de marché et à la protection des droits de propriété » (Falque & Millière, 1992, p. 1).
Ce livre proposait « Une autre approche de l’environnement », inspirée par la révolution intellectuelle du Free Market Environmentalism. Ce courant puisait ses origines dans les travaux du PERC(Property & Environment Research Center), un think tank localisé à Bozeman, dans le Montana, animé notamment par John Baden, Terry Anderson, P.J. Hill et Richard Stroup. Inspirés par La théorie des droits de propriété – une approchedéveloppée par le prix Nobel d’économie Ronald Coase puis Harold Demsetz ou encore les professeurs Armen Alchian et Henry Manne –, ces universitaires étaient déjà des praticiens de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Analyse économique du Droit. Fred s’est efforcé de faire connaître leurs travaux et leurs idées. Il en fut le passeur, le vulgarisateur auprès des milieux politiques, professionnels et gouvernementaux de Washington.
Cette idée de renverser le paradigme écologique, Fred Smith en fut l’un des plus ardents défenseurs, notamment lorsqu’il s’impliqua en ex-URSS pour tenter d’éviter aux russes, fraîchement dégagés du joug communiste, de tomber dans les travers de l’écologie politique dans laquelle les États-Unis, et des pays occidentaux comme la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas, se sont malheureusement enfermés depuis les années 1970. La conférence prononcée par Fred Smith à Moscou, lors d’un colloque du Cato Institute en septembre 1990, critiquait vivement la politique écologique américaine dont il précisait déjà les défauts[3] :
« Les bureaucrates déterminent les cibles à atteindre, les planificateurs les traduisent en règlements, et leurs directives sont envoyées aux citoyens. Ce processus engendre certains gains … mais il ne permet de mobiliser ni l’énergie, ni le génie des populations. Au contraire, il arrive souvent qu’un tel procédé les paralyse ! Au moment où l’ancienne URSS renonce à la planification économique, les nouvelles républiques de la CEI (Communauté des États indépendants) devraient se garder de recopier l’approche américaine ! » (id . p. 238).
Le CEI fut ainsi le promoteur d’une approche de l’environnement qui insistait sur le rôle de la conservation privée, afin que l’action écologique n’ignore ni les valeurs économiques ni les droits de propriété. Son propos fut surtout de transcender, en cette matière comme dans d’autres, l’État centralisé et dirigiste, et d’imaginer : « un programme de privatisation écologique (et de) multiplier les expériences environnementales qui débouchent sur des échanges volontaires et pacifiques » (in : Falque & Massenet, p. 49).
Il faudrait, disait Fred Smith découvrir tout ce que des institutions privées peuvent apporter à l’environnement, afin de remplacer la gestion publique, souvent défaillante, par l’engagement volontaire des propriétaires fonciers. Il soutenait ces proposition par diverses preuves : les viviers, les cheptels et les animaux domestiques prospèrent partout parce qu’ils sont d’appropriation privée ; en revanche, la faune, la flore et le milieu vivant, laissés en déshérence, s’appauvrissent ou sont menacés d’extinction, même lorsqu’ils sont gérés par l’État ou par d’autres personnes publiques !
Dès la chute du mur de Berlin en 1989, Fred Smith souligna la profonde différence entre l’état du territoire et du milieu de vie en République démocratique allemande (RDA) et celui de la République fédérale occidentale : régions allemandes bien plus propres, plus riches, plus libres et plus compétitives que l’ensemble des provinces orientales de la RDA, essentiellement nationalisées depuis l’occupation russe, gérées à la mode communiste par l’État et des collectivités de type soviétique.
Réaliste, Fred Smith ne sous-estimait pas la difficulté de la tâche : « se libérer de la mainmise d’une bureaucratie politique et culturelle est rarement facile » admettait-il (id. p. 50). Mais, pour entretenir l’espoir, il rappelait la parole biblique : dès le Jardin d’Eden, Dieu confia à l’Homme le droit et la responsabilité de conserver ce Jardin. Instaurant ainsi les premiers droits de propriété, le Créateur, soulignait Fred, « sacralisa ce droit qui reste l’un des fondements essentiels de notre civilisation, et dont la violation doit donc être sévèrement punie » (id. p. 51).
Cela étant posé, Fred Smith et son équipe du CEI étudièrent aussi, avec beaucoup d’attention et de précision, les circonstances dans lesquelles certains peuples (des tribus indiennes du Canada, par exemple) ou des communautés fermées (des pêcheurs côtiers, notamment) ont défini et fait respecter des règles durables pour entretenir et partager équitablement l’exploitation d’une ressource dont les membres du groupe pouvaient tirer un parti personnel[4]. Ces règles permettent de surmonter l’effet de « passager clandestin », selon lequel prévaut une incitation à abuser d’une ressource sans maître, droit ni titre. Citant les travaux de Demsetz sur l’organisation coopérative du territoire de chasse des Indiens Montagnais aux XVIIe et XVIIIe siècles, F. Smith écrivit cette belle leçon de choses :
« Avant le commerce des fourrures, la terre était propriété collective ; grâce à ce commerce, le prix de la peau de castor augmenta beaucoup ; la chasse s’intensifia, menaçant la population des castors. Afin de la préserver, les Indiens privatisèrent les barrages de castors ; tout barrage découvert était revendiqué et marqué ; les familles n’en exploitaient qu’une partie chaque année. Cette “ propriété informelle ” fonctionna bien : les castors étaient chassés de manière “ soutenable ” ; de tels exemples de propriété créative se sont développés dans de nombreuses sociétés. » (id. p. 52).
Autre exemple parlant, emprunté au savant économiste péruvien Hernando de Soto, à propos du sous-développement économique du Pérou moderne : Fred Smith évoquait l’échappatoire imaginée par les paysans péruviens pour développer leurs relations économiques, en dépit des contrôles rigoureux et étriqués d’un État tatillon, inquisitorial et borné :
« l’exode rural massif du dernier demi-siècle (suscita) l’émergence d’une propriété spontanée, non-contrainte, informelle ; (ces peuples) ne pouvaient survivre qu’en se tournant vers le marché noir ! En fait, les Péruviens ont créé des droits de propriété informels parce qu’ils étaient incapables de remplir les exigences d’une réglementation intransigeante et de payer le coût exorbitant nécessaire pour obtenir un titre légal » (id. p. 54)
Comprendre de tels systèmes et les intégrer dans un mécanisme que les paysans admettraient, et en lequel ils auraient confiance, n’est pas simple ; c’est pourquoi, concluait Fred : « ni les valeurs économiques niles valeurs écologiques ne sont bien gérées dans la plupart des régions du globe ! » (id. p. 55). La conclusion coule alors de source :
« Intégrés et protégés par des normes locales, ces droits de propriété peuvent survivre longtemps ; toutefois, dès que cet îlot se perd dans l’économie globale, ils peuvent être sabordés par la guerre, le vol ou l’expropriation … Trop souvent, le monde extérieur ne comprend pas ces règles (informelles). C’est ce qui s’est produit avec les castors (canadiens) : la venue des Anglais sur le territoire des indiens engendra un vrai conflit culturel : ces droits informels n’étant pas légitimes aux yeux des étrangers, le système judiciaire canadien ne l’a pas fait respecter ; dès lors, la population des castors a décliné. » (id. p. 52)
Fred Smith posait ainsi le défi du monde actuel : peut-on conserver nos droits de propriété formels (ceux de notre Code civil, par exemple) tout en tirant parti du réalisme des systèmes informels inventés par la coutume, ici et ailleurs ? C’est une entreprise difficile, admettait-il ; d’autant que ces droits coutumiers se combinent non seulement avec les droits privatifs de chacun, mais aussi avec des propriétés publiques et leurs multiples avatars (en France, ceux du Conservatoire du Littoral, par exemple) dont le champ d’action s’étend sans que l’on en discerne vraiment l’effet bénéfique, nonobstant les principes qui en ont permis la construction :
« en Europe et aux États-Unis, la réglementation d’État contraint la propriété privée à un point tel que certains attributs traditionnels de la propriété privée n’existent plus : (sous prétexte d’écologie), la politique légitime les torts causés aux propriétaires privés (du seul fait de règles d’ordre public) ! » (id. p. 53-54)
Un remarquable prosélyte des libertés
Fred Smith fut un exceptionnel passeur d’idées. Il fut l’agent opérationnel d’une grande famille intellectuelle, ouvrant un débouché politique à ses idées. Il accomplit cette tâche avec un brio incontestable et des résultats, encore incertains certes, mais qui devraient progresser. Il s’était spontanément tourné vers l’Europe centrale et orientale dès la chute du régime soviétique en 1989. Très sensible aux dégâts écologiques laissés par les soviets et par leurs émules, partout où ils ont régné pendant trois quarts de siècle, Fred donna de son temps et de son énergie pour porter la bonne parole en Russie. Déçu par l’évolution de la Russie actuelle, comme nous tous, il évoquait cette expérience dans ces termes :
« Il y a quelques années, je donnais des conférences en ex-Union soviétique ; j’expliquais que le modèle américain de protection de l’environnement – consistant à tout réglementer – est extrêmement coûteux, qu’il nécessite une bureaucratie importante et puissante, qu’il est vulnérable aux pressions politiques, qu’il privilégie les intérêts particuliers plutôt que l’intérêt général. Je leur ai suggéré de chercher une nouvelle approche et, puisqu’ils s’engageaient dans un effort massif de privatisation, qu’ils pourraient aussi fournir un effort en matière d’environnement. Je résumais en disant que le modèle politique n’est pas nécessairement sage ! »
On sait, malheureusement, que cette leçon n’a guère porté ! Réaliste, tenace et confiant en l’avenir de la raison, Fred Smith concluait, limpide : « La privatisation écologique est une idée nouvelle qui consiste à redécouvrir des pratiques anciennes et efficaces. Nous devons l’explorer pour faire triompher nos idées : l’essentiel reste à faire !» (id. p. 55)
Dans des formats et dans des contextes variés, Fred Smith s’exprimait aussi brillamment à l’oral qu’à l’écrit. A la manière de Bastiat (dont il était un grand admirateur et auquel il ne manquait jamais une occasion de se référer), il parsemait ses interventions d’illustrations nombreuses et vivantes ; il partageait ses convictions avec verve et clarté. Tempérées par une sérieuse dose d’humour, par sa solide maîtrise de l’économie politique, par son habileté rhétorique et par sa culture générale, ses interventions firent des merveilles ! L’une de ses qualités fut d’aborder simultanément un grand nombre de sujets, dans de multiples domaines, et de jongler avec les concepts. Ses capacités d’expression étaient exceptionnelles : usant de mots simples, d’illustrations convaincantes et d’une énergie conquérante, Fred Smith nous engage à poursuivre son œuvre sans relâcher nos efforts : découvrir et mobiliser de nouveaux droits de propriété afin d’améliorer notre environnement, nos modes de vie et notre qualité de vie !
Ce projet optimiste implique de remplacer l’action publique, étatique et centralisée dont on connaît les travers et les limites, par une mobilisation de la société civile, dans le cadre d’actions volontaires et responsables. L’objectif est atteignable.
Nous sommes nombreux de ce côté-ci de l’Atlantique à regretter son départ, tout comme le pleurent, là-bas vers l’ouest, ses fidèles compagnons du continent américain ! Tous ceux qui, avec assiduité, ont fréquenté, pendant des années, les bancs de l’Université d’été de la Nouvelle Économie à Aix en Provence, se souviendront longtemps des contributions de ce grand brasseur d’idées libérales. Ils ne manqueront pas d’y associer le souvenir d’une autre personnalité américaine, très vieil ami de Fred, aujourd’hui également disparu : le professeur Leonard Liggio, qui a si puissamment aidé Jacques Garello à faire d’Aix en Provence un pôle d’attraction, un point de passage obligé pour tant d’universitaires libéraux de renommée internationale.
Bibliographie sommaire
- Contributions en français sur l’écologie et les droits de propriété
- 1992 : « Économie de marché et protection de l’environnement » de Fred L. Smith, pp. 237 à 279 (adapté de l’anglais par Jacob Arfwedson & Henri Lepage), in Écologie & Liberté, sous la direction de Max Falque & Guy Millière, LITEC, Paris, collection Liberalia.
- 1997 : « Protection de l’environnement par la privatisation écologique : un paradigme pour la réforme » de Fred L. Smith, pp.49 à 55 (adapté de l’anglais par Max Falque) in Droits de propriété & Environnement, coll. -ICREI, sous la direction de Max Falque & Michel Massenet, Dalloz, Paris (372 p.) collection : Thèmes & Commentaires.
- Voir aussi les nombreux documents sur le site de l’ICREI : https://www.icrei.fr/documentation/
- Accessibles sur le site du Competitive Enterprise Institute (cei.org)
- In Memoriam: https://cei.org/issues/capitalism/in-memoriam/
- Introduction du livre publié par d’anciens collaborateurs en 2021: https://cei.org/studies/labor-of-love-a-fred-smith-story/
- Article fondateur sur la « Free Market Ecology » de 1995 : https://bit.ly/3CfBFT3
- Synthèses sur les droits de propriété et l’écologie de marché (début des années 2000)
- « Sustainable Development A Free-Market Perspective » https://bit.ly/3WlpnPF
- « Eco-Socialism Threat to Liberty Around the World » https://bit.ly/4heb9bK
- « The Bankruptcy of Collectivist Environmental Planning » https://bit.ly/3PJ6zGA
[1] Fred Smith: “Selling Ideas in a Rationally Ignorant World! ,” The Insider, nov. 1999, The Heritage Foundation, Washington DC,
[2] On trouvera en annexe quelques références pour mieux connaître Fred Smith, le CEI qu’il a fondé, et son mode d’action, notamment en faveur de l’écologie de marché. Voir aussi : https://cei.org/experts/fran-sm
[3] Retranscrite et adaptée de l’anglais par Jacob Arfwedson & Henri Lepage, cette communication est reprise au chapitre : « Économie de marché et protection de l’environnement » in : Falque & Millière, 1992, pp. 237 – 279.
[4] On songe à ce propos aux travaux d’Elinor Ostrom qui décrivit et expliqua l’importance de ces règles informelles.