L’actualité de ce début de 2025 ne conduit guère à l’optimisme quant à l’évolution de nos finances publiques :
- D’abord, avec la perspective de pousser plus encore l’endettement mutualisé de l’union européenne, chaque pays y ayant sa part au prorata de son poids dans l’union.
- Ensuite avec la décision d’exclure les dépenses d’armement dans le calcul des déficits budgétaires qui doivent être soumis à la commission européenne dans le cadre du pacte de stabilité. Il est vrai qu’il était patent que ce dernier n’était pas appliqué de la même manière selon les pays et certains en dénoncent aujourd’hui le caractère obsolète (B.Lyddon, 2023)
- Enfin, l’abandon par l’Allemagne de sa propre règle de plafonnement du déficit budgétaire.
Déjà les réactions sont claires, l’écart entre les taux d’intérêt français et allemands sur les obligations d’État à 10 ans, ce que l’on appelle le spread, de l’ordre de 0,75% en mars 2025 (0,45% un an plus tôt) s’ajoute à un taux allemand à 10 ans de 2,85%, en hausse de 0,45% depuis le début de l’année. Une telle situation, si elle devait perdurer, ou pire s’aggraver, ne manquerait pas d’alourdir la charge de la dette et de rendre plus difficile encore la maîtrise de l’endettement.
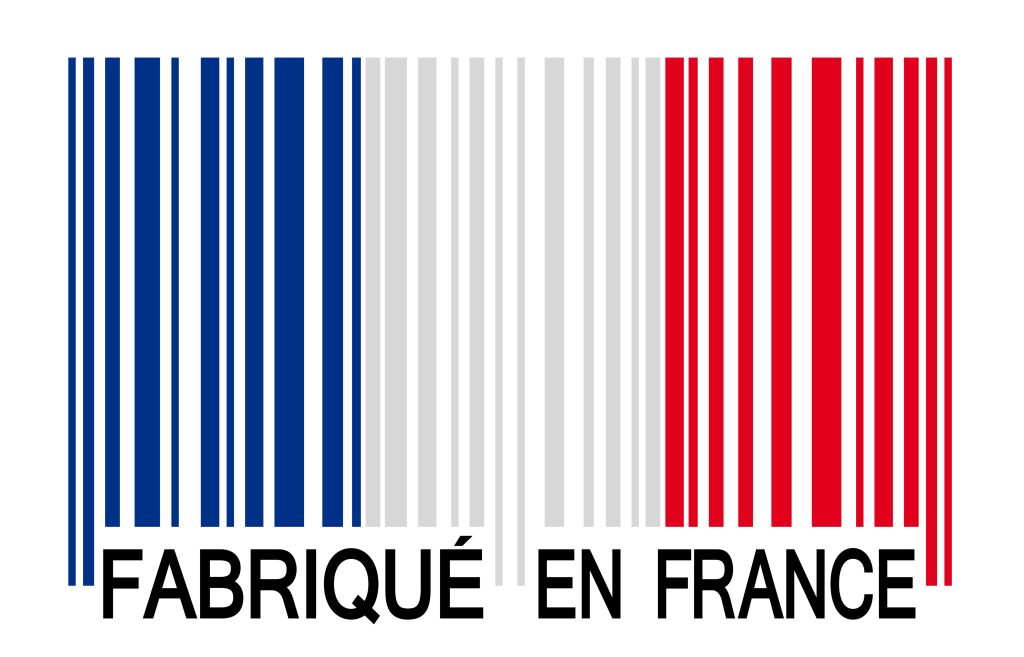
1. Un constat…
Dans un article récent François Facchini (2024-1) a dressé un tableau éloquent de la dégradation des comptes publics de 2017 à 2023. La dérive était déjà dénoncée il y a vingt ans par Michel Pébereau (2005) : la dépense a été utilisée comme instrument visant à régler toutes sortes de problèmes sans grand souci d’efficacité malgré une part des dépenses d’éducation, de santé, de logement dans le PIB, nettement supérieure à la moyenne européenne (Robert, 2024). De plus, par une sorte d’effet de cliquet, dès lors qu’une dépense existe, il est apparu politiquement « délicat » de la mettre en question compte tenu de l’opposition des groupes qui en bénéficient.
Des dépenses croissantes, essentiellement courantes (transferts sociaux, fonctionnement) sont à l’origine de déficits récurrents. Ceux-ci débouchent sur un compte financier déficitaire dans la balance des paiements, rendant la France dépendante d’acteurs étrangers pour son financement, qu’il s’agisse de souscrire à sa dette ou de prendre possession d’un nombre croissant de ses actifs.
Le soutien budgétaire à l’activité n’a pas brillé par son efficacité comme l’avaient déjà montré les relances Chirac et Mitterrand. À la suite de l’épisode Covid, l’accélération de l’endettement conjugué à une politique monétaire permissive, a fini par réveiller l’inflation (D’Arvisenet, 2025).
Les ressources consacrées à la dépense publique sont détournées de l’investissement productif. Avec le temps, le stock de capital s’en trouve érodé et avec lui la capacité à créer des emplois et à stimuler les gains de productivité et donc le potentiel de croissance. Alors même que l’endettement progressait, la croissance moyenne s’érodait progressivement : 5% l’an dans les années 1960, 4% dans les années 1970, 3% dans les années 1980, 2% dans les années 1990, et désormais 1%. François Facchini (2024-2) a mis en évidence pour les pays de l’OCDE une relation clairement négative à long terme (1980-2019) entre l’évolution des dépenses publiques et celle du PIB par tête.
Avec les dépenses de ses administrations qui approchent 58 points de PIB, la France se place désormais au premier rang des pays de l’OCDE.
La France a été le seul pays de l’Union européenne à enregistrer une dérive dans les années qui ont suivi la fin de la pandémie : le déficit est passé de 4,7% du PIB en 2022 à 5,5 en 2023 et 6,2 en 2024, le double du niveau atteint à la veille du covid, alors même que le PIB avait retrouvé, puis dépassé son niveau d’avant crise.
Le rebond de l’activité post covid a éliminé un output gap négatif (écart entre PIB observé et PIB potentiel) qui avait atteint 6,1% du PIB en 2020. Le maintien de déficits massifs ne peut donc être imputé à un facteur conjoncturel. De fait, le déficit structurel (corrigé des effets du cycle et donc attribuable aux mesures discrétionnaires) est quasi identique au déficit observé, une situation qui tranche avec celle de nos voisins : le déficit structurel pour l’ensemble de l’UE s’est en effet replié de 4,5 points en 2021 à 2,8 en 2024.
2. … et des débats
Alors que certains pensaient que le déficit ne posait pas problème –récemment encore, le gouvernement se voyait conseiller d’emprunter plus encore pour profiter des taux bas –, d’autres – à l’instar des partisans de la « théorie monétaire moderne » — prônaient le financement monétaire direct par la banque centrale de dépenses publiques sans cesse plus élevées, tant que l’inflation ne se manifeste pas. L’épisode récent d’une inflation liée à la conjonction de contraintes d’offre et de politiques monétaires trop longtemps expansionnistes a eu raison de ces préconisations.
D’autres enfin, craignent le report de la charge de l’endettement sur les générations futures. S’il leur est parfois répliqué que ces dernières bénéficieront des infrastructures financées par l’endettement, la vérité est que l’endettement conduit plus à un transfert des contribuables présents (et futurs) vers les créanciers, nationaux ou pas (et leurs héritiers).
3. La hausse tendancielle de la dépense : des facteurs économiques…
L’évolution de la dépense est souvent interprétée, soit à l’aune des fonctions de l’État décrites par Musgrave : allocation des ressources, redistribution et régulation conjoncturelle, soit par référence au passage d’un État régalien à un État providence.
Au début des années 1900, le ratio dépenses publiques sur PIB était de l’ordre de 10-15%, suite aux deux conflits mondiaux et à la crise de 1929 cette proportion a considérablement augmenté pour atteindre 38% en 1950, mais à peine plus en 1970 (40%, seuil au-dessus duquel l’économie devenait socialiste selon les termes du Président Giscard d’Estaing). Une nouvelle phase d’accélération des dépenses publiques s’est manifestée avec les chocs pétroliers (43% après le premier choc, 50% avec le 2ème choc et la relance Mitterrand), puis avec la grande crise financière et enfin avec le covid (61,3% en 2020, 58,1% en 2022), bien plus que la moyenne de la zone euro (50,8%).
De nombreuses explications à cette tendance séculaire de la dépense publique ont été avancées. A la fin du XIXe siècle Wagner y voyait une réponse à la hausse des besoins liés au développement économique, à l’urbanisation… Peacock et Wiseman, étudiant l’évolution de la dépense publique britannique entre 1890 et 1955, ont remarqué que l’évolution de la dépense n’est pas linéaire mais connait des phases de poussée liées aux crises, aux guerres… les hausses observées au cours de tels épisodes ne sont pas suivies de repli. Cela tiendrait au fait qu’un besoin sous-jacent est révélé et conduit à l’acceptation de prélèvements accrus (R. Higgs, 1987). A noter que ce phénomène n’a pas toujours existé : entre 1918 et 1928, la situation budgétaire est retournée à la normale observée avant la première guerre mondiale. L’écart entre les évolutions tendancielles de gains de productivité entre secteurs a été mis en avant comme facteur de hausse du poids de l’État et donc de la dépense publique. C’est le résultat de la loi de Baumol. William Baumol (1967) a développé un modèle de croissance déséquilibrée reposant sur les écarts de gains de productivité du travail entre un secteur dynamique (industrie notamment) et un secteur dit stagnant. Les forts gains de productivité du premier débouchent sur des salaires élevés dont le niveau se diffuse dans le secteur « stagnant » dont les coûts relatifs connaissent en conséquence une dérive haussière, de même que le prix relatif de sa production. Malgré ses hypothèses restrictives (il s’agit d’un simple modèle d’offre sans effet de la demande (Harvey, 1998)), le modèle montre une dynamique de croissance qui conduit à un poids accru des services à faibles gains de productivité, ce qui peut naturellement s’appliquer à l’État.
L’école du public choice a mis en avant plusieurs types de mécanismes :
- l’asymétrie entre avantages et coûts fiscaux de certaines mesures. Les groupes organisés bénéficiaires de certains dépenses (et réglementations) sont incités à investir en temps (grèves, manifestations, lobbying c’est le « voice » de A. Hirschman) pour obtenir satisfaction, alors que le coût fiscal de ces mesures – très bénéfiques pour ces groupes limités et bien identifiés – est dispersé sur l’ensemble de la population des contribuables, peu incités à s’opposer (à la limite ils pratiqueront l’exit…).
- Le cycle politico économique : jusqu’à l’apparition d’un épisode de stagflation dans les années 1970, il s’agissait de pratiquer un arbitrage entre inflation et chômage rendu possible par l’existence d’une relation de Phillips. Compte tenu de la mémoire supposée courte des électeurs, il y a intérêt à relancer l’économie par une politique monétaire expansionniste et/ou par la dépense publique (ou les baisses d’impôts) avant les élections. Les effets inflationnistes de l’opération n’apparaissant qu’à l’issue de certains délais, ils pouvaient être corrigés une fois les électons passées (cycle dit naïf à la Nordhaus). La portée de la courbe de Phillips a été mise en cause par Friedman, à raison : la relation de Phillips à long terme est de fait devenue une verticale, le taux de chômage tendant à revenir à son niveau naturel, la courbe de Phillips traditionnelle ne valant qu’à court terme, étant appelée à disparaître dès lors que les agents économiques adaptaient leurs anticipations d’inflation à un niveau plus élevé (pour une présentation, voir P. d’Arvisenet, 2014). Plus récemment, depuis la fin des années 1990, les politiques monétaires se sont caractérisées par un biais accommodant : taux directeurs nuls voire négatifs, maintenus en deçà de ce qu’auraient suggéré les comportements habituels (fonction de réaction de Taylor) et achat massif d’actifs sur les marchés, normalisation tardant à se concrétiser après les crises (éclatement de la bulle des nouvelles technologies, crise des subprimes, covid).
- Une variante existe au cycle politico-économique : le cycle partisan. Dans ce scénario, les gouvernants, une fois élus, récompensent leur électorat et sont amenés, là encore, à corriger dans un deuxième temps.
- Autre importante contribution du public choice : les analyses du fonctionnement de la bureaucratie. Une entité publique (que Niskanen désigne par « le bureau ») fournit des prestations à un public (les usagers), mais son « client » est l’autorité de tutelle qui lui délivre un budget, ce n’est pas directement l’usager. Le bureau en question cherche naturellement à maximiser ce budget. L’autorité de tutelle n’est pas jugée par les électeurs sur la seule activité du bureau considéré, mais sur une large variété de domaines (tout le champ de l’activité des administrations), dès lors elle pourra voir avec « sympathie » la demande des gestionnaires du « bureau » ; d’autant que tout ceci manque de transparence pour les usagers qui ne subissent les coûts qu’indirectement, les impôts finançant naturellement une multitude de dépenses (par opposition à un prix de marché lié au service rendu). Les « usagers » sont ainsi incités à consommer davantage : comme on a pu l’énoncer en France : « c’est gratuit, c’est l’état qui paie ! ». M. Friedman et R. Friedman, dans leur magnifique exercice de vulgarisation (1980) invitent à considérer les degrés de « générosité » associés à différentes façons de dépenser : son propre argent ou celui des autres, pour soi ou pour les autres…
- Enfin, il existe un biais pour le facteur travail dans la fonction de production du secteur public (Parkinson, 1983).
La théorie économique du public choice fournit ainsi de nombreuses explications à la croissance des dépenses publiques. La théorie économique explique également jusqu’à quel point ces dépenses sont soutenables.
La France s’est caractérisée de manière récurrente par des soldes primaires trop dégradés pour stabiliser l’endettement. En 2024, trois ans après la sortie de l’épisode covidien, avec un écart de 1,35 point entre le taux d’intérêt implicite de la dette (2%) et la croissance en valeur (3 ,3%) et un taux d’endettement de 109,9 %, le déficit primaire compatible avec une stabilisation de la dette est estimé à 1,5 point. Or le déficit primaire observé (c’est-à-dire, le solde négatif du budget des administrations publiques sans prendre en compte les intérêts versés sur la dette et les revenus d’actifs financiers reçus) est de 4,1 points, d’où une hausse du taux d’endettement de 4,1 – 1,5 = 2,6 points, portant ce dernier à 112,5 points.
L’écart entre le taux d’intérêt réel, r, et le taux de croissance du PIB, g, a un rôle clé dans la croissance de la dette. Intuitivement, si la croissance est forte et que l’on peut emprunter à des taux raisonnables l’endettement sera soutenable. Cet écart, noté r – g, est lui-même sensible au niveau de l’endettement. Lian et al. (2020), dans une étude fondée sur 56 pays (dont 31 émergents) observés sur une période de 70 ans (1950-2019), montrent qu’un niveau élevé d’endettement est associé à un écart r – g positif et élevé. Avec l’endettement, en effet r et g tendent à évoluer en sens inverse. En outre, la durée des épisodes de r – g négatif est d’autant plus faible que le taux d’endettement est élevé et que l’effet d’un choc négatif sur le PIB sur l’écart r – g croît avec le niveau d’endettement, notamment lorsqu’une part de la dette est contractée en devise étrangère. De ce point de vue, tout se passe comme si l’euro était une monnaie étrangère puisque la souveraineté monétaire des pays membres a été cédée à une institution internationale, la BCE.
4. …et des facteurs politiques
Le souci de lisser le cycle (amortir les fluctuations économiques) est souvent évoqué pour justifier le recours à l’endettement, mais de façon temporaire. Il s’agit de laisser se creuser un déficit lors des phases baissières du cycle : les prélèvements se contractent avec la modération des assiettes fiscales et sociales, les dépenses en faveur des victimes de la conjoncture progressent. Mais il s’agit aussi de laisser apparaître un excédent dans la phase haussière du cycle. Si bien qu’au total, cette évolution conjoncturelle spontanée (hors mesures discrétionnaires) n’est pas de nature à déboucher sur une hausse durable de l’endettement. Une telle politique contra-cyclique s’appuie sur le jeu des stabilisateurs automatiques (et non pas, une fois encore, sur des mesures discrétionnaires).
Or, la politique que l’on peut observer n’est pas de cette nature, elle est asymétrique : elle est « expansionniste » dans les phases baissières de l’activité et tend à le demeurer dans les phases haussières, ce qui est un bon moyen d’inscrire l’endettement sur une tendance à la hausse.
La réticence à l’ajustement des finances publiques est patente au regard du caractère pro-cyclique de la politique budgétaire. L’aversion de la France à utiliser les reprises conjoncturelles pour améliorer les comptes publics avait trouvé une illustration éloquente avec le fameux épisode de la « cagnotte » (alors que le taux d’endettement dépassait le seuil des 60%) : une quarantaine de milliards de recettes supplémentaires liées à la reprise de la croissance n’avaient alors pas été mise à profit pour consolider la situation budgétaire.
Enfin les hypothèses de croissance économique adoptées en amont de la préparation et de la présentation des budgets sont généralement marquées d’un optimisme exagéré, si bien que lorsqu’une situation budgétaire se dégrade, il est facile d’accuser la conjoncture.
Pourquoi les ajustements budgétaires sont-ils repoussés ?
La nécessité de consolider les finances publiques et les pressions financières liées à une forte hausse de la dette souveraine sont bien sûr des incitations à agir. Les crises sont – ou en tous cas devraient être – un catalyseur pour le lancement de réformes, qu’il s’agisse du marché du travail, du marché des biens ou des finances publiques.
Alors que les situations de crise apparaissent propices aux réformes (« on ne peut plus reculer »), le maintien de déficits budgétaires récurrents peut surprendre, d’autant que l’on sait que la trajectoire budgétaire est insoutenable, et que le coût d’un ajustement augmente avec le temps. Mais l’opinion qui prévaut est que tant que la situation n’est pas intenable, on ne fait rien. Pourquoi cette réticence politique à ajuster ? Alesina et Drazen (1989) et Alesina et Passalacqua (2016) y voient le résultat de guerres d’usure (war of attrition) menées entre groupes ou entre leurs représentants dans les sociétés divisées où les agents sont hétérogènes face au coût d’un ajustement et quant à l’intensité de leur opposition à ce dernier. Tous les groupes ne partagent pas les mêmes objectifs (bénéficiaires et cotisants par exemple), tous n’ont pas les mêmes préférences partisanes (par exemple impôt proportionnel ou impôt indirect pour les uns, impôt progressif et taxation du capital pour d’autres). Chaque groupe cherche naturellement à passer à travers les gouttes et souhaite que d’autres paient la facture (impôts, réduction des transferts…). Dans cette lutte redistributive, ils militent (lobbying, action collective). Plus la polarisation politique est forte et plus longue est la période d’instabilité et le délai pour arriver à une décision. Celle-ci intervient une fois que le groupe politiquement le plus faible s’incline.
Quel rôle joue l’Union économique et monétaire ?
Avec le covid, le pacte de stabilité et de croissance a été gelé dès le début de 2020. Il a été réactivé sous une nouvelle forme en 2024 avec le souci affiché de conduire les États à s’engager plus sérieusement dans l’assainissement de leurs finances et à s’impliquer de façon plus marquée dans la correction des déséquilibres macroéconomiques. Pour cela, les états devraient fournir un plan budgétaire et structurel à moyen terme (4 ans, éventuellement allongé à 7 en cas de difficulté).
Le souci de simplification se traduit par la référence à un critère unique : l’évolution des dépenses publiques hors intérêts et hors indemnisation du chômage. Le sentier d’évolution de la dépense, propre à chaque pays, devrait être compatible avec une réduction de l’endettement (au moins 0,5 point de PIB par an). L’exigence de réduction de 1/20 ème par an de l’écart des taux d’endettement observés par rapport à l’objectif de 60% a été abandonnée. Si son taux d’endettement dépasse 90%, le pays concerné est censé réduire ce taux d’un point par an, il en est toutefois exempté si son déficit dépasse trois points !!! En outre l’effet de la hausse des charges d’intérêt est décompté jusqu’en 2027. Pour un taux d’endettement compris entre 60 et 90 points, l’exigence de réduction est réduite à 0,5 point l’an. Le déficit français, malgré un niveau de 6,2 points en 2024 (contre 4,4 points attendus après 5,5 points en 2023) et un contexte politique rendant l’évolution budgétaire très incertaine, n’a pas suscité de réaction négative de la part de la Commission européenne. Les agences de notation ont conservé pour leur part une position attentiste.
Parallèlement, on assiste à une montée en puissance de l’ambition fédéraliste des institutions européennes avec notamment le plan Next Generation EU de près de 800 Mds d’euros (338 Md€ sous forme de subvention, 385,8 Md€ sous forme de prêts), en partie financé par emprunt communautaire (contraire aux traités) à échéance 2058, avec, pour la France, une garantie de la dette commune à hauteur de son poids dans l’UE (B. Lyddon, 2023).
Le poids des intérêts et des remboursements futurs, en l’absence de provisionnement, risque fort de faire revenir la question d’un nouvel impôt européen pour lever de nouvelles ressources… et de la perte supplémentaire de souveraineté que cela ne manquerait pas d’occasionner. La distribution des fonds est assortie de contraintes d’utilisation (réformes structurelles touchant le marché du travail, les retraites …). Toutes, cependant, n’ont pas un effet positif sur le potentiel de croissance (« transition énergétique » …) et supposent… le respect des « valeurs européennes ».
Suite à l’épisode du covid, des contraintes d’offre généralisées (la mondialisation n’exerçant plus une influence modératrice sur les prix) se sont révélées être plus durables que prévu (pénuries de main d’œuvre…). Elles se sont conjuguées au maintien d’un policy mix (monétaire et budgétaire) ultra expansionniste, alors même que se manifestaient les signes d’un réveil de l’inflation. Les achats de dette publique par l’euro-système ont représenté 85,4% des montants émis en 2020, 145,3% en 2021 et 44,8% en 2022. Alors que la taille du bilan de l’euro système par rapport au PIB de la zone est passé de 21,7% en 2007 à 71,5% en 2021, la part de dette publique qu’il détient a atteint 32,9%. La grande crise financière de la fin des années 2000 a conduit à une hausse du bilan de la Banque Centrale Européenne de 14,2 points de PIB, le covid à une hausse de 33,9 points. Les conditions monétaires ont alors échappé à la logique du marché, stimulant l’endettement et in fine l’inflation, d’abord des prix d’actifs et ensuite des biens et services, contexte propice au gonflement de bulles, à la hausse des inégalités de patrimoine et à l’instabilité financière.
Le caractère tardif du lancement de la politique de normalisation n’a pas manqué de susciter des interrogations sur la conduite de la politique monétaire.
De fait, si aux termes des traités et du mandat de la BCE, la stabilité des prix est la priorité affichée de la politique monétaire (le soutien aux autres politiques de l’Union est possible pour autant qu’il n’entre pas en conflit avec l’objectif principal de stabilité), le retard dans la normalisation n’a-t-il pas été suscité par la crainte des effets d’une hausse de l’endettement pour les finances des états ?
Pour Hayek (1976), une banque centrale ne peut être véritablement indépendante dès lors qu’elle doit répondre aux attentes de l’État. L’origine des banques centrales, tout comme leur histoire ne font qu’en attester (Bordo et al 2020). Comme le remarquent Sargent et Wallace (1981), l’accumulation de déficits publics conduit à abandonner la priorité donnée à la stabilité des prix au profit de la soutenabilité de la dette. Une hausse des taux d’intérêt destinée à maîtriser l’inflation modère aussi l’activité. Dès lors, l’évolution de l’écart r – g suppose un solde primaire compatible avec la soutenabilité de la dette plus difficile à atteindre, d’où le dilemme auquel est confrontée la politique monétaire.
Le lancement en 2022, du dispositif destiné à limiter la hausse des spreads intra zone euro, le TPM (transmission protection mechanism), tout comme la modification du mandat de la BCE en 2012, lui ouvrant la possibilité d’acheter de la dette publique sans limite, sous réserve de la mise en œuvre de réformes structurelles, en constituent de bonnes illustrations. Comme le souligne C. Plosser, cité par J. Dorn (2021) : à chaque crise, « la Fed prend du pouvoir mais perd de l’indépendance », on peut en dire autant de la BCE malgré la pluralité des juridictions dont elle émane.
La conjonction des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes a débouché, avant même le début de la guerre en Ukraine, sur un retour de l’inflation.
De la même façon, le soutien de la BCE aux investissements en faveur des énergies intermittentes n’est, d’une part, pas véritablement en phase avec la stabilité des prix comme en atteste le lien positif entre la part des énergies intermittentes dans le mix électrique et la prix du Kwh (R. Prud’homme, 2022 ), et d’autre part, relève de choix en matière d’allocation des ressources (et pas de la stabilisation macro-économique), ce qui dépasse le mandat de l’institution et pourrait être considéré comme s’écartant de la légitimité démocratique.
5. Les remèdes
Un audit détaillé de la situation de nos finances publiques est bien évidement indispensable. Le redressement suppose des choix, le rabotage des dépenses ne marche pas. Les sources d’économie sont connues, ce n’est pas ici le lieu d’en dresser une liste détaillée, les références et sources d’information sont multiples (IREF, Contribuables Associés, de Larosière (2024), Robert (2024), la Cour des Comptes, l’IFRAP, FIPECO, ACDEFI, etc.).
On sait – contrairement à ce que pensent les tenants d’un keynésianisme naïf – que le redressement des comptes publics n’est pas obligatoirement défavorable à la croissance. C’est le cas lorsque l’assainissement budgétaire est mené via la modération de la dépense notamment courante, et non par des hausses de prélèvements par nature désincitatifs. Les résultats favorables d’une telle politique dite d’austérité expansionniste ont été confirmées par les analyses économétriques menées sur un vaste échantillon de pays sur longue période par Alesina et al (2019). Ces dernières confirment les enseignements des expériences bien connues de la Suède , du Canada, de la Nouvelle Zélande, de la Finlande… sans oublier bien sûr celle de la France au début de la 5ème république avec le plan Armand Rueff et sa réduction de 15% de la dépense, ou encore les efforts consentis par plusieurs pays dans la perspective d’une entrée dans l’euro.
Inverser la tendance à l’explosion des effectifs affectés aux tâches administratives, supprimer les doublons et chevauchements, les agences inutiles, revoir le périmètre de l’activité de l’État (par exemple la multiplicité de chaînes de l’audiovisuel public) et de ses financements (Union européenne, aide au développement, recours aux cabinets conseil, subventions à des associations dont les activités peuvent ne pas apparaître souhaitables… autant de pistes qui mériteraient d’être enfin sérieusement considérées.
L’assainissement des finances publiques passe aussi par le dynamisme de l’économie, mais celui-ci ne tombe pas du ciel. Il suppose qu’il soit mis un terme à la débauche normative et à l’étouffement des producteurs sous le poids des charges (Bouckaert, 2024).
Au-delà, il conviendra d’établir des règles budgétaires appropriées (s’en tenir au jeu des stabilisateurs automatiques ? Règle d’or ? Trajectoire et plafonds annuels de dépense ou de déficit ?) et de définir les modalités institutionnelles propres à assurer leur respect.
Références
Alesina, A. et A. Cukierman (1987), “The Politics of Ambiguity,” NBER working paper 2486, Dec.
Alesina, A. et A. Drazen (1989), “Why are Stabilizations delayed?,” NBER working paper 3053, Aug.
Alesina, A., C. Favero et F. Giavazzi (2019), “Austerity,” Princeton University Press.
Alesina, A. (2019) “Effects of Austerity: Expenditure and Tax Based Approaches,” Journal of Economic Perspectives, spring.
Alesina, A. et A. Passalacqua (2015) “The Political Economy of Government Debt,” NBER working paper 21821, December.
Ardanaz, M. et A. Izquierdo (2017) “Current Expenditure Upswings in Good Times and Capital Downswings in Bad times,” IDB, Working paper 838, sept.
d’Arvisenet, P. (2014) « Les politiques monétaires dans la tempête », Economica, 2014
d’Arvisenet, P. (1999) La politique économique conjoncturelle, Dunod.
d’Arvisenet, P. (2015) “The Genesis of the Eurozone Sovereign Debt Crisis” in Managing the Risks in the European Periphery Debt Crisis, Palgrave Mc Millan, Basingstoke, NY, 2015
d’Arvisenet, P. (2025) « L’inflation ou le grand n’importe quoi de la politique monétaire », Revue Banque, mars et avril.
Bouckaert, B. (2024) « L’Europe, continent de l’incontinence normative ?», Journal des libertés, été 2024
Daniel, J-M. (2021) Histoire de l’économie mondiale, Taillandier.
Daniel, J-M. (2021) Il était une fois l’argent magique, Le cherche midi.
Facchini, F. (2024) « Histoire de la dégradation récente des finances publiques, 2017-2023 », Journal des libertés, été.
Facchini, F. (2024) « Finances publiques et décrochage économique français », Journal des libertés, automne.
Friedman, M. et R. Friedman (1980) La liberté de choix », Belfond.
Friedman, M. et R. Friedman (1984) La tyrannie du statu quo, J-C Lattes.
Hirschman, A. (1970) Exit, Voice and Loyalty, Harvard U Press.
Higgs, R. (1987) Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford U Press.
Ilzetzki, E., E. Mendoza et C. Vegh: « How Big (Small) are Fiscal Multipliers?”, IMF WP 11/52, IMF 2011
de Larosière, J. (2024) Le déclin français est- il réversible?, Odile Jacob.
Lian, W., A. Presbitero et U. Wiriadinata (2020) “Public debt and the r-g Risk”, IMF working paper, 20/137.
Lutfalla, M. (2017)“Une histoire de la dette publique en France, Classiques Garnier.
Lyddon, B. (2023) « Invest EU, net zéro et l’endettement croissant des citoyens de l’Union européenne », Journal des Libertés, Hiver.
Parkinson, C.N. (1983) Les lois de Parkinson, Robert Laffont.
Pébereau, M. (2015) « Rompre avec la facilité de la dette publique », Ministère de l’économie et des finances, décembre.
Prud’homme, R. (2022) Les vrais responsables de la crise énergétique, L’artilleur.
Robert, A-V. (2024) La France au bord du gouffre, L’Artilleur.





