Déficit public, dette publique, dépenses publiques font la une de l’actualité en France depuis quelques années. Il n’en a pas toujours été ainsi. Mais la crise sanitaire a rendu intenables les discours léthargiques des économistes et des hommes politiques qui s’appliquaient à minimiser, plus encore à nier, le problème. On pensait avoir atteint le fond avec la présidence Sarkozy, mais les chiffres de l’après-crise 2008 appartiennent déjà à un passé révolu. Le déficit public a atteint 9,2 % du PIB en 2020 et la dette publique 115,7 %, soit la bagatelle de 2 650 milliards d’euros, tandis que les dépenses publiques ont culminé à 62,1 % du PIB.
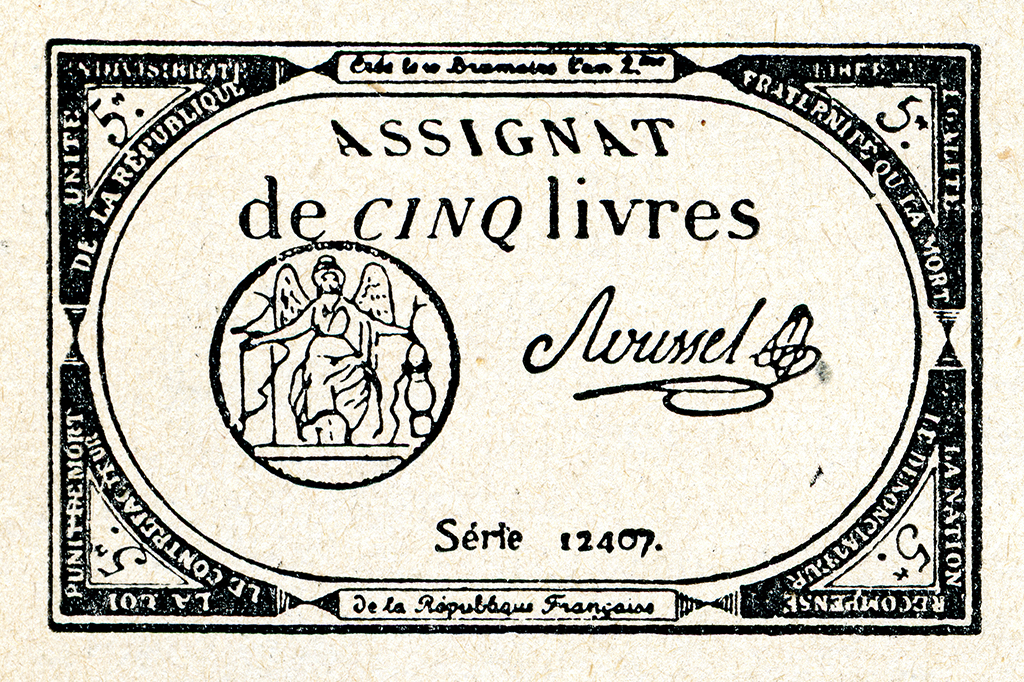
La crise sanitaire a d’ailleurs bon dos. En 2019, les dépenses publiques s’affichaient déjà à 55,6 % du PIB, soit 8,6 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Ce qui a distingué la France, ce n’est pas l’explosion des chiffres, mais le fait que ces derniers aient déjà été très haut avant la pandémie. La cigale ayant chanté tout l’été, et même de nombreux étés de suite, les marges de manœuvres ne peuvent qu’être réduites aujourd’hui. L’Etat affiche une incapacité congénitale à freiner ses dépenses, a fortiori à les réduire. Quelle que soit la conjoncture, la structure des dépenses publiques reste identique. Lorsque la croissance est – un peu – plus importante, aucune réduction des déficits ne survient. Lorsqu’elle est en berne, ceux-ci s’accroissent plus encore. Toute crise provoque un alourdissement de l’interventionnisme puisque les gouvernants – de droite, de gauche comme du centre, peu importe – croient indispensable de « soutenir l’activité », alors même que les difficultés pourraient être l’aiguillon d’une – profonde – réforme.
Y aurait-il dès lors une singularité française en la matière et, si oui, peut-on historiquement en trouver la source ? Entre autres intérêts, le stimulant ouvrage de François Facchini sur Les dépenses publiques en France[1] avive la réflexion. Explicitement centré sur la période 1870-2015, il voit dans les réformes de la Libération une rupture de la dynamique des dépenses publiques en France. L’objet du présent article est de vérifier cette hypothèse en procédant, si l’on peut dire, à l’envers. Au lieu de nous demander s’il existe une « exception française », puis de nous attacher à son origine historique spécifique, nous partirons de l’hypothèse d’une rupture en 1946 (I) avant d’élargir le problème, que nous avons soulevé dans notre dernier ouvrage[2], à la réalité d’une exception française sur le temps long (II).
- Une rupture dans la dynamique des dépenses publiques en 1946 ?
Sur fond d’appareil statistique impressionnant, François Facchini tient qu’il est impossible d’expliquer la dynamique des dépenses publiques sans comprendre les choix effectués à la Libération. La majorité socialo-communiste modifie la nature du régime économique en créant « à la fois un sentier de dépendance institutionnelle et un effet de blocage ». L’auteur insiste tout particulièrement sur deux réformes fondamentales : la loi de 1946 sur le statut de la fonction publique qui va aboutir à évincer les élus de la gestion de la masse salariale des administrations publiques ; les ordonnances sur la Sécurité sociale dont l’octroi des « droits sociaux » produira l’une des causes majeures de la croissance des dépenses publiques. Le modèle social français, fondé sur le « paternalisme » des hommes politiques, produit un processus d’auto-renforcement qui aboutit à un blocage institutionnel[3].
Par-delà l’économétrie, François Facchini souligne le changement idéologique survenu à partir des années 1930. Jusque-là, la doctrine classique des finances publiques sacralisait l’équilibre budgétaire. Toutefois, celui-ci n’excluait pas l’emprunt et la dette publique pour financer « les dépenses exceptionnelles comme la guerre et les grands travaux ». Alors que de 1871 à 1930, le bon gouvernement « rétablit les équilibres », en 1944 il utilise les dépenses publiques pour « produire ces biens collectifs que sont la croissance et le plein emploi » et pour « réduire les risques d’occurrence » des crises provoquées par le capitalisme[4].
Que penser de cette thèse ? Intéressons-nous d’abord à la méthodologie. La méthode économétrique est utile, mais elle recèle aussi des limites. C’est tout l’intérêt de l’ouvrage de François Facchini que de traiter des finances publiques, non pas sous l’angle habituel des spécialistes – généralement conservateurs, parfois socialistes – du droit public, mais essentiellement avec les lunettes – en l’occurrence libérale – de l’économètre. Cependant, au-delà la fiabilité et de la cohérence des paramètres utilisés – point fréquemment mise en exergue par l’auteur – se pose évidemment la question de l’interprétation des statistiques.
Un exemple paradigmatique de cette difficulté apparaît dans le traitement de l’inflation législative entre 1871 et 2016 calculée suivant le nombre de pages du Journal Officiel[5]. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre remonte à environ 15 000 par an. Or, une chute inédite se produit durant le gouvernement de Vichy puisque l’activité législative représente moins de 10 000 pages annuelles. Un lecteur pressé pourrait en conclure que l’Etat français n’a guère été parasité par la bureaucratie et il trouverait aisément des explications dans la période exceptionnelle de l’Occupation. Mais un observateur suspicieux relèverait immédiatement que la division du pays en deux zones jusqu’en novembre 1942 réduisait d’autant le territoire sujet à la règlementation si bien que, finalement, la diminution de l’intensité législative n’aurait rien d’évident. Bien plus fondamentalement, le tableau en lui-même ne permet pas de comprendre que le gouvernement de Vichy ait été la quintessence de la bureaucratie française. Ainsi que nous le mentionnons dans notre ouvrage[6], on a pu comptabiliser 16 786 lois et décrets promulgués entre 1940 et 1944 ! Les explications de ce prurit règlementaire données par les historiens renvoient alternativement ou cumulativement aux circonstances de la guerre et à la pression de l’occupant – donc exactement l’inverse de l’explication livrée précédemment –, à une réaction contre la Troisième République ou bien au contraire à la volonté de s’inscrire dans la lignée de cette dernière malgré les circonstances.
Revenons à l’appareil statistique. Une figure de l’ouvrage de François Facchini montre l’évolution du ratio des dépenses publiques sur le PIB de 1871 à 2019[7]. L’auteur, dans son commentaire, divise la période en deux : une augmentation continue certes de 1927 à 2015, mais précédemment, entre 1871 et 1914, une « progression très faible passant de 10 % du PIB à environ 15,47 % », à comparer à une augmentation de 30 jusqu’à 40 % du PIB entre 1944 et 1958 lors de la période critique qui retient l’attention de l’économiste.
Il nous est permis d’adopter une interprétation différente. La figure précitée montre que la « très faible » progression au début de la IIIe République revient tout de même à 54,7 % d’augmentation en 43 ans entre 1871 et 1914. A comparer aux 33% de hausse en 14 ans, entre 1944 et 1958. La hausse des dépenses publiques apparaît donc marquée lors des premières décennies de la IIIe République et ce, en raison de l’idéologie républicaine, de ses réalisations législatives et des conséquences du solidarisme conçu dans les années 1890-1900.
Idéologiquement, François Facchini a raison de souligner le changement de paradigme relatif à l’équilibre budgétaire. Lieu commun jusqu’à la Première Guerre mondiale, cette notion s’effiloche avant de disparaître, sauf exception, après la crise de 1929. Mais il manque un tableau sur la même période des budgets votés en équilibre d’une part, et des budgets clos en équilibre, d’autre part. Il démontrerait que l’orthodoxie budgétaire tient plus du livre que que de la réalité. Il faut attendre 1882 pour qu’un ministre des Finances consente à avouer l’existence d’un déficit dans le budget ordinaire sous la IIIe République[8]. Certes, l’hypocrisie en la matière provoque un effet de freinage des dépenses publiques – on ne grève le budget que d’une main tremblante… – mais le budget de l’Etat n’en croît pas moins. Et les déficits s’accumulent pour la simple et bonne raison que les « dépenses exceptionnelles » dont parle François Facchini tendent à devenir tout simplement normales. La France multiplie les guerres et les situations de tension internationale s’accumulent, sans parler des grands travaux qui ne surviennent pas simplement lors du Plan Freycinet.
En substance, François Facchini touche juste lorsqu’il focalise son attention sur la période de la Libération. Les importantes réformes menées au milieu des années 1940 influent toujours : statut de la fonction publique et création de la Sécurité sociale certes, mais aussi nationalisations, statut du fermage, Ecole nationale d’administration, autres lois sociales, régime de la presse, etc. L’instauration d’un régime libéral ne pourra survenir que moyennant l’abandon des principes de la « démocratie sociale » gravés dans le marbre après guerre. Il reste cependant à expliquer pourquoi une « rupture » serait survenue en 1946 plutôt qu’à un autre moment. Et si une rupture est bien manifeste, c’est qu’elle a dû être préparée, sur une période plus ou moins longue, dans les mentalités, avant, bien avant.
- Une exception française dans la dynamique des dépenses publiques ?
La notion d’ « exception française » a été tellement utilisée qu’elle en a été galvaudée et qu’elle reste aujourd’hui contestée. Certains partisans des réformes s’en méfient car ils argüent que la thèse d’une spécificité hexagonale pourrait être mobilisée par les partisans du statu quo. L’objet de notre ouvrage Exception française a été de démontrer de manière pluridisciplinaire la véracité de l’expression en utilisant la méthode du temps long. Il nous est apparu que la compréhension de la période contemporaine, de ses difficultés et des réformes à mettre en œuvre ne pouvait venir que d’une analyse serrée de l’histoire de France, en droit, en économie, en religion, en sociologie, etc. Utiliser des connaissances depuis le Moyen Age permettait d’éviter de trouver la cause des difficultés françaises à une période précise de notre histoire, fréquemment 1981 ou 1944-1946, au mieux 1936. La méthode de François Facchini, on l’a compris, est différente et, s’il ne réduit pas son propos à l’après Seconde Guerre mondiale puisque son ouvrage concerne la France depuis 1870, la période reste assez brève au regard de l’histoire de notre vieux pays. La question des finances publiques sous l’Ancien Régime se trouve traitée en quatre pages, ce qui s’explique aisément[9]. D’abord parce que la période choisie démarre après le Second Empire, ensuite parce que les instruments de l’économétrie s’appliquent difficilement en l’absence de statistiques suffisamment fiables existantes à l’époque ou même construites bien a posteriori. L’histoire du temps long nous montre, aussi loin que l’on remonte, que la France est un puits sans fond en matière de dépenses publiques et ce, malgré une lourde fiscalité.
Revenons à l’équilibre budgétaire. Comme nous l’avons relevé, celui-ci figure au rang de tabou, mais plus encore de mythe, tant les moments de bonne gestion des finances publiques relèvent de l’Arlésienne. Il est d’ailleurs piquant de relever que l’une des rares périodes d’équilibre se trouve… postérieurement à la « rupture » de 1946, à partir du milieu des années 1960 jusqu’à la première crise pétrolière. Trop rare parenthèse dans l’histoire des finances publiques françaises qui n’empêche pas les dépenses de croître concomitamment[10]… Dire que la France n’a jamais été gérée correctement et qu’elle s’est trouvée en déficit permanent depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours serait à peine exagéré. Les gouvernements choisissent une sorte de système de Ponzi permanent. Comme l’expliquer ? Les finances ordinaires ne résistent pas aux périodes de guerre que mènent nos rois de France de manière si… ordinaire.
Par ailleurs, une caractéristique de la monarchie, plus encore de la monarchie absolue, échappe souvent à tous ceux qui accusent – souvent à juste raison – la démocratie de ne pas être un régime économe. L’une des caractéristiques de notre ouvrage Exception française a été de montrer, à la suite de Tocqueville, la continuité plus que la rupture entre l’Ancien Régime et la Révolution. Si la République a été dispendieuse, c’est qu’elle s’est inscrite dans les brisés d’une monarchie ô combien dépensière ! La sobriété n’a rien d’une vertu avant 1789, en matière financière tout du moins. Bien au contraire, la monarchie se doit d’être ostentatoire[11].
Centré sur la France, l’ouvrage de François Facchini a le mérite de compter de multiples statistiques depuis 1870 relatives aux pays étrangers. Mais il faut remonter plus loin. La comparaison avec ces derniers depuis le Moyen Age n’est guère reluisante pour notre pays. Pas plus sous la République depuis la Révolution jusqu’à la Première Guerre mondiale. Avec – rappelons-le – un franc stable, le budget de l’Etat dépasse le cap symbolique du milliard de francs sous la Restauration, deux milliards en 1860, trois en 1876, quatre au début du XXe siècle et cinq avant 1914. Un historien voit la France championne d’Europe des dépenses publiques en termes absolus et relativement à sa population tant en 1871 qu’en 1913. En 1885 selon un auteur de l’époque, la France se classait numéro deux des dépenses publiques derrière la Russie. Une France alors double championne du Continent en matière de capitalisation des dettes amortissables et consolidées, et en matière de dépenses du service des dettes et de l’amortissement[12].
* *
*
Au regard du temps long, nous sommes conduits à relativiser la « rupture » de 1946 dans la dynamique des dépenses publiques. Certes, il est indiscutable que, mutatis mutandis, la sphère de l’Etat était autrement réduite dans la France de 1900 que dans celle de 1946 ou de 2021. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Si notre pays se classe au firmament de l’O.C.D.E. pour les dépenses publiques en termes de PIB depuis quelques années, il faisait déjà partie du peloton de tête des pays développés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe et ce, en continuité avec l’Etat français postrévolutionnaire, lui-même en congruence avec la monarchie sous l’Ancien Régime.
Nous préférons ainsi raisonner en termes de continuité plus qu’en termes de rupture parce que nous préférons raisonner sur le temps long. Il nous apparaît en effet qu’il est impossible d’expliquer la dynamique des dépenses publiques sans comprendre les choix effectués depuis l’Ancien Régime. Il n’est d’ailleurs pas interdit de relever dans l’histoire française une ou même plusieurs ruptures. Mais, avant tout, ce qui compte, c’est la pente. Or, la route de nos dépenses publiques depuis l’Ancien Régime est droite, mais la pente est forte…
[1] François Facchini, Les dépenses publiques en France, Louvain-La-Neuve, De Boeck Supérieur, 2021, 315 p.
[2] Jean-Philippe Feldman, Exception Française. Histoire d’une société bloquée de l’Ancien Régime à Emmanuel Macron, Odile Jacob, 2020, 521 p.
[3] François Facchini, Les dépenses publiques en France, op. cit., pp. 20, 154, 163 et 183.
[4] Ibid., pp. 146-148.
[5] Ibid., p. 157.
[6] Jean-Philippe Feldman, Exception française, op. cit., p. 120.
[7] François Facchini, Les dépenses publiques en France, op. cit., p. 42.
[8] Jean-Philippe Feldman, Exception française, op. cit., p. 200.
[9] François Facchini, Les dépenses publiques en France, op. cit., p. 23.
[10] Jean-Philippe Feldman, Exception française, op. cit., p. 203.
[11] Ibid., p. 193.
[12] Ibid, pp. 198-199.



