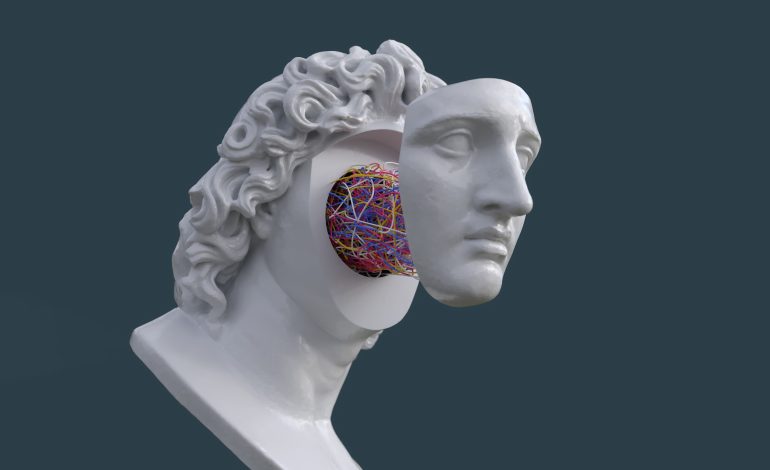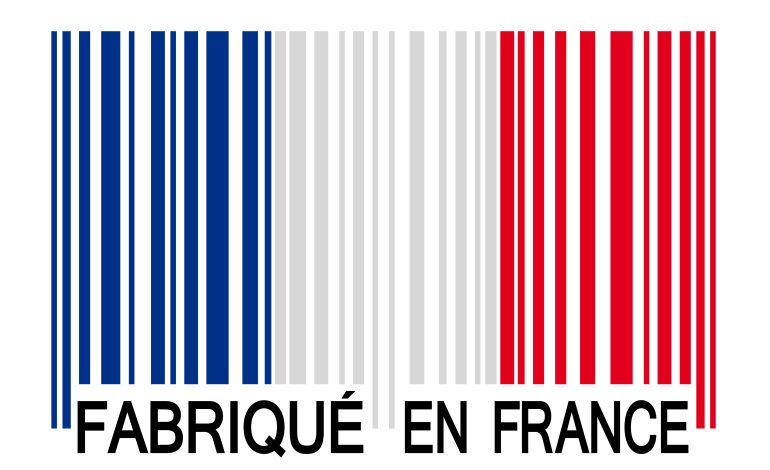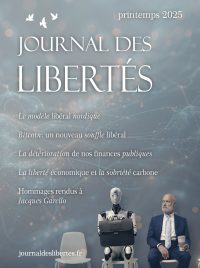La décarbonation de l’économie mondiale est devenue le mot d’ordre obsessionnel de la pensée « multilatéraliste » contemporaine depuis l’entrée en vigueur de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en 1994. Cette obsession se traduit par divers engagements de « neutralité carbone » pris par les États lors des diverses Conventions des Parties (COP) s’étant tenues depuis lors, afin d’enrayer le « réchauffement climatique » que le Groupement International d’Experts sur le Climat (GIEC) attribue aux émissions de gaz à effet de serre (GES) notamment issues de la combustion des énergies fossiles. Bien qu’inégalement suivis d’effets, ces engagements procèdent d’un « forçage technocratique » de la décarbonation des économies mondiales par l’entremise de politiques publiques dites d’atténuation, dont le coût réglementaire et financier est de plus en plus douloureusement ressenti par les populations qui les subissent : subventionnement des énergies renouvelables, obsolescence programmée des technologies thermiques, raréfaction du logement imputable aux diagnostics énergétiques et autres politiques de non artificialisation, contraintes kafkaïennes de reporting vert, etc.

Peut-on toutefois concevoir la décarbonation en termes à la fois plus raisonnables et plus optimistes, c’est-à-dire en tant que simple produit de la liberté économique, et dans quelle mesure ? C’est à l’éclaircissement de cette question que se dédie cet article.
Pour en juger, il faut d’abord porter un regard économique plutôt qu’écologique sur les GES anthropiques, c’est-à-dire les considérer en tant que déchet de l’activité de production – donc symptôme de relative inefficience économique – plutôt que fauteurs « d’urgence climatique », cet article ne revenant pas sur les outrances du climato-alarmisme[1]. Chat GPT tend à confirmer la pertinence de ce recadrage puisque quand on lui demande si les GES sont associés à des modes de production inefficients, il répond « oui » et en donne une liste de raisons recevables, bien que formulées dans la langue écologiquement correcte de son temps : inefficience énergétique, déperditions, surproduction industrielle et agricole, logistique inefficace. Or, la quête de processus économiquement efficients est bien accueillie par l’économie de marché qui demeure ce que l’humanité a trouvé de mieux pour optimiser son utilisation des ressources rares. En conséquence, les pays les plus libres – ceux dont le système économique est le plus proche du modèle de l’économie de marché – devraient être les plus aptes à enrichir leur population en émettant le moins de carbone possible.
Pour en juger, cet article s’appuie sur une recherche originale, dont le lecteur trouvera l’intégralité dans une monographie récemment publiée[2]. Nous n’en restituons ici que les éléments essentiels. Le protocole d’enquête est schématiquement le suivant : on a d’abord identifié 53 pays émettant, en 2022, environ 90% des GES d’origine humaine. On a ensuite relevé leur produit intérieur brut (PIB), leur PIB par habitant (PIB/h), leurs émissions de GES et leur population en 1990 et en 2022 ; ces deux dates sont les jalons qui nous permettent d’apprécier l’évolution de ces données « structurelles » au cours des trois dernières décennies. Deux indicateurs-clés découlent de cette collecte de données :
(1) la « sobriété carbone », qui correspond ici au rapport entre émissions de GES et PIB annuel, mesurant la capacité d’un pays à produire sans trop émettre de carbone ;
(2) le « PIB/h sobre » c’est-à-dire la différence entre le taux de croissance du PIB/h et le taux de croissance des émissions d’un pays entre 1990 et 2022, évaluant sa capacité à enrichir sa population sans trop émettre de GES.
Parallèlement, on a pu apprécier la liberté économique de chaque pays de l’échantillon – et l’évolution de cette liberté entre 1990 et 2022 – grâce à l’évaluation qu’en fait l’Institut Fraser[3] . Celui-ci note de 0 à 10 non seulement le niveau de liberté générale de chaque pays mais chacune des cinq composantes institutionnelles dont elle est la synthèse :
- continence de l’État (indicateur que nous baptisons « empreinte étatique » et qui recouvre la modicité des impôts et des dépenses publiques),
- efficacité du droit,
- rigueur monétaire,
- ouverture internationale et
- parcimonie de la réglementation.
On a ensuite classé les pays de l’échantillon par ordre de performance sur chacune des données structurelles et institutionnelles étudiées. On a enfin calculé de nombreuses corrélations deux à deux entre les variables, pour voir si elles étaient appariées ou au contraire, dissociées. Ces calculs fournissent la trame de notre argumentation.
La première partie de l’article en livre les enseignements généraux les plus percutants. La seconde partie propose une typologie de pays grands émetteurs en fonction de leur développement économique et de leur trajectoire carbone, ces dernières décennies.
1. Quelle relation entre sobriété carbone et liberté économique ? Panorama général.
1-1. Les variables structurelles : dynamisme, richesse et sobriété des pays grands émetteurs
Entre 1990 et 2022, le PIB, les émissions et la population des pays grands émetteurs ont augmenté respectivement de 3,18%, 1,59% et 1,1% l’an, en moyenne. Le monde a donc plus produit qu’il n’a émis de GES, une situation faisant écho à ce que la littérature académique qualifie de « découplage relatif » (ou « faible ») entre PIB et émissions. Ce constat correspond corrélativement à une sobriété carbone croissante, au sens où nous l’entendons ici : en 2022, les pays de notre échantillon ont réduit leur ratio émissions / PIB d’environ 65% par rapport à 1990. Enfin, le PIB ayant crû presque trois fois plus que la population, celle-ci s’est donc considérablement enrichie, ces dernières décennies.
C’est d’ailleurs bien la démographie qui apparaît être l’élément moteur de la production et des émissions ; c’est très net quand on observe la trajectoire carbone des 53 pays de l’échantillon (seconde partie). Ce constat n’a rien de surprenant : il alimente les dystopies dont se repaît de tout temps l’écologisme radical, pour lequel il y a toujours trop d’humains sur Terre. La population mondiale étant censée augmenter jusqu’en 2075 avant de décliner lentement[4], cette projection sonne comme un désaveu cinglant pour les politiques autarciques d’atténuation menées à marche technocratique forcée par l’Union européenne, en particulier. Car dès lors que de plus en plus d’humains naîtront et grandiront – particulièrement en Afrique et dans les pays arabo ou indo-musulmans – les émissions de GES continueront d’augmenter. Rien n’interdit cependant qu’elles augmentent moins que par le passé. Pour autant, l’ambition du « net zéro » – la « neutralité carbone » qu’il faudrait atteindre en 2050 pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ou 2°C – est une chimère de premier ordre.
L’examen de la sobriété carbone de notre échantillon de pays délivre deux enseignements remarquables :
(1) six pays seulement ont un rapport émissions / PIB plus élevé en 2022 qu’en 1990 ; ce sont tous de grands producteurs de pétrole (Venezuela, Oman, Arabie Saoudite, Libye, Iran, Koweït) ;
(2) avant eux, les cancres de la sobriété carbone se trouvaient notamment dans les rangs des économies communistes (mourantes mais encore nombreuses, en 1990).
Cette observation confirme que la sobriété carbone est un indicateur pertinent d’efficience économique ; car les économies collectivistes n’ont aucune incitation à économiser les facteurs de production – matières premières et énergie en premier lieu – ni à investir dans un capital efficace. Elles sont donc particulièrement inefficientes et les pays qui ont pu s’en libérer ont, en matière de sobriété carbone, réalisé des progrès considérables.
1-2. Les variables institutionnelles : liberté, libertés, libéralisation des pays grands émetteurs
L’index moyen de liberté générale des 53 pays de notre échantillon est 16,5% plus élevé en 2022 qu’en 1990. Cela vient de ce que 40 pays réalisent des progrès significatifs quand 13 d’entre eux seulement – généralement des pays occidentaux – voient leur index baisser sur la période. Malgré cette réduction de l’écart entre les pays les plus et les moins libres de notre échantillon, les premiers conservent toutefois leur leadership.
Toutes les variables constitutives de l’index général sont plus élevées en 2022 qu’en 1990 sauf une, dont le débat public se fait de plus en plus souvent l’écho : la réglementation des entreprises s’est dans l’ensemble alourdie – la moitié de notre échantillon réglemente plus ses entreprises en 2022 qu’en 1990 – comme pour compenser la privatisation croissante de leur capital.
Enfin, quand on entre dans le détail de ce qui fait liberté, force est de constater que l’une de ses composantes est le vilain petit canard de la famille : globalement, les pays les plus libres sont aussi ceux dont le droit est le plus efficace, la monnaie la mieux gérée, les échanges internationaux les plus développés et la réglementation la moins pénible. Mais ils sont aussi ceux dont l’empreinte étatique est la plus forte. Les pays occidentaux sont évidemment emblématiques de ce cas de figure : leurs institutions sont globalement plus libérales que celles du reste du monde. Mais leur État est partout et hélas, de plus en plus.
1-3. Liberté, libéralisation et sobriété
Le monde se répartit très schématiquement entre pays libres et riches d’un côté (gros PIB par habitant), pays moins libres et pauvres de l’autre. La relation de cause à effet entre liberté et richesse ne fait aucun doute et nos corrélations vont évidemment dans ce sens. Ces dernières décennies, cependant, les pays libres et riches profitent en quelque sorte de leur retraite, vivant des rentes que leur histoire libérale leur a permis de constituer : ils vieillissent, produisent peu et, en contrepartie, diminuent leurs émissions de GES. Naturellement, les pays pauvres tendent à faire l’inverse. Et corrélativement, tandis que les vieux pays riches semblent s’accommoder d’un recul de leurs libertés – à quoi bon être libre quand on dort ? – les jeunes pays pauvres s’en montrent de plus en plus gourmands.
Ce tableau très général délivre deux enseignements principaux quant au rapport entre liberté économique et sobriété carbone :
- Les pays les plus libres sont bien les plus sobres, c’est-à-dire ceux dont le ratio émissions / PIB est le plus faible. Les coefficients de corrélation sont particulièrement élevés entre sobriété carbone et ouverture internationale, privatisation des entreprises et faible réglementation des marchés, chacun de ces trois items renvoyant aux bienfaits de la concurrence sur l’efficience économique.
- En revanche, les pays ayant le plus libéralisé leur économie entre 1990 et 2022 – ceux dont l’index général a le mieux évolué – ne sont généralement pas ceux dont la sobriété carbone a le plus progressé. Cette observation doit cependant être discriminée. On constate en réalité que quatre vecteurs de cette libéralisation jouent en défaveur de la sobriété : la réduction de l’empreinte étatique, la modernisation du droit, la déréglementation des entreprises et celle des marchés. Chacune de ces quatre dimensions de libéralisation participe d’une liberté d’entreprendre en progrès dans de nombreux pays pauvres, lesquels en conçoivent une augmentation de leur activité relativement dispendieuse en carbone. À l’inverse, l’ouverture internationale ainsi que la déréglementation du capital et du travail tendent à améliorer le ratio de sobriété parce qu’elles participent d’une liberté d’embaucher et d’investir favorables à la rationalisation de l’appareil de production.
1-4. Liberté économique et sobriété carbone : une synthèse
Dans l’ensemble, les pays les plus libres sont les plus sobres parce qu’ils sont les plus riches, donc les mieux dotés en capital investi dans des équipements coûteux mais économiquement efficients ; il faut par exemple être riche pour pouvoir s’offrir – et exploiter au long cours – un parc nucléaire important, garant d’une production d’électricité décarbonée et pilotable.
Cette conclusion fait écho à la littérature économique sur le sujet. Une étude récente évalue par exemple l’impact de six facteurs socio-économiques sur le découplage entre croissance économique et émissions : trois d’entre eux – innovation, commerce international, énergies décarbonées – jouent en la matière un rôle bien plus déterminant que les trois autres – réglementation, valeurs environnementales, tertiarisation de l’économie – ce qui, dans l’ensemble, consacre la prééminence de « l’économie banale[5] » sur l’interventionnisme vert[6].
Il reste à porter un regard plus particulier sur la liberté économique et la sobriété carbone des 53 pays de notre échantillon, en appréciant leur aptitude à enrichir leur population sans trop émettre de GES.
2. Sobriété carbone et liberté économique des pays grands émetteurs : une typologie
Dans cette seconde partie, on a calculé la croissance annuelle moyenne du « PIB/h sobre » de chaque pays de l’échantillon entre 1990 et 2022, c’est-à-dire, la différence entre le taux de croissance de leur PIB par habitant et celui de leurs émissions de GES. Cet indicateur permet de classer les pays grands émetteurs en fonction de leur aptitude à enrichir leur population en émettant aussi peu de GES que possible. On en dérive une typologie en 10 groupes relativement homogènes de pays, dont les intitulés sont largement inspirés d’une matrice stratégique célèbre, celle du BCG[7].
On distingue ainsi deux groupes « aberrants » dont l’évolution du PIB/h sobre se traduit par une croissance exceptionnellement élevée (pays « surperformants ») ou au contraire, une décroissance sévère (pays « sinistrés »). Le reste de l’échantillon est distribué entre deux catégories structurantes – pays riches et pays pauvres – accueillant chacune quatre groupes :
- Les pays vedettes caractérisés par une forte croissance du PIB/h (indicateur de dynamisme) et une faible croissance relative (voire une décroissance) des émissions (indicateur d’efficience).
- Les pays vaches à lait caractérisés par une faible croissance du PIB/h et une faible croissance relative (voire une décroissance) des émissions.
- Les pays dilemmes caractérisés par une forte croissance du PIB/h et une forte croissance des émissions.
- Les pays poids morts caractérisés par une faible croissance du PIB/h et une forte croissance des émissions.
Le tableau suivant détaille la composition de chacun de ces groupes.
| Catégories et groupes | Pays inclus |
| Pays surperformants | Roumanie, Pologne, Chine, Taïwan, Myanmar, Tchéquie, Kazakhstan |
| Pays sinistrés | Ukraine, Libye, Soudan, Venezuela |
| Vedettes riches | Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, États-Unis |
| Vaches à lait riches | France, Italie, Russie, Japon |
| Dilemmes riches | Espagne, Australie, Canada |
| Poids morts riches | Koweït, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Émirats Arabes Unis |
| Vedettes pauvres | Bangladesh, Inde, Thaïlande, Corée du sud |
| Vaches à lait pauvres | Colombie, Vietnam, Chili, Éthiopie, Argentine, Nigeria, Pérou |
| Dilemmes pauvres | Égypte, Philippines, Maroc, Indonésie, Malaisie, Turquie |
| Poids morts pauvres | Brésil, Pakistan, Kenya, Algérie, Iran, Mexique, Afrique du sud, Irak |
2-1. Deux groupes de pays « aberrants » : les pays surperformants et les pays sinistrés
Ces deux groupes témoignent d’une évolution aberrante de leur PIB sobre entre 1990 et 2022 : les pays surperformants parce qu’ils ont considérablement enrichi leur population au prix d’une dépense nettement plus faible en carbone ; les pays sinistrés parce que, tout à l’inverse, ils ont appauvri leur population sans toujours parvenir à baisser leurs émissions.
Le groupe des surperformants comprend lui-même deux sous-groupes : la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie et le Kazakhstan ont un taux de croissance du PIB/h digne des pays émergents, concomitant d’une baisse des émissions ; leur profil ressemble à celui des grands pays européens mais en nettement plus dynamique. Les trois pays asiatiques du groupe, quant à eux, enrichissent leur population à un rythme inégalé – plus de 6% l’an en moyenne – au prix d’émissions croissant à un rythme nettement moindre. Ces pays sont particulièrement productifs : leur population est dans l’ensemble âgée – la croissance démographique de ce groupe est relativement faible – mais produit beaucoup de valeur ajoutée. Il s’agit, de tous les groupes de l’échantillon, de celui dont l’index de liberté générale a le plus augmenté sur la période couverte par l’étude.
Le groupe des pays sinistrés est le négatif des pays surperformants. Il se caractérise par une décroissance parfois sévère du PIB par habitant concomitante d’une faible croissance des émissions (mais toutefois une décroissance pour l’Ukraine). Il s’agit du groupe le moins libre de l’échantillon et son histoire récente tourmentée – guerre d’invasion en Ukraine, révolution en Libye, violences endémiques au Soudan, dictature socialiste au Venezuela – n’est évidemment pas propice à la prospérité économique.
2.2. Les pays riches
Ce groupe comporte essentiellement des pays développés : qu’il s’agisse de PIB par habitant, de croissance démographique ou de liberté générale, peu de choses séparent vedettes, vaches à lait et dilemmes de ce groupe. On doit tout de même remarquer que les vedettes ont, ces trente dernières années, mis en œuvre des politiques particulièrement volontaristes de décarbonation de leur production d’énergie, sans que la croissance de leur PIB par habitant s’en ressente de façon manifeste. Les vaches à lait étaient déjà très sobres en 1990 et le sont restées en 2022 mais au prix d’une dynamique économique nettement en retrait ; c’est aussi le groupe le moins libre de la catégorie des pays riches et l’on peut évidemment déplorer que la France en fasse partie. Enfin, les dilemmes se distinguent par une croissance démographique supérieure à leur catégorie de référence, concomitante d’une hausse des émissions qui, pour les pays développés, est une anomalie.
Les poids morts riches sont un cas à part dans la mesure où leur rente pétrolière les dote d’un PIB par habitant très élevé tandis que leurs caractéristiques structurelles – forte croissance des émissions et de la population – ainsi qu’institutionnelles – une liberté relativement faible – sont celles des pays en développement. La vigueur de leur démographie se traduit donc par une économie faiblement productive dont témoignent à la fois la faible croissance du PIB par habitant et la très forte croissance des émissions de GES.
2.3. Les pays pauvres (et émergents)
Cette catégorie comporte des pays pauvres ou émergents dont les caractéristiques sont relativement homogènes et, bien entendu, symétriques de celles des pays riches (faible PIB par habitant, forte croissance de la démographie et des émissions, faible liberté générale mais progrès parfois notables en la matière).
Le groupe des vedettes se démarque toutefois de sa catégorie générale, au point de comporter une aberration : la Corée du sud, pays riche dont la croissance du PIB/h sobre est toutefois celle d’un pays pauvre/émergent. La dynamique de développement des vedettes pauvres/émergentes évoque stricto sensu celle d’un rattrapage se traduisant par une forte croissance de la richesse par habitant, concomitante d’une libéralisation conséquente de l’économie reposant elle-même sur un effort important d’ouverture internationale et de déréglementation, toutes deux favorables à une relative efficience économique.
Peu de choses séparent en revanche les vaches à lait et les dilemmes de leur catégorie, sinon que ces derniers sont particulièrement dispendieux en carbone. Ces pays ont des caractéristiques structurelles similaires et leur rapport à la liberté économique est pour le moins contrarié, à quelques exceptions notables près telles que la Malaisie pour ce qui concerne la liberté générale – dixième rang de l’échantillon en 2022 – ou le Pérou au regard des efforts de libéralisation consentis par ce pays.
Les poids morts pauvres/émergents témoignent enfin d’une caractéristique qui les rapproche de leur alter ego « riche » : une croissance démographique particulièrement vigoureuse et en conséquence, dispendieuse en émissions. Mais c’est la faible croissance de leur PIB par habitant qui distingue particulièrement les pays de ce groupe : ceux-ci souffrent de handicaps institutionnels dans l’ensemble bien trop lourds pour enclencher une dynamique d’enrichissement durable de leur population. Ils souffrent, en particulier, d’un système judiciaire trop peu libéral, peu propice à la sécurité des transactions économiques. Or, il s’agit d’une condition infrastructurelle du développement économique.
Conclusion : décarboner au rythme de l’économie de marché plutôt que de la technocratie publique
L’amélioration de la sobriété carbone est une tendance lourde de l’économie mondiale. Elle passe par l’amélioration et non la diminution de la production de richesses, fantasme « décroissantiste » dont les conséquences socio-économiques ne peuvent être autres que tragiques.
En la matière, les politiques d’atténuation veulent aller plus vite et plus loin que la dynamique naturelle de l’économie de marché, au risque d’en gripper l’efficacité. Elles précipitent l’avènement de technologies immatures et prétendent régenter la consommation des ménages dans des proportions et selon des modalités qui ne sont pas tolérables.
Il est donc temps que les maîtres d’œuvre de ces politiques dangereuses rendent les armes idéologiques et redécouvrent les charmes de la liberté économique. Celle-ci est bonne pour la planète. De sorte que pour préserver celle-ci, le mieux est encore de conserver celle-là : tel devrait être le mot d’ordre de toute politique écologique, histoire de se rappeler que le vert est fondamentalement la couleur de l’espoir.
[1] Voir, entre autres références, mes deux articles sur le sujet dans le Journal des libertés, n°17 et n°18, 2022 (https://rebrand.ly/a1yqntt et https://rebrand.ly/o6kdhh1) ainsi que ceux de Vincent Bénard dans ce même Journal des libertés, n°24 et n°26, 2024 (https://rebrand.ly/d2580ae et https://rebrand.ly/fuhju7t).
[2] Voir https://rebrand.ly/c7ur8or.
[3] https://efotw.org/economic-freedom/approach
[4] Cf. https://rebrand.ly/nyetjpx
[5] Peter G. Klein (2008), « The Mundane Economics of the Austrian School », Quarterly Journal of Austrian Economics, 11, p. 165-187 (https://cdn.mises.org/qjae11_3_1.pdf).
[6] S. Lundquist (2021), « Explaining events of strong decoupling from CO2 and Nox emissions in the OECD 1994-2016”, Science of the Total Environment, 793, 148390.
[7] Voir https://asana.com/fr/resources/bcg-matrix.