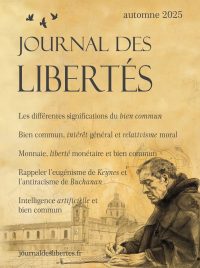Au commencement était le règne du plus fort comme dans les forêts où sont nés peut-être nos premiers parents de lignées animales, auxquelles ils ont apporté l’étincelle de la raison et l’inquiétude de leur origine et de leur fin. Contrairement à ce que croyait Rousseau, c’était alors le règne de la force. Le droit n’existait pas sinon à l’état le plus rudimentaire et les individus étaient soumis aux plus forts et livrés à la déraison de la vengeance non contenue. Ainsi dans l’Iliade, l’enlèvement par le prince troyen Pâris d’Hélène, l’épouse du roi de Sparte Ménélas, conduit ce dernier à lever toute la Grèce contre Troie pour l’anéantir. Le bien commun n’était sans doute pas dans les préoccupations majeures des clans, tribus et hordes qui s’opposaient les uns aux autres. Mais le bien commun va naître dans le temps avant de se dévoyer.
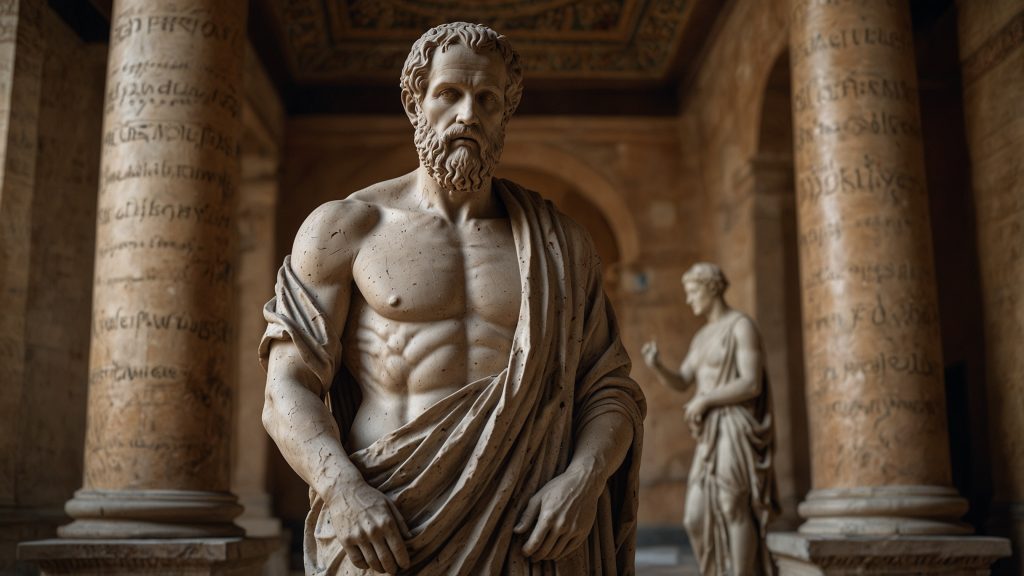
- Naissance et développement du bien commun
Il fallut plusieurs millénaires pour que se façonne le bien commun par une lente progression du droit et un processus d’individuation dans la reconnaissance successive de la proportion des peines, du respect d’autrui, de l’égalité devant la loi et de la séparation des pouvoirs qui consacrèrent la reconnaissance de l’individu.
- La loi du talion ou l’introduction de la proportion des peines
Mais pour mieux survivre et s’organiser, voire faire grandir la communauté, il apparut que la vie commune exigeait de contenir la violence. Ainsi sans doute fut instituée par les lois d’Eshnunna (vers 1800 avant J.-C.), comme un immense progrès contre la barbarie de la vengeance sans fin, un droit définissant en argent les peines prévues pour sanctionner crimes et délits. Peu après, au dix-huitième siècle avant notre ère, dans le même creuset oriental de nos origines civilisatrices, le Code d’Hammurabi institua la loi du talion[1], d’un prêté pour un rendu, qui cherchait aussi une proportionnalité, une équivalence réparatrice : « Si quelqu’un a cassé la dent d’un homme libre, son égal en âge, on lui cassera la dent », dit le code qui prévoit aussi, par exemple, dans un souci de juste proportion, la libération, après trois ans, des personnes mises en esclavage pour dettes.
En édictant son code, Hammurabi se revendique d’un certain bien commun. Il veut établir le droit et la justice « pour que le fort n’opprime pas le faible […] pour assurer le bonheur des gens »[2].
- Le respect réciproque : « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas ce qu’il te fasse »
Peu après l’époque où fut édicté le code d’Hammurabi (à moins que ce ne fut plusieurs siècles après, on ne sait guère), sur les terres où se constituera l’empire perse, Zoroastre aurait déjà énoncé le grand principe, sur la base duquel repose toute organisation sociale équilibrée, qui consiste à éviter de faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent. « Tout ce qui te répugne, aurait-il dit, ne le fais pas non plus aux autres »[3]. Cette règle, dite « d’or », de vie commune se retrouve dans la plupart des grandes traditions religieuses qui naissent ou se cristallisent entre le VIIIème et le Vème siècle avant J.-C. Bouddha (560-480 avant J.-C.) aurait tenu des propos similaires : « Ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouverais toi-même blessants »[4] et l’épopée du Mahâbharata (vers 400 avant J.-C.), la « Bible » du brahmanisme, le formule autrement : « On ne doit pas se comporter envers les autres d’une manière qui nous répugne nous-mêmes. C’est le cœur de toute morale »[5]. Dans la Bible, le Livre de Tobie le dit déjà : « Ce que tu serais fâché qu’on te fît, prends garde de ne jamais le faire à autrui. »[6] et le Rabbin Hillel résumait ainsi la loi à l’époque de Jésus : « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît, ne l’inflige pas à autrui. C’est là toute la Torah, le reste n’est que commentaire. Maintenant, va et étudie »[7]. Saint Augustin enseigne que dans tous les contrats de droit, il faut respecter la maxime commune : « Qu’on ne fasse point à autrui ce qu’on ne veut point endurer»[8].
Ces règles fondent le droit du Bien commun dans son principe, en ne disant pas ce qu’il faut faire, c’est-à-dire en ne disant pas le bien, mais en disant ce qu’il ne faut pas faire : « ne fais pas à autrui… ». Ainsi, la très grande majorité des dix commandements de la Bible sont négatifs. Quant aux principes, seuls les dieux savent le Bien. Les hommes tâtonnent à sa recherche.
- Le droit comme égalité devant la loi
En Grèce, Hésiode (VIIIème siècle avant J.-C.) avait déjà introduit le droit, la Diké, comme la caractéristique des hommes et un bien à partager entre eux. Solon (640-558) qui, selon ses propres mots, ne voulait pas se faire « le tyran de ses égaux » avait élargi l’égalité d’accès à la justice et protégé les droits des citoyens ainsi qu’il le rappelle dans les fragments qui nous restent de ses élégies politiques :
« J’avais donné par mes lois une égale puissance à tous les citoyens ; je n’avais rien ôté, rien ajouté à personne ; j’avais ordonné aux plus riches et aux plus puissants de ne rien faire contre les faibles, j’avais protégé les grands et les petits d’un double bouclier d’une force égale de chaque côté, sans donner plus aux uns qu’aux autres[9]. »
Clisthène, au vie siècle avant J.-C., institua le principe d’égalité devant la loi, l’isonomie, qui reste la pierre angulaire des démocraties contemporaines et de l’état de droit. L’isonomia, l’égalité des droits politiques, n’était qu’une partie de l’égalité citoyenne qui comportait aussi l’isegoria, l’égal droit de parole devant les assemblées politiques, l’isogonia, l’égalité par la naissance ou encore l’isokratia, l’égalité de pouvoir. Athènes n’était pourtant pas une cité égalitaire au sens où nous l’entendrions aujourd’hui.
Ainsi peu à peu le bien commun devint le but du gouvernement. Aristote hésite dans sa définition du bien commun qu’il identifie au bonheur dans le livre premier de l’Éthique avant de l’associer au juste et à la paix au livre VIII. Mais c’est bien essentiellement dans l’exercice de la justice qu’il situe la recherche du Bien Commun :
« Et c’est en vue de l’avantage de ses membres, pense-t-on généralement, que la communauté politique s’est constituée à l’origine et continue à se maintenir. Et cette utilité commune est le but visé par les législateurs, qui appellent juste ce qui est à l’avantage de tous »[10].
Même si Aristote fait prévaloir la Cité sur l’individu[11], il impose le respect humain au travers du droit que ce soit dans les transactions privées relevant de la justice commutative, pour lesquelles les biens ou services échangés doivent être d’égale valeur, ou au titre de la justice distributive, publique, qui observe une égalité de proportion selon laquelle il s’agit de rendre à chacun la part qui lui revient en fonction de ses mérites[12]. Cette règle établit un bien commun fondé sur le respect réciproque, incluant le respect des différences et des aptitudes et contributions de chacun à la vie sociale.
Cette égalité en droit apparaît aussi dans le droit romain dès les XII Tables (450 avant J.-C. environ) pour exiger une égalité en droit : « Que ceux qui sont engagés et ceux qui sont dégagés aient le même droit ». Mais alors qu’en Grèce le droit public l’emportait sur le droit civil, à Rome, celui-ci prend toute sa part et la première place revient à l’individu et à sa liberté (contrat, famille, propriété). Il existait bien sûr dans le droit romain la notion de bien commun (res communis), comme une chose inappropriable par essence, tels que l’air, l’eau courante, la mer et le rivage de la mer. Ce qui n’était pas nécessairement un bien public (res publicae). Mais il ne s’agissait pas de Bien commun. A cet égard, on a souvent utilisé la notion romaine de jus commune pour imaginer que, opposé au jus singulare, il s’agissait d’un droit général et commun, proche peut-être de ce qui aurait pu être un droit du bien commun. Il ne semble pas qu’une telle analyse soit possible[13]. Cicéron observe que :
« Le premier caractère de l’homme juste est de ne jamais nuire à personne, à moins qu’il ne soit injustement attaqué ; ensuite, de se servir des biens communs comme appartenant à tous, et des siens seulement comme lui appartenant en propre[14]. »
Cicéron ne méconnaît pas le bien commun, mais n’en fait pas une définition particulière ; il dit :
« Ceux qui sont chargés du gouvernement des peuples doivent observer fidèlement ces deux préceptes de Platon : Veiller d’abord aux intérêts de leurs concitoyens avec un dévouement de tous les instants et un désintéressement absolu ; donner ensuite les mêmes soins à tout le corps de la république, et ne point témoigner à l’une de ses parties une prédilection qui tournerait au détriment des autres[15]. »
- La séparation des pouvoirs et le mouvement d’individuation
Les mécanismes de droit créateurs du bien commun sont des mécanismes d’individuation, à l’encontre de toute vengeance ou action collective comme à l’encontre de la communauté elle-même. Ils régulent les comportements personnels pour permettre aux membres de la communauté de vivre en paix.
Le christianisme va renforcer ce mécanisme d’individuation en affirmant le caractère individuel du salut de chacun et en veillant à la séparation des pouvoirs avec les mots du Christ « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César », à conjuguer avec ceux de Saint Paul dans Romains (XIII, 1-7) « Nulla potestas nisi a Deo » / « Il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu ». La séparation des pouvoirs érige chacun des pouvoirs, religieux et politique, en instance autonome, avec sa propre légitimité. Mais le fait que tout pouvoir provienne de Dieu oblige celui qui l’exerce à pratiquer la justice sans laquelle, nous dit Saint Augustin, « les empires ne sont que des ramassis de brigands ». L’État a ainsi le devoir de veiller que soit rendu à chacun selon ce qui lui est dû. On reste ici dans la conception antique du Bien commun.
La séparation des pouvoirs va elle-même contribuer à séparer le pouvoir politique de la société civile libre, de ses échanges, de ses liens, de ses initiatives et à autonomiser le pouvoir judiciaire et l’ancrer dans un rapport aux individus (ce à quoi contribuent déjà toutes les lois antiques que j’ai citées).
- Éclosion du Bien commun
Le Bien commun retrouve de la vigueur au Bas Moyen Age. Après qu’Aristote a été complètement traduit en latin (en 1260, Guillaume de Moerbeke traduit en latin la Politique d’Aristote qui était son dernier ouvrage non traduit), Albert le Grand (†1280) a nourri sa réflexion sur le Bien commun par la lecture de son Éthique à Nicomaque et de son Politique. Mais la notion de Bien commun s’imposera à tout l’Occident par l’analyse de Saint Thomas (†1274) qui fit du Bien commun une pierre angulaire de sa vision politique. Après avoir considéré que le pouvoir politique est une nécessité rationnelle[16], il constate aussi que le gouvernement des hommes a le souci de l’intérêt collectif qui n’est pas la somme des intérêts particuliers, car le salut éternel est strictement individuel et propre à chacun. « Les êtres sont divisés sous l’angle de leurs biens propres ; ils sont unis sous l’angle du bien commun » observe-t-il[17] ou encore « le bien commun est la fin de chacune des personnes vivant en communauté, comme le bien du tout est la fin de chacune des parties [18]». Parce que l’intérêt commun n’est pas et ne peut jamais être la somme des intérêts individuels. Ces derniers sont différents et parfois contradictoires du fait de la singularité de chaque être humain. Ce pourquoi il faut un pouvoir politique ayant le rôle d’arbitrer et de veiller à ce que les conflits soient solubles. Le Bien commun a vocation à permettre l’harmonie entre les différents pouvoirs, politique et religieux, en même temps qu’entre les hommes pris individuellement et, tout à la fois et distinctement, comme citoyen et comme être spirituel. La conciliation est possible en admettant que « le bien du tout est la fin de chacune des parties » (cf. note 16) mais que le pouvoir politique doit respecter la conscience de chacun et sa loi privée. « Il est conforme au Bien commun que les individus n’épuisent pas toutes leurs virtualités dans le groupe social. En même temps, il y a un destin collectif qui subordonne les destins individuels sans les absorber : l’effort que postule le Bien commun est un effort de coordination et de cohérence reposant sur la solidarité et non sur l’incompatibilité du collectif et de l’individuel » observe Jean-Claude Ricci[19]. Le Bien commun explique encore Bénédicte Serre [20] suppose la participation de tous, il est, dit-elle, « participé », chacun s’y ordonne aux autres. Se concilient ainsi, et notamment dans le respect d’un principe de subsidiarité, la supériorité absolue de l’individu en tant qu’être spirituel et la supériorité relative de la communauté en tant qu’organisation nécessaire et naturelle.
Ce Bien commun reconnaît donc chacun comme sujet de droit et il pourrait être ce que nous appelons aujourd’hui l’état de droit. Il consiste d’abord à assurer la paix de tous avec tous. Pour Thomas d’Aquin, « La fin de la loi humaine, c’est la tranquillité temporelle du corps social, et le législateur atteint ce but par la répression des actes extérieurs, en défendant les crimes qui peuvent troubler l’ordre public »[21] et en se préservant des périls extérieurs[22]. Thomas d’Aquin considère d’ailleurs que, hors les cas de guerre, le souverain ne doit pas lever d’impôts, et qu’il doit vivre et faire vivre ses fonctions royales du produit de ses domaines, ce qui démontre suffisamment combien il limite la tâche du roi. La notion de bien commun est très vague ou très générale ; elle n’ouvre pas encore à des devoirs précis.
II. Postérité et dévoiement du bien commun
Parallèlement, le Bien commun devint une expression commune[23]. Les vers de Dante Alighieri déclinent que le bien commun est le but de toute société et de toute loi. Le poète de cour Eustache Deschamps en donnait lui-même la définition :
« Qu’est-ce que le Bien Commun ?
Ce qui peut regarder
Proufit de tous, jeunes et anciens,
Garder la loy, son païs et les siens »
Le Bien Commun est le gardien de la paix et de l’unité d’un royaume. Il répond d’abord au souci de sécurité intérieure et extérieure des sujets. Le Souverain comme les Villes s’en prévalent pour nombre de leurs décisions. En 1322, Charles IV établit une foire à Nîmes en période de Carême après s’être assuré que cette décision ne va pas à l’encontre du commune bonum. C’est aussi pro bono communi que Jean Le Bon consent en 1360 un nouvel octroi ou encore que Charles V considère « le proffit et Bien Commun de noz sujets » pour décider qu’à Millau tout le sel devra désormais être vendu en place publique. Les décisions en ce sens sont légion.
Par ailleurs, dans la lignée de Saint Thomas, sur le plan théorique, l’école de Salamanque, de Vitoria et Suarez à Domingo de Soto et Luis De Molina, étendra le bien commun à l’ordre international ou à un bien commun de l’humanité. Vitoria pensera un droit des gens comme un droit universel du genre humain et un droit pour régir les relations entre nations[24]. La notion thomasienne de bien commun sera pendant longtemps la référence de la philosophie politique dans l’appréciation des gouvernements. Bodin (1529 ou 1530 / 1596), conseiller des rois Charles IX et Henri III, considère que le souverain est naturellement dépositaire du Bien de la République, seul à le déterminer en conséquence de sa nature ; il est celui par qui la justice s’infusera dans la République. Mais néanmoins, il en limite le pouvoir. « La finalité politique n’a pas de visée éthique ; elle est tout entière tournée vers le souci de permettre aux hommes de vivre ensemble suivant un juste ordonnancement, sans virer au chaos. Le pouvoir n’a pas en conséquence à être mis au service du bonheur des sujets puisque cette dimension humaine n’est pas d’ordre politique. En quelque sorte Bodin apparait résolument moderne en ce sens qu’il donne à l’État des droits incommensurables, mais que dans le même temps il réserve les droits des individus, la liberté naturelle et la propriété des biens, « car il n’y a point de chose publique, s’il n’y a quelque chose de propre, et ne se peut imaginer qu’il n’y ait rien de commun, s’il n’y a rien de particulier ». C’est en ce sens aussi qu’il est favorable à la liberté de conscience, à la liberté de religion dans un temps où celle-ci est bien mise à mal.
Le bien commun ne cessera de s’enrichir, en particulier dans l’impératif catégorique d’Emmanuel Kant exigeant que l’Homme ne soit jamais considéré comme un moyen mais toujours comme une fin, ou encore dans le principe de subsidiarité – « en bas tout le possible, en haut tout le nécessaire » – opposé par Mgr von Kettler au Kulturkampf de Bismarck. Le Bien commun a retrouvé toute sa force dans l’état de droit, que proposent les libéraux de Locke et Constant à Hayek et bien d’autres et qui n’est pas le droit de l’État.
Dénaturation du bien commun
Mais parallèlement, le Bien commun a été utilisé à tort et à travers. Face aux besoins financiers pour construire des ouvrages publics – ponts, fontaines ou voies, théâtres ou jardins…– les communes vont, très tôt, prétexter du Bien commun et faire appel à l’impôt bien dénommé comme un « commun » dans le midi de la France.
« Les exemples les plus précoces qui ont pu être relevés concernent l’Auvergne du XIIIème siècle, après cependant Montpellier où il est fait état de la levée d’un « commun » dès 1232. Peu après, en 1239, la charte de franchise accordée aux habitants d’Ambert autorise ses consuls à lever des communes destinées ad necessitates ville, tandis que celle de Vodable de 1262 prévoit que chaque contribuable devra s’acquitter régulièrement d’une commune suum. Moins de vingt ans plus tard, en 1280, c’est aux consuls d’Aurillac qu’est reconnu le droit de liberre comunes tallias facere et per se levare. Puis, en 1291, se voient officiellement octroyer “ tailles et autres mises de deniers communs sur les habitants de ladicte ville ” leurs collègues de Montferrand[25]. »
Ainsi sont nés les impôts locaux comme des communs.
Les villes adoptent cette référence au bien commun pour renforcer le contrôle des prix alimentaires, surveiller les marchés ou la qualité des produits, rechercher la fraude ou l’usure, protéger la santé ou la salubrité… La ville de Zurich déclare qu’en protégeant les oiseaux insectivores, elle agit au nom du bien commun. Chacun voit le bien commun à sa manière parfois contradictoire, en favorisant la concurrence ou en la limitant : au XVème siècle, Augsburg impose un marché libre de la viande deux fois par semaine pour le bien commun des pauvres et des riches tandis que Cologne interdit les machines textiles qui améliorent la production et réduisent l’emploi[26]. Ainsi s’annonce notre État providence et son intérêt général au nom duquel il se permet d’intervenir en tout.
L’instrumentalisation du christianisme
D’une manière plus générale, le pouvoir politique se prévaudra volontiers du christianisme pour justifier de l’extension de ses interventions. En effet, à l’antique loi commune de respect mutuel, le Christ a ajouté une autre exigence, individuelle : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le vous-même pour eux » (Sermon sur la Montagne). Mais cette exigence de charité, personnelle et volontaire, proposée par le Christ à chacun, la politique en fera sa loi pour étendre son pouvoir. L’égalité des hommes devant Dieu que prêche le Christ sera également travestie au service des pouvoirs politiques qui abusent de la faiblesse humaine à leur profit. Car à défaut pour beaucoup de vouloir ou pouvoir faire l’effort de grimper l’escalier social, qui est raide et sans ascenseur, il leur est plus facile d’exiger une mise en commun des ressources collectives pour tenter, vainement, d’obtenir la liberté par l’égalité. La société va ainsi consacrer comme un bien commun un État social ou État providence qu’elle va se donner comme obligation de faire croître sans cesse pour produire la liberté des individus qu’elle contribue pourtant ainsi à évincer en les déresponsabilisant pour mieux les assujettir. L’intérêt public ou l’intérêt général supplantent le bien commun et le dénaturent, voire le détruisent[27].
[1] La loi du talion était réservée à la réparation des dommages causés aux hommes libres (avilum). Ceux causés aux personnes de conditions intermédiaires (muskenûm) ou aux esclaves (wardum) étaient réparés en argent.
[2] Olivier Artus, Les lois du Pentateuque, Cerf, 2005, p. 120.
[3] Shayast-na-Shayast 13, 29.
[4] Udana-Varga, 5, 18.
[5] Épopée du Mahâbharata, 114, 8.
[6] Chapitre 4, 16.
[7] Talmud de Babylone, traité Shabbat 31 a.
[8] De Ordine Partie 2, Chap. 8, 25.
[9] Les Petits Poèmes grecs, traduits et publiés par Ernest Falconnet, Paris, Auguste Desrez, imprimeur-éditeur, 1840, p. 267.
[10] Éthique, VIII, 11, 1160 a 11-13.
[11] Éthique I, 1, 1094 b 6-10 : « La fin de la Politique sera le bien proprement humain. Même si, en effet, il y a identité entre le bien de l’individu et celui de la cité [bonum civitatis], de toute façon c’est une tâche manifestement plus importante et plus parfaite d’appréhender et de sauvegarder le bien de la cité : car le bien est assurément aimable même pour un individu isolé, mais il est plus beau et plus divin appliqué à une nation ou à des cités ». Politique, I, 1, 1252 a 1-5 : « Nous voyons que toute cité est une sorte de communauté et que toute communauté est constituée en vue d’un certain bien […] : il en résulte clairement que si toutes les communautés visent un bien déterminé, celle qui est la plus haute de toutes et englobe toutes les autres, vise aussi, plus que les autres, un bien qui est le plus haut de tous. Cette communauté est celle qui est appelée cité, c’est la communauté politique ».
[12] Ibid., V, 10, 35.
[13] André Gouron, Le droit commun a-t-il été l’héritier du droit romain ? Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Année 1998, 142-1 pp. 283-292.
[14] Cicéron, Traité des Devoirs, De Officiis, Livre I, VII
[15] Ibid., XXV.
[16] De Regno, I, 1 « Si donc il est dans la nature de l’homme qu’il vive en société d’un grand nombre de semblables, il est nécessaire qu’il y ait chez les hommes un principe par lequel gouverner la multitude. En effet, comme les hommes sont en grand nombre et que chacun pourvoit à ce qui lui est approprié, la multitude serait éparpillée en divers sens, s’il ne se trouvait aussi quelqu’un qui prenne soin de ce qui regarde le bien de la multitude, de même que le corps de l’homme ou de n’importe quel animal se désagrégerait, s’il n’y avait dans le corps une certaine force directrice commune, visant au bien commun de tous les membres ».
[17] Ibidem.
[18] Somme Théologique IIa, IIae, qu. 58, art. 9, ad. 3 : « Le bien commun est la fin de chacune des personnes vivant en communauté, comme le bien du tout est la fin de chacune des parties. Or le bien d’une personne en particulier n’est pas la fin d’une autre. C’est pourquoi la justice légale qui a le bien commun pour objet peut s’étendre davantage aux passions intérieures, par quoi l’homme est plus ou moins déterminé en lui-même, plus que ne le fait la justice particulière qui est ordonnée au bien d’une autre personne en particulier. Ce qui n’empêche pas la justice légale de s’étendre à titre de principe aux autres vertus considérées dans leurs activités extérieures, c’est-à-dire en tant que “ la loi ordonne d’accomplir les œuvres qui conviennent à l’homme fort, tempérant et doux ”, dit Aristote ».
[19] Jean-Claude Ricci, Le Bien commun : les prémices d’une idée, Les Cahiers Portalis. http://bit.ly/43pHfwH.
[20] « Aristote et le Bien commun au Moyen Âge : une histoire, une historiographie » par Bénédicte Sère, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques No. 32, 2e semestre 2010 : « L’idée de l’émanation du bien commun, bonum commune diffusivum sui, est annexée de l’idée de participation. Le bien est en commun c’est-à-dire qu’il peut être participé : l’individu doit nécessairement participer au « bien en commun » (bonum in commune), présent dans l’univers, afin d’exister et d’être bon : c’est une participation par similitude ou par analogie. Thomas opère un parallèle entre bonum et esse à partir des propos sur le livre IV de la Métaphysique d’Aristote : la participation est ontologique en termes d’être et en termes de bonté (vertu). L’ensemble de ses principes s’applique avec cohérence en matière politique. Pour Thomas, l’ordre de l’univers reste le même. L’humain s’ordonne au spirituel et la politique s’ordonne à la théologie. Ainsi l’homme en tant que citoyen s’ordonne à l’homme en tant qu’être spirituel. Partant, le bien commun en politique s’ordonne au bien commun de l’univers, ou bien suprême, parce que le bien commun politique est un bien secundum quid en vue du bien simpliciter, il est l’utilitas qui vise l’autarcie et la félicité de la communauté politique en vue du bien supérieur qui est l’honestas c’est-à-dire le salut éternel de chacun. De ces axiomes, on a pu attribuer à Thomas une prédominance du tout sur la partie, voire un écrasement de la collectivité sur l’individu. En réalité, cette hiérarchie de finalités harmonise plus qu’elle n’oppose les biens entre eux. Le bien de l’homme transcende le bien du citoyen en étant ultimement orienté vers Dieu mais le citoyen reste dévoué à sa cité comme étape de progression vers son bien suprême. Le bien commun est alors envisagé comme une forme particulière de la charité, dans un ordo caritatis ou l’amour du bien public est intériorisé dans la conscience individuelle de chacun ».
[21] Thomas d’Aquin, Somme théologique, I II q.98, art. 1.
[22] Thomas d’Aquin, De Regno, Livre I, chapitre XV.
[23] Cf. mon ouvrage La justice fiscale et l’abus de bien commun, Desclée de Brouwer, 2016.
[24] Jean-François Marchi, « Bien commun et droit international », Les Cahiers Portalis – n°4 – Septembre 2016.
[25] Albert Rigaudière, ibidem, p.47.
[26] Ibidem, pp.146 et 147.
[27] Ce que j’expose plus amplement dans mon ouvrage L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun.