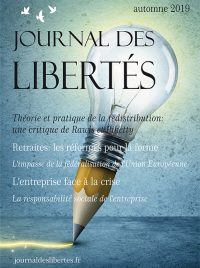Introduction : les libéraux et la doctrine sociale de l’Eglise
Les débats actuels sur les sujets économiques et sociaux portent largement sur les questions éthiques. Les adversaires du libéralisme dénoncent souvent son immoralité ; mais que diraient-ils s’il est démontré qu’il y a convergence entre les approches et les écrits du libéralisme classique et la doctrine sociale de l’Eglise catholique ?

Il est vrai que tous les libéraux ne sont pas « classiques », certains ne retiennent du libéralisme que sa dimension économique et négligent ou critiquent sa dimension éthique, alors même que c’est bien « l‘action humaine » (Cf. Mises) qui inspire et régit les relations économiques et sociales.
Il est également vrai qu’il est difficile pour la plupart des gens, et parfois même pour des catholiques, de hiérarchiser les multiples déclarations d’hommes d’église. Même si on s’en tient au niveau du magistère romain (le pape) toutes les déclarations n’ont pas la même valeur : un commentaire à chaud dans une conférence de presse improvisée n’a pas le même poids qu’une encyclique. De plus, dans bien des cas, il s’agit de domaines prudentiels, c’est-à-dire qui n’engagent pas l’autorité du pape. Celui-ci peut avoir ses propres opinions, par exemple en politique, et le pape François, marqué par le péronisme et par la situation de l’Amérique latine, n’a pas la même sensibilité que Jean-Paul II, confronté au totalitarisme nazi, puis communiste.
Parmi les textes publiés par les papes, il y a d’abord les reconnaissances de dogmes, phénomène très rare (un par siècle en moyenne, le dogme de l’Immaculée conception au dix-neuvième siècle et celui de l’Assomption au vingtième). Ces éléments ne concernent que la foi et donc les croyants. On trouve ensuite les encycliques, qui sont des lettres ouvertes du pape, qui concernent le plus souvent des questions de foi, par exemple sur la Vierge Marie, ou le Saint-Esprit ou autres sujets théologiques. Parmi les encycliques, les seules qui concernent notre sujet sont appelées « encycliques sociales », et portent sur l’économie, le social, les droits de l’homme, voire la démocratie, etc. Elles ne sont pas très nombreuses, un peu plus d’une dizaine en tout (une seule chez Léon XIII, en 1891, la première encyclique sociale, Rerum novarum, puis trois chez Pie XI, deux chez Jean XXIII, deux chez Paul VI, trois chez Jean-Paul II, une chez Benoît XVI et enfin une chez François). Ce sont d’ailleurs les seuls textes qui s’adressent non seulement aux catholiques, mais aussi à tous « les hommes de bonne volonté », car ils reposent aussi sur la raison, et pas seulement sur la foi.
Même dans les encycliques sociales, tout n’appartient pas au « patrimoine doctrinal de l’Eglise ». Il y a, dans les encycliques sociales, à côté de ces éléments doctrinaux, beaucoup de passages « prudentiels », c’est-à-dire qui n’engagent pas l’autorité du pape et donc qui n’impliquent pas l’adhésion des catholiques. Quand Paul VI critique le commerce international dans les années 60 ou quand François s’engage sur des terrains tels que le réchauffement climatique, les catholiques restent libres de leur propre jugement. Il en va, a fortiori, de même pour tous les autres textes, discours ou conférences de presse des papes ; c’est ce qui explique une certaine confusion, chez les catholiques comme pour les non-catholiques, face à la multiplication des déclarations. Pour s’en tenir au pape François, ses multiples déclarations, notamment en matière économique et sociale, ou sur les questions environnementales, n’ont pas de portée doctrinale, contrairement aux grands principes explicités dans les encycliques sociales. Bien entendu, il est normal que le pape s’exprime librement, comme tous ses prédécesseurs l’ont fait, mais si l’on veut savoir ce qui constitue « la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique » (DSEC), il faut s’en tenir, comme son nom l’indique, aux seuls éléments doctrinaux, ce que nous ferons dans cet article.
1. Rappel des grands principes de la DSEC
Puisque la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique juxtapose des textes écrits sur plus d’un siècle, de l’Encyclique Rerum Novarum de Léon XIII à Laudato Si de François il est sans doute nécessaire de rappeler les grands principes qui fondent la doctrine sociale.
La dignité de l’homme
Au centre, se trouve la personne. « Il convient de garder présent à l’esprit que ce qui sert de trame et d’une certaine manière de guide à l’encyclique et à toute la doctrine sociale de l’Eglise, c’est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique », la personne qui a une « dignité incomparable » et des droits qui « dérivent de sa dignité essentielle de personne[1]». Les libéraux seraient-ils choqués à l’idée de dignité de l’homme, de ses droits fondamentaux, du fait qu’à chaque droit correspond un devoir ? Seraient-ils en désaccord avec l’idée que l’homme étant une personne, a une « dimension sociale » qui « ne s’épuise pas dans l’Etat[2] », mais se réalise dans les groupes intermédiaires, allant de la famille aux entreprises en passant par les associations? Seraient-ils en désaccord quand cette doctrine affirme que le « socialisme réel » a éliminé aussi bien la « personnalité de l’individu » que la « personnalité de la société[3] » ?
Le bien commun
Par contraste un autre principe pourrait poser un sérieux problème aux libéraux : le bien commun. Ce concept ne serait-il pas de nature collectiviste ou holiste ? Remarquons tout de suite qu’il n’a aucun rapport avec l’intérêt général. Jean XXIII le définit ainsi : le bien commun « c’est-à-dire l’ensemble des conditions sociales permettant à la personne d’atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement[4] ». Rien de collectiviste dans le but du bien commun : l’épanouissement des personnes. Quant aux moyens, aux « conditions sociales », la liberté, y compris en matière économique, la propriété, le marché, de même que la défense des droits fondamentaux en font partie ; et le bien commun n’est pas l’apanage de la classe politique, chacun doit y contribuer puisqu’il y a un bien commun d’une famille, d’une association d’une entreprise, etc.
La propriété privée…
Autre principe, la propriété privée, associée à la destination universelle des biens. L’Eglise a toujours défendu la propriété privée, considérée comme un droit naturel, depuis le début de la doctrine sociale. Dans la première encyclique sociale, Léon XIII affirmait déjà, en condamnant la proposition socialiste de supprimer la propriété privée, « qu’il reste donc bien établi que le premier fondement à poser par tous ceux qui veulent sincèrement le bien du peuple, c’est l’inviolabilité de la propriété privée[5] ». Il ajoutait même qu’il y avait une condition pour que la propriété produise tous ses avantages, c’est qu’il « ne faut pas que la propriété privée soit épuisée par un excès de charges et d’impôts[6]».
… et la destination universelle des biens
L’autre partie du principe, « la destination universelle des biens », pourrait inquiéter, surtout quand on évoque les premiers chrétiens qui auraient été aussi les premiers communistes ! Le sens donné par la doctrine est tout à fait différent, et Léon XIII l’avait bien précisé : la destination universelle des biens ne commande pas le partage des terres et des richesses, mais la possibilité pour chaque être humain d’accéder à la propriété, et « qui en manque y supplée par le travail ». Autrement dit c’est l’activité économique, dont le travail, qui fournit des revenus permettant à leur tour de s’approprier les biens de nature à satisfaire ses besoins. Jean-Paul II ajoutera que la propriété de l’entreprise, permettant de multiplier les biens, contribue à cet objectif de création de biens pour tous et que c’est le devoir de l’entrepreneur de contribuer à cette création. Enfin, pour ceux qui n’ont pas d’accès aux revenus, il y a la solidarité, autre thème important de l’Eglise, vue comme un devoir moral, (et non comme une obligation légale). D’ailleurs, défendant la propriété, Léon XIII précise qu’en « substituant à la providence paternelle la providence de l’Etat, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille[7] ». Un siècle plus tard Jean-Paul II s’en fera l’écho dans sa critique de l’Etat providence ou « Etat de l’assistance ».
Il existe d’autres principes de la doctrine sociale de l’Eglise, parmi lesquels il faut faire une mention particulière pour la subsidiarité, principe dont les libéraux, à juste titre, se sentent spontanément les plus proches. La subsidiarité peut ainsi être un élément majeur de compréhension mutuelle.
2. La subsidiarité : un élément majeur de compréhension mutuelle ?
Qu’est-ce que la subsidiarité ?
La subsidiarité est un principe présent dans la philosophie politique comme dans la doctrine sociale de l’Église depuis l’origine, mais sa définition précise a été donnée en 1931 par Pie XI dans Quadragesimo anno. Le texte évoque un « principe essentiel » de philosophie sociale, « qu’on ne saurait ni changer, ni ébranler » : il serait extrêmement grave et « très dommageable » « de retirer aux groupements d’ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes.[8]»
Le principe de subsidiarité signifie que l’organisation de la vie sociale doit se passer au plus bas niveau possible. C’est un principe qui respecte l’homme et sa liberté. Cet homme est un être social, dont la dignité s’exprime dans sa capacité à exercer librement ses responsabilités, en lien avec d’autres personnes.
Une expression de l’inaliénable liberté humaine
En effet, pour Benoît XVI, « la subsidiarité est une expression de l’inaliénable liberté humaine » (Caritas in veritate). Nier la subsidiarité revient pour lui à nier la liberté de l’homme, son droit d’agir dans les groupes naturels comme la famille ou dans les groupes créés par l’homme : associations, entreprises… Il affirme que la subsidiarité est une manifestation particulière de la charité. C’est une aide à la personne à travers l’autonomie des corps intermédiaires. Elle a donc une visée émancipatrice. La subsidiarité n’est pas seulement une question d’organisation de la vie en société, mais concerne l’essentiel : la liberté, la charité, l’émancipation des hommes.
La subsidiarité accorde donc une place centrale aux « corps intermédiaires », expression qui dans la DSEC ne signifie pas la légitimité des « corporations » auxquelles les libéraux se sont toujours opposés. Il s’agit de tous les groupes, volontairement et librement constitués, qui constituent la société civile, de la famille aux entreprises, en passant par les associations de toute nature, En effet, comme on l’a vu avec la formule déjà citée de Jean-Paul II, la dimension sociale de l’homme ne s’épuise pas dans l’Etat, mais passe par tout le dynamisme de la société civile.
Regroupements interdits
Pour comprendre la préoccupation de l’Eglise, il faut remonter à la Révolution française et aux corporations qui existaient sous l’Ancien Régime. Ce qui était réclamé dans les Cahiers de doléances a conduit au décret d’Allarde qui a supprimé les corporations en 1791 ; elles étaient souvent devenues un obstacle au libre choix de sa profession et à la liberté du travail. Mais, toujours en 1791, la loi Le Chapelier est allée plus loin en interdisant tout regroupement et notamment ceux des employeurs ou des salariés pour défendre leurs « soi-disant » intérêts communs. Cela voulait dire l’interdiction des syndicats, patronaux ou salariaux. Quand Napoléon remit un peu d’ordre dans le système juridique français, son Code pénal interdit pratiquement toute forme d’association, puisqu’il fallait l’autorisation du ministère de l’Intérieur et que celle-ci était en pratique très peu donnée.
Cela explique, notamment en France, la faiblesse des « corps intermédiaires ». Par cette expression, il faut comprendre tous les regroupements qui structurent à la fois la personne et la société. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église désigne ainsi « la famille, les groupes, les associations, les réalités territoriales locales, toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective » (n. 185).
Le XIXème siècle s’est ainsi développé en France avec une société civile tronquée et un faible tissu associatif. Même les sociétés de secours mutuel ont été limitées et surveillées, alors qu’elles auraient pu contribuer avec efficacité et équité à la protection sociale. La « question sociale » trouve largement son origine dans ce refus des groupements volontaires et, par réaction, cela amènera l’idée que seul l’Etat peut résoudre la question sociale, d’où le développement ultérieur de l’Etat providence, au lieu de favoriser des systèmes privés et volontaires de type mutualiste ou assuranciel. Tocqueville avait déjà observé dès la première moitié du XIXème que lorsque les Américains avaient un problème, ils créaient une association, alors que lorsque les Français avaient un problème, ils faisaient appel à l’Etat. Affaiblissez la société civile et c’est l’Etat qui occupera le terrain.
L’Église défend les corps intermédiaires
Quand la doctrine sociale de l’Église est née en 1891 avec l’encyclique Rerum Novarum, l’une des priorités essentielles du pape Léon XIII a été de plaider pour ces corps intermédiaires. Au XXème siècle, la préoccupation est restée la même, bien que l’on ait quand même avancé, en France par exemple, avec la loi sur les syndicats en 1884 et la loi sur les associations en 1901. Mais les corps intermédiaires sont souvent restés faibles, fragiles et contestés par l’omniprésence de l’Etat, qui n’a cessé de chercher à occuper la place de la société civile.
Il y a un lien étroit entre les notions de « société civile », de « personnalité de la société », de « corps intermédiaires » et la subsidiarité. En effet, la subsidiarité implique que les réalités de la vie sociale s’expriment au plus bas niveau possible ; cela suppose que l’on comprenne par exemple que ce qui peut être fait au niveau de la famille doit être fait à ce niveau-là, et ainsi de suite pour les associations, les entreprises, les collectivités locales. On doit ainsi mettre en valeur toutes les composantes de la société civile. Mais ce n’est pas un principe hiérarchique, où le « plus important » serait en haut, parce que le plus vaste : le plus important, c’est la personne humaine et, au-delà, les groupes dans lesquels elle s’épanouit librement en lien avec les autres. D’ailleurs, on n’est pas d’abord ou seulement dans une vision verticale de la subsidiarité, mais surtout dans une vision horizontale de celle-ci, chaque personne, chaque groupement, ayant son autonomie et ses propres vocations et objectifs. C’est d’ailleurs ce que veut dire Benoît XVI quand il parle de la subsidiarité comme expression de la liberté humaine.
Ne pas confondre la subsidiarité avec la seule décentralisation
On confond souvent la subsidiarité avec la décentralisation. Certes, la décentralisation, c’est la subsidiarité appliquée aux institutions publiques. Cela veut dire, si l’on prend le système français, que ce qui peut être fait au niveau de la commune ne doit pas remonter au niveau du département, ce qui peut se faire au niveau du département ne doit pas remonter au niveau de la région, etc. Mais ce n’est qu’un aspect de la subsidiarité qui doit s’appliquer aussi à toutes les institutions civiles, à tout le tissu familial, associatif, entrepreneurial, etc.
La subsidiarité en matière d’institutions publiques implique une vraie décentralisation : en France, même s’il y a eu des lois sur la décentralisation, on reste très jacobin et on est loin de la décentralisation qui existe dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse ou les États-Unis. En France, les collectivités locales n’ont pas d’autonomie financière ni fiscale. Elles doivent attendre leurs recettes du bon vouloir de l’État et elles perdent beaucoup de leur autonomie. C’est une atteinte au principe de subsidiarité.
Le niveau supérieur doit-il intervenir ?
La subsidiarité n’exclut donc pas une intervention du niveau supérieur, mais uniquement quand c’est indispensable. Tout ce qui peut être réalisé au niveau le plus bas doit l’être, mais, si ce n’est pas possible, il faut remonter à un échelon supérieur. Ce n’est donc pas un principe absolu de non-intervention : c’est un principe d’intervention limitée, chaque fois que c’est nécessaire. Ce n’est pas non plus un principe collectiviste, car le fait qu’un individu ou une famille ne puisse pas faire quelque chose ne signifie pas que cela doive être fait au niveau de l’État. Ce doit être fait au niveau le plus proche, qui peut être la commune, l’entreprise, une association, etc.
Subsidiarité et économie
La subsidiarité implique que « la priorité revient à l’initiative privée des individus, agissant soit isolément, soit associés de diverses manières[9] », d’où les prises de position de l’Eglise en faveur de l’économie de marché, de la liberté d’entreprendre et du libre commerce. Le principe de subsidiarité s’applique aussi à l’intérieur de toutes les institutions humaines ; elle doit donc s’appliquer à l’intérieur de l’entreprise. Certes, il faut bien à un moment que quelqu’un tranche au niveau le plus élevé. Mais l’Eglise a toujours défendu l’idée que les salariés puissent jouer un rôle actif dans l’entreprise, chacun étant, à sa place, créateur. Les entrepreneurs savent qu’on peut obtenir beaucoup plus, au niveau de la productivité mais aussi de respect de la personne, en appliquant le principe de subsidiarité. En impliquant les salariés dans des cercles de qualité, des équipes autonomes de production, ou une gestion participative, on peut trouver des idées, des méthodes, des améliorations qui bénéficient à tous. Le principe de subsidiarité a sa place dans l’entreprise, la subsidiarité améliore l’efficacité, tout en respectant mieux chaque acteur de la vie de l’entreprise[10].
Le cas de l’école
Autre exemple : l’éducation. La France a un système extrêmement centralisé avec l’Éducation nationale. Même le secteur privé doit obéir aux règles définies par le ministère[11]. Il y a aussi un monopole d’État pour les grades universitaires, etc. L’application du principe de subsidiarité devrait reconnaître que les premiers éducateurs des enfants sont les parents et que cela implique le libre choix de l’école. Or beaucoup d’éléments empêchent ce libre choix ; beaucoup d’écoles, mêmes privées, ont du mal à développer leur caractère propre, et il y a des obstacles à ce libre choix.
La protection sociale
Qu’en est-il pour la protection sociale ? Une obligation d’assurance a ici un sens pour la maladie, comme c’est aussi le cas pour l’automobile, car si l’on provoque un accident ou si l’on est gravement malade, le risque est que l’on ne puisse pas avoir les fonds soit pour indemniser, soit pour se soigner. Est-ce que cette obligation d’assurance implique pour autant un monopole public comme celui de la « Sécu », système uniforme et dont on voit les problèmes de gestion, de fraude, de bureaucratie ? La subsidiarité conduit ici à la même réponse que celle que fournissent les libéraux.
Plus généralement, cela pose la question de la solidarité. Benoît XVI a expliqué comment solidarité et subsidiarité sont indissociables. Il affirme dans Caritas in Veritate que, s’il y a la subsidiarité sans la solidarité, on risque de tomber dans l’individualisme, au sens du chacun pour soi seul. Inversement, s’il y a la solidarité sans la subsidiarité, on va tomber dans l’assistanat. Dans beaucoup de pays, avec le développement de l’État-providence, il existe un système extrêmement centralisé de solidarité. L’enseignement social de l’Église dénonce cette dérive, parce que ce système uniforme et lointain a tous les inconvénients de la bureaucratie et de l’assistanat, alors que souvent la solidarité implique une proximité avec la personne. On le voit très bien en matière d’emploi, pour des personnes qui ont été exclues longtemps du marché du travail. À l’expérience, des organismes centraux — comme Pôle Emploi — sont rarement capables d’aider ces personnes à se réinsérer. Au contraire, les associations locales de réinsertion peuvent réapprendre à ceux qui sont marginalisés à reprendre un rythme régulier et à se réinsérer sur le marché du travail.
Une application européenne inversée
Peu diffusé pendant longtemps en dehors de l’Église, si ce n’est par des penseurs libéraux (dont Bastiat en particulier), le principe de subsidiarité est passé dans le domaine public, notamment au niveau européen. Sous l’influence de Jacques Delors, il a même été intégré aux traités européens, mais d’une manière partielle, et erronée, avec deux singularités.
La première est qu’il n’est prévu d’appliquer le principe de subsidiarité qu’aux relations entre le niveau européen et le niveau national. C’est une première faiblesse, car la subsidiarité s’applique à l’ensemble des corps intermédiaires, à toute la société civile, et pas seulement jusqu’à l’État, mais aussi à tous les échelons inférieurs. La conception européenne de la subsidiarité est donc tronquée.
La deuxième singularité, c’est que la façon dont ce principe est présent dans les textes européens en fait une subsidiarité descendante et non ascendante : on définit d’abord ce qui est de la compétence de l’échelon européen avant d’attribuer les compétences de l’échelon national. En simplifiant, ce qui est « à Bruxelles » n’est pas négociable et ce qui est encore au niveau national peut se discuter. C’est donc une subsidiarité « à l’envers», c’est du colbertisme !
La toute-puissance excessive de l’État
L’Église a toujours considéré que l’État était le responsable ultime du bien commun, mais n’a jamais dit que tout devait se passer au niveau de l’État. On peut critiquer le poids excessif de l’État en s’appuyant sur le principe de subsidiarité, quand l’État sort de son domaine propre. Par exemple, au niveau de l’éducation, notamment en matière morale. Est-ce l’État qui doit se charger de l’éducation morale des enfants en imposant « sa » morale, alors que les premiers éducateurs sont les parents ? Souvent, la « morale » véhiculée par l’État dans de nombreux textes ne respecte guère les consciences et la morale naturelle. L’État prétend ici imposer aux familles sa fausse conception de la morale !
La subsidiarité est plus efficace
Les pays les plus respectueux du principe de subsidiarité sont aussi les plus efficaces. Les pays fédéraux notamment appliquent bien mieux le principe de subsidiarité : l’Allemagne, la Suisse, les États-Unis. Aux États-Unis, c’est un grand débat depuis toujours entre ceux qui voudraient que les décisions remontent davantage au niveau fédéral et ceux qui veulent qu’elles restent au plus bas niveau possible.
Dans les classements de productivité des pays dans le monde, les pays fédéraux et plus généralement les plus décentralisés, sont devant. En Allemagne, des questions comme celle de l’éducation relèvent des Länder. L’efficacité du système éducatif s’en ressent et les bons résultats en matière de chômage des jeunes parlent d’eux-mêmes. En France, le chômage des jeunes est deux ou trois fois supérieur à celui des adultes, ce qui montre que notre système éducatif centralisé ne fonctionne pas. Si l’on regarde le classement des pays les plus compétitifs, selon le Forum économique mondial, on trouve notamment, en 2018, parmi les premiers les États-Unis (1er), mais aussi l’Allemagne (3°), la Suisse (4°), des pays où le principe de subsidiarité est largement appliqué. La France, elle, est loin (au 17e rang).
Certes,
la question de la décentralisation dans les institutions publiques n’est qu’un
aspect de l’application de la subsidiarité. Mais les pays qui accordent la plus
grande place au principe de subsidiarité dans tous les domaines (institutions
publiques, éducation, économie, solidarité, vie culturelle, etc.) sont les pays
les plus dynamiques et les plus efficaces, tout en respectant mieux la liberté
et la dignité des personnes et l’autonomie des corps intermédiaires qui
composent la société civile. Sur ce point, il n’y a pas de divergence majeure
entre la tradition libérale classique et celle de l’Eglise. Que l’Eglise y
ajoute sa propre conception de la morale, puisque la doctrine sociale est
d’abord une éthique économique et sociale, ne devrait guère choquer les
libéraux, attachés à la liberté d’expression de chacun.
[1] Jean-Paul II, Centesimus annus, 1991, §11.
[2] Jean-Paul II, op. cit. § 13.
[3] Idem.
[4] Jean XXIII, Mater et magistra, 1961, § 65.
[5] Léon XIII, Rerum novarum, 1891, § 12.
[6] Idem, §35-5.
[7] Léon XIII, Rerum novarum, § 11.
[8] Pie XI, Quadrasesimo anno, 1931, § 36.
[9] Jean XXIII, Mater et magistra, 1961, § 51.
[10] Il appartient aux responsables de l’entreprise de faire le choix de la forme et de l’importance que la subsidiarité prendra, en aucun cas il ne saurait y avoir une « responsabilité sociale de l’entreprise » (Cf. l’article de S. Schweizter dans ce numéro.)
[11] Les accords Lang Cloupet (1984) passés entre le ministère de l’Education Nationale et la Direction Nationale de l’Enseignement Catholique prévoient qu’en aucun cas les effectifs des élèves de l’école privée peuvent être supérieurs à 20 % du nombre total des élèves.