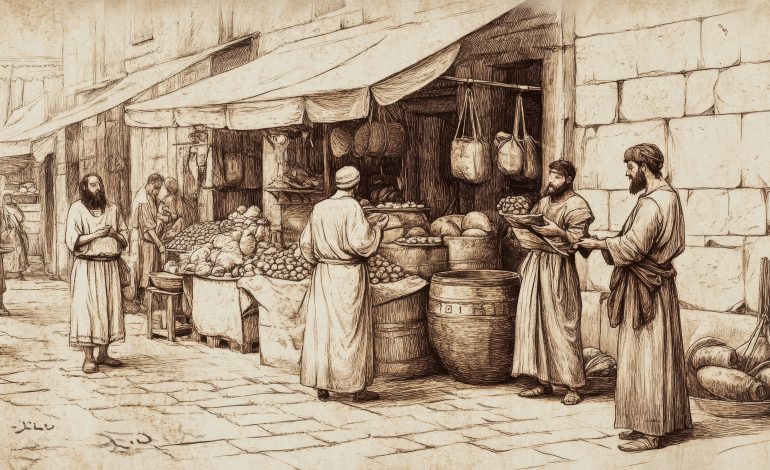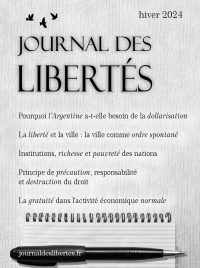Dans son article sur les « biens à effet secondaires » de l’économie de marché, le Professeur Jörg Guido Hülsmann démontre brillamment combien cette économie produit par elle-même, à titre d’effets indirects désirables, les biens gratuits que le Pape Benoît XVI requiert des entrepreneurs. Une société ouverte et libre produit naturellement et gratuitement du « bien commun », qui permet aux individus de vivre en paix ensemble, dans le respect du droit. Elle nous permet de bénéficier des acquis antérieurs qu’elle a préservés. Elle favorise les échanges qui s’inscrivent dans un processus de création de valeur. La suite d’essais et d’erreurs de chaque entrepreneur dans le développement de son entreprise sert de leçon gratuite à tous les autres. Les externalités positives et gratuites de l’économie de marché sont nombreuses et devraient d’ailleurs, dans son évaluation, être prises en compte en compensation de ses externalités négatives qui existent aussi. D’une manière générale, l’économie de marché a démontré qu’en dépit de toutes ses imperfections, elle était bien mieux capable que les autres d’accroitre la richesse générale et de réduire la pauvreté. Et l’éclairage du Professeur Hülsmann est lumineux, notamment dans son explication des erreurs que font aussi bien les partisans de l’économie libérale mainstream que ceux d’une économie planifiée par leur méconnaissance de la création de valeur propre à l’échange économique.

Toutefois je ne crois pas que l’ignorance qui entoure encore les bienfaits de l’économie de marché soit due principalement à la mauvaise analyse par Aristote de la commutativité de l’échange qui aurait été poursuivie par l’Église jusqu’à Benoît XVI. Celui-ci assumait sa mission évangélique en souhaitant que les entreprises intègrent une dimension de gratuité dans leur démarche économique, mais il n’était pas hostile au développement économique et au marché. Il est vrai que l’Église catholique peine à reconnaître la force éthique du marché, mais elle n’en méconnaît pas les vertus tout en s’évertuant à en tempérer les vices.
La lente découverte des vertus de l’échange
Certes, Aristote, comme tout le monde civilisé alors, ignorait le caractère valorisant de l’échange dans lequel le juste, nous dit-il, « consiste à posséder après, une quantité égale à ce qu’elle était auparavant »[1], l’échange n’ayant pas vocation à enrichir les parties à l’échange. Aristote relie le prix aux besoins ou à l’utilité non par rapport à leur évaluation individuelle, mais par rapport à leur appréciation sociale, en se référant à une mesure commune qui est exactement le besoin que nous avons les uns des autres[2]. Le prix est juste pour autant qu’il contribue à assurer l’harmonie de la Cité et c’est à ce titre seulement qu’il se préoccupe de satisfaire aux besoins des individus, Aristote condamnant par ailleurs la chrématistique commerciale, le commerce conçu non pour « subvenir aux nécessités de la vie, mais en vue d’un gain »[3].
Mais plus de seize siècles plus tard, Saint-Thomas, qui fait largement reposer sa philosophie sur celle d’Aristote, admet néanmoins que le prix dépende des circonstances :
« Les mesures des choses qui se vendent doivent nécessairement varier selon les pays, à raison du plus ou moins d’abondance où ces choses s’y trouvent ; car on comprend que les mesures soient plus grandes là ou l’abondance règne[4]. »
De la même manière, un marchand de blé arrivant dans un village qui en est dépourvu est en droit de vendre ses produits à une prix tenant compte de leur rareté, sans révéler que d’autres marchands le suivent et pourront sans doute procurer l’abondance qui fait défaut au moment où il propose sa marchandise[5].
L’individualisation du prix résulte sans doute en partie de la redécouverte, à partir du XIIème siècle, du droit romain quand bien même la détermination des prix reste encore limitée par la notion de juste prix soumise à une appréciation commune, à un critère « d’optimalité collective ». Les prix étaient alors souvent administrés, fixés par un « appréciateur » ou par arrêté. Mais l’Église reconnaissait l’utilité sociale et économique des marchands, comme le déclare le canon 22 du concile de Latran de 1179, en les faisaient bénéficier de la trêve de Dieu[6].
Ce sont les travaux de l’École de Salamanque qui, dans la suite de l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin, ont fait émerger, non sans hésitations ni divergences, le concept de prix de marché en faisant reposer le système de prix sur les choix individuels des agents économiques. André Lapidus[7] cite Domingo de Soto (1533 : 169a) :
« Les prix s’élèvent quand les acheteurs sont nombreux et baissent quand ils sont rares. De la même manière, les prix baissent quand les vendeurs sont nombreux et s’élèvent quand ils sont rares. »
et L. Saravia de la Calle (1544 : 80) qui met en évidence le rôle autonome des quantités offertes ou de la monnaie sur les prix nominaux :
« La simple abondance ou rareté des biens, des marchands et de la monnaie augmente ou diminue les prix, comme les marchandeurs des foires le savent par expérience[8]. »
On trouve également, écrit-il[9], chez Diego de Covarruvias, en 1554, une approche évoquant Jevons ou les autrichiens, en ce qu’elle place l’accent exclusivement sur le rôle de l’utilité individuelle, et élimine toute considération relative aux coûts de production :
« La valeur d’un article ne dépend pas de sa nature essentielle mais de l’estimation des hommes, même si cette estimation est stupide. De sorte que le blé est plus cher aux Indes qu’en Espagne car les hommes l’y estiment plus, bien que la nature du blé soit la même aux deux endroits. » (Covarruvias, 1583 : II, iii, 4).
La justice commutative s’éloigne ainsi peu à peu de son cadre initial et aristotélicien selon lequel le prix devait refléter des valeurs dites égales en fonction de critères, d’ailleurs incertains, liés plutôt aux coût de production des articles échangés, mais aussi au besoin social, collectif des biens échangés, ce qui introduisait une appréciation arbitraire de la valeur en fonction de la position sociale des individus et des besoins de la collectivité[10]. En commentant Thomas d’Aquin à Salamanque au XVIème siècle, notamment sur les questions du droit et de la justice, son lointain disciple Vitoria souligne l’objectivité de la justice commutative :
« Dans l’objet de la justice, c’est-à-dire dans ce qui est juste, il ne faut pas prendre en considération la condition de l’agent, à savoir si celui qui achète est riche ou pauvre pourvu qu’il donne l’équivalent. [ … ]. Et si l’on demande à un expert dans les affaires humaines combien vaut un cheval, on dira : combien est-il juste de donner pour un cheval ? On répondra : il est juste de donner cent ducats sans prendre en considération si l’on est pauvre ou riche[11]. »
Il ne revient pas à la loi pour autant de fixer le prix du cheval dont la valeur est, elle, subjective en fonction du souhait du vendeur de le vendre et de l’envie de l’acquéreur de l’acheter comme le rappelait Luis de Molina (1535-1600), un autre représentant de l’école de Salamanque, exposant que :
« Le prix est dit « naturel » parce qu’il résulte de la chose même sans égard aux lois et décrets, et qu’il dépend de maintes circonstances qui le modifient, telles que les sentiments des gens, leur estimation des différents usages, souvent même selon les humeurs et plaisirs[12]. »
L’appréciation subjective de la valeur en fonction des besoins de chacun, et non de la collectivité, apparaît désormais. L’échange est toujours commutatif, pratiqué à des valeurs qui conviennent aux deux parties également, sinon elles n’auraient pas procédé à cet échange. Mais l’appréciation de la valeur est différente pour chacun, contient une part de subjectivité personnelle et non sociale. Quand Pierre échange une pomme contre la poire de Paul, l’un et l’autre considèrent qu’ils font un échange égal, mais la pomme a plus de valeur pour Pierre parce qu’il préfère les pommes aux poires et vice versa. Le fait que chacun ait intérêt à l’échange, donc y trouve de la valeur ajoutée, ne signifie pas que l’échange est inégal. Il reste commutatif car chacun y trouve un avantage de même importance mais différent. C’est précisément ce qui fait le marché.
On peut donc considérer que l’école scolastique tardive de Salamanque a permis de concevoir, dans des approches diversifiées, le marché dans sa fonction créatrice de richesse. L’Église s’intéressera peu ensuite à la question des prix, mais ne méconnaitra pas leur rôle. En 1751 par exemple, l’abbé Ferdinando Galiani, dans son Trattato della moneta (De la Monnaie, Paris, Librairie M. Rivière, 1955), situe la question de la valeur dans l’ordre des phénomènes psychologiques en s’appuyant sur l’utilité et la rareté.
« Il distingue la détermination de la valeur d’échange pour ; les biens non reproductibles où la rareté est déterminante mais avec un prix qui ne saurait être trop élevé car alors la demande s’effondrerait sous l’effet de phénomènes de substitution ; les biens reproductibles, où la valeur se fixe par une série d’oscillations en fonction de l’offre et de la demande. La valeur est directement rattachée au prix de marché[13]. »
Benoît XVI et le marché : à chacun son ordre
Il est vrai que l’Église catholique a toujours eu une réserve à l’égard du marché. L’idée d’un marché basé sur l’intérêt personnel du boucher d’Adam Smith ou des abeilles de Mandeville fait craindre la réduction de l’Homme à son seul ego alors que la doctrine chrétienne croit fondamentalement à la bonté naturelle, mas pas exclusive, de toute nature humaine créée par un Dieu bon. A cet égard, l’égoïsme humain n’est pour elle que le fruit d’un mauvais exercice de la liberté humaine. Elle peine donc à admettre que le progrès humain puisse reposer sur l’instrumentalisation naturelle du vice. Néanmoins, elle reconnaît, généralement du moins, le marché comme un rouage de l’économie humaine susceptible d’œuvrer au Bien.
Avec Saint Augustin, l’Église admit très tôt que les institutions humaines, toutes imparfaites qu’elles soient, peuvent permettre de concourir à l’édification du Bien :
« Toutes les institutions humaines qui ont pour objet l’usage des choses nécessaires à la vie, sont loin d’être indignes de l’attention du chrétien. […] Quant à celles qui ont pour objet les rapports des hommes entre eux, on peut en user dans ce qu’elles n’ont pas de superflu et d’excessif…[14]. »
Certes la cité céleste de saint Augustin offre la paix éternelle, mais elle ne dédaigne point la cité terrestre,
« elle ne fait point difficulté d’obéir aux lois qui servent à régler les choses nécessaires à la vie mortelle ; car cette vie étant commune aux deux cités, il est bon qu’il y ait entre elles, pour tout ce qui s’y rapporte, une concorde réciproque. »
La cité céleste « use d’ailleurs, pendant son pèlerinage, de la paix temporelle et des choses qui sont nécessairement attachées à notre mortelle condition; elle désire et protège le bon accord des volontés, autant que la piété et la religion le peuvent permettre… »[15]. Il nous dit au fond qu’il faut distinguer les ordres sans négliger les lois qui permettent de régir au mieux la vie terrestre. Il ajoute ailleurs que dans notre vie terrestre, nous devons supporter notre condition selon l’ordre des choses humaines[16].
Dans cet esprit, après avoir constaté l’échec du communisme, le pape Jean-Paul II s’interrogeait dans son encyclique Centesimus Annus (N°42), sur la question de savoir si le capitalisme devait servir de modèle :
« La réponse est évidemment complexe. Si sous le nom de “capitalisme” on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu’elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive, même s’il serait peut-être plus approprié de parler d’« économie d’entreprise », ou d’« économie de marché », ou simplement d’« économie libre ». Mais si par « capitalisme » on entend un système où la liberté dans le domaine économique n’est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l’axe est d’ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative. »
Certes, le Pape François dans son exhortation Evangelii gaudium du 24 novembre 2013 piétine l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII et Centesimus Annus qui en célébrait le centenaire. Il soutient que l’économie de marché serait la cause de plus de crainte et de désespérance, d’une extinction de la joie de vivre, d’une augmentation du manque de respect mutuel et de la violence. « Une telle économie tue » dit-il (page 47). Mais ces propos sont en déphasage avec la doctrine antérieure de l’Église.
Son prédécesseur Benoît XVI prônait la croissance économique et le développement humain en condamnant tout autant ceux qui sont prêts à s’abandonner tout entiers à la technique que ceux qui se livrent à des
« idéologies qui nient in toto l’utilité même du développement, qu’elles considèrent comme foncièrement antihumain et exclusivement facteur de dégradation. Ainsi, finit-on par condamner non seulement l’orientation parfois fausse et injuste que les hommes donnent au progrès, mais aussi les découvertes scientifiques elles-mêmes qui, utilisées à bon escient, constituent au contraire une occasion de croissance pour tous. L’idée d’un monde sans développement traduit une défiance à l’égard de l’homme et de Dieu. C’est donc une grave erreur que de mépriser les capacités humaines de contrôler les déséquilibres du développement ou même d’ignorer que l’homme est constitutivement tendu vers l’ “être davantage”[17]. »
Il refuse autant d’absolutiser le progrès technique que d’aspirer à l’utopie d’une humanité revenue à son état premier de nature qui sont deux manières opposées de séparer le progrès de son évaluation morale et donc de notre responsabilité.
Il observait encore dans Caritas in veritate (36) que ;
« La société ne doit pas se protéger du marché, comme si le développement de ce dernier comportait ipso facto l’extinction des relations authentiquement humaines. Il est certainement vrai que le marché peut être orienté de façon négative, non parce que c’est là sa nature, mais parce qu’une certaine idéologie peut l’orienter en ce sens. Il ne faut pas oublier que le marché n’existe pas à l’état pur. Il tire sa forme des configurations culturelles qui le caractérisent et l’orientent. En effet, l’économie et la finance, en tant qu’instruments, peuvent être mal utilisées quand celui qui les gère n’a comme point de référence que des intérêts égoïstes. Ainsi peut-on arriver à transformer des instruments bons en eux-mêmes en instruments nuisibles. Mais c’est la raison obscurcie de l’homme qui produit ces conséquences, non l’instrument lui-même. C’est pourquoi, ce n’est pas l’instrument qui doit être mis en cause mais l’homme, sa conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. […] La sphère économique n’est, par nature, ni éthiquement neutre ni inhumaine et antisociale. Elle appartient à l’activité de l’homme et, justement parce qu’humaine, elle doit être structurée et organisée institutionnellement de façon éthique ».
Il en appelait à l’État de droit pour limiter les risques de dévoiement des comportements humains :
« Le devoir de l’État, c’est de maintenir l’ordre dans la communauté humaine, de créer un équilibre tel entre les biens et la liberté que chacun puisse mener une vie digne de son humanité… L’État garantit le droit comme condition de la liberté et du bien-être commun… Cependant, il n’est pas du rôle de l’État de réaliser le bonheur de l’humanité ; il n’est pas non plus chargé de créer des hommes nouveaux. Il n’est pas davantage de son rôle de transformer le monde en paradis, et il en est du reste incapable. S’il s’y essaie malgré tout, il se pose comme absolu et dépasse ses limites[18]. »
Prix et gratuité
Il reste que l’Église et les théologiens ont toujours été naturellement méfiants vis-à-vis de la richesse. Ils l’assimilent au lucre qui subordonne l’âme et toute la vie au gain et qui, de ce fait, est nuisible au salut. A l’inverse, ils valorisent le don et la charité ains que l’évoque le Compendium de la doctrine sociale de l’Église qui résume la problématique de la manière suivante :
« bien que participant activement à l’œuvre tendant à satisfaire ses besoins au sein de la société familiale, civile et politique, la personne humaine ne trouve pas sa réalisation complète tant qu’elle ne dépasse pas la logique du besoin pour se projeter dans celle de la gratuité et du don, qui répond plus entièrement à son essence et à sa vocation communautaire[19]. »
Il s’agit d’affirmer que la personne ne se résume pas à l’expression et la satisfaction de ses besoins matériels. Ce qui n’est en rien contradictoire avec l’idée que le marché est en l’état sinon le seul moyen de satisfaire aux besoins humains, du moins le moins mauvais malgré tous ses défauts.
Benoît XVI admet le marché comme une institution qui permet aux personnes de se rencontrer pour échanger selon les « principes de la justice dite commutative, qui règle justement les rapports du donner et du recevoir entre sujets égaux », mais il insiste sur
« l’importance de la justice distributive et de la justice sociale pour l’économie de marché elle-même […]. En effet, abandonné au seul principe de l’équivalence de valeur des biens échangés, le marché n’arrive pas à produire la cohésion sociale dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner. Sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd’hui, c’est cette confiance qui fait défaut, et la perte de confiance est une perte grave. » (Caritas in veritate, 35).
Au-delà du contrat, écrit-il, la vie économique a « tout autant besoin de lois justes et de formes de redistribution guidées par la politique, ainsi que d’œuvres qui soient marquées par l’esprit du don » (idem, 21). Un don sans contrepartie précise-t-il.
Le pape Benoît XVI ne rejette pas le marché, mais demande qu’il soit ouvert
« aux activités économiques réalisées par des sujets qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Les nombreux types d’économie qui tirent leur origine d’initiatives religieuses et laïques démontrent que cela est concrètement possible. » (ibidem)
Mais en réalité, le principe même de l’économie de marché est que toute personne physique ou morale peut s’y inviter, à condition d’en respecter les règles du jeu de façon à ne pas nuire aux autres intervenants du marché. Car lorsqu’un acteur du marché s’y présente en ayant fabriqué ses produits avec des subventions de l’État ou des dons privés, il fait une concurrence malhonnête aux autres acteurs et leur nuit, ce qui est injuste. Ainsi apparaît la limite de la confusion entre les ordres des deux cités terrestre et céleste. « Sans la perspective d’une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l’intérieur de l’histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l’avoir » (Caritas in veritate, 11) énonce Benoît XVI non sans raison. Mais l’ordre céleste, pour en revenir à Saint Augustin, ne peut pas exiger de l’ordre terrestre ce qu’il ne peut pas donner et doit en accepter l’imperfection.
Les grandes religions, morales, cultures et sagesses antiques, y compris l’Ancien Testament, ont érigé en loi le grand principe fondateur de l’état de droit qui permet aux communautés de vivre en paix : « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît, ne l’inflige pas à autrui »[20]. Mais le Christ a ajouté à cet ordre social une dimension d’amour incommensurable et entièrement nouvelle en renversant les termes antérieurs de cette règle pour enseigner de « faire aux autres ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous » (Mt 7, 12, Lc 6, 31). Il a toutefois contextualisé cette règle d’or en rappelant qu’il fallait distinguer les royaumes et « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ainsi, la loi civile définit ce qu’il ne faut pas faire quand la loi morale incite à faire ce qui est bien. L’Autorité légale a pour charge de dire le juste et d’assurer la justice, pas de dicter le Bien qui relève de l’Autorité morale. Le respect de cette dualité des ordres protège contre l’hégémonie, voire du totalitarisme qui germe sur cette confusion.
Et d’ailleurs, Benoît XVI admet le profit : « Le profit est utile si, en tant que moyen, il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif aussi bien quant à la façon de le créer que de l’utiliser ». Il prévient seulement de son usage : « La visée exclusive du profit, s’il est produit de façon mauvaise ou s’il n’a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d’engendrer la pauvreté » (Caritas in veritate, 21). Dès lors qu’il admet, sous certaines conditions, les bienfaits de la croissance économique (cf. ci-dessus) et du profit, même s’il perçoit mal les vertus de l’échange égal, commutatif, il ne peut pas ne pas admettre, pour le moins implicitement, que le profit naît de l’échange, ce qui n’est possible qu’en considérant que l’échange a vocation à être potentiellement profitable pour chacune des parties même si c’est différemment.
Benoît XVI demande que soient respectés dans les relations marchandes les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité, qui ne peuvent être négligés ou sous-évalués, mais aussi que trouvent leur place à l’intérieur de l’activité économique normale le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité (Caritas in veritate, 36). Mais il ajoute : « Le marché de la gratuité n’existe pas et on ne peut imposer par la loi des comportements gratuits. Pourtant, aussi bien le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes au don réciproque » (Caritas in veritate, 37). On peut admette qu’ils en aient besoin en effet, mais cette économie du don dans le marché ne peut passer que par le comportement des hommes, pas par le mécanisme du marché lui-même, sauf à le pervertir. Le marché exclut le don car l’échange, réalisé à la valeur attribuée aux biens échangés par chacune des parties, donne ainsi un prix de marché et garantit l’efficience du rapport entre le coût et le prix. L’introduction du don dans le marché vient fausser celui-ci.
Ce qui n’exclut pas que les entreprises soient gouvernées avec une bienveillance non exclusive d’une certaine exigence. La meilleure contribution sociale de l’entrepreneur est de favoriser le développement global de la collectivité. L’échange est le meilleur moyen d’enrichir le monde. Dans le cadre d’une rencontre mondiale des Mouvements populaires tenue le 16 octobre 2021, le pape François a dénoncé très généralement la libération rapide et considérable des échanges mondiaux qui a pourtant permis que depuis la fin de la guerre froide, en moins de quarante ans, le taux d’extrême pauvreté passe de 40 % à 10% d’une population mondiale ayant augmenté pourtant sur cette même période de plus de 50%. A la suite de l’École de Salamanque, d’autres hommes d’Église ont reconnu très tôt le rôle bénéfique des échanges. L’abbé Antonio Genovesi, un philosophe et économiste napolitain du XVIIIème siècle, qui s’est prononcé avant Turgot en faveur de la liberté du commerce des grains, a, en 1765, insisté dans ses Leçons sur le commerce (issues de son cours de 1757-1758) sur le rôle des échanges économiques comme des relations d’assistance réciproque.
« Dans un système économique, commente Marc Feix, chaque agent est ainsi appelé à aider les autres à satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Selon cette conception, l’engagement dans une relation économique est un exercice vertueux et la vertu est de ce fait considérée comme une ressource économique[21]. »
Conclusion
La vie est un tout. Benoît XVI a eu raison de rappeler que justice et charité vont de pair dans l’édification d’une société bonne, du moins meilleure. L’économie du don est une partie intégrante de la vie humaine, mais elle n’est pas dans le principe de fonctionnement de l’économie de marché qui ne peut pas l’intégrer sans risquer de perdre ses vertus, que le pape Benoît XVI lui reconnaît. Ce qui ne veut pas dire que le devoir personnel des responsables d’entreprise, du patron au chef d’atelier et à l’ouvrier de base, n’est pas d’humaniser les rapports professionnels tandis que la mission de l’entreprise ne peut pas se réduire à l’optimisation de son profit sans respect ni du droit et de la morale ni de la dignité de ses salariés et autres parties prenantes. C’est au demeurant l’intérêt même de l’entreprise d’être attentif à un certain bien être et à la satisfaction de ses employés. Ce qui est une autre vertu de l’économie de marché. En quelque sorte, l’économie de marché ne pratique pas l’économie du don directement mais elle contribue autrement et parfois mieux au développement humain. Car il n’est pas prouvé que les salariés des entreprises associatives ou publiques soient plus heureux que dans les entreprises de marché.
[1] Éthique à Nicomaque, V, 7, 1132 b20.
[2] Idem, V, 8, 1133b.
[3] Somme théologique, II-II, q.77, article 4, resp.
[4] Somme théologique, II-II, q. 77, article 2.
[5] Somme théologique : II-II, q.77, a.3, obj. et ad4.
[6] Canon 22 : « Défense d’inquiéter, de maltraiter les moines, les clercs, les pèlerins, les marchands, les paysans allant en voyage, ou occupés à l’agriculture, les animaux employés au labourage. On défend aussi d’établir de nouveaux péages ou d’autres exactions sans l’autorité des souverains ». Voir Genèse des marchés, Colloque des 19 et 20 mai 2008, Gérard Guyon, « La position de l’Église face aux marchés : le réalisme théologique et canonique appliqué au juste prix et au prêt à intérêt au Moyen Âge ».
[7] Cf. André Lapidus, Le détour de valeur, Chapitre I – La conception thomiste du juste prix. Economica, 1985.
[8] André Lapidus, ouvrage cité, Chap. 3.1.
[9] Ibidem.
[10] Cf. Jean-Philippe Delsol, « La justice et la morale », Journal des Libertés, septembre 2019.
[11] Francisco de Vitoria, La Justice, Q 57, article 1er, 4, Étude et traduction de Jean-Paul Coujou, Éditons Dalloz, 2014, p.5.
[12] Luis de Molina, De justitia et de jure, Cologne 1596-1600 ; disp. 347, n°3.
[13] Marc Feix (2014), « De la théorie économique à l’enseignement social de l’Église, la recherche du bien commun », Revue des sciences religieuses, 88/3.
[14] Saint Augustin, De la doctrine chrétienne, Livre II, Chapitre XXVI, 40.
[15] Saint Augustin, La cité de Dieu, 19,17.
[16] Saint Augustin, Explication de quelques propositions de l’Épître aux Romains, « Car, quoique nous soyons appelés à ce royaume où il n’y aura plus aucune puissance semblable, néanmoins, tant que nous sommes voyageurs ici-bas, et jusqu’à ce que nous soyons entrés dans cette vie où toute principauté et toute puissance disparaît, supportons notre condition par respect pour l’ordre des choses humaines ».
[17] Caritas in veritate, 14.
[18] Joseph Ratzinger/ Benoît XVI, Libérer la Liberté, Foi et politique, Parole et Silence, p.122, 2018.
[19] Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, 25 juin 2004, § 391.
[20] Talmud de Babylone, Traité Shabbat 31 a.
[21] Marc Feix, ouvrage précité.