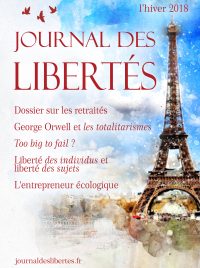L’actualité de cet automne a été particulièrement mouvementée. Les gilets jaunes ont occupé tous les terrains, depuis nos ronds-points jusqu’aux plateaux de télévision ; depuis la Canebière jusqu’aux Champs-Élysées. Ils entendaient exprimer une colère ; de ces colères que l’on ressent face à une injustice, face à une violation de ses droits légitimes. Le monde politique, mais sans doute aussi le monde tout court, a été surpris par la force et parfois la violence de cette réaction qui partait au départ d’une nième hausse du prix des carburants.
 |
Pierre Garello est économiste, Professeur des Universités et Président de l’Institute for Economic Studies-Europe. |
Une fois passée la surprise, les analyses du malaise ont fusé dans tous les sens.
Le caractère insoutenable de la pression fiscale a bien entendu été évoqué et tout le monde semble à présent avoir intégré cette vérité : notre beau pays de France — que certains économistes et juristes persistent curieusement à qualifier de néolibéral (Libération, 3 décembre) — est bel et bien champion du monde des prélèvements obligatoires. L’on n’a pas manqué de souligner également la faillite des « corps intermédiaires ». Nous ne manquerons pas de remarquer pour notre part que, dans le cas français, cette faillite est d’une certaine façon la faillite de l’État tant il est vrai qu’en France les corps intermédiaires (syndicats, partis politiques et même associations) sont traditionnellement de connivence avec l’État. Les libéraux, enfin, ont sans doute lu dans cette crise avant tout une illustration de l’impasse à laquelle conduit inexorablement une confusion sur le concept de droit.
Un système politique libéral se définit en effet par la reconnaissance et la protection de certains droits ; les droits fondamentaux (naturels) : liberté, égalité en droit, protection de la personne et de ses biens et, par extension, liberté d’expression, liberté de pratiquer la religion de son choix (ou de ne pas en pratiquer), liberté de contracter, etc. L’une des caractéristiques essentielles de ces droits est qu’ils ne nécessitent pas de dépenses extravagantes pour être effectifs. Il suffit que chacun s’abstienne de violer les droits des autres et contribue au maintien d’un État, voire d’une association privée, assurant la mission de sanctionner les violations de droits.
Cette conception des droits a longtemps constitué un socle solide pour développer toutes sortes de coopérations, d’entraides mutuelles, marchandes ou non marchandes, d’initiatives fraternelles. Mais de nouvelles générations — en particulier depuis 1945 — ont été plus gourmandes, plus pressées et elles ont souhaité allonger la liste de nos droits. A la première liste que nous donnions ci-dessus, et que l’on appelle parfois la liste des droits « négatifs » car ils n’imposent quasiment rien aux individus si ce n’est de s’abstenir de violer les droits des autres, est venue s’ajouter une seconde génération de droits : les droits « économiques et sociaux ». Droit à l’emploi, à l’éducation, à la santé, à un logement décent, à une retraite, à la culture… la liste est potentiellement sans fin. Autant de choses qui coûtent et c’est pourquoi on les nomme souvent des droits-créances. Mais alors qui va payer ? Qui va gérer ?
Il est évident que l’introduction de cette deuxième génération de droits nécessitait une gestion très habile et très prudente de leur financement. Cela s’imposait d’autant plus que, quelques décennies plus tard, venait s’ajouter à la liste une troisième génération de droits, tels que le droit de l’environnement, qui elle aussi nécessite le plus souvent des financements nouveaux (les gilets jaunes en savent d’ailleurs quelque chose qui n’ont eu de cesse de pester contre une taxe carbone supposée rendre effectif ce droit de l’environnement). Mais la gestion publique est rarement vertueuse pour la simple raison que les décideurs dans ce contexte ne sont pas les payeurs et que les électeurs-payeurs préfèrent souvent se baigner d’illusions plutôt que de faire des choix. Demander plus sans se soucier de qui paiera : à entendre une majorité de gilets jaunes, il semblerait en effet qu’il suffise de rétablir l’impôt sur la fortune (qui a rapporté péniblement 5 Mds d’euros en 2017 et dissuadé beaucoup d’investisseurs) pour résoudre nos problèmes. En réalité nous votons un projet de loi des finances 2019 avec un déficit annoncé qui tournera autour des 100 Mds d’euros (à moins que l’on fasse payer les GAFA !)
Au cœur de la crise des gilets jaunes il y a donc bien une réflexion sur « les droits » et leur financement. Il est clair qu’en allongeant la liste des droits de deuxième et troisième générations on fait peser une forte menace sur les droits de la première génération.
C’est du sentiment, et bien souvent du vécu, de ne plus pouvoir vivre du fruit de son travail qu’est née la colère des gilets jaunes. Et cette colère, que l’on peut d’une certaine façon qualifier de sainte colère, ne servira à quelque chose que si l’on est capable de plonger jusqu’aux racines du malaise, à savoir, une confusion sur la nature des droits.
Analyser les racines du malaise, démasquer les illusions, dénoncer les fausses solutions et surtout expliquer les pistes les plus prometteuses : tel est la tâche que nous nous sommes données avec le Journal des libertés et que nous poursuivons dans ce troisième numéro dont tous les articles, chacun à sa façon, fournit un élément de réponse pour une sortie de la crise.
Je vous souhaite donc une excellente lecture et j’en profite pour vous souhaiter également de bonnes fêtes de fin d’année. L’année 2019 sera d’autant plus belle que nous parviendrons à sortir de « l’économie du Père Noël » pour passer à une économie de personnes libres et responsables, soucieuses de leurs droits et de leurs devoirs.