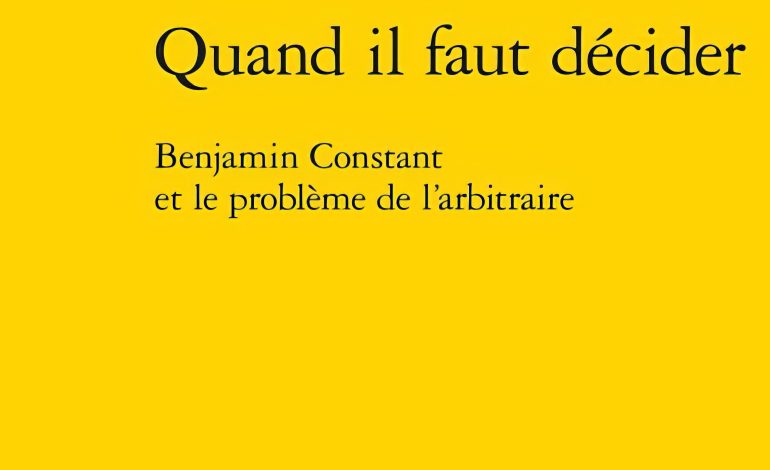The Meaning of Wealth, the Future of the Economy, and the Time Theory of Money
de George Gilder
Regnery Gateway, 2023 (223 pages)
George Gilder est un auteur prolifique, auteur d’ouvrages qui ont connu un certain succès éditorial, dont le plus marquant est sans doute Wealth and Poverty, paru en 1981. Cette contribution s’inscrivait dans le mouvement de l’économie de l’offre, ce courant de pensée qui s’opposait alors à l’approche keynésienne et aux tenants de la demande effective. George Gilder a donc contribué à la contre-offensive intellectuelle des libéraux contre l’interventionnisme étatique et a participé à la réponse politique libérale de la fin des années 1970 et au début des années 1980 avec l’avènement du Reaganisme aux Etats-Unis.
Life after Capitalism se veut ni plus ni moins qu’une nouvelle rupture intellectuelle qui repose sur le constat d’un changement de nature du capitalisme avec l’avènement d’une société de l’information, un « âge de l’information » qui va au-delà de la simple utilisation de l’information pour améliorer les techniques productives. Ce changement s’accompagne aussi d’une altération définitive de la nature de la monnaie, à présent coupée de tout référentiel matériel. C’est cette double rupture qui nécessite de reconceptualiser l’approche de l’économie, ce que nous propose de faire George Gilder en 15 chapitres, dont deux ont été écrits par Gale L. Pooley, sans que le nom de ce dernier n’apparaisse ni sur la couverture, ni dans la table des matières !
D’un point de vue formel, l’organisation des chapitres manque un peu de cohérence obligeant à des allers-retours pour le lecteur entre les thématiques abordées. Au-delà d’une forme d’inconfort pour le lecteur, l’ouvrage laisse un goût d’écriture ou d’une conception par trop rapide faisant place à quelques répétitions, nuisant finalement à la qualité de la démonstration. Par ailleurs, l’auteur de l’ouvrage a adopté une forme de « vulgarisation du propos », ce qui présente l’immense avantage d’être facilement accessible pour le non spécialiste… et de faire l’économie d’une pensée plus détaillée. Ainsi le concept d’ « emergency socialism » (p. ix), que nous traduirons par « socialisme de crise », constituerait selon l’auteur le déclencheur de ces ruptures, mais il n’est malheureusement pas plus défini ni discuté. Or il aurait mérité de l’être. Cela aurait pu, par exemple, être mis en rapport avec d’autres analyses éprouvées (Mises 1981 [1932]), mais l’auteur les rejette en précisant seulement qu’elles lui paraissent dépassées.
Cinq idées majeures composent l’ouvrage : la fin de l’approche matérialiste de l’économie, la connaissance est l’origine de la richesse, l’apprentissage est la source de la croissance, la monnaie est du temps, tandis que l’information est relative à la surprise, la découverte et l’innovation. En fait, la thèse majeure de l’ouvrage s’appuie sur une théorie de l’information qui nourrit une forme d’économie post-capitaliste (p.11), dont la seule limite est la créativité et la connaissance humaine, source d’innovations. Ces innovations permettent ainsi d’économiser du temps, d’améliorer les process de production et d’accroître les richesses, qui peuvent se passer d’une forme matérielle de la monnaie. On retrouve ainsi les grandes caractéristiques de l’économie de l’offre, avec une place importante donnée à la créativité humaine dans un monde dématérialisé sans que ne soit pensée l’autre dimension du marché à savoir la demande ; une démarche totalement assumée (p. 180). Il est également remarquable que l’ouvrage n’évoque jamais la question des droits de propriété, les conditions de liberté dans lesquelles agissent les agents. Cette approche décontextualisée n’est pas sans contradiction, puisqu’elle-même est issue d’un contexte, qui lui est propre et fondateur, à savoir celui de la dématérialisation et de la digitalisation de l’économie (p.11). Là également la démonstration reste absente.
Gilder dénonce d’emblée l’erreur majeure qu’ont commis selon lui l’ensemble des courants théoriques en économie, pris dans la superstition matérialiste (p. 1). Y sont condamnés à la fois les économistes classiques tels que Smith, les marxistes, les économistes autrichiens, les keynésiens, les monétaristes et les tenants de l’économie de l’offre, dont l’auteur faisait partie. Cette illusion matérialiste aurait embarqué l’ensemble de la profession vers une conception de l’économie définie comme la science de l’allocation des ressources, en considérant la rareté comme le problème fondateur. Une « dépendance de sentier » aurait été initiée en considérant de manière erronée que l’économie revenait à gérer la rareté, alors qu’elle devrait identifier les conditions de la création de richesse. Plus en avant dans son analyse, Gilder dénonce la conception de l’homo economicus comme un agent s’adaptant aux incitations qui lui sont offertes (p. 26), et qui masquerait la dynamique de l’intelligence humaine qui se concrétise dans la créativité et l’innovation. Selon lui, il est nécessaire de se départir de cette conception matérialiste de l’économie pour saisir les fondements de l’enrichissement en s’appuyant sur la théorie de l’information, supposant des vecteurs de diffusion (réseaux), des mécanismes de transmission (langages et codes) et des supports (la pensée humaine). C’est l’intelligence humaine source de créativité et de surprise qui est la véritable source de la richesse. La théorie de l’information sur laquelle s’appuie Gilder n’est pas celle qui consiste en sa traduction « matérialisée », à savoir une information qui constitue une ressource utilisée pour décider de l’allocation des biens et services (dimension allocative) (le prix d’une marchandise est supérieur sur un marché et va justifier l’approvisionnement des consommateurs) ou d’une expression en termes d’incitations (théorie des contrats avec la relation principal-agent par exemple) que l’on retrouve dans une approche néoclassique contemporaine (Laffont et Tirole 2013). Selon Gilder, les individus sont des formes de répertoires d’intelligence et de créativité qui peuvent être mobilisés pour produire des expressions ou des formes du monde (nouvelles modalités de communication comme internet ou de stockage comme le container) qui dépassent leur simple configuration matérielle (internet permet des transactions bancaires dématérialisées, le container a changé les modalités du transport des biens et de stockage). Dans cette approche, la conception matérialiste de la monnaie (conçue comme un bien) doit être abandonnée. Au-delà de la facilitation des échanges, la monnaie permet d’exprimer une unité de biens ou de services en temps, c’est-à-dire le nombre d’heures de travail nécessaires pour l’obtenir. Elle permet ainsi de mesurer des prix en temps, ni plus ni moins (p. 182-183).
Quelques remarques peuvent être formulées sur cette première thèse. La première est la réaction que suscite la thèse du rejet global des enseignements des économistes quels qu’ils soient, et ce, quand bien même leurs travaux font l’objet de débats scientifiques, voire de polémiques. Ce rejet global ne manque pas de susciter de la part du lecteur un certain scepticisme sur ses fondements. Seuls échappent à la critique Jean-Baptiste Say et sa théorie de l’offre. Par ailleurs, la thèse de l’erreur collective – ils se sont tous trompés ! – est là aussi quelque peu problématique, d’autant que l’auteur se fait son propre critique pour avoir défendu une approche dite de l’économie de l’offre. Comment peut-il être certain de ne pas commettre une nouvelle erreur en assénant un avis aussi définitif ?
Deuxièmement, l’illusion matérialiste, dénoncée par Gilder pour mieux concevoir une économie de l’information, trouve ses limites et sans doute une forme de contradiction par la traduction ultime de cette activité créatrice dans l’expression physique de la richesse, dont le chapitre 9 est une formidable expression. Comment penser cette contradiction ? Par ailleurs, comment interpréter l’expression créatrice en richesses matérielles tout en ne pensant pas la demande et justifier l’absence de réflexion quant à la satisfaction des besoins ou le remplacement d’états moins satisfaisants par d’autres qui le sont davantage (Mises 1985) ? Enfin, les motivations des créateurs de richesse sont totalement absentes dans la dynamique que nous propose Gilder.
Troisièmement, Gilder fait l’économie incroyable de ne pas considérer la question de la connaissance, de sa production, de sa répartition et de son partage. Il n’établit pas de liens avec la compréhension des mécanismes de marché et des dynamiques sociétales comme l’a fait en son temps Hayek (Hayek 2006 [1960] ; 1995) qu’il critique. Il ne discute pas plus l’apport de la théorie de la découverture entrepreneuriale et de l’esprit d’entreprise développée par Kirzner (2000 ; 2005). Sans doute à la lecture éclairante de ces derniers auteurs, Gilder aurait tempéré quelques-unes de ses assertions.
Deuxième idée défendue dans l’ouvrage de Gilder : l’argent, c’est du temps. Pour Gilder, le progrès économique ne peut être mesuré en unités monétaires. En conséquence, comparer le prix de 100 grammes de tabac aujourd’hui à celui d’il y a 10 ans revient à commettre une erreur, car ces prix sont exprimés en unités monétaires dont la valeur est manipulée par les autorités (p. 14), et qu’un raisonnement supposant une actualisation des valeurs ne peut corriger. Ce qu’il convient de faire pour mesurer l’enrichissement est de raisonner en termes d’heures de travail pour obtenir une unité dudit bien. Selon Gilder, lorsqu’on dépense de l’argent, on dépense du temps, celui qui a été nécessaire pour obtenir les unités monétaires en question. Selon Gilder, le temps est un étalon de mesure plus fiable que la monnaie étatique, dans la mesure où il ne peut faire l’objet de manipulations. L’appréciation de l’enrichissement se traduit par une réduction du temps nécessaire pour obtenir un bien ou un service. Alors que le constat d’une manipulation monétaire par les autorités n’est pas une idée nouvelle, il n’est pas certain que la solution proposée soit aussi convaincante que ne le pense l’auteur. Premièrement, l’enrichissement associé à la réduction du ratio en termes de temps par unité de bien suppose, outre un retour par la dimension physique de l’économie, que ce qui est produit est valorisé par les consommateurs (les biens additionnels produits) et qu’il peut être directement comparable dans le temps (qu’en est-il pour des biens dont les caractéristiques évoluent ?). Sans ce processus de valorisation ultime, la disponibilité de biens additionnels est dépourvue de sens. Deuxièmement, l’étalon de mesure, à savoir l’heure de travail, suppose que celle-ci n’évolue pas au cours du temps et qu’il existe une mesure moyenne au sein de la société. Or les productivités individuelles varient au fil du temps et entre individus, de sorte qu’il n’existe aucune certitude à ce que l’étalon lui-même ne fasse pas l’objet de variabilité. Cette critique est celle qui avait été faite à l’approche marxiste sur la composition en travail de la marchandise. Enfin, cette approche par la productivité constitue une forme de contradiction interne à la thèse défendue par l’auteur concernant la source originelle et dématérialisée de la richesse, à savoir la créative humaine.
Une autre idée défendue par Gilder est que la croissance économique résulte de l’apprentissage et de l’acquisition de nouvelles connaissances. Les entreprises et les entrepreneurs seraient mus par une incitation à faire mieux et à innover. Ils sont les vecteurs de transmission de nouvelles informations et de surprise aux origines de l’enrichissement. Le marché est ainsi conçu comme un processus cybernétique, un réseau de transmission d’informations, de mise en relation de connaissances, qui ne doit pas être entravé pour fonctionner au mieux. De cette conception, émerge une forme de « techno capitalisme », qui laisse une large part aux industries de la tech (chapitre 7). Finalement, la conception défendue par Gilder propose une vision appauvrie du fonctionnement du marché. Les recours aux exemples de la loi de Moore, aux gains obtenus en termes de productivité dans la production des semi-conducteurs laissent à penser à une vision très mécanique, oubliant les dynamiques sociales et individuelles à l’œuvre (Hayek 1995). Par ailleurs, l’auteur semble négliger l’importance conférée au capital humain, qui n’est pas chose nouvelle tant pour expliquer le développement économique (Carnis 2023) que les choix économiques individuels (Becker 1993) qui ont de considérables effets sur les trajectoires économiques. Cette approche par la dimension humaine, qui ne néglige pas pour autant les dimensions techniques et technologiques, permet de penser les aspérités au sein du fonctionnement des sociétés, ce que ne fait pas une vision cybernétique restrictive, telle que défendue par l’auteur.
Pour Gilder, la richesse n’est pas le résultat de ressources matérielles ou de leur combinaison, foin des terres, des matériaux, des machines… (p.49) La connaissance est la cause de tout ! C’est elle qui permet de donner sens aux choses, en mêlant connaissances tacites et codifiées. Le génie humain consiste ainsi à concevoir ce que peut être une ressource et comment en faire un usage approprié. La machine ne présente une valeur que dans la mesure où elle a été conçue pour certaines finalités, ce qui lui confère son statut. Elle est machine, dans la mesure où elle est considérée comme machine. Le mécanisme de marché est alors interprété comme un test de validation et de falsification des nouvelles connaissances de type poppérien (p. 54-55). Toute intervention sur ledit marché conduit à perturber et à travestir ce processus de sélection. En effet, c’est une dimension éminemment subjective qui est à l’œuvre pour définir ce que peut-être la richesse. En reprenant Sowell, Gilder souligne que les transactions économiques sont d’abord des achats et des ventes de connaissance (p. 61). Oui, mais pas n’importe lesquelles : les connaissances issues de l’activité humaine et des fins propres aux individus. Cela n’est pas précisé. En fin de compte, sur ce point, Gilder n’est pas très éloigné de l’approche des économistes autrichiens, tout en se gardant de citer la source de ses influences.
Gilder traite également de la place de la monnaie. Il dénonce ainsi la place considérable prise par le milieu de la finance dans l’économie (hypertrophie financière) ; envahissement qui a été rendu possible par l’expansion inconsidérée de la production de monnaie par les autorités (chapitre 10). Cela a eu pour conséquence un décentrement des lieux de création de profit vers les institutions financières au détriment de l’appareil industriel. Cela a conduit aussi à dénaturer le rôle de la monnaie comme instrument de mesure, devenu inopérant dans un cadre volatile et biaisant le calcul économique. Or, selon notre auteur, la monnaie n’est pas un bien, ni de la richesse contrairement à ce que peuvent penser bon nombre d’économistes (p. 144). Elle ne serait qu’un vecteur de transmission d’information permettant de fluidifier les échanges, remédiant ainsi à la tragédie de la coïncidence des besoins. Or l’exigence de ce rôle implique de disposer d’un système qui limite les fluctuations relatives au support de la mesure, une métrique stable et transparente, ce que ne permet plus la circulation des masses monétaires actuelles dont le volume s’accroît régulièrement (p. 153). Le point de référence ultime serait alors l’unité de temps, permettant de déterminer des prix en temps. Pour Gilder, la monnaie doit être à la fois rare, mais pouvant être créée selon les besoins des transactions et des projets économiques, ce que ne sauraient satisfaire les monnaies électroniques (limitées par leur non-extension) (p.166 et s.). D’une certaine façon, on retrouve ici chez Gilder quelques enseignements monétaristes qui exigeaient une croissance de la masse monétaire en proportion avec la croissance économique. Pour Gilder, l’or présenterait des avantages notables à cet égard et c’est pour cette raison qu’il milite pour un retour à une monnaie réelle et non fiat. Une position que soutiendrait sans doute certains économistes autrichiens. Mais une nouvelle fois, il existe un nouveau point de tension sur la représentation matérielle de la monnaie, notamment l’or, qui ne peut être seulement un support d’information. Comment gérer cette contradiction ?
Pour conclure, Life after capitalism de Gilder est une contribution moins innovante qu’anticipée. Le constat d’une place trop importante prise par la finance, la nécessité de disposer d’une monnaie solide, de ne pas entraver le fonctionnement du marché et d’être attentif à la création de connaissances, à la transmission des informations qui permettent la création de richesse feront consensus parmi les libéraux. La conception cybernétique du marché, le rôle limité conféré aux consommateurs, et aux individus à la source du processus économique est plus discutable, d’autant qu’elle s’appuie sur une série de critiques non fondées et pas démontrées à l’égard d’éminents penseurs. In fine, il y aura sans doute une vie après Life after Capitalism et il n’est pas certain que cette contribution passe le test redoutable du marché de la connaissance.
Références
Becker, Gary S. (1993), Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, NBER, The University of Chicago Press, 3rd edition.
Carnis, Laurent (2023), « Le Voyage de l’Humanité aux origines de la richesse et des inégalités d’Oded Galor, Notes de lecture », Journal des libertés, 2023, n°21, Eté, pp. 131-138.
Gilder, George (1993), Wealth and Poverty, ICS Press.
Hayek, Friedrich A. (2006 [1960], The Constitution of Liberty, Routledge.
Hayek, Friedrich A. (1995), Droit, législation et liberté (3 volumes), Collection Quadrige, Presses Universitaires de France.
Kirzner, Israel M. (2005), Concurrence et esprit d’entreprise, Economica.
Kirzner, Israel M. (2000), The Driving Force of the Market, Essays in Austrian Economics, Foundations of the Market Economy, Routledge.
Laffont Jean-Jacques et Tirole Jean (2013), Théorie des incitations et réglementations, Economica.
Von Mises, Ludwig (1981 [1932]), Socialism – An Economic and Sociological Analysis, Liberty Classics.
Von Mises, Ludwig (1985), L’action humaine, traité d’économie, Libre échange, Presses Universitaires de France.`