Essai critique sur l’ouvrage de Kevin Brookes Why Neo-liberalism Failed in France: Political Sociology of the Spread of Neo-Liberal Ideas in France (1974-2012), Cham, Palgrave Macmilan, 2021, XXIV-355 p.
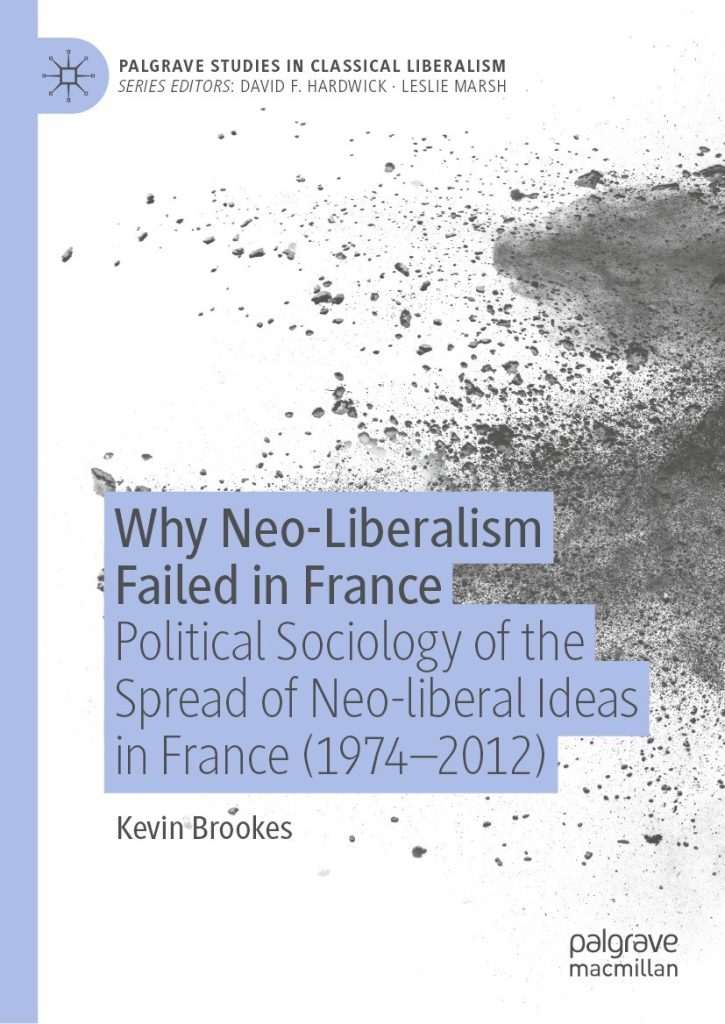
Les ouvrages sur le libéralisme sont assez rares en France, si ce n’est quelques livres critiques. Il faut donc saluer l’édition d’une thèse révisée ès science politique, d’autant plus qu’elle a été soutenue à l’Université de Grenoble, presque une provocation ! Si ce n’est que l’édition sort en Suisse et en langue anglaise….
Kevin Brookes se demande « pourquoi le néolibéralisme a échoué en France » avec comme sous-titre une « sociologie politique de la diffusion des idées libérales » dans notre pays de 1974 à 2012. La thèse originelle, soutenue en 2018, s’intitulait : « Ce n’est pas arrivé ici », clin d’œil à un ouvrage de Martin Seymour Liset qui se demandait pour quelle raison le socialisme avait échoué aux Etats-Unis (pp. 14 & 319). L’auteur aurait dû plutôt citer Werner Sombart dont l’ouvrage éponyme tentait en 1906 de résoudre la question de l’absence surprenante de socialisme outre-Atlantique, ce qui renvoie aux nombreux manques de ce qui est intitulé coupablement « bibliographie » (pp. 327 s.) et dont on rappellera qu’il s’agit par définition de la recension exhaustive des travaux sur un sujet donné. Quant à la forme, on regrettera au demeurant l’absence d’index nomimum, même si un index des matières clôt le livre.
Quelle est la thèse soutenue par l’auteur ? Elle est exposée avec une grande clarté à plusieurs reprises. De manière large, il s’agit d’analyser la diffusion du néolibéralisme – nous reviendrons sur ce mot – contemporain dans la vie politique française (p. 1). Or, l’auteur constate un paradoxe : la présence d’une génération prolifique de théorie économique libérale, d’une part, et la domination de l’État central dans la formulation des politiques publiques, d’autre part (p. 319).
Méthodologiquement, le livre entérine un certain nombre de réflexions anglo-saxonnes bien développées par François Facchini, d’ailleurs membre du jury de soutenance de la thèse. Ainsi, dans un ouvrage récent, ce dernier expose qu’il est devenu politiquement coûteux de réduire les dépenses publiques dans notre pays et qu’une technologie devient dominante en raison d’un processus d’auto-renforcement du fait d’une « dépendance de sentier » et d’un effet de blocage[1]. A un autre endroit de l’ouvrage, Kevin Brookes revient sur le point essentiel de ses analyses : le développement d’une idéologie dans un pays dépend largement des coûts individuels supportés par les tenants de cette idéologie. A leur tour, ces coûts dépendent avant tout de deux types de facteurs. D’abord, des facteurs institutionnels, lesquels renvoient à la structure de production du savoir et au système partisan. Ensuite, des facteurs historiques, lesquels déterminent les structures incitatives qui gouvernent les actions individuelles (p. 46).
Les pages limpides de Kevin Brookes sur l’échec du « néolibéralisme » français entre 1974 et 2012 retiennent l’attention, particulièrement la période 1986-1988, d’abord analysée de manière assez rapide (pp. 68 s.), ensuite et avec bonheur de manière détaillée et très utile (pp. 270 s.). En revanche, l’auteur n’insiste pas suffisamment sur le caractère crucial de cette période lors de laquelle tous les facteurs, internationaux à l’évidence, intérieurs en apparence, étaient favorables à une « révolution libérale » dans notre pays.
Même s’il n’est pas mentionné comme tel, l’un des fils conducteurs de l’étude est celui de l’ « exceptionnalisme français » : comment expliquer cette spécificité française de l’échec de l’influence du libéralisme sur les politiques publiques ? Pour le dire autrement, comment expliquer la tyrannie du statu quo qui règne dans l’hexagone ? L’expression d’un exceptionnalisme ou d’une exception française se trouve effectivement mentionnée à plusieurs reprises (pp. IX, 13, 37, 55, 58, 70, 108, 118, 223 et 320). Kevin Brookes pointe comme facteurs décisifs de freins la structure des « institutions », spécialement celles qui encadrent la production de l’expertise et des idées, l’administration étouffant l’influence des économistes issus de l’Université et les think tanks, étant précisé que l’auteur a une expérience professionnelle au sein de ces derniers (pp. 203-204).
C’est ici que se trouvent les limites de la thèse. Pour bien les comprendre, il faut en revenir au titre même de l’ouvrage. Le terme de néolibéral peut surprendre, pour ne pas dire agacer. Il n’est pas propre d’ailleurs à l’édition anglaise puisque l’auteur l’utilise systématiquement dans ses travaux en langue française. La question est si sensible que Kevin Brookes, après avoir consacré une section dans son introduction à la question : « Qu’est-ce que le néolibéralisme ? » (pp. 4 s.), revient sur le sujet au début du chapitre 3. A priori, il ne devrait pas se servir du terme puisqu’il reconnaît qu’il n’est utilisé pour l’essentiel que par la gauche critique (p. 4), que les « néolibéraux (sic) eux-mêmes refusent aujourd’hui de se reconnaître dans ce label » (p. 5) et que le terme « est sujet à d’intenses disputes sur ses définitions » (p. 56, n. 2). Pour justification, il ne voit certes pas dans le mot une rupture avec le « libéralisme classique » (il est amusant de relever que l’ouvrage est publié dans les « Etudes Palgrave en libéralisme classique »…), mais il considère étrangement que le terme libéral serait trop imprécis car il pourrait se confondre avec les théories de la justice sociale à la John Rawls ou celles du libéralisme social (p. 9). Mais on a du mal dès lors à comprendre la vertu heuristique du mot.
L’auteur définit ensuite le terme néolibéral comme « un ensemble de politiques publiques destinées à limiter l’intervention de l’État dans les affaires économiques et à étendre le rôle du marché dans la production et l’allocation de ressources » (p. 56). Définition intéressante à un double titre. D’abord, parce qu’elle confirme que l’auteur traite bien du libéralisme et non pas de son avatar néolibéral. Ensuite, parce qu’elle montre que l’auteur retient une conception uniquement économique du libéralisme. Cette conception nous apparaît toutefois dommageable pour le traitement de la thèse.
Il manque en effet deux dimensions à l’ouvrage. D’abord, une conception du temps long. Certes, l’auteur traite explicitement d’une période réduite à moins de quatre décennies, du milieu des années 1970 au début des années 2010. Mais le soubassement historique n’en apparaît pas moins réduit à sa plus simple expression : une analyse superficielle est coupable de la prétendue « tradition intellectuelle spécifique » du libéralisme français au XIXème siècle qui entérine notamment les erreurs commises par Lucien Jaume (p. 11) ; une observation sur le fait que la France aurait expérimenté des périodes libérales sur le plan économique au XIXème siècle, sans préciser plus avant (p. 96) ; une référence rapide et plus que contestable à l’établissement prétendument tardive de la Sécurité sociale en France (p. 79) ; ou encore des références cursives à l’après deuxième Guerre mondiale (pp. 62-63). L’utilisation du temps long aurait pourtant permis à l’auteur d’étayer sa thèse.
Ensuite, le concept du libéralisme entendu de manière unidimensionnelle – économique – est assez étonnant s’agissant d’une thèse ès science politique. Certes, elle se comprend en apparence puisque le livre traite particulièrement du groupe des « nouveaux économistes » constitué dans les années 1970 (pp. 3, 9, 238, 239, 268-269, 271-272, 276, 282, 284-285, 286, 300-301, 306, 308 et 314) et de l’homme politique qui a symbolisé le libéralisme en France, Alain Madelin, et qui a occupé systématiquement des ministères à dimension économique (pp. 10, 35, 68, 72, 270, 271, 272-273, 274-275, 276, 277, 278, 279-280, 281, 284, 287-288, 289, 290, 291 s., 301, 306-307, 311, 314, 315 et 323). Et pourtant, l’auteur cite aussi bien les « nouveaux économistes » qu’Alain Madelin, lesquels insistent sur le fait que le libéralisme doit être total et qu’il ne se réduit nullement à la sphère économique. La focalisation de l’auteur sur cette dimension du libéralisme l’empêche là encore de bénéficier de divers étaiements à sa thèse et elle l’empêche de saisir une partie des raisons pour lesquelles il existe un « exceptionnalisme français » qu’il reconnaît pourtant.
Sans viser à l’exhaustivité[2], l’ouvrage aurait gagné à parler d’un État-nation centralisé, d’une absence ancestrale de protection assurée du droit de propriété, du constitutionnalisme, de la religion, de la question sociale, du poids historique de la fonction publique et des fonctionnaires dans la vie politique, de l’étatisme de nombre de penseurs français, du poids de l’enseignement, de la culture et des médias, ou encore des échecs renouvelés du réformisme depuis Turgot.
Les brèves observations sur l’enseignement économique (p. 237) ne pallient pas les absences surprenantes de l’antilibéralisme de l’enseignement et particulièrement de l’enseignement public en France ou sur les biais de gauche et d’extrême-gauche des médias. De même, si l’auteur mobilise les thèses néo-institutionnalistes, il conçoit les institutions de telle manière qu’il obombre les aspects de droit constitutionnel et de théorie de l’État qui auraient pu, ici encore, appuyer ses théories.
Nous ne saurions clore cette recension critique sans souligner les réelles qualités de la thèse de Kevin Brookes qui expose avec beaucoup de pédagogie ses analyses, avec un ensemble suggestif de tableaux et de statistiques, dont les tables se trouvent utilement mentionnées en liminaire. Il reste à espérer que son ouvrage soit un jour publié en français, mais de cela nous n’avons aucune certitude compte tenu du climat politique hexagonal…
[1] François Facchini, Les Dépenses publiques en France, Nouvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2021, p. 163.
[2] Nous renvoyons à notre ouvrage Exception française. Histoire d’une société bloquée de l’Ancien Régime à Emmanuel Macron, Odile Jacob, 2020.



