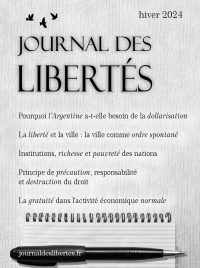de John L. Campbell et Ove K. Pedersen
Princeton University Press 2014 (424 pages)
Ce compte rendu de lecture tardif pour un livre déjà ancien publié en 2014 se justifie par l’importance que le Journal des Libertés accorde à l’histoire des idées et plus particulièrement aux idées dans les choix politiques et finalement les performances économiques d’un pays.
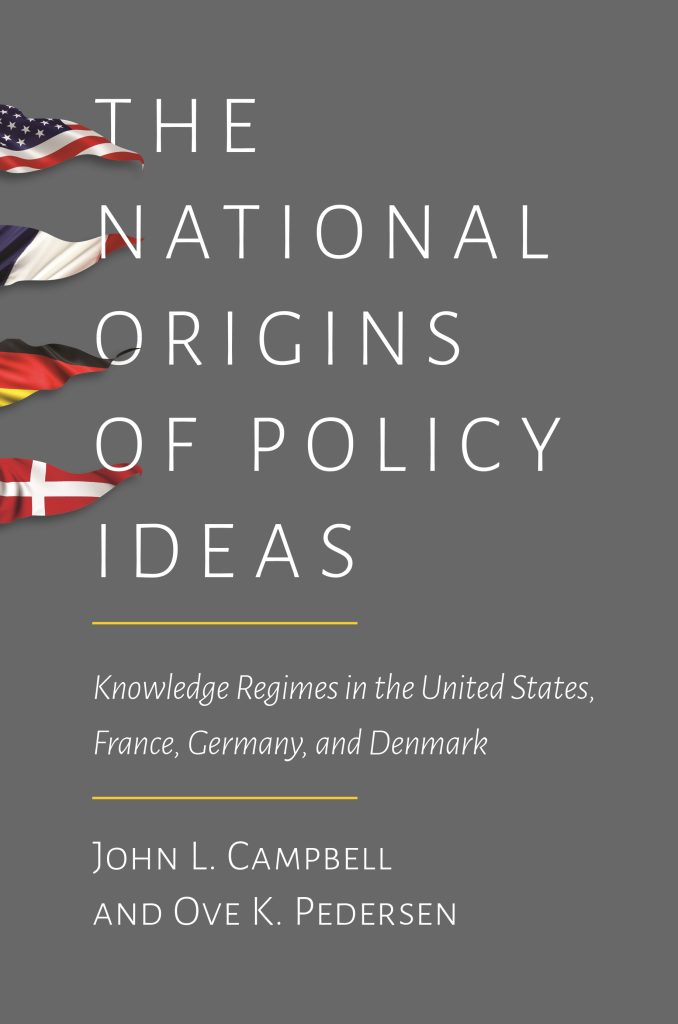
Le livre de Campbell et Pedersen traite de ce lien en adoptant une méthode originale qui renforce la thèse selon laquelle les idées en politique ont un rôle central, mais que comme toujours la manière dont ces idées sont financées a un effet sur leur contenu et finalement la capacité d’un pays à donner de bonnes solutions aux problèmes économiques et sociaux qu’il rencontre.
Pour Campbell et Pedersen (2014, p.2), en politique, les idées comptent, « in politics, ideas matters ». Pour s’en convaincre ils citent un certain nombre de travaux contemporains qui confirment cette proposition (Hall 1989a[1], Blyth 2002[2], Schmidt 2002[3]). Ce qui frappe ici c’est l’origine de ces travaux. Ils sont tous issus du paradigme critique de la doctrine néolibérale. Mark Blyth (2015)[4] a écrit un livre dont le titre confirme ce positionnement : Austérité. Histoire d’une idée dangereuse. Car derrière toute cette tradition d’histoire des idées et du rôle qu’elles peuvent jouer dans les choix de politiques publiques, il y a le dévoiement du mot idéologie par Marx et toute la tradition qui va s’en revendiquer. L’idéologie n’est plus la science des idées comme chez l’idéologue français Destutt de Tracy. L’idéologie est seulement une manière de justifier ex post ses intérêts matériels. La science économique classique (Smith-Say-Turgot-Ricardo) devient une science bourgeoise au service d’une classe sociale qui produit un discours pour justifier le rapport d’exploitation qu’impose le capitalisme aux ouvriers.
Dans leur introduction, Campbell et Pedersen (2014) se positionnent vis-à-vis de cette littérature néo-marxiste et en particulier vis-à-vis des écoles françaises de la régulation et de la variété des capitalismes. Ils écartent le fonctionnalisme (p.15) et le matérialisme de ces écoles de pensée (p. 17[5]) qui consistent à penser que les régimes de connaissance et les idées sont nécessairement l’expression des intérêts matériels politiques et économiques (p. 15) sans toutefois adopter la position idéaliste (p. 16). Les deux auteurs s’inscrivent en faux vis-à-vis de cette hypothèse matérialiste (p. 15). Ils soutiennent que les régimes de connaissance sont en partie indépendante par rapport aux circonstances et aux intérêts en présence.
Sur cette base, et indépendamment de savoir si les idées sont indépendantes ou pas des intérêts de ceux qui les défendent et les choisissent, la contribution de Campbell et Pedersen (2014) est de focaliser l’attention sur la manière dont ses idées sont produites et se diffusent dans le corps social et en particulier dans l’espace des décideurs politiques (Campbell et Pedersen 2014, p. 2). Ils s’inscrivent dans le champ de la sociologie de la connaissance et toutes les recherches qui décrivent la manière dont sont produites les connaissances scientifiques autrement dit la littérature sur le « social knowledge making » (p. 19).
Leur principal apport n’est ni sur le rôle des idées dans les choix publics ni sur les raisons qui conduisent un décideur politique à choisir une idée plutôt qu’une autre (p. 2). Ils veulent comparer les régimes de connaissance de quatre pays (Etats-Unis, France, Allemagne et Danemark) et décrire la manière dont ils ont évolué à la suite des grandes crises des années soixante-dix et quatre-vingt (p. 20). Ils constatent par exemple que l’argent privé a une place beaucoup plus importante dans le régime de connaissance des Etats-Unis que dans le régime de connaissance français (p. 18) qui est fondamentalement étatiste et centralisé.
La notion de « régime de connaissance » est la contribution théorique de l’ouvrage. Un régime de connaissance est défini tout d’abord comme un ensemble d’organisations et d’institutions qui génèrent des données, des recherches et des recommandations politiques et d’autres idées qui influencent le débat public et l’élaboration des politiques publiques (Campbell et Pedersen 2014, p. 3). Les idées politiques (policy ideas) spécifient une relation causale entre, par exemple, l’impôt, les dépenses publiques et les performances économiques d’un pays (p. 29) et s’inscrivent dans un paradigme théorique ou des hypothèses idéologiques. Pour les auteurs il y a deux grands paradigmes : le keynésianisme et le néo-libéralisme (courbe de Laffer, politique de l’offre). Cette première définition explique la manière dont est conduite l’analyse comparative des autre pays mentionnés dans le titre. Il s’agit de cartographier les organisations qui produisent des idées politiques dans chaque pays. Ces organisations sont les think tanks, les administrations publiques (ministère), les partis politiques, les fondations rattachées à ces partis, et les universités.
La seconde définition a une nature plus analytique. Un régime de connaissance est un appareil de création de sens (sense-making apparatus) (p. 3). Il est noté que les périodes de crise, d’ambiguïté et d’incertitude rendent plus difficile cette création de sens, mais aussi plus utile. C’est lorsque les prescriptions politiques conventionnelles ne fonctionnent plus que les idées produites par l’ensemble des organisations qui composent le régime de connaissance d’un pays sont décisives pour comprendre la manière dont le pays s’adapte – ou pas – aux évolutions de son environnement. Campbell et Pedersen (2014, p. 4) soutiennent que chaque pays à un régime de connaissance singulier. Les idées politiques auraient des origines nationales et la manière dont elles sont produites est en grande partie déterminée par des composantes qui sont spécifiques à chaque pays (p. 4) ; raison pour laquelle chaque pays réagit différemment aux chocs exogènes (crises mondiales) et aux chocs endogènes (vieillissement). Les décideurs politiques (policymakers) reconnaissent que leur connaissance est inadaptée (dysfunctional) dans le sens qu’elle ne produit plus d’idées capables de résoudre les problèmes sociaux et cherchent à la modifier en agissant sur le régime de connaissance lui-même et sur son contenu. Ce qui rappelle la distinction entre la connaissance proprement dite et le processus par lequel les hommes apprennent (apprendre à apprendre). Les auteurs montrent qu’en période de crise, de nouvelles organisations productrices de connaissance apparaissent effectivement qui modifient la manière dont les décideurs publics se représentent les problèmes et leurs solutions (sense-making apparatus).
Le livre dans ses grandes lignes
Les chapitres 2, 3, 4 et 5 décrivent respectivement les régimes de connaissance des Etats-Unis, de la France, de l’Allemagne et du Danemark. Le sens que les décideurs politiques de chacun de ces pays ont donné aux effets de mondialisation et aux crises des années soixante-dix et quatre-vingt a été différent parce que chaque pays avait un régime de connaissance singulier (p. 26 Figure 1.2). Pour définir les régimes de connaissance de chaque pays les deux auteurs ont interrogé 101 experts affiliés à 75 organisations de recherches en politiques publiques. Ils ont ensuite complété ce corpus de connaissance par la lecture d’un très grand nombre de rapports rédigés par ces organisations productrices d’idées de politiques publiques. La comparaison entre les régimes est facilitée par le fait que les auteurs utilisent la même méthode pour chaque pays. Illustrations :
- Le régime de connaissance américain est qualifié de partisan, la globalisation et le déclin de l’âge d’or du capitalisme a provoqué une crise de ce modèle partisan.
- Le régime de connaissance français est un régime étatique (state ideas). La crise a conduit à un développement des organisations privées (think tanks), a une recentralisation partielle et une semi-externalisation de la recherche hors des expertises internes faites par les administrations publiques. L’avènement d’Internet qui permet l’épanouissement d’une pensée hétérodoxe (quelle qu’en soit l’inspiration) a renforcé cette tendance.
- Le régime de connaissance allemand est défini comme corporatiste alors que le régime de connaissance danois serait de nature pluraliste (party ideology).
Il n’est pas juste alors de soutenir comme une partie de la littérature que la mondialisation a créé une culture monde (world culture) (p. 12). Car les États-Nations n’ont ni adopté les mêmes politiques ni développé les mêmes arrangements institutionnels, les mêmes normes et/ou les mêmes idées.
L’adoption des politiques néolibérales a en ce sens été très inégale d’un pays à l’autre et cela peut s’expliquer en grande partie par la nature nationale et singulière des régimes de connaissance de chaque pays.
La deuxième partie du livre est consacrée à l’étude des effets des spécificités de chaque régime de connaissance sur le traitement des crises ainsi qu’aux conséquences de ces crises sur le régime de connaissance lui-même.
Le Chapitre 6 répond à la question de la convergence. Est-ce que la mondialisation a homogénéisé les régimes de connaissance de chaque pays ? La réponse est non. Il y a peu de preuves de convergence au sein et entre les régimes de connaissances. Cette absence de convergence explique pourquoi certains pays ont adopté des politiques néolibérales orthodoxes alors que d’autres, comme la France, sont en partie restés à l’écart de ce mouvement.
Le Chapitre 7 traite de l’influence des régimes de connaissances sur l’élaboration des politiques. Campbell et Pedersen cartographient l’influence de chaque régime en distinguant l’influence directe, l’influence indirecte et l’anecdote. L’influence directe est la mise en évidence des liens entre la production d’un rapport et la décision de politique publique. L’influence indirecte passe par les médias. L’information produite sur les réseaux sociaux façonne les discours et les débats publics. Les auteurs ajoutent à ces deux types d’influence une dimension subjective. Les régimes de connaissance non seulement déterminent le contenu de la connaissance qui sera mobilisée pour interpréter les crises et définir les maux sociaux, mais ils façonnent également la manière dont cette connaissance exerce son influence sur les choix publics.
Le Chapitre 8 conclut l’ouvrage par une nouvelle question. Quel est le meilleur régime de connaissance ? Pour y répondre il convient de chercher le régime qui met à la disposition des décideurs politiques la connaissance qui sera la plus à même de résoudre les crises, mais aussi celui qui permet de se réformer ; de produire les nouvelles idées permettant aux gouvernements de faire évoluer les institutions de manière à traiter les maux qui frappent le pays. La nature du bon régime de connaissance est ainsi de permettre l’adaptabilité des institutions aux performances sur le moyen et le long terme d’un pays.
Comme l’indique le quatrième de couverture The National Origins of Policy Ideas en s’appuyant sur des entretiens approfondis avec de hauts responsables d’organisations de recherche sur les politiques, ce livre démontre donc pourquoi les régimes de connaissance sont aussi importants pour le capitalisme que l’État et l’entreprise.
Il jette un nouvel éclairage sur les débats sur les effets de la mondialisation, et la montée du « néolibéralisme » dans certains pays et pas d’autres. Il explique au passage que le déclin français peut se lire comme la conséquence d’un régime de connaissance inadapté, incapable de comprendre l’importance pour les performances économiques du pays d’un certain nombre de réformes. Cela justifie que nous ne nous arrêtions pas à cette simple présentation de l’argumentaire des deux auteurs et que nous cherchions à exposer plus en détail ce régime de connaissance français qualifié par les deux auteurs d’étatique (Chapitre 3).
Le régime de connaissance français : un régime dirigiste pour une économie dirigée
Le régime de connaissance français est qualifié par les auteurs d’étatique. Les chocs de la fin du XXe lui aurait imposé de changer. Il aurait vu le dirigisme décliner (Chapitre 3. The decline of dirigisme in France).
Il est admis, tout d’abord, que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le dirigisme domine en France (p. 84). Au début des années quatre-vingt apparaît, le plus souvent à la demande de l’État, de nouvelles organisations de recherche dont la mission est de pallier une crise des idées (crisis of ideas) à l’intérieur de l’État, crise des idées perçue comme telle par les décideurs publics qui travaillent pour l’État. Cette prise de conscience, d’après Campbell et Pedersen (2014, p. 85), n’aurait cependant été que de courte durée. L’État dès le début du XXIe siècle aurait repris le contrôle de la production de connaissance en privilégiant certaines activités et en abandonnant d’autres. Le titre du chapitre, « le déclin du dirigisme en France », est en ce sens plus une question qu’une affirmation. Il n’y a pas déclin, mais transformation du modèle dirigiste.
On peut alors estimer au regard de ce que disent les deux auteurs que le régime de connaissance français est au XXIe siècle néo-dirigiste, les rapports cités au chapitre 6 du Centre d’Analyse Economique (CAE) qui écartent toutes réformes du modèle économique mis en œuvre en 1946 en sont une expression parfaite. Les rapports du CAE permettent de bien comprendre ce que produit le régime de connaissance français (p. 307). Malgré la conscience que le régime de connaissance français ne parvient plus à jouer plus son rôle, « il n’a pas été purgé » pour autant de son attrait pour toutes les formes de dirigisme et évidemment de son aversion presque naturelle envers le néo-libéralisme. Cette aversion pour le néolibéralisme de tous les membres du CAE révélait le fait que le régime de connaissance français a toujours été moins orienté à droite que l’est le régime américain (p. 307). L’opposition au néolibéralisme d’auteurs comme Fitoussi ou Blanchard apparaît symptomatique du régime de connaissance français qui ne réussit ni à sélectionner parmi ses experts des économistes qui défendraient une politique de l’offre ni à produire de tels économistes. Il s’agit toujours pour les experts du CAE, au mieux de réformer le capitalisme, au pire d’en sortir. Tous les rapports qui y sont produits rejettent les solutions de marché et cherchent des complémentarités publics-privés (p. 306). C’est aussi à l’État de créer les avantages comparatifs, l’excellence de l’État est indispensable à l’excellence des firmes (Rapport CAE 2008, p. 64, Campbell et al. 2014, p. 306).
Le régime de connaissance français est, au moins depuis la fin de la seconde guerre mondiale, qualifié d’étatique. Les administrations publiques centrales dominent la production de connaissance (p. 90-93), même si elles sont épaulées en cela depuis la fin du XXe siècle par i) des organisations semi-publiques comme l’OFCE, le CEPREMAP, l’IRES, le CEPII et l’IFRI (p. 93-95), ii) des think tanks tels que l’Institut Montaigne, et l’IFRAP, iii) des fondations politiques (Gabril Peri, Jean Jaurès, Pour l’innovation politique, Robert Schuman), iv) des clubs comme l’Institut de l’entreprise (IDEP) ou l’Institut Choiseul et v) les recherches faites dans les universités et les grandes écoles.
Les universités ne jouent quasiment aucun rôle dans ce régime (p. 101). Seules les grandes écoles, parce qu’elles forment les élites administratives, influenceraient les choix de politique économique du pays. Les recherches faites au CREST, le centre de recherche de l’école polytechnique, ou par les anciens élèves de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique, ENSAE) peuvent influencer les politiques françaises, de même les savoirs produits à l’institut d’études politique (Science Po. Paris) et en particulier la République des idées, autour de Pierre Rosanvallon exerceraient une influence indirecte via leur lien avec les médias, la presse et le monde de l’édition. La production de connaissance est donc en France dominée par les administrations publiques c’est-à-dire l’INSEE (Institut nationale de la statistique et des études économiques), le CNIS (Conseil national de l’information statistique), le CREST (Centre de recherche en économie statistique), la DGT (Direction générale du Trésor, qui remplace en 2010 la DGTPE, direction générale du Trésor et de la politique économique), la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques), le CAE (Centre d’Analyse Economique) et le CAS (Centre d’analyse stratégique, nouveau nom pour le commissariat général au Plan qui est devenu en 2013 France stratégie).
Ce qui frappe dans cette liste c’est l’importance que le régime de connaissance français accorde au statistique. La plupart de ces centres de recherche produisent des statistiques et les interprètent. Ce qui évidemment confirme tous les travaux qui ont mis en exergue les liens naturels qui existent entre dirigisme et statistiques. Historiquement le mot statistique est lié à l’État. A la fin des années vingt, par suite de la crise de 1929, les pays anglo-saxons (Crook et al. 2011[6], Chassé 2011[7]) ont fortement investi dans les statistiques nationales et la construction d’indicateurs de comptabilité nationale. En France le projet d’une statistique nationale prend véritablement corps sous Vichy (Desrosières 1998[8]). Puis les Nations-Unies (ONU) et les pratiques des organisations internationales comme l’OCDE, la Banque mondiale, ou le Fonds monétaire international ont popularisé l’usage des statistiques pour comparer les pays, mais aussi fixer des critères économiques pour conditionnaliser des aides, des prêts (Ward 2004[9]). Ce régime de connaissance est lui aussi dirigiste, car la statistique garde pour ambition de construire des modèles de prévision économique qui, associés à la planification, doivent permettre de faire mieux que le marché, autrement dit d’assurer la croissance sans l’instabilité, les fluctuations. Les États sous l’influence des organisations internationales (Macekura 2019[10]) ont financé une industrie publique de la statistique qui a acquis une sorte de monopole du savoir. La statistique a réussi à imposer un régime de connaissance mondiale qui place en son cœur, le chiffre et finalement le gouvernement du chiffre.
Actualité et utilité du concept de régime de connaissance
Ce concept de régime de connaissance ne s’est pas imposé en sociologie de la connaissance comme incontournable. Il a été utilisé récemment dans une étude sur la construction des statistiques sur les inégalités au Royaume uni publié dans une nouvelle revue consacrée à ces questions de formation de la connaissance (Römer 2020[11]) : Know: a journal on the formation of knowledge. Il fût, aussi, au cœur du chapitre 5 de l’ouvrage de Kevin Brookes (2021) dédié à l’échec du néolibéralisme en France (Chapitre 5 The Structure of French Knowledge Regimes as a Factor in Resistance to Neoliberalism)[12]. Ce chapitre est un complément précieux des premières analyses sur le régime de connaissance français de Campbell et Pedersen (2014) en particulier parce qu’il donne une vision beaucoup plus détaillée de l’offre d’idées dans les think tank (budget, emploi, etc.) et explique très bien la nature très technocratique de l’expertise (monopole de l’administration publique).
S’il est vrai que ce concept s’inscrit dans tout un courant de pensée qui développe l’idée d’une construction sociale de la réalité, des représentations et finalement une critique du néolibéralisme, l’écarter entièrement serait une erreur pour plusieurs raisons :
- On peut ne pas retenir sa dimension relativiste et sa critique des politiques néolibérales. En particulier parce que le mot néolibéral est un mot valise qui le plus souvent décrit des politiques de l’offre (baisse d’impôts, diminution de la dépense publique et libre échange), autrement dit des politiques qui redonnent à chacun sa liberté économique, ce qui n’est pas néolibéral mais libéral.
- On peut l’utiliser comme un moyen de nourrir la réflexion engagée par Hayek sur les limites épistémiques des politiques publiques dont Scott Scheall en particulier s’est fait l’un des spécialistes[13].
- On peut, aussi, l’associer aux critiques des statistiques développées dès ses origines par les économistes classiques et Jean-Baptiste Say en particulier (Ménard 1987[14]). Les statistiques peuvent illustrer une théorie, mais ne pourront jamais s’y substituer. Un bon économiste n’est pas un statisticien, c’est quelqu’un qui connaît bien la théorie des prix et le rôle joué par l’entrepreneur dans les progrès économiques d’une nation.
L’effet d’un régime de connaissance étatiste ou dirigiste sur les performances économiques du pays et sa capacité à adapter ses institutions à la concurrence mondiale est par ailleurs un thème central dans la réflexion qu’il faut mener sur le rôle des politiques scientifiques sur le contenu de la connaissance disponible et le niveau des coûts de justification dans le débat public de politiques favorables à la garantie des libertés économiques de chacun.
recensé par
François Facchini
[1] Peter Hall (1989) montre l’importance des idées keynésiennes et de la doctrine néolibérale dans la formation des politiques économiques depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il édite une série Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Voir aussi Hall, P. (ed.), The Political Power of Economic Ideas, Princeton: Princeton University Press.
[2] Mark Blyth (2002) met en évidence la manière dont les décideurs politiques utilisent les idées pour justifier leur réforme fiscale et budgétaire. Blyth, M., 2002. Great Transformation: The Rise and Decline of Embedded Liberalism, New York: Cambridge University Press.
[3] Vivien Schmidt (2002) explique comment les structures cognitives et discursives aident à encadrer les débats politiques de différentes manières dans différents pays. Schmidt, V., 2002. The Futures of European Capitalism, New York : Oxford University.
[4] Blyth, M. 2015. Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press.
[5] « Notre approche ne s’inscrit pas dans une ligne d’argumentation strictement marxiste, gramscienne ou autrement matérialiste dans laquelle les idées produites par les régimes de connaissance peuvent d’une manière ou d’une autre être réduites à de puissants intérêts économiques ou représenter les intérêts hégémoniques d’une classe dirigeante. Ces intérêts font partie de l’histoire (…) Mais l’influence des régimes décisionnaires, sans parler des experts et des analystes eux-mêmes est trop importante pour adopter ce genre de réductionnisme économique » (p. 17).
[6] Crook, T., et G., O’Hara 2011. eds., Statistics and the Public Sphere: Numbers and the People in Modern Britain, c. 1800–2000, New York: Routledge.
[7] Chassé, D.S., 2011. « The Use of Global Abstractions: National Income Accounting in the Period of Imperial Decline », Journal of Global History 6, 7-28.
[8] Desrosières, A., 1998. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, Cambridge, MA: Harvard University Press.
[9] Ward, M., 2004. Quantifying the World: UN Ideas and Statistics, Bloomington: Indiana University Press.
[10] Macekura, S., 2019. « Whither Growth? International Development, Social Indicators, and the Politics of Measurement, 1920s–1970s », Journal of Global History, 14, 261–79.
[11] Römer, F., 2020. “Evolving Knowledge Regimes: Economic Inequality and the Politics of Statistics in the United Kingdom since the Postwar Era,” Know: a journal on the formation of knowledge, 4 (2) (fall), 325-352
[12] Brookes, K., 2021. Why Neo-liberalism Failed in France. Political Sociology of the Spread of Neo-liberal Ideas in France (1974-2012), Palgrave Macmillan. Compte rendu de lecture critique. Feldman J.P., 2022. Pourquoi la France a-t-elle raté son tournant libéral, Journal des Libertés, 17 (été), 151-156. Voir aussi la recension de Behrent, M.C., 2022. Pourquoi la France n’est pas (tout à fait néolibérale), La vie des idées, 29 juin 2022.
[13] Facchini, F., 2022. Compte rendu de lecture. « Les limites épistémiques des choix publics – ou l’approfondissement par Scott Scheall de l’argument d’Hayek », Journal des Libertés, 16 (printemps), 179-184.
[14] Ménard, C., 1987. « Trois formes de résistance à la statistique : Say, Cournot, Walras », in Pour une histoire de la statistique, tome 1, Insee-Economica, Paris, pp. 417-429.