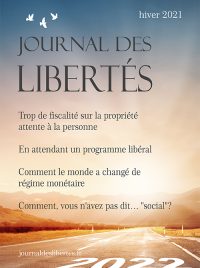de Gérald Bronner
Presses Universitaires de France, Paris, 2021 (386 pages)
Gérald Bronner, la petite cinquantaine, se présente comme l’un des sociologues français les plus renommés. Proche du regretté Raymond Boudon, il a le mérite de démontrer que sociologie ne rime pas forcément avec marxisme. Auteur d’une douzaine d’ouvrages depuis la fin des années 1990, il est professeur à l’Université de Paris, membre de l’Académie nationale de Médecine et de l’Académie des Technologies. Ses livres ont rencontré le succès et le dernier de la liste ne dépareille pas avec les précédents, d’autant que Apocalypse cognitive a reçu le prix Aujourd’hui. Un prix qui a déjà consacré entre autres Raymond Aron et Jean-François Revel.
Gérald Bronner s’affiche aussi comme un sociologue en cour, ce qui a fait jaser. En effet, le Président Macron l’a intronisé en 2021 à la tête de la commission sur les Lumières à l’ère numérique, chargée de faire des propositions dans les domaines de l’éducation, la « régulation », la lutte contre les diffuseurs de haine et la désinformation. Il s’agit de mesurer les dangers du numérique sur la cohésion nationale et sur nos institutions, et de faire des propositions pour y remédier. Or, ce sont justement l’aura de l’auteur et la parution de Apocalypse cognitive début 2021 qui ont mené le chef de l’État à le nommer Président de cette commission. De là, l’intérêt tout particulier à analyser cet ouvrage.
La thèse centrale de Gérald Bronner est aujourd’hui bien connue, et il l’a développée dans moult articles et autres entretiens à la presse. Nous pouvons la résumer ainsi.
De manière toute à la fois passionnante et inquiétante, le début du XXIe siècle a instauré une « dérégulation massive » du marché cognitif, c’est-à-dire du « marché des idées » (pp. 12-13). Notre cerveau ancestral se trouve confronté à une concurrence généralisée des objets de contemplation mentale, associée à une libération inconnue jusqu’alors du « temps de cerveau disponible » (p. 21). L’objet de l’ouvrage est de démontrer que la concurrence sur le marché cognitif permet de dévoiler certaines de nos aspirations profondes. Et la question essentielle que se pose notre sociologue est de savoir ce que nous allons faire de ce temps de cerveau libéré (p. 22).
Insistons sur cette dernière notion : au fil de l’histoire, l’homme a augmenté la productivité de son temps de survie en « dégageant une plus-value qui se mesure en temps libéré ». La libération du temps de cerveau a constitué « une sorte de trésor de guerre attentionnelle » (p. 37). Tout cela est évidemment une excellente chose puisque l’individu, en s’échappant progressivement des contingences, a pu déployer tout son génie.
Malheureusement, « le plus précieux des trésors peut être détourné et même dérobé » (p. 63). En effet, la « dérégulation du marché cognitif », c’est-à-dire le fait que n’importe qui peut intervenir sur le « marché public de l’information », permet la captation du temps de cerveau disponible d’autrui (p. 185). Il s’ensuit un dilapidage de « notre précieux trésor attentionnel par des activités de plaisir à court terme, stériles, abrutissantes, qui font revenir sur le devant de la scène l’homme préhistorique » par le truchement de la conflictualité, de la peur ou encore de la sexualité (p. 194). Ne croyons pas pour autant que l’auteur verse dans le moralisme : à la base de sa réflexion se trouve une critique des populismes, des extrémistes et – même s’il ne le développe pas ouvertement – de l’anti-élitisme contemporain selon lequel tout le monde a un avis sur tout et l’avis d’un individu en vaut celui d’un autre, fût-il expert en la matière, bref ce mécanisme démocratique délétère brillamment mis en lumière en son temps par Tocqueville.
Il faut en revenir au titre du livre qui peut induire en erreur. A ceux qui ne l’auraient pas encore compris, Gérald Bronner donne la clef au milieu d’Apocalypse cognitive. Il ne faut pas entendre le premier terme au sens contemporain de catastrophe, mais en son sens étymologique de révélation, de découverte : notre sociologue nous dévoile une vérité auparavant cachée – même si cette vérité ne nous fait pas plaisir (p. 190). Il s’amuse d’ailleurs de la mauvaise interprétation que beaucoup seraient tenté de faire du titre… en dévoilant ainsi leur ignorance de l’œuvre (p. 191).
Selon la méthode qu’il affectionne, Apocalypse cognitive fourmille d’analyses de livres et surtout d’articles en anglais qui nous permettent de comprendre grâce à la sociologie ou aux neurosciences – dévoilement toujours – certains faits qui ont pu nous frapper. S’ensuivent des développements suggestifs et qui se lisent aisément sur le point de savoir pourquoi la peur attire notre attention au-delà du raisonnable (pp. 101 s.) ou encore pourquoi les médias diffusent avant tout des mauvaises nouvelles (pp. 201 s.). Des thèmes classiques si l’on a lu les œuvres précédentes du sociologue qui a tendance à reprendre au fil de ses publications les mêmes sujets en les actualisant.
Focalisons maintenant notre attention sur la question centrale qui revient à se demander si la concurrence sur le marché de l’information « favorise toujours le meilleur produit ou seulement le plus satisfaisant » (p. 20). La libération du temps de cerveau n’a hélas pas produit une société de sagesse et de connaissance, « plus exigeante intellectuellement et explorant le possible pour atteindre le meilleur des mondes de façon rationnelle » (pp. 262-263). Or, soutient l’auteur, « l’utilisation de notre trésor attentionnel est la question la plus politique » qui soit (p. 201). Et, contrairement à ce qu’écrivait Thomas Jefferson – « Seule l’erreur a besoin du soutien du gouvernement » –, la vérité ne peut pas se défendre toute seule (p. 216).
Les tribunes et les entretiens de notre sociologue à la fin de l’année 2021 n’incitent guère à l’optimisme sur ce dernier point. Il semble avoir anticipé l’opposition macronienne entre les rationnels et les irrationnels. D’un côté, la raison ; de l’autre, le populisme, l’extrémisme de droite et de gauche, le complotisme. Il s’agirait de trouver un équilibre entre le respect de la liberté d’expression et la sauvegarde de la rationalité dans le débat public. Or, soutient Gérald Bronner, la « dérégulation » du marché de l’information, certes nécessaire, n’en fait pas moins peser des risques sur nos démocraties. Et justement le socle épistémologique commun de la démocratie, c’est la rationalité. Comment dès lors rendre attractifs les discours raisonnables qui sont défavorisés par le marché cognitif ?
Il y aurait donc, si l’on comprend bien, une sorte de troisième voie – la « régulation » – entre le pur et simple libre marché cognitif, d’une part, et les atteintes caractérisées à la liberté d’expression et d’opinion, d’autre part. Et comme « la vérité ne peut se débrouiller toute seule », il appartiendrait à l’État d’intervenir.
La thèse de l’auteur ne saurait donc satisfaire les libéraux. Elle obombre d’ailleurs de multiples difficultés.
D’abord, notre sociologue ne se demande jamais s’il existe en pratique un véritable libre marché cognitif. Certes, il cite à répétition l’exemple américain et on peut supposer que le marché des idées y règne autrement qu’en France… N’y aurait-il pas cependant des nuances à apporter au « type idéal » que construit l’ouvrage ? Il n’existe pas de libre marché des idées en France. Dans notre pays, la liberté de l’information se trouve enserrée par un État interventionniste qui dispose de médias publics, qui pèse sur les opérateurs privés et qui encadre l’enseignement des individus, par conséquent des journalistes et des citoyens[1]. L’auteur n’y fait jamais référence.
Ensuite, Gérald Bronner fait preuve d’une coupable imprécision sur le terme « régulation » qu’il adopte généreusement. En fait de régulation – qui ne peut renvoyer qu’à la régulation spontanée du marché –, il s’agit de son équivalent anglais qui se traduit exactement par le mot de règlementation. L’interventionnisme est-il la panacée ? Bien qu’il ne l’exprime pas ainsi, l’auteur a raison de montrer les limites de la démocratie où la parole de l’un vaut celle de l’autre, où n’importe qui se permet de présenter un avis ou une opinion qui a le même poids que celui d’une personne bien informée, où le terme d’élite ou plutôt le terme au pluriel devient un gros mot sous le coup des démagogues qui instrumentalisent le « peuple » et ceux qui sont assez naïfs ou benêts pour les croire. Ce qu’on peut reprocher au livre est de ne pas distinguer clairement entre démocratie et démocratie libérale.
Toujours sur le même thème, l’idée selon laquelle l’utilisation du temps de cerveau disponible serait « politique » apparaît fausse et inquiétante. Elle est d’ailleurs très française car, dans notre beau pays, qu’est-ce qui n’est pas politique ? Autrement dit, qu’est-ce qui relève de la sphère de la société civile sans intervention gouvernementale ?
Au fondement de cette politisation se trouve le mode de raisonnement tout aussi discutable selon lequel la liberté n’est pas si bonne car ses effets sont – au moins sur certains points – pervers. Or, la liberté – Benjamin Constant le martelait – se défend par les principes. Faut-il remettre en cause la liberté d’expression au motif qu’elle mène à la publication d’ouvrages néfastes ou mauvais et à la défense d’opinions ineptes ou ridicules ? L’État doit-il systématiquement intervenir car nous mésusons de notre liberté ou, pis encore, car nous risquons de le faire ?
Surtout, les hommes de l’État sont-ils légitimes à intervenir ? N’est-il pas naïf de faire comme s’ils étaient exempts des biais cognitifs que l’auteur dénonce au sujet des individus lambda ? N’avons-nous point vu ces dernières années des monuments de propagande gouvernementale éhontée ? Poser les questions, c’est déjà y répondre…
Enfin, l’insistance sur la raison – on serait tenté au terme de l’ouvrage de mettre une majuscule à ce mot phare des Lumières continentales… – laisse mal à l’aise et plus encore lorsque l’État est appelé à la rescousse pour promouvoir une rationalité en danger. Un libéral se lamentera que les leçons de l’épistémologie autrichienne ne soient pas même évoquées. Le lecteur chercherait d’ailleurs vainement dans les indications bibliographiques une référence au libéralisme autrichien, et notamment aux œuvres hayekiennes. Il est permis de le regretter.
En substance, Apocalypse cognitive pose plus les problèmes qu’il ne les résout et sa conclusion ne donne que de trop vagues indications (pp. 331- s..). Gérald Bronner nous en réserve sans doute la primeur dans son rapport des Lumières à l’ère numérique. Gageons que celles-ci se rapprocheront bien plus de leur ancêtre continental que des Lumières anglo-écossaises…
[1] Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage Exception française. Histoire d’une société bloquée de l’Ancien Régime à Emmanuel Macron, Odile Jacob, 2020, chapitre XI, « L’étatisme dans les têtes », pp. 371 s.